« La fonction première de la liberté est de libérer quelqu’un d’autre. »
Ces mots sont ceux de Toni Morrison, qui, en 1993, est devenue la première afro-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature. Ils ont été prononcés aux diplômées de 1979 du Barnard College – un établissement affilié à l’Université Columbia à New York – lors de leur graduation. Elle recevait alors la Médaille de Distinction, la plus haute récompense octroyée par cet établissement.

Une enfant tenace
Lorsque je repense aux mots de Morrison, je suis transportée à l’époque de mon enfance. Celle d’une jeune bien ordinaire ayant vu le jour au début des années 1990 dans un Québec de l’entre-deux référendums. Une enfant aux racines haïtiennes très profondes des deux côtés de sa famille.
Cette enfant était aussi une très grande idéaliste, alors qu’elle avait dix mille fois plus de bâtons dans les roues qu’aujourd’hui. Dans son esprit, tout était possible. Une enfant tenace et consciente de son droit au respect et à la dignité, malgré toutes les briques lancées dans sa direction. La petite Kharoll-Ann se savait sous-estimée. Malgré sa grande sensibilité, elle savait qui elle était. À plusieurs égards, je la trouve plus sage que la femme adulte.
Cette enfant, je la porte toujours en moi. Elle est ma boussole, celle qui me guide dans chacune de mes actions. Lorsqu’on me demande pour qui je travaille, mon cœur et mon esprit se tournent automatiquement vers la jeunesse, particulièrement les jeunes qui n’ont pas eu les mêmes chances que moi; ces jeunes dont on sous-estime l’intelligence, le potentiel et la pertinence. Je me vois en cette jeunesse comme elle se voit en moi.
Un parcours ancré en travail social
Mon engagement dans la communauté a débuté au début du secondaire, dans le cadre du programme d’éducation internationale (P.E.I.) de mon école. J’ai eu la piqûre, et j'en faisais plus que ce qui était exigé par le cursus. De fil en aiguille, j’ai complété un DEC en Intervention en délinquance (aujourd’hui appelé « Techniques d’intervention en criminologie »), un baccalauréat et une maîtrise en travail social avec option en études féministes et de genre à l’Université McGill. Mon mémoire s’intitule Le respect de la dignité des femmes dévoilant une agression à caractère sexuel : perspectives d’intervenantes sociales et communautaires montréalaises. Je suis allée à la rencontre de douze intervenantes issues des milieux communautaires, institutionnels et de la pratique privée afin de comprendre les différents sens qu’elles donnent à la dignité en contexte d’intervention, tant dans ce qui la favorise que dans ce qui l’entrave, et ce, dans une diversité de milieux.
Lorsqu’on me demande pour qui je travaille, mon cœur et mon esprit se tournent automatiquement vers la jeunesse, particulièrement les jeunes qui n’ont pas eu les mêmes chances que moi. Ces jeunes dont on sous-estime l’intelligence, le potentiel et la pertinence.
Aujourd’hui, contre toute attente, je suis chercheuse-doctorante. Dès le début de mes études doctorales en 2019, j’ai voulu explorer les violences sexuelles envers les femmes noires. À

l’époque, je me disais que ce sujet allait être perçu comme trop « niché » pour que je sois embauchable. Néanmoins, comme il s’agit d'un sujet très important et trop peu abordé au Québec, j’ai décidé de m’y plonger malgré tout.
Cette thèse dont je termine la rédaction s’intitule Regards de militantes afroféministes sur le mouvement #MoiAussi au Québec. Elle documente le militantisme de femmes noires dans les luttes féministes en lien avec les violences sexuelles et la culture du viol. Pour ce faire, j’ai mené des entretiens semi-dirigés avec douze des principales concernées en plus de produire une analyse critique du discours médiatique du mouvement #MoiAussi entre 2017 et 2020.
Je suis une grande passionnée des êtres humains dans toute leur complexité. J’aime raconter des histoires à l’écrit ou à l’oral comme j’adore entendre celles des autres. Dans un monde où peu de choses semblent « faire sens », je trouve mon oxygène dans les conversations à cœur ouvert que j’ai avec mes ami·es, mais aussi avec des inconnu·es que je rencontre grâce au pouvoir de la littérature et des mots. Je suis aussi une férue d’actualité, d’histoire et de géopolitique depuis que je suis toute petite; enfant je lisais le Journal de Montréal après mon père, principalement pour les affaires judiciaires et le courrier du cœur. À l’adolescence, je lisais religieusement les chroniques de Rima Elkouri dans La Presse. Chez moi, la télévision était souvent sur la chaîne TVA, à un point tel que je pouvais nommer tous les journalistes de ce réseau sur le bout de mes doigts et les reconnaître au son de leur voix lorsque j’étais dans une autre pièce. Tout naturellement, j’ai écrit des chroniques société dans les journaux étudiants de mon école secondaire, au cégep et à l’université.
En parallèle de mes études, j’ai été impliquée à temps partiel comme bénévole et/ou intervenante salariée dans une grande diversité de milieux : CLSC, milieu hospitalier, foyer de groupe pour des adultes ayant vécu des enjeux de santé mentale, familles de protection de la jeunesse en contexte de visites supervisées, lignes d’écoute pour personnes aînées isolées, refuges pour femmes, organismes pour survivantes de violences sexuelles, travailleuse sociale en prévention des violences sexuelles dans un cégep, et j’en passe.
Mon engagement sur le terrain se poursuit, car je juge important de briser les silos, et de maintenir le dialogue entre le monde académique et la société civile. C’est le terrain qui m’a forgée comme femme et dans lequel s’ancre ma posture pédagogique et de chercheuse. Il y a une richesse infinie dans la curiosité et le désir d’apprendre tout au long de la vie.
Comme je n’ai jamais « planifié » atterrir dans la sphère académique, cet univers représente pour moi un moyen, voire un outil, jamais une finalité en soi. J’aime la nature du travail académique. Lire, écrire, apprendre, réfléchir et enseigner à la prochaine génération d’intervenant·es sociaux m'apporte énormément. Concevoir des projets de recherche fait appel à ma créativité. Gérer mon propre horaire sans avoir un « patron » qui me dit quoi et comment faire mon travail convient parfaitement à ma personnalité. Plus j’apprends, plus que je réalise que j’en sais peu. Ce constat me donne autant le vertige que des palpitations. Je n’ai pas le temps de m’ennuyer.
C’est le terrain qui m’a forgée comme femme et dans lequel s’ancre ma posture pédagogique et de chercheuse. Il y a une richesse infinie dans la curiosité et le désir d’apprendre tout au long de la vie.
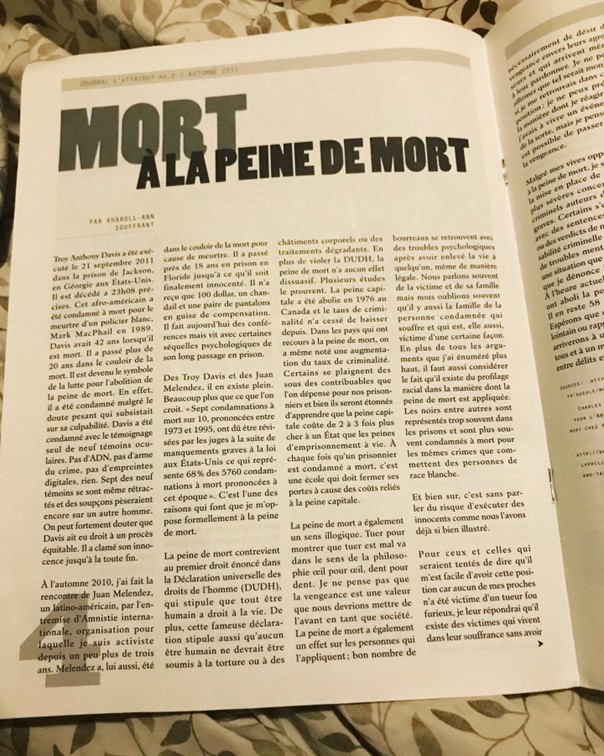
Cela étant dit, au cours de mes années de doctorat, il m’est arrivé à plusieurs reprises de recevoir des courriels d’étudiant·es en détresse d’autres universités qui se méprennent, pensant que je suis professeure. Ces derniers me demandaient de superviser leurs mémoires ou thèses en raison de la violence psychologique et épistémique qu’ils subissent de leurs directeurs et directrices de thèse. J’entends par là du dénigrement ou encore du pillage intellectuel de la production des travaux d’étudiant·es. Il y a lieu de se questionner sur la culture du monde académique et la manière dont elle peut briser les rêves de jeunes chercheurs et chercheuses qui souhaitent contribuer.
Le but d’une maîtrise et d’un doctorat est de démontrer que l’on peut mener une recherche scientifique de manière indépendante. Ça implique que l’étudiant·e développe sa propre posture. Celle-ci n’a pas à être un calque de celle de son ou sa directeur·trice de thèse, et cette posture peut évoluer avec le temps. On ne doit jamais toucher au fond de ce qu’un étudiant·e souhaite dire, mais plutôt offrir des conseils et suggestions sur la forme, la structure et la méthode. Même s’il faut que cette production scientifique rencontre certains standards exigés par le monde académique, il s’agit du mémoire et de la thèse de l’étudiant·e, après tout.
Enseigner à la relève du travail social
Le monde universitaire, comme partout ailleurs, est traversé par le néolibéralisme et la logique marchande. J’essaie dans mon enseignement de créer des micro-espaces (je ne parle pas ici de safe spaces, je n’y crois pas!) qui ébranlent ce qui semble immuable hors des murs de ma classe.
Évidemment, avoir une telle posture n’est pas aisée, selon le nombre d’étudiant·es dans la classe, si c’est un cours obligatoire ou à option, bref selon le contexte et le moment où l’on enseigne.
Je raconte à mes étudiant·es comment je me sentais lorsque j’étais assise à leur place, étant une universitaire de première génération. Je leur nomme que ça m’a pris des années avant de commencer à comprendre le sens du mot « épistémologie ». J’ose dire avec eux « je ne sais pas » lorsque je ne sais pas. J’autorise les émotions lorsqu’elles surgissent parce qu’elles peuvent être le meilleur professeur si on prend le temps de les accueillir sans les refouler. Dans mes cours, j’ose parler de moi, de mes expériences professionnelles et personnelles pour appuyer des aspects théoriques des savoirs enseignés.
L’opposition entre entre « rationnalité/objectivité » et « émotion/subjectivité » est une fausse dichotomie. Mes émotions et mon intellect sont en relation dialogique, ces deux facettes me sont impossibles à dissocier.
Par exemple, à titre de travailleuse sociale, les observations sur le terrain m’ont prouvé que les personnes les plus irrationnelles en contexte d’intervention sont celles qui sont coupées de leurs propres émotions. Lorsqu’on est « gelé », que l’on est plus en contact avec sa propre vulnérabilité, on fait et dit des choses qui sont dépourvues de toute logique, d'empathie et d'humanité.
Quand un ou une étudiante s’absente régulièrement, je tiens pour acquis qu’il doit se passer quelque chose en coulisses dans sa vie personnelle qui vient entraver sa capacité à être pleinement présent. Dans ces cas de figure, j’ai tendance à faire un check in plutôt que de présumer de sa paresse/insolence/je-m'en-foutisme.
Je raconte à mes étudiant·es comment je me sentais lorsque j’étais assise à leur place, étant une universitaire de première génération. [...] Dans mes cours, j’ose parler de moi, de mes expériences professionnelles et personnelles pour appuyer des aspects théoriques des savoirs enseignés.
Je suis ravie quand un ou plusieurs étudiant·es expriment un point de vue différent sur un aspect du cours. Parce que cela signifie qu’ils se sont sentis suffisamment en sécurité pour penser par et pour eux-mêmes, et le pour dire à voix haute, malgré le rapport de pouvoir inhérent entre enseignant·es et étudiant·es.
Comme je donne des cours en lien avec les violences de genre, je sais avec certitude qu’il y a des personnes survivantes dans mes classes, même si ce n’est pas dit explicitement par celles-ci. Il n’y a qu’à regarder les chiffres alarmants sur ce fléau social pour le savoir. Malheureusement, j’ai toujours raison lorsque les langues se délient en cours de semestre.

En travail social, il est crucial de privilégier le savoir-être. Même si nous sommes contraints à donner des notes, je suis davantage rassurée par une future travailleuse sociale qui n’a pas réponse à tout, surtout lorsque l’on parle d’êtres humains en difficulté. Il y a quelque chose de très sage dans le doute et la capacité à célébrer l’inconfort.
Ultimement, j’aimerais que l’existence des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux devienne caduque. Cela voudrait alors dire que l’équité pour tous aurait été atteinte. C’est certes utopiste, mais il s’agit d’une visée que nous devrions avoir. Cette vision ne se réalisera pas en quelques années ou de notre vivant. Les avancées ne sont jamais acquises, le statu quo cherche toujours à reprendre ses droits.
J’encourage mes étudiant·es à voir leur contribution comme faisant partie d’une course à relais intergénérationnelle et multidimensionnelle. Qu’il existe mille et une manières de vouloir améliorer le sort du monde, qu’il leur faut déconstruire « le mythe de la première » : bien avant nous, des gens ont déjà proposé les mêmes solutions que nous avançons aujourd’hui. Les changements qui s’opèrent dans notre société ne sont jamais le fait d’une seule et unique personne.
C’est noble de vouloir changer le monde pour le mieux. Or, pour contribuer à cette transformation sur le long terme, il faut accepter d'avoir besoin de repos, peu importe la forme qu'il prend. Il ne faut jamais se sentir coupable d’avoir besoin de recharger ses batteries, sinon on ne fera pas long feu.
Lorsque je regarde le parcours de la jeune Kharoll-Ann à la femme adulte, ce qui me rend fière est la manière dont je mène ma vie plutôt que certains accomplissements en soi. Ce profond refus de verser dans le côté obscur de la nature humaine est pour moi une véritable posture politique. Refuser de laisser mon cœur s'endurcir et être envahi par la haine, la rancœur ou la vengeance est un pied de nez à mes détracteurs et à une société qui a souvent cherché à m'écraser. On ne peut que s’épanouir dans l’amour de soi et des autres.
Pour moi, recharger mes batteries implique d’être en communauté, notamment avec des jeunes. Si mon travail leur parle et les touche, je sais que j’ai accompli mon devoir. Le reste devient secondaire. Ma liberté n’a de sens que si elle alimente la leur. La jeunesse a toujours été (et sera toujours) mon baromètre de la réussite.
Pour moi, recharger mes batteries implique d’être en communauté, notamment avec des jeunes. [...] Ma liberté n’a de sens que si elle alimente la leur.
- Kharoll-Ann Souffrant
Université d'Ottawa
Kharoll-Ann Souffrant est candidate au doctorat en travail social à l’Université d’Ottawa. En tant que chargée de cours, elle a enseigné au 1er et 2e cycle universitaire en travail social, en études féministes, en études noires et en criminologie. Ses travaux de recherche portent sur l’intersection entre la victimologie et le sentiment de justice des victimes-survivantes, les mouvements sociaux pour la justice sociale ainsi l’analyse critique des discours médiatiques.
En tant que travailleuse sociale, elle cumule plusieurs années d’expérience en intervention auprès de diverses populations, dont des femmes fuyant la violence. Elle est chroniqueuse pour Noovo Info et pour la revue sociale et politique À Bâbord! Elle a publié, aux Éditions du remue-ménage, Le privilège de dénoncer – Justice pour toutes les victimes de violences sexuelles (Lauréate – Auteure de l’année – Gala Dynastie 2024; Sélection du Jury du Grand Prix du Livre de Montréal 2023) en plus d’avoir co-dirigé avec la poète, traductrice et professeure Chloé Savoie-Bernard, le numéro Futurités noires pour la revue Possibles.
Elle travaille sur plusieurs autres projets d’écriture, dont un ouvrage à paraitre aux Éditions du remue-ménage sur les thèmes de l’identité et de l’appartenance en lien avec le Québec et Haïti.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre




