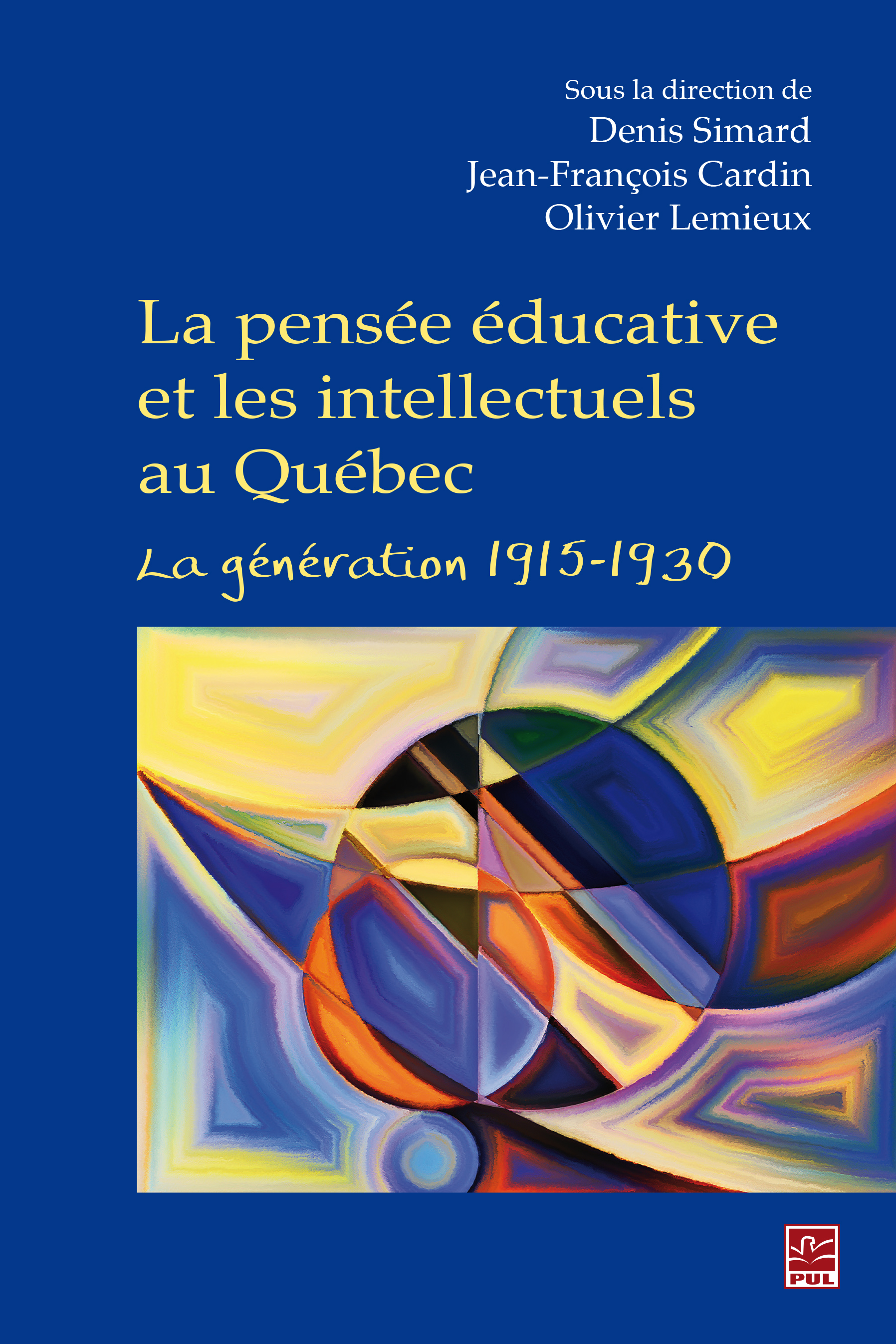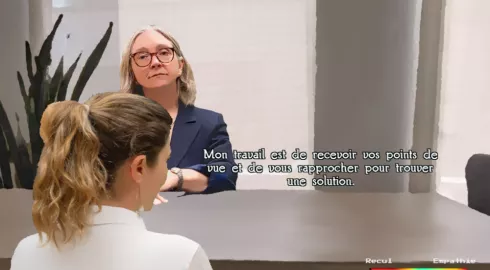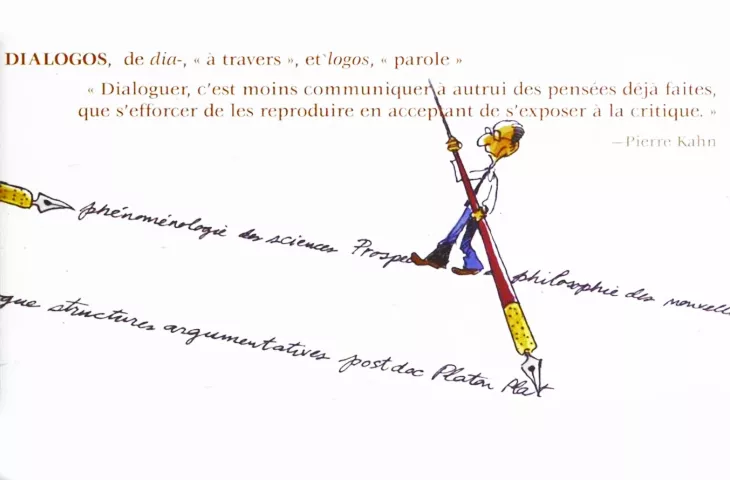« Vous, vous publiez des livres. Moi, je les enseigne », disait Jeanne Lapointe (1915-2006) aux auteurs dont elle suivait le parcours et qui auraient souhaité la lire davantage ».
[Le texte ici publié est le chapitre 2 « Jeanne Lapointe, une intellectuelle qui fonde son action sur l'enseignement », tiré de l'ouvrage collectif La pensée éducative et les intellectuels au Québec. La génération 1915-1930, publié en mai 2019.]1
Introduction
« Vous, vous publiez des livres. Moi, je les enseigne », disait Jeanne Lapointe (1915-2006) aux auteurs dont elle suivait le parcours et qui auraient souhaité la lire davantage2
Sa carrière intellectuelle est importante : diplômée en 1938, elle a été la première femme professeure au Département des littératures et la première professeure titulaire de la Faculté des lettres de l’Université Laval ; membre du comité de rédaction de Cité Libre, membre de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la Province de Québec (qui a donné naissance au rapport Parent), membre de la Commission de l’enseignement supérieur de l’éducation, membre de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (Commission Bird), et membre de plusieurs comités canadiens sur les arts et sur la recherche.
Après des débuts remarqués, lors de ses chroniques littéraires à Radio-Collège et à Radio-Canada, avec ses articles polémiques au Devoir littéraire ou à la Revue dominicaine, et une longue collaboration à Cité libre, où elle a même lancé un débat en critique littéraire, il faut pourtant constater la rareté de ses publications : aucun livre publié sous son seul nom, une trentaine d’articles, 12 conférences et communications. Comment alors expliquer sa grande réputation aujourd’hui?
Témoins de son action, nous chercherons à éclairer sa démarche qui fait primer le contact direct de l’enseignement et de l’entretien sur l’action différée de l’écrit. Nous l’avons connue à des étapes différentes de sa carrière : Denis Saint-Jacques, quand elle œuvrait à libérer la culture québécoise des carcans du nationalisme conservateur et du cléricalisme, et un peu plus tard, Marie-José des Rivières, quand elle travaillait à mettre sur pied les études féministes à l’Université.
Nous citerons aussi d’autres témoins de son activité, soit des auteurs qui ont participé au recueil Jeanne Lapointe, artisane de la Révolution tranquille, dirigé par Chantal Théry.
Vous serez à même de découvrir, avec nous, ses valeurs, les relations exceptionnelles qu’elle entretenait avec ses étudiantes et ses étudiants, et surtout la façon par laquelle elle a fait évoluer la pensée éducative au Québec.
Témoignages
-
Par Guy Rocher
Comme l’a écrit Guy Rocher3, elle a eu une immense influence à la Commission Parent :
- Heureusement que Paul Gérin-Lajoie et Arthur Tremblay ont eu la bonne inspiration [de l’y inviter car sans sa présence] le Rapport Parent n’aurait eu ni le contenu, ni la qualité, ni la densité qui ont [concouru] à l’influence qu’il a exercée […]. La contribution de Jeanne Lapointe fut triple : intellectuelle, méthodologique, rédactionnelle.
- Dans l’activité proprement intellectuelle de la Commission […], Jeanne Lapointe a apporté l’essentielle contribution d’une attitude critique et d’une certaine philosophie radicale qu’on peut appeler de gauche. C’est elle qui parmi nous était en contact avec les mouvements d’avant-garde, […], qu’ils soient d’inspiration laïque ou nationaliste […]. Elle était dotée d’un flair particulier pour ce qui sortait des sentiers battus, du conventionnel […]. Et ce sont ces vents de changements qu’elle introduisait dans nos délibérations.
« Son apport unique ne cessait, en nous alimentant, de faire avancer nos […] (parfois) trop hésitantes prises de décisions. […] Pour la rédaction du Rapport, nous lui sommes infiniment redevables » (p. 33), souligne Guy Rocher, qui poursuit avec un exemple de son esprit novateur : audacieuse, elle a proposé aux commissaires d’avoir recours à un spécialiste de la dynamique de groupe, une nouveauté à l’époque, pour aider à établir des terrains d’entente ; l’expérience, qui a fini par être acceptée, s’est révélée concluante.
-
Par Denis Saint-Jacques
Pendant qu’elle siégeait à la Commission d’enquête, Jeanne était professeure à la Faculté des lettres de l’Université Laval; c’est là où Denis Saint-Jacques l’a rencontrée.
À l’hiver 1961, un vent de démocratisation soufflait sur le monde de l’enseignement. C’était, pour bien situer l’époque, l’année de création de la Commission Parent. La rumeur voulait que les Jésuites prétendent fonder deux nouvelles universités, une francophone, l’autre anglophone, alors que le ministère de l’Éducation du Québec n’existait pas encore. Ce dernier ne verrait le jour qu’en 1964. Mais on étendait déjà la fréquentation scolaire obligatoire à quinze ans. Ajoutons que sur une autre scène, gouvernementale celle-là, Claire Kirkland-Casgrain devenait la première femme élue à l’Assemblée nationale. Enfin, dans les universités et les collèges, les jeunes issus du baby boom adhéraient au Mouvement d’action laïque de langue française et lisaient Pourquoi je suis séparatiste de Marcel Chaput.
Je délaissais à ce moment des études d’ingénieur et songeais à choisir plutôt la philosophie ou les sciences sociales. La philosophie, telle qu’on l’enseignait, m’apparaissait trop thomiste et, hésitant entre la politologie et la sociologie, je décidais de joindre, pour un trimestre, des amis en Faculté des lettres, le temps de me faire une idée pour la suite. J’y découvrais parmi les étudiants inscrits, à ma grande surprise, plus de cornettes et de soutanes que de costumes civils. L’enseignement de la plupart des professeurs ressassait, à coup de considérations érudites, un corpus exaltant les grands noms de la littérature française, à l’exception de ceux du XVIIIe siècle, trop dangereux sans doute, et de poussiéreux auteurs canadiens- français qui n’avaient pas été rebaptisés québécois et dont j’avais jusqu’alors ignoré l’existence. Qu’étais-je allé faire là? Mes amis, pourtant, me retenaient ; il fallait que je suive les cours d’une prof épatante qui était tout autre : une certaine Jeanne Lapointe, titulaire de la chaire de grammaire. De grammaire! Voilà qui ne promettait guère. Mais j’ai suivi le courant.
Je me suis donc inscrit à un cours de littérature québécoise dont elle était responsable. Cette officielle linguiste enseignait de fait plutôt la littérature. Et quelle littérature ! Au lieu des Octave Crémazie, Émile Nelligan, Louis Hémon ou autre Félix-Antoine Savard auxquels on aurait pu s’attendre, elle proposait, en plus de la dernière œuvre d’André Langevin, romancier contemporain, Les frères Karamazov de Dostoïevski, un Russe, The Sound and the Fury de William Faulkner, un Américain, et The Power and the Glory de Graham Greene, un Anglais. Au programme d’un cours de littérature canadienne-française ! Elle nous recommandait du reste de lire les deux dernières œuvres en anglais, si nous le pouvions.
La raison? Nous avions besoin de nous aérer l’esprit, nous aurions bien le temps plus tard de lire « L’heure des vaches » et autres récits du terroir. Elle nous faisait comprendre que la littérature ne connaissait pas vraiment de frontières et qu’il fallait ouvrir grands nos yeux de lecteurs.
Vous imaginez une de ces intellectuelles de « retour d’Europe », fascinée par la grande culture étrangère et méprisant nos valeurs locales? Vous n’auriez qu’à moitié raison. Diplômée à Paris, admiratrice de la grande culture universelle, indiscutablement, mais réviseuse de Gabrielle Roy, amie d’Anne Hébert, conseillère de Marie-Claire Blais, défendant notre littérature récente dans les pages de Cité libre, elle s’intéressait d’abord à nous. Et quand je dis « nous », je veux bien sûr dire nos écrivains, mais aussi, nous, ces étudiants et étudiantes qui lui faisions face en classe. Elle savait nous provoquer en faisant lire des auteurs étrangers comme s’ils étaient québécois. La provocation faisait partie de sa méthode. Je ne vois pas très bien quelle autorité universitaire l’aurait laissée aujourd’hui ainsi bouleverser le contenu des programmes. Elle nous intéressait pourtant à notre patrimoine littéraire plus que tous les autres professeurs réunis.
La provocation faisait partie de sa méthode. Je ne vois pas très bien quelle autorité universitaire l’aurait laissée aujourd’hui ainsi bouleverser le contenu des programmes. Elle nous intéressait pourtant à notre patrimoine littéraire plus que tous les autres professeurs réunis.
Il faut voir comment cela se passait. Elle ne paraissait à l’abord dotée d’aucun magnétisme personnel particulier. En classe, plutôt réservée, elle ne jouait pas, elle ne cherchait pas à séduire, à remporter l’assentiment. Elle arrivait avec des plans de cours rigoureusement organisés et clairement photocopiés, qu’elle nous distribuait en ces temps où n’existaient pas encore la communication internet et les portails électroniques. Ses collègues avaient beaucoup tendance à se limiter à la lecture à haute voix de leurs notes de cours. Pour sa part, elle partait de ses notes, que nous avions en main, mais pour nous interpeller. Les renseignements factuels établis, les analyses logiques développées d’entrée de jeu, le cours portait donc sur le questionnement qui en découlait. La littérature ne constituait pas pour elle le domaine de l’évasion, un refuge hors d’un réel prosaïque ; la littérature faisait partie du monde, de ce milieu ambiant qui se transformait soudain si vite en cette période de Révolution tranquille.
Et quel monde! Pas celui rassurant des Fables de Lafontaine, ou étroitement policé de À la recherche du temps perdu. Non, celui de la dégénérescence morale: aliénation mentale, inceste et violence, chez Faulkner; de la remise en question de la religion chrétienne, opposant le Jésus évangélique à un grand inquisiteur représentant l’église historique, chez Dostoïevski ; de la persécution jusqu’à son exécution subie par un prêtre à la moralité paradoxale, chez Greene. Celui d’André Langevin, le seul auteur québécois du lot, dans Le temps des hommes, n’offrait guère mieux: adultère, assassinats, déchéance d’un prêtre cherchant sans succès à se racheter. Récits de bruit et de fureur, donc, sans pouvoir ni gloire.
Ces ouvrages, tels qu’elle nous les présentait, n’exprimaient pas tant la réalité, ne la représentaient pas tant, qu’ils la mettaient en question. Et la réalité, c’était aussi nous. De telle sorte qu’elle donnait beaucoup moins de temps à l’explication qu’au questionnement. Et les interrogations fusaient : « Et vous Marie-Claire, qu’en pensez-vous? » Marie-Claire Blais assistait souvent aux cours avec nous. «Et vous Noël Audet, André Ricard? » Ceux-là y fourbissaient aussi leurs armes d’écrivains à venir. Et inévitablement, venait le tour du futur professeur encore ignorant de son avenir : « Saint- Jacques, vous dormez? Ça ne vous dit rien? » Une fois que le poisson avait mordu, elle savait tirer la ligne. Le cours se transformait en conversation. Ce n’est peut-être pas tout à fait le terme, disons plutôt en dialogue socratique. Elle posait les questions et relançait ; elle corrigeait le moins possible et ne se laissait pas entraîner à conclure de façon rassurante pour nous.
En fait, nous nous en rendions assez vite compte, elle s’intéressait vraiment à nous. La littérature constituait pour elle un levier, il s’agissait de nous bousculer, de nous conduire à penser, à remettre en question les idées reçues. Nous n’allions pas nous en tirer facilement. Obligation de jouer le jeu ou alors d’aller voir ailleurs. Mais si nous participions, nous allions avoir accès à un nouvel univers, russe, américain, anglais, québécois aussi, pourquoi pas? À un nouvel univers où, une fois les certitudes ébranlées, resteraient des questions. Elle nous voyait à un âge où les questions valent mieux que les doctrines, la perplexité, mieux que la satisfaction de soi, la liberté, mieux que la tradition.
Cela n’allait pas sans travaux pratiques, qui prirent, en la conjoncture, une forme inattendue. Une fois par semaine, elle se joignait à nous pour le repas du midi dans un modeste restaurant des environs. Et dans une atmosphère plus décontractée, le cours continuait sur des sujets non programmés, mais toujours à propos de nous, ce que nous vivions, ce que nous sentions, ce que nous projetions, de la place que nous voulions investir dans ce monde, de ce que nous voulions en faire. Elle nous donnait conscience de nos possibilités, mais aussi de la complexité des enjeux, de leur diversité.
Et hors des contraintes universitaires, il en résultait soudain une invitation. Une de ses amies, Judith Jasmin, la journaliste bien connue de Radio-Canada, préparait un reportage télévisé sur l’état d’esprit des étudiants universitaires québécois. N’étions-nous pas à cette époque où déjà ceux de Berkeley, en Californie, formaient des mouvements de contestation sociale et où ce ferment allait agir de Berlin à Tokyo, Rome ou Paris? Se passait-il quelque chose ici? Jeanne Lapointe croyait que oui et nous donnait la responsabilité d’en faire état. Une fois encore, elle nous donnait la parole. Nous en sommes tous restés marqués. Et pour ma part, c’est grâce à elle si je suis resté en lettres et que je suis devenu professeur.
-
Par Marie-Claire Blais
Marie-Claire Blais4 a aussi écrit sur la pédagogie de Jeanne et sur la « satisfaction sans réticence qu’elle éprouv[ait] à enseigner ». Lors des rencontres du samedi, les noms de Katherine Mansfield, Pasternak, Gogol ou Radiguet brisaient le silence de l’appartement. Simone Weil et Graham Greene lui étaient particulièrement chers, peut-être «parce que [ces] deux écrivains [étaient] déchirés par des questions religieuses, […] ou que Jeanne reconnai[ssait] ses déchirements spirituels à travers l’un et l’autre […] ou que tout simplement ces deux êtres humains la séduisaient » (p. 74).
-
Par Marie-José des Rivières
Marie-José des Rivières a pour sa part d’abord rencontré Jeanne Lapointe dans un groupe militant qu’elles avaient contribué à fonder, en 1977, soit le Regroupement des femmes de l’Université Laval (RFUL), qui menait des actions féministes. Monique Bégin, qui a été secrétaire générale de la Commission Bird, puis ministre canadienne de la Santé a bien raconté la « conversion » de Jeanne au féminisme en 1967. La direction de la Commission avait alors invité les membres à lire une minibibliothèque de textes incontournables sur ce que le féminisme venait de publier, ainsi que des mémoires sur l’éducation des filles. Jeanne «qui désirait absolument voir corriger les injustices faites aux femmes […] fut certainement notre meilleure élève! »5 . La Québécoise est alors devenue celle qui proposait ou appuyait des recommandations touchant la représentation des filles et des femmes dans l’orientation professionnelle ou les manuels scolaires, notamment. À la suite de la Commission, l’enseignement et la recherche de Jeanne Lapointe se sont orientés vers une perspective résolument féministe.
Dans ses séminaires, pour débusquer « l’ordre phallocratique du discours »6 , elle nous faisait lire Luce Irigaray, linguiste et psychanalyste, qui contestait les théories freudiennes et lacaniennes. Jeanne nous a aussi fait rencontrer Anne Hébert, « féministe avant la lettre, [disait-elle, qui avait] osé écrire et sortir des sentiers battus des petites femmes soumises aux hommes d’Église et aux hommes à la maison » (p. 52). Nous avons eu la chance de discuter avec l’écrivaine et poète Madeleine Gagnon, aussi avec Louky Bersianik, auteure du premier grand roman féministe au Québec, L’Euguélionne. Jeanne nous emmenait à des colloques, pour mieux connaître des chercheuses canadiennes-anglaises aux idées sociales et éducatives novatrices. Elle nous présentait enfin des femmes remarquables qui avaient réussi leur carrière parmi les hommes, comme l’Honorable Monique Bégin. Souvent, après les séminaires, elle nous invitait chez elle pour poursuivre les discussions et fêter.
Jeanne Lapointe et son héritage
Jeanne Lapointe est l’une des pionnières de l’institutionnalisation des études féministes au Québec; en 1983, elle participe à la création du Groupe de recherche multidisciplinaire féministe (GREMF) de l’Université Laval et, en 1988, à celle de la revue Recherches féministes et de la Chaire Claire-Bonenfant sur la condition des femmes. Elle crée enfin le prix Elsie-Gregory-MacGill pour encourager de jeunes intellectuelles engagées pour la cause des femmes ; cette distinction récompense plus précisément un mémoire remarquable, écrit selon une perspective féministe. Sa pensée éducative s’est donc sensiblement nourrie de sa pensée féministe.
Rappelons, en terminant, son insatiable curiosité intellectuelle, sa vivacité d’esprit et son humour légendaire ; philosophe, elle prônait l’humour comme solution à bien des problèmes. Et elle savait manier l’ironie !
En souriant, ses étudiants l’appelaient parfois « la papesse Jeanne », alors qu’elle n’a jamais voulu occuper la moindre position de pouvoir, ni éditrice, ni rédactrice en chef, ni doyenne durant sa carrière.
Nous pouvons aussi nous souvenir d’elle comme « Jeanne la Magnifique», à la façon de Louky Bersianik7 , ce qui évoque son action aussi remarquable que celle de Gaston Miron dans le champ de la poésie.
Conclusion
Enfin, nous avons voulu faire voir comment, avec assez peu de prestations individuelles sur la place publique, Jeanne Lapointe a pu devenir une de nos grandes intellectuelles québécoises. Elle a fait primer l’échange direct socratique sur l’échange distancié médialisé par l'écrit. Enseignante jusque dans sa démarche intellectuelle, ne mettait-elle pas ainsi en valeur le fondement du système éducatif qu’elle a contribué à moderniser?
Intellectuelle en éducation par l’enseignement même, elle a pris part à la démocratisation de l’éducation au Québec. Il faut aussi dire que son esprit pénétrant, ses résistances, son audace et ses prises de position souvent perturbantes ont permis d’élargir les perspectives de la critique littéraire et d’enrichir, de mieux faire connaître les études féministes.
Bibliographie :
- Raby, C. (2007). Le parcours critique de Jeanne Lapointe (Mémoire de maîtrise, Université Laval).
- Théry, C. (dir.) (2013). Jeanne Lapointe, artisane de la Révolution tranquille. Montréal, Triptyque.
- 1Note de la rédaction : les écrits de Jeanne Lapointe ont fait l’objet d’une anthologie toute récente Jeanne Lapointe, Rebelle et volontaire. Anthologie 1937-1995, sous la direction de Marie-Andrée Beaudet, Mylène Bédard et Claudia Raby, avec la collaboration de Juliette Bernatchez, Montréal, Leméac (Essais littéraires), 2019, 256p.
- 2Madeleine Gagnon, 2012, dans C. Théry, 2013, p. 52
- 32013, dans C. Théry, 2013, p. 32-33
- 42010, dans C. Théry, 2013, p. 74
- 5Monique Bégin, 2013, dans C. Théry, 2013, p. 39
- 6Madeleine Gagnon, 2012, dans C. Théry, 2013, p. 49
- 7Dans C. Théry, 2013, p. 45
- Marie-José des Rivières et Denis Saint-Jacques
Université Laval
Marie-José des Rivières travaille à l’Université Laval. Elle est directrice adjointe de la revue Recherches féministes, membre associée du Centre interuniversitaire de recherche sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), du Groupe de recherche sur l’histoire de la vie culturelle et coordonnatrice du comité des Prix et distinctions de l’Université Laval. Elle est aussi membre associée de l’Institut Femmes, Sociétés, Égalité, Équité. Elle a publié Châtelaine et la littérature1960-1975; elle est coauteure, avec Denis Saint-Jacques, des anthologies L’heure des vaches et autres récits du terroir et Chercher fortune à Montréal, enfin des collectifs De la Belle Époque à la Crise. Chroniques de la vie culturelle à Montréal et Les médias parlent et chantent et prépare, enfin, toujours en codirection, pour 2020 : Une culture exportable (sur l’internationalisation de la vie culturelle québécoise). Elle a participé à plusieurs collectifs, dont Femmes de rêve au travail; le Traité de la culture; 1937: un tournant culturel; Dialogue et choc des muses. Elle travaille sur l’histoire des magazines au Québec.
Denis Saint-Jacques est professeur émérite de littérature française et québécoise au département des littératures de l'Université Laval et membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ). Il codirige le collectif La vie littéraire au Québec, Québec, PUL, six volumes parus. Il a coédité, avec Marie-José des Rivières De la Belle Époque à la Crise. Chroniques de la vie culturelle à Montréal, Les médias parlent et chantent, Nota Bene, 2015, Chroniques de la vie culturelle à Montréal durant la Crise et la Guerre, Montréal, Nota Bene, 2018, et, avec Paul Aron et Alain Viala, le Dictionnaire du littéraire, PUF, 3e édition 2010. Il prépare, avec Marie-José des Rivières et Elizabeth Plourde le collectif Une culture exportable, Nota Bene, 2020.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre