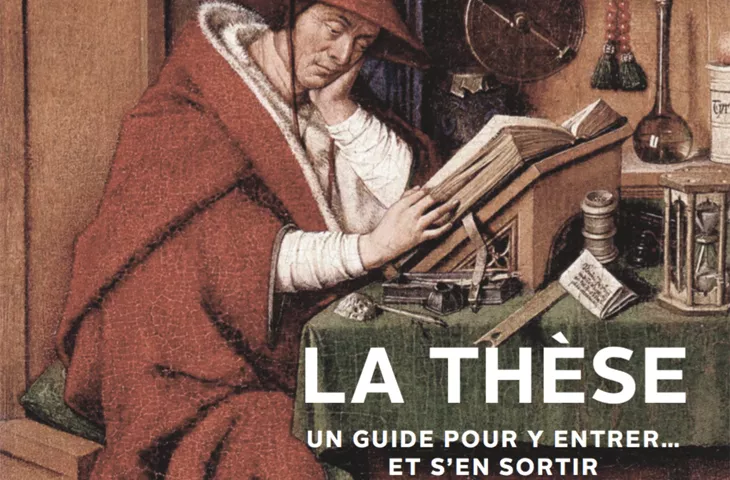Raconté sous forme de dialogue, ce livre est à la fois « une monographie sur le cerveau et un récit sur les origines de la pensée » [p.4]. C’est aussi un ouvrage de vulgarisation ambitieux dans sa visée de saisir la complexité de la nature humaine, et rigoureux dans ses descriptions des avancées scientifiques. Il s'appuie sur une recherche dont les références mises en ligne permettent au lecteur d’y poursuivre leur parcours. Pour leur part, les quelque 105 illustrations de Rémy Guenin offrent une pointe d’humour qui complète agréablement les plus de 200 schémas techniques et photos du bouquin. S'ajoutent à la qualité de l'ouvrage, une table des matières détaillée, et des index très fournis de termes et de personnes clés. Bref, une somme qui s’appuie sur près de 30 ans de pratique en vulgarisation sur le cerveau et son monde.
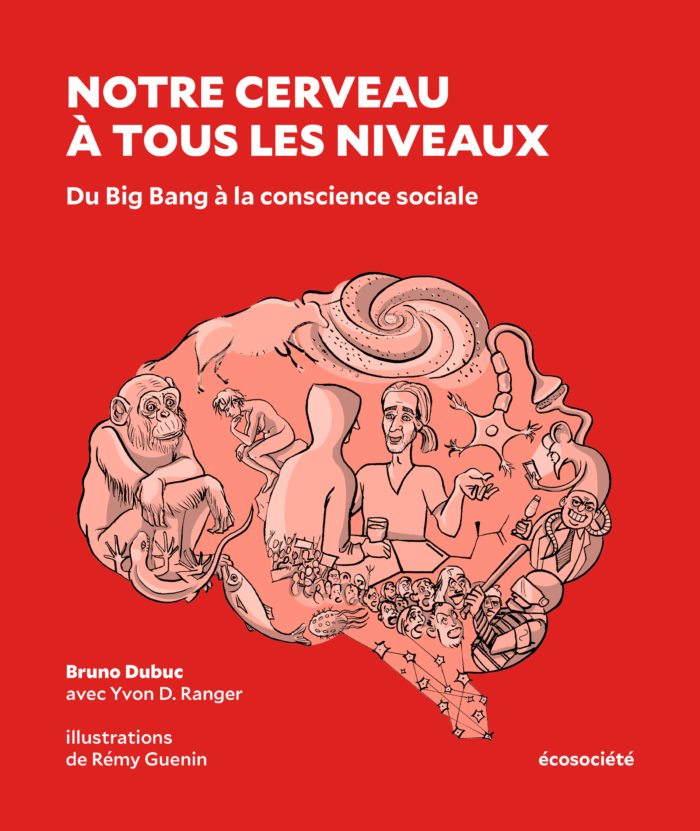
Johanne Lebel : Bonjour Bruno, ton ouvrage de vulgarisation scientifique sur le cerveau fait 576 pages... comment cette longue aventure a-t-elle commencée?
Bruno Dubuc : On peut faire remonter l’histoire à mon baccalauréat en biologie à l'Université de Montréal. Après, j’ai eu besoin de décrocher. Pendant un an, je suis allé en France faire des « études libres » centrées sur la neuro et la psycho. J’ai beaucoup lu, oui, et aussi beaucoup skié et roulé à vélo.
Au retour, en 1988, j’ai entrepris une maîtrise en neurobiologie avec Vincent F. Castellucci, qui venait tout juste de revenir au pays pour y travailler à l'Institut de recherches cliniques de Montréal. Depuis 1975, il était professeur à l’Université Columbia de New York, où il avait réalisé des travaux sur les mécanismes cellulaires de la mémoire avec Eric Kandel (1929 -), chercheur en neuroscience d’origine autrichienne, et lauréat en 2000 d’un Nobel pour, justement, ses travaux sur la mémoire.
JL : La mémoire a-t-elle été alors l’objet de ton mémoire…
BD : Un de ses aspects, je dirais. Mon champ de recherche, c'était les mécanismes moléculaires de l'apprentissage et de la plasticité neuronale. L’animal sur lequel je branchais mes électrodes était une aplysie, le modèle par excellence en neuroscience dans les années 1960 et 70. Ce gros mollusque, à peu près de la taille de mon poing, ne possède que 20 000 neurones de bonne taille. Le plus gros d’entre eux mesure 1 mm, et on peut voir à l'œil nu son corps cellulaire, soit la partie centrale où se trouve le noyau, et d’où partent les dendrites d’un côté, et l’axone de l’autre.
Son système nerveux est constitué d’une quinzaine de ganglions, des sortes de « tapons » de neurones répartis un peu partout dans le corps. Je travaillais pour ma part sur le ganglion abdominal. Les expériences consistaient, entre autres, à toucher l’animal au même endroit à plusieurs reprises, pour le voir d’abord se rétracter, puis peu à peu s’habituer. Une algue le frôlait sans doute, rien de dangereux. Derrière ce phénomène d’habituation se jouait une communication entre les neurones sensoriels de la peau et les neurones moteurs du ganglion abdominal qui eux transmettaient les signaux de contraction au muscle. Et si je pinçais l’animal à un autre endroit, tout son système redevenait immédiatement en alerte. Chez mes parents, il y avait cette horloge qui sonnait toutes les heures, et que je finissais par ne plus entendre. Une fois, après une fausse alerte du détecteur de fumée, quand l’heure a sonné, j’ai sursauté. « OK, non, ce n'était pas le détecteur ». Tout comme mon « lièvre de mer » (surnom de l’aplysie) mon corps était en mode alerte.
Après le mémoire, j’ai quitté le milieu de la recherche, entre autres parce qu’il me paraissait extrêmement compétitif. Et c’est suite à une rencontre avec Étienne Denis, alors rédacteur en chef à Québec Science, que j’ai eu mes premiers contrats de vulgarisation. Il m'a formé à l'écriture journalistique avec son langage, comment dire, cru et clair, mais cru... « Tu ne sais pas écrire de manière journalistique, me disait-il ». C’était à la dure, mais j’ai appris.
Pendant quelques années, j’ai fait des mandats m’amenant à creuser divers domaines scientifiques; du côté des magazines, mais aussi de la télévision. Puis, il y a eu ce contrat de soutien logistique au groupe de recherche mené par Maurice Dongier, neuropsychiatre à l’Hôpital Douglas [aujourd’hui Institut universitaire en santé mentale Douglas]. Pour son atelier sur la conscience humaine réunissant des scientifiques canadiens, il cherchait un moyen de mettre en commun les propos échangés. C’était l’époque où se développait une nouvelle technologie, comment ça s'appelait déjà, une techno très prometteuse, accessible partout dans le monde, 24 heures sur 24, ah oui, le web (rires)... La proposition a convenu, et je leur ai construit un site. On était en 1998.
Après ce premier contact avec le web, j'ai monté un site de vulgarisation présentant le cerveau à tous les niveaux du moléculaire au social (www.lecerveau.mcgill.ca). Au bout de 9 mois, à la fin de ce projet initial, le site fonctionnait bien, la navigation était adéquate, et deux thèmes étaient développés : anatomie générale du système nerveux et mémoire.
JL : Un retour donc à la recherche en neuroscience, mais sous un autre angle.
BD : En effet, et heureusement, il y aura rapidement une suite. En 2000, le gouvernement canadien mettait en place les Instituts de recherche en santé du Canada, et j’avais relevé sur le site l’intention de faire des liens avec le public. Je suis donc allé voir le premier directeur de l'Institut des neurosciences en santé mentale et toxicomanie, Rémi Quirion. « Je viens de développer un outil centré sur le cerveau. Si vous me financez, je l'arrime à votre institut, c’est du clé-en-main ». On a jasé une heure. Il m’a dit, « fais-moi un budget ». C’était parti pour 10 ans...
Le financement a duré jusqu'en 2013... jusqu’aux coupes du gouvernement Harper. Mais j’ai continué à le faire rouler doucement, grâce, entre autres, à du sociofinancement. J’avais aussi joint au site, à la fin de 2010, un blogue que je poursuis encore aujourd’hui, où pratiquement chaque semaine, je discute d’une étude de neuroscience, en faisant des liens avec les pages du site.
La matière du site se retrouve dans le livre, mais réorganisée, suivant un fil rouge, soit une interrogation autour de ce qui produit les comportements humains, avec comme hypothèse que la connaissance de ce savoir porte un potentiel de transformation sociale.
Bref, à la fin du financement régulier, j’ai commencé à « parler » du cerveau pour essayer de gagner ma vie de cette manière. J’ai fait des conférences à l'Université du 3e âge, monté un cours de 20 heures, organisé des journées d’étude pour les enseignants du collégial où je présentais les dernières avancées en sciences cognitives, et autres.
Aujourd'hui je remercie Stephen Harper, parce que sans lui, je ne me serais pas « botté le cul » pour développer cette tout autre manière de communiquer la science, où il faut tirer un fil narratif de la jungle de connaissances (rires).
J'ai fait beaucoup d'erreurs. Oh, ça, je me suis parfois planté d'aplomb. Puis, à force de jouer avec mes blocs, je suis arrivé avec un déroulement évolutif qui est aujourd’hui à la base du livre. En partant de l’échelle moléculaire, j’ajoute peu à peu les niveaux de complexité pour me rendre jusqu’au social.
La matière du site se retrouve dans le livre, mais réorganisée, suivant un fil rouge, soit une interrogation autour de ce qui produit les comportements humains, avec comme hypothèse que la connaissance de ce savoir porte un potentiel de transformation sociale.
JL : Comment le projet de ce livre t’est-il venu?
BD : Après quelques années d'échanges avec David Murray, mon éditeur chez Écosociété. « Il faudrait bien faire un livre sur le cerveau », me disait-il déjà vers 2015. Je n’étais pas très motivé, je trouvais qu’il y avait déjà beaucoup de livres sur le sujet… jusqu'à ce que je pense à la forme du dialogue. Là j’ai senti que je pourrais m’engager pour toffer la run, comme on dit. Un dialogue entre Bruno Dubuc, vulgarisateur scientifique et Yvon D. Ranger, un militant curieux, critique et très engagé dans son monde.
Le vrai travail sur le livre a débuté en 2020. Ça m'a pris 4 ans, presque à temps plein.
JL : Sur le site, pour tous les thèmes, on peut circuler entre trois niveaux : débutant, intermédiaire et avancé. En reste-t-il des traces dans le livre?
BD : Le dialogue avec Yvon m’a permis de rendre ça accessible et concret. Les débuts de rencontres sont mollo; les deux gars commencent à échanger « au niveau débutant ». Je voulais que l’on entre peu à peu dans la complexité du thème abordé, et ce à chacune des 12 rencontres qui forment la structure du livre; rencontres qui ont eu lieu à 12 endroits différents, des lieux bien choisis, permettant de faire des liens avec le sujet du « chapitre ». Je dirais, cependant, que l’ensemble du livre correspond au niveau intermédiaire du site. Pour quelqu’un qui lit un peu sur différents sujets, c’est accessible.
Souvent, Dubuc se laisse emporter dans de longues tirades par ce qui le passionne. Mais, j’ai senti que s’il y avait trop de matière dans les dialogues, l’esprit de ceux-ci serait dénaturé, déséquilibré. Les tirades ont donc été « encadrées » (rires). Si on veut aller plus loin, on s’arrête à ces encadrés, sinon on poursuit avec le dialogue.
JL : J’ai fait des sauts de puces dans l’ouvrage, et effectivement, ça fonctionne plutôt bien.
BD : Hum, sauts de puce… pas trop tout de même :-), car je suggère fortement d’y aller linéairement, d’autant que j'ai pris beaucoup de soin à introduire progressivement les concepts d'une rencontre à l'autre. Pour comprendre le cerveau dans ses multiples dimensions, de la molécule à la pensée réflexive, il faut poser les paliers les uns après les autres, puis les relier entre eux. Il y a eu tout ce jeu de progression linéaire et cumulative à mettre en place. Bref, si on « saute » directement au dialogue sur le langage, on risque de manquer des couches d’informations et d’avoir une compréhension en surface de ce phénomène émergent de haut niveau. Alors que si on fait le voyage au complet, là je pense que, rendue au langage, la perception en sera beaucoup plus riche, voire radicalement modifiée.
...je suggère fortement [d'en faire une lecture linéaire], d’autant que j'ai pris beaucoup de soin à introduire progressivement les concepts d'une rencontre à l'autre.
JL : Je vois, une couche s’adossant à celle qui précède, comme une spirale, où d’un tour à l’autre on revient sur certaines notions, mais jamais tout à fait à la même place.
BD : J'adore, et je bonifierais la représentation en ajoutant des ponts entre les « étages » au fur et à mesure que l’on monte, et plus tu montes, plus ils sont fréquents.
JL : Parlant des savoirs qui s’accumulent, quelles sont les dernières avancées en neurosciences et comment ont-elles marqué ton ouvrage?
BD : Les deux grands champs de recherche qui ont transformé les neurosciences récemment traversent presque tout le récit.
Il y a d'abord l’approche du cerveau prédictif qui a opéré un véritable renversement depuis une quinzaine d’années. On sait maintenant que le principal flux d'informations va de notre cerveau vers le dehors, vers l’environnement. On projette sur le monde ce qu'on s'attend à y voir. On analyse à partir de nos expériences, nos catégories, nos préjugés, bref de nos différents modèles du monde sans cesse en évolution. Ce qui monte de l’extérieur en nous, c'est simplement la surprise, l'écart ou l'erreur par rapport à la prédiction.
JL : Si je comprends bien, notre cerveau possède un modèle de la réalité qu'il compare en temps réel avec l'information qu'il reçoit de l’extérieur. Ce modèle est fait de mots, de catégories, de récits, de ressentis, de valeurs. Bref, on a une marge de manœuvre pour être un meilleur humain si on intervient sur ce qu’on se met en tête, sur ce qui entre dans notre tête : nos relations, nos lectures, nos expériences, nos divertissements.
BD : En effet, tout cela joue sur les décisions que l’on doit prendre continuellement. Notre cerveau est toujours à l'affût du « Qu'est-ce que je dois dire ou faire ensuite? ». C'est très adaptatif, et c'est conséquent avec l’approche évolutive au cœur de mon bouquin. C’est l’idée qu’on n’a pas évolué initialement pour jouer aux échecs, mais pour se déplacer dans notre environnement sans se casser la gueule et afin d'y trouver des ressources pour survivre. Le grand cadre théorique du cerveau prédictif permet donc de remonter jusqu’à l’essence même des êtres vivants, c’est-à-dire à leur capacité à maintenir leur organisation complexe un certain temps, dans un monde voué par ailleurs au désordre croissant, à l’entropie.
Le chercheur incontournable sur cette question, c’est le Britannique Karl Friston (1959 -). Du côté français, Stanislas Dehaene a fait un cours complet au Collège de France sur ce qui est aussi appelé le cerveau bayésien. Celui-ci fait des inférences sur le monde, basées sur ses connaissances a priori, ses expériences, ses croyances. Il cherche la cause probable pour expliquer ce qui arrive.
Pour saisir l’ampleur de cette « révolution bayésienne », il faut voir à quel point ce cadre théorique renverse complètement le modèle « input – cognition – output » calqué sur l’ordinateur, qui a dominé toute la seconde moitié du 20e siècle. Pour le dire vite, on a assisté à une inversion complète du flux principal de l’information : au lieu de considérer un cerveau qui attend passivement que les stimuli sensoriels arrivent de l'extérieur, en les modifiant peut-être un peu selon ses attentes, on comprend maintenant que ce sont nos prédictions, donc des projections top down, qui constituent l’essentiel du travail cognitif; les signaux sensoriels bottom up venant simplement nous indiquer notre niveau d’erreur afin que se modifient en conséquence nos modèles internes, et donc apprendre. Je dis souvent à la blague durant mes conférences qui si je me fiais seulement à ce qui stimule ma rétine (stimuli extérieurs, bottom up), j’aurais l’impression de parler à une assemblée de culs-de-jatte, parce que, cachées par les tables ou par les voisins d’en face, je ne vois aucune jambe. Mais j’infère automatiquement que personne n’a cet handicap que je sais être plutôt rare, et aussi parce que je me souviens que tout le monde est arrivé en marchant. Mon cerveau a donc, de manière top down, corrigé les stimuli.
...on comprend maintenant que ce sont nos prédictions [...] qui constituent l’essentiel du travail cognitif.
JL : Et l'autre grande avancée…
BD. C'est la dimension incarnée et située de la conscience, embodied and embedded cognition. Francisco Varela – s'il y a un seul nom à donner – et son collègue Evan Thompson ont vraiment mis le spotlight sur l’unité entre cerveau, corps et environnement. Le cerveau n’a pas évolué dans le vide, mais toujours dans un corps qui pose certaines contraintes, lui-même situé dans un environnement, un contexte, qui nous pénètre à notre insu, beaucoup plus qu’on ne le pense, pour influencer notre pensée.
Toute la recherche en sciences cognitives est maintenant compatible avec cette vision incarnée et située de la cognition. Le cerveau humain ne peut se détacher de la sensorimotricité, et le piège, c'est que nous sommes tellement bons dans l'abstraction que permet le langage qu'on finit par penser que nos idées existent hors du corps, hors de nos émotions, hors de nos relations aux autres, et, de ce fait, de se croire beaucoup plus objectif et rationnel que nous le sommes.
Avec la création du concept d'énaction, Varela va plus loin. Il trace la continuité entre la vie et la cognition. La cognition, c’est plus que résoudre des problèmes, c'est créer du sens, c'est donner une valeur aux choses, aux relations. Vivre est un processus créateur de sens. Notre cerveau-corps essaie constamment d’attribuer une signification, bonne, mauvaise ou neutre, aux choses et aux êtres qu’il rencontre, pour ensuite agir en conséquence. Et ce sont ces affects primaires qui, encore une fois interprétées par notre cerveau prédictif leur attribuant la signification la plus plausible selon le contexte, va nous les faire ressentir comme telle ou telle émotion. Émotions qui agiront comme moteur à l’action, pour survivre et se reproduire, on y revient toujours…
...nous sommes tellement bons dans l'abstraction que permet le langage qu'on finit par penser que nos idées existent hors du corps, hors de nos émotions, hors de nos relations aux autres, et, de ce fait, de se croire beaucoup plus objectif et rationnel que nous le sommes.
JL : Je t'écoute et je vois tout le métier accumulé, un mouvement de spirale, encore une fois.
BD : Mais parce que c'est ça l'être humain! On est la somme de notre histoire de vie, de nos influences. À la fin du livre, cette idée revient : sur la page de gauche, un dessin pleine page concluant la fin des rencontres porte l’idée qu’on est plusieurs, puis sur la page de droite, au milieu des très nombreuses personnes dont les propos ont fait ce livre et que je remercie, on trouve ce mot d’Henri Laborit, l’un des auteurs qui m’a le plus influencé : « Nous ne sommes que les autres ».
À la onzième rencontre, on aborde aussi la question du libre arbitre. Certains lecteurs devront sans doute revoir à la baisse ce qu’on appelle le mérite. Yvon s’inquiète de la remise en question de cette liberté, pour laquelle il s'est tant battu. Oui, on doit se battre pour la liberté d’expression politique, bien sûr, mais en considérant tout ce que notre cerveau fait inconsciemment, et tout ce qu’il gobe à notre insu. On doit admettre qu’on est beaucoup plus la somme de ce qui nous influence que d’une quelconque « volonté personnelle ».
Les implications de cette minimisation du libre arbitre sont importantes, car elles reportent une partie de notre responsabilité sur les structures sociales, sur le milieu dans lequel on grandit, sur l'environnement produit par nos puissantes technologies numériques. Là, on est à la fin du livre, qui débouche évidemment sur ces grandes questions éthiques et politiques. Parce que la suite des choses pour notre espèce risque de pas mal dépendre du type de société qu’on va proposer à nos jeunes : produire encore plus, ou continuer notre longue aventure. Les deux ne semblent plus compatibles. Et c’est à nous, qui avons eu la chance d’être éduqués et d’avoir pu éviter la violence des guerres, de tenter d’inverser la tendance. « So try », comme l’écrivait le grand primatologue et neurobiologiste Robert Sapolsky, un autre à qui je dois beaucoup.
"Nous ne sommes que les autres", Henri Laborit.
Pour en savoir +
- Conférence de l'auteur autour du livre, organisée par Les Sceptiques du Québec; durée 55 minutes, disponible en ligne.
- Bruno Dubuc
vulgarisateur scientifique
Détenteur d’une maîtrise en neurobiologie de l’Université de Montréal, Bruno Dubuc est vulgarisateur scientifique. Après avoir œuvré une dizaine d’années à titre de journaliste et recherchiste scientifique, il a lancé en 2002 le site web Le cerveau à tous niveaux (www.lecerveau.mcgill.ca), reconnu tant dans le milieu scientifique qu’auprès du grand public qu’il côtoie régulièrement à titre de conférencier depuis 2014. Année où il a joint aussi le collectif derrière l’Upop Montréal (www.upopmontreal.com), dont les activités gratuites s’inscrivent dans le sillage des universités populaires.
Son alter ego Yvon D. Ranger est quant à lui détenteur d’un certificat en philosophie, et d’un autre en scénarisation cinématographique. Il a coordonné de 2002 à 2014 le mensuel indépendant satirique Le Couac tout en réalisant de manière tout aussi indépendante une vingtaine de courts métrages, cinq longs métrages et une web série, tous à saveur politique.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre