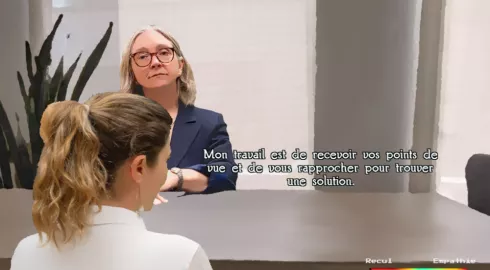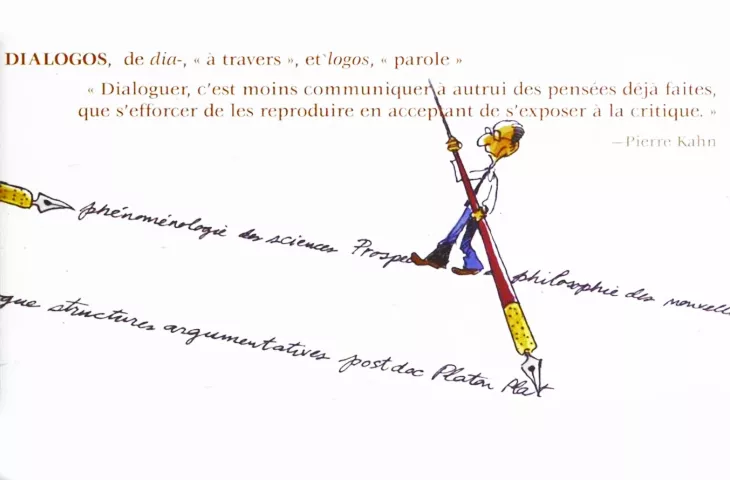[L'affaire Maillé est] le témoignage important, émouvant et surtout courageux d’une jeune chercheuse encore idéaliste (mais c’est peut-être un pléonasme…) confrontée à une société privée visée par un recours collectif et dont les avocats (c’est leur fonction) ne reculent devant rien (tant que c'est légal...) pour s’approprier les données, pourtant confidentielles, produites dans le cadre de sa recherche doctorale sur la controverse entourant l'implantation d’un parc éolien dans le Centre-du-Québec.
 Avec l’aimable autorisation des éditions Écosociété, nous publions la préface de Yves Gingras à l’ouvrage de Marie-Ève Maillé, L’affaire Maillé, publié aux édidtions Écosociété en 2018 https://ecosociete.org/livres/l-affaire-maille ). - La rédaction
Avec l’aimable autorisation des éditions Écosociété, nous publions la préface de Yves Gingras à l’ouvrage de Marie-Ève Maillé, L’affaire Maillé, publié aux édidtions Écosociété en 2018 https://ecosociete.org/livres/l-affaire-maille ). - La rédaction
L’« affaire » que vous allez lire – car c’en est une – est une histoire d’horreur dont le monde de la recherche scientifique aurait pu se passer. Ce n’est pas une intrigue universitaire dans le style du roman Un tout petit monde de David Lodge1 ou, plus près de chez nous, de celui du professeur André C. Drainville, dont les Carnets jaunes de Valérien Francoeur, qui a crevé quelques enflés2avaient à l’époque suscité beaucoup d’émoi dans le landerneau académique de la capitale nationale3. Bien que la victime – car c’en est une – soit ici une jeune chercheuse, ce n’est pas non plus l’histoire sordide de pauvres doctorantes ou postdoctorantes mal payées et exploitées par leurs directeurs ou directrices de recherche (comme c’est le cas dans le roman à clé Félicitations du jury de Clarisse Buono4) qu’on lira ici, même si on y retrouve aussi un peu de cette vie vouée à la recherche et néanmoins précaire.
Ce récit est plutôt le témoignage important, émouvant et surtout courageux d’une jeune chercheuse encore idéaliste (mais c’est peut-être un pléonasme…) confrontée à une société privée visée par un recours collectif et dont les avocats (c’est leur fonction) ne reculent devant rien (tant que c'est légal...) pour s’approprier les données, pourtant confidentielles, produites dans le cadre de sa recherche doctorale sur la controverse entourant l'implantation d’un parc éolien dans le Centre-du-Québec. Ce n’est pas la première fois que des chercheuses, mêmes établies et reconnues, sont aux prises avec ce genre de prédation juridique. L’auteure évoque d’ailleurs les précédents survenus à l’Université d’Ottawa en 2012 et à l’Université Western Ontario en 2016, où les chercheuses ont elles aussi dû se défendre pour assurer la confidentialité des données recueillies dans le cadre de recherches pourtant conformes aux règles édictées en matière d’éthique de la recherche.
Si la situation décrite dans ce livre n’a donc rien d’inédit pour un observateur du monde de la recherche universitaire et de ses multiples controverses, l’originalité de Marie-Ève Maillé est de raconter dans le détail comment elle a vécu au jour le jour une saga judiciaire qui est venue bouleverser sa vie, alors que la plupart des autres victimes d’affaires similaires ont plutôt choisi, par prudence, de garder le silence.
Comme d’autres, Marie-Ève Maillé croyait sans doute qu’une recherche scientifique rigoureuse sert le bien public et peut améliorer la vie en société. Comme d’autres, elle approuvait probablement les beaux discours des dirigeantes et dirigeants universitaires qui vantent sur toutes les tribunes l’importance de la recherche « au service de la société » et invitent « leurs » chercheurs à s’impliquer socialement. Ainsi, nos établissements universitaires publient tous des « plans stratégiques », documents produits en couleur avec force photos de personnes tout sourire – selon les conseils de leurs experts en « communication » et marketing qui tendent de plus en plus à dicter le « discours officiel » d’établissements supposés être de « haut savoir ». Dans l'un de ces « plans », choisi au hasard, la présidente du conseil d’administration souligne que des « organisations innovantes savent se doter de planifications stratégiques audacieuses et stimulantes ». Ainsi, nous assure-t-on dans cette université bien québécoise, « l'engagement envers la société et le milieu colorera toutes les expériences » de l’établissement. Mieux, « les membres de sa communauté seront conviés à répondre aux grands enjeux de société, qu'ils se déroulent dans le quartier voisin ou dans un pays en développement ». Comment? « Par l'innovation », évidemment. « Par le courage de l'engagement sincère et solidaire. » Je souligne à double trait : « courage » et « engagement »… On nous dit même que ses « leaders oseront transformer la société ». On oublie (ou évite?) de dire dans quelle direction cette transformation se fera (en faveur du privé ou du public?) mais en entendant un tel appel, quelle personne passionnée de recherche et soucieuse d’engagement social ne répondrait pas à l’invitation? En étudiant, par exemple, la controverse dans le quartier Limoilou concernant la poussière métallique générée par le port de Québec5. Ou encore, en analysant comme Marie-Ève Maillé, une projet de développement économique controversé qui a déchiré le tissu social d’une communauté jusque-là paisible... Plus impliqué que cela tu meurs (pour reprendre le ton qu'adopte l'auteure dans son récit).
Le hic, c’est que « les bottines ne suivent pas toujours les babines » et que nos « grandes » institutions se défilent trop souvent aussitôt que ces beaux et nobles principes sont attaqués par des organisations (souvent puissantes) qui n’ont d’intérêt que pour leurs intérêts et pour qui les principes d’éthique et d’équité du monde scientifique et universitaire ne sont qu’un obstacle à éliminer. Ainsi, en 2012, les deux chercheuses de l’Université d’Ottawa se sont fait dire par leur institution de se débrouiller, tout comme avant elles Nancy Olivieri (encore une femme…) qui avait été lâchée par l’Université de Toronto, à la fin des années 1990, face aux poursuites dont elle faisait l’objet pour avoir dénoncé les dangers d’un médicament6. Sachant que la société pharmaceutique en question négociait alors une généreuse contribution au fonds de dotation de l’université, on comprend plus facilement le choix de la direction…
Dans tous ces cas, c’est finalement l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) qui est montée au créneau pour assurer la défense des chercheuses. Bien sûr, à la suite de pressions et surtout de dénonciations publiques dans les grands médias – une publicité qui ne pouvait qu’affecter négativement l’« image » de ces institutions frileuses –, les universités ont fini par se ranger du côté de leurs professeures. De ce point de vue, l’histoire racontée par Marie-Ève Maillé prend des airs de déjà-vu. Et je pourrais moi-même en raconter d’autres si l’espace le permettait7…
En conclusion de son récit, l'auteure dit redouter le jour où, « devenues de plus en plus frileuses, nos institutions universitaires perdront complètement de vue que leur mission première est de produire et de transmettre la connaissance, et non de protéger leur image comme si elle n’était qu’un produit de marketing ». J’ai bien peur de devoir lui dire ici que cette phrase ne peut plus s’écrire au futur, car c’est déjà le présent et même le passé depuis au moins une décennie. Nombreux sont en effet les exemples qui prouvent que la priorité des universités est bien « de protéger leur image comme si elle n’était qu’un produit de marketing ». Et ce, pour ne pas déplaire aux « donateurs » généreux (mais pas désintéressés) qui acceptent de déposer leur « dons » dans les goussets des universités – les guillemets s’imposent ici car ces dons, ne l’oublions pas, sont déductibles d’impôt et donc en partie payés par les fonds publics8.
[...] l'auteure dit redouter le jour où, "devenues de plus en plus frileuses, nos institutions universitaires perdront complètement de vue que leur mission première est de produire et de transmettre la connaissance, et non de protéger leur image comme si elle n’était qu’un produit de marketing".
Mais en bonne dialectique, et au lieu de simplement se désoler, on peut tirer parti de cette obsession de l’image. Comme la réputation semble primer tout, et que ce qui peut l’affecter doit se négocier loin des feux de la rampe, il faut jeter le maximum de lumière sur le manque de courage de dirigeantes et dirigeants – de moins en moins recrutés parmi les chercheuses et chercheurs – qui courbent l’échine lorsque confrontés à une attaque contre l’autonomie de la recherche. Mais pour cela, il faut aussi une bonne dose de courage, car le risque est grand de subir des représailles, souvent subtiles, bien sûr, le monde universitaire étant fort en matière de rhétorique mise en forme par une panoplie d’avocats, de « communicateurs » et autres « faiseurs d’image ». Comme l’écrit Robert Musil dans son essai sur la bêtise, « il n'y a qu'une différence de degré entre l'oppression et l'interdiction, d'une part, et les doctorats honorifiques, les nominations académiques et les remises de prix d'autre part9 ». Mais si les hochets de la vanité peuvent contribuer à acheter le silence, il n’en demeure pas moins qu’on peut aussi malmener les « lanceurs d’alerte » en faisant tout pour miner leur crédibilité.
Le récit de Marie-Ève Maillé est bien sûr très personnel mais en même temps représentatif du contexte actuel de la recherche. Il est en effet de plus en plus fréquent de voir des résultats de recherche contestés avec acharnement par des groupes qui voient leurs discours, leurs pratiques, leurs « convictions » ou leurs idéologies remis en question par des travaux fondés sur des données et des méthodes d’analyse rigoureuses. Incapables de répondre par les mêmes armes, ils choisissent l’attaque personnelle, la rhétorique morale du « respect » et de la « loyauté » et même, pour miner la crédibilité des messagers, les insinuations à leur égard. Ici, il s'agit d'une société qui vend des éoliennes, mais demain ce pourraient être – et ce seront – des groupes qui mettront en cause des sciences entières au nom de leur « culture » et de leur « savoir spécifique», sans que leurs « méthodes » ne soient partageables, comme l’exige la vraie science, qui est collective et qui vise l’universel et non les particularismes.
Cet ouvrage, bref et vivant, devrait être lu d’abord et avant tout par tous ceux et celles qui envisagent d’occuper un poste de direction dans le domaine de la recherche scientifique, toutes disciplines confondues. Il leur rappellera que leur premier rôle est d’être le chien de garde de la liberté de recherche, c’est-à-dire du droit de poser toutes les questions possibles, sans tabou ni censure et, surtout, d'en assumer les conclusions, même les plus déplaisantes, quand elles sont robustes. Comme le disait le grand sociologue Max Weber en 1917, la première tâche d’un enseignant « est d’apprendre à ses élèves à reconnaître des faits désagréables, des faits, je veux dire, qui sont désagréables pour sa propre opinion partisane10 ». Ce qui est vrai des enseignants l’est aussi des chercheurs. Un siècle après Weber, il faut cependant ajouter à cet impératif celui de défendre avec courage ses résultats de recherche dans un monde de plus en plus hostile à la raison quand celle-ci s’oppose frontalement aux intérêts d’individus et de groupes devenus la mesure de toute chose.
Les personnes qui, après avoir refermé ce livre, ne se sentiront pas le courage et l’énergie de Marie-Ève Maillé et des autres chercheuses qui, avant elle et comme elle, ont su défendre leurs idéaux de scientifiques au prix de leur santé physique et mentale (mais aussi – heureusement – grâce à de nombreux appuis) devraient éviter de briguer des postes de direction d’institutions vouées à la recherche, ou si elles sont déjà en poste, avoir au moins la décence de s’abstenir de promouvoir en public des principes qu’elles n’auront pas le courage de défendre jusqu’au bout.
Le récit de Marie-Ève Maillé est bien sûr très personnel mais en même temps représentatif du contexte actuel de la recherche. Il est en effet de plus en plus fréquent de voir des résultats de recherche contestés avec acharnement par des groupes qui voient leurs discours, leurs pratiques, leurs « convictions » ou leurs idéologies remis en question par des travaux fondés sur des données et des méthodes d’analyse rigoureuses.
Note de la rédaction : Les textes publiés et les opinions exprimées dans Découvrir n’engagent que les auteurs, et ne représentent pas nécessairement les positions de l’Acfas.
- 1David Lodge, Un tout petit monde, traduction de Maurice et Yvonne Couturier, Paris, Rivages 1992.
- 2André C. Drainville, Carnets jaunes de Valérien Francoeur, qui a crevé quelques enflés, Montréal, L'Effet pourpre, 2002.
- 3Voir par exemple Bryan Miles, « Tensions à l'Université Laval. L'enquête sur le professeur et romancier a débuté en février », Le Devoir, 14 mai 2003.
- 4Clarisse Buono, Félicitations du jury, Paris, Privé, 2007.
- 5Chantal Pouliot, Quand les citoyens.ne.s soulèvent la poussière. La controverse autour de la poussière métallique à Limoilou, Montréal, Carte Blanche, 2015. Voir aussi le documentaire des frères Jonathan et Jean-Laurence Seaborn, Bras de fer (Spira, 2017, 77 min.), primé au Festival international du film des droits de l’homme de Paris: <www.spira.quebec/film/231-bras-de-fer.html>.
- 6Marie-Ève Maheu, « Sciences et démocratie. Pour qui, la recherche? », Le Devoir, 25 avril 2009.
- 7Pour un exemple récent de conflits générés par les relations universités-industries et la promotion « innovatrice » des « chercheurs-entrepreneurs », voir Céline Gobert, « Il devra payer plus de 11 M$ à l’Université Laval et au CHU », Droit-Inc.com, 31 mai 2018, <www.droit-inc.com/article22623-Il-devra-payer-plus-de-11-M-a-l-Universite-Laval-et-au-CHU> (consulté le 25 juillet 2018).
- 8 Pour ceux et celles qui doutent encore du pouvoir des « donateurs », rappelons la controverse récente entourant l’octroi d’un doctorat honoris causa à David Suzuki par l’Université de l’Alberta: au printemps 2018, les médias ont rapporté qu’un cabinet d’avocats de Calgary avait annoncé en représailles qu'il mettait fin à son engagement de verser 100 000 $ par année à la faculté de droit de cette université...
- 9Robert Musil, De la bêtise, Paris, Allia, 2015 [1937], p. 8. Je suggère fortement d’ajouter à cette lecture celle de l’essai d’Armand Farrachi, Le triomphe de la bêtise, Arles, Actes Sud, 2018.
- 10Max Weber, Le savant et le politique, traduction de Catherine Colliot-Thélène, Paris, La Découverte, 2003, p. 96.
- Yves Gingras
Université du Québec à Montréal
Yves Gingras est professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 1986. Sociologue et historien des sciences, il est aujourd’hui directeur scientifique l’Observatoire des sciences et des technologies et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences.?
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre