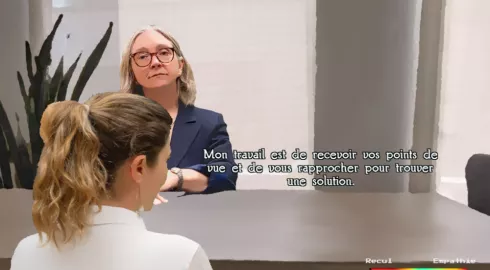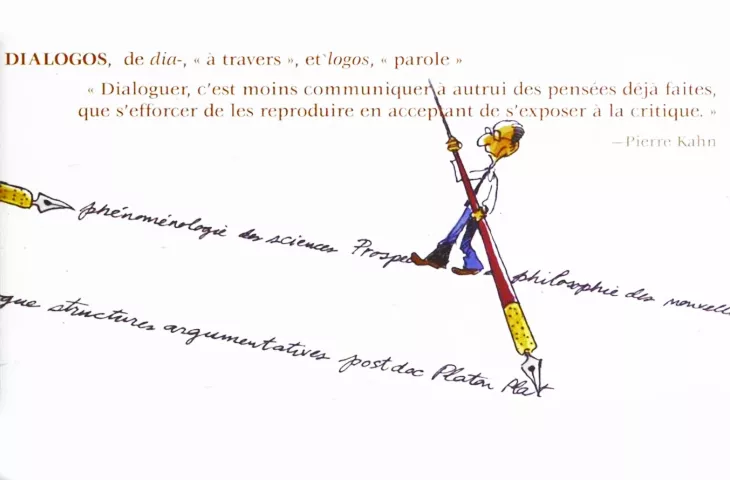C’est parce qu’il aimait contempler les roses de la Brenta au point d’en faire son épitaphe que l’écrivain Heinrich Heine souhaitait embrasser tout l’univers : « À la voûte azurée du ciel, où scintillent les belles étoiles, je voudrais coller mes lèvres dans un ardent baiser. » Le désir est le moteur de tout apprentissage. Que l’on veuille devenir un jour poète ou scientifique n’y change rien.

[Article produit dans le cadre du colloque 54 du Congrès de l'Acfas 2013 - Libido sciendi ou variations sur le désir de connaître]
Je ne comprenais rien aux maths
Je ne comprenais rien aux maths. Mes parents non plus. Pourtant, ils avaient l’habitude des soustractions. Chaque fin de mois nous rapprochait du zéro. Avant même de connaître l’existence des nombres négatifs, je savais que la température d’une société pouvait chuter, selon le revenu par habitant, sous le seuil de l’imaginable. J’apprenais malgré moi que la misère fait descendre l’espoir plus bas que le point de congélation. Plus rien ne bouge, on sombre dans l’attente d’un miracle qui ne vient jamais.
À la maison, un seul livre, coupé en deux, la première moitié d’un Petit Larousse, l’autre moitié étant portée disparue depuis belle lurette, comme si les pages roses des expressions latines représentaient l’étape ultime de notre apprentissage catholique et bien-pensant: O tempora! O mores! Au milieu des années soixante, dans la plupart des écoles primaires de mon coin de pays, Rome était encore la Ville éternelle. Et la prière, notre quête de l’infini.
Objectif Imagination
À la bibliothèque de l’école, je devais avoir sept ou huit ans, j’allais faire une rencontre déterminante. Un jeune reporter, à la houppe célèbre, m’ouvrait toutes grandes les portes de l’imagination : Tintin, Objectif Lune. J’éprouvais enfin la joie d’échapper un temps à l’inertie du quartier, qui envahissait les salles de classe comme les modestes habitations où nous vivions tous à l’étroit. Mon plus jeune frère et moi dormions dans le salon sur un canapé-lit transformable, j’apprenais mes leçons sur la table de la cuisine, alors que la radio faisait tourner les succès de l’heure et que les vêtements à sécher pendaient au beau milieu de la pièce, laissant tomber plein de gouttes sur du papier journal répandu sur le plancher comme un destin trace sa route. Mais une fois mes devoirs terminés, je me penchais, avec le professeur Tournesol, sur les plans d’une fusée spatiale. Je participais à cette folle aventure qui allait permettre sous peu à Neil Armstrong de mettre le pied sur la Lune et de prononcer une petite phrase qui devrait toujours guider la marche du progrès : That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind. On pouvait donc faire des choses pour l’humanité.
De nombreuses années plus tard, je lirais Norman Mailer, Bivouac sur la Lune, plus de 500 pages sur la mission Apollo XI. J’en retiendrais ceci, où Mailer compare les astronautes à des athlètes professionnels : « […] ils avaient la modestie de savoir qu’on pouvait être bon et perdre quand même1. » Ce danger de l’échec, on le retrouve dans une série télévisée qui aura illuminé mon enfance : Star Trek. Dans un épisode inoubliable, alors que plusieurs officiers craignent d’accueillir à bord de l’Enterprise d’étranges sphères qui pourraient se révéler périlleuses, le capitaine Kirk plaide en faveur des impératifs du savoir et de la recherche, il rallie ses officiers en évoquant le sens même de leur mission spatiale : Risk is our business2 . (Notre business : la défense d’une société basée sur la connaissance. Soit une lutte à mort, contre les préjugés, l’étroitesse d’esprit, l’absence de remise en question).
Après les torpilles à photons de Star Trek, je suis passé au Gun Club de Jules Verne. En lisant De la Terre à la Lune, je notais que les explorateurs du cosmos se nourrissaient de la même obsession, résumée par l’aventurier Michel Ardan : « Aussi, dans ma parfaite ignorance des grandes lois qui régissent l’univers, je me borne à répondre : Je ne sais pas si les mondes sont habités, et, comme je ne le sais pas, je vais y voir ! » La curiosité, le goût du risque, la détermination, autant de vertus pour quiconque rêve de partir à la découverte d’un univers aussi fascinant qu’énigmatique.
Mon contact avec les sciences s’est noué grâce à la fiction. J’en arrive d’ailleurs à croire avec Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien et essayiste français, qu’il « n’est pas interdit de penser qu’une meilleure fréquentation de la fiction littéraire pourrait assouplir et développer l’imagination scientifique (c’est ici que la science-fiction peut jouer un certain rôle)3. » Tintin, le capitaine Kirk et Michel Ardan auront formé, pour l’enfant que j’étais, la trinité d’un nouveau catéchisme.
La connaissance à l’air libre
J’étais amoureux de l’espace, mais il fallait vivre sur terre. Première secondaire, un cours d’écologie. Nouvelle matière à l’étude : les sciences naturelles. Avant chacune de nos arrivées en classe, un instituteur dont le moindre geste trahissait l’habitude de l’ennui blanchissait le tableau vert avec questions et réponses que l’on devait retranscrire dans nos cahiers sans dire un seul mot, ayant comme musique d’ambiance les pages d’un journal que le maître tournait avec un bruit sec qui nous sortait à peine quelques secondes d’une torpeur imposée. J’avais du mal à croire que l’écologie était la science du vivant. J’attendais un signe. Une bactérie est venue à ma rescousse. Le maître avait mal au ventre. Un suppléant allait nous donner du cœur à l’ouvrage.
Au lieu de sortir nos cahiers, nous sommes tous allés dehors. Nous devions ramasser des feuilles, puis identifier les arbres d’où elles étaient tombées. L’observation était de mise. La feuille était-elle dentée, lobée ou entière? Provenait-elle d’un frêne, d’un chêne ou d’un tilleul? Autour de nous, plein de questions; dans nos mains, les réponses. Nous avions le monde sous les yeux. Un monde que l’on devait apprendre à nommer, à classer, à reconnaître. Un monde que l’on aimait voir s’épanouir à l’air libre. Un monde tenu au loin par une craie traçant la frontière entre le goût du savoir et l’obstination à ne rien enseigner. Le maître est revenu. Il était guéri. Le tableau vert redevenait tout blanc. Et la science, toute noire. Dans nos yeux, une lumière s’éteignait. C’est à la petite école que naissent les grandes occasions. Et les instituteurs ne sont des maîtres que s’ils acceptent de ne pas être des tire-au-flanc.
Relire Rostand pour son enthousiasme
Deux ou trois années plus tard, au milieu de mon adolescence, alors que la télévision de Radio-Canada rediffusait Le sel de la semaine, j’ai retrouvé la joie du vivant grâce aux bons soins de Fernand Seguin, biochimiste et animateur de la célèbre émission. Il avait eu l’heureuse idée d’interviewer le biologiste Jean Rostand. C’était à une époque où l’on pouvait encore faire de la science chez soi, dans un laboratoire privé, à l’aide des grenouilles d’un étang situé derrière la maison du chercheur. Le vieil homme aux épaisses lunettes noires avait l’œil aiguisé des traqueurs de sens. Il avait aussi cette sagesse narquoise que l’on prête aux paysans qui attendent la mort comme le dernier coup dur de la vie. Il parlait de sa « fougue sénile », que Seguin traduisit ainsi : « Il aurait pu être un merveilleux professeur, un propagateur d’enthousiasme4. »
Le mot est lâché : enthousiasme. Du grec enthousiasmós, « possession ou transport divin ». Je n’ai jamais compris que dans la formation des maîtres n’entrent pas de façon claire et précise l’amour du savoir et le besoin d’en répandre les fruits. On se perd dans toutes sortes de joutes verbales qui s’apparentent aux controverses de jadis sur le sexe des anges. Le jargon méprise la langue commune. Et finit par mépriser une profession où le souci de bien parler et de bien écrire devrait être indispensable. Dès que j’ouvre n’importe quel livre de Jean Rostand, je vois d’abord l’expression d’une culture. D’un art de vivre en français. J’y vois également une éthique de la science : « Recherche : partir de ce qu’on croit savoir, et tirer sur le fil en souhaitant qu’il se brise… 5». Aucun fil ne se brise dans la tête de ceux qui prétendent avoir trouvé. Jamais ils n’auront la force de conclure avec Fontenelle que l’être humain devient « moins capable d’erreur dès qu’il sait à quel point il l’est6 ». Rostand n’est pas lu dans nos facultés des sciences de l’éducation. Ni Fontenelle. On oublie que pour rendre le savoir vivifiant, il faut une langue vivante.
Tristes mathématiques
Au collégial, je me suis éloigné des sciences à cause des mathématiques. Je les maîtrisais mal. On me donnait à savoir, sans me donner à comprendre. Or il existe une grammaire des mathématiques tout comme il existe une grammaire du français. Cette grammaire repose sur des notions et des règles fondamentales que l’on doit saisir dès le plus jeune âge. D’autant plus que ces notions et règles sont abstraites et doivent être apprivoisées sur une longue période de temps.
La mathématicienne et chercheuse en pédagogie Stella Baruk nous parle même d’une autre réalité, celle des mathématiques, comme étant « [c]ette réalité du savoir, cette consistance d’une matière invisible aux yeux du corps, mais, comme dirait Montucla [auteur d’une Histoire des mathématiques en 1758], seulement visible à ceux de l’esprit7 », une réalité à laquelle les enfants demeurent sensibles « à travers les étonnements, ébahissements et parfois scandales intellectuels, source de plaisirs et même de bonheurs peut-être tout aussi intenses que ceux des mathématiciens8. » La science, ce n’est pas uniquement ce que l’on voit, c’est aussi ce que l’on ne voit pas. Ce que l’on ne verra jamais. Les mathématiques procurent du bonheur à ceux et celles qui en maîtrisent le langage. Et qui ont accès à cette autre réalité dont parle Stella Baruk. Pour les autres, les mathématiques à l’école se comparent à des instruments de torture avec lesquels on châtie l’ignorant au lieu de l’instruire.
Je me souviens de ces heures pénibles où, adolescent puis jeune adulte, j’essayais de comprendre tout seul ce qu’aucun maître ne semblait vouloir me faire comprendre. Mes parents ne pouvant être d’aucun secours, leurs études ayant pris fin un peu après le primaire, j’apprenais par cœur de longues démonstrations mathématiques auxquelles on ne devait jamais changer la moindre variable pour que j’obtienne des résultats pas trop médiocres. Je songe aujourd’hui à ces deux étudiants de science qui suivaient il y a peu un de mes cours de littérature : le père de l’un est physicien et chercheur, alors que celui de l’autre n’a pas terminé ses études secondaires; bizarrement, ces deux étudiants n’avaient pas et n’ont toujours pas les mêmes aptitudes en mathématiques... Et quand on sait le rôle joué par les mathématiques dans les sciences en général, priver quelqu’un d’une bonne connaissance des mathématiques, c’est tôt ou tard le priver des sciences. Parce que les chances ne sont pas les mêmes pour tous, l’école doit être une chance pour chacun. Le plus tôt sera le mieux.
Créer un environnement rassurant pour l’amygdale
La neurobiologiste Catherine Vidal rappelle que, sans surprise, « de nombreuses études ont montré que des enfants adoptés à la naissance et élevés dans un milieu favorisé obtiennent de meilleurs scores aux tests de QI que des enfants élevés dans un milieu défavorisé9 ». Elle précise toutefois que « [r]ien n’est inéluctable. […] D’où l’importance des programmes éducatifs de rattrapage et de soutien scolaire pour aider les enfants en difficulté10. »
Marc Jeannerod, directeur de l’Institut des sciences cognitives, souligne que « [d]ans le cadre du codage génétique, il existe un vaste espace indéterminé […]. Chez le singe macaque, le poids du cerveau à la naissance atteint 75 % de son poids à l’âge adulte. Chez l’humain, en revanche, le poids du cerveau à la naissance ne représente que 30 % de son poids adulte. L’avantage de cette situation est que la poursuite du développement du cerveau humain se fait à l’air libre, au contact des stimulations du monde extérieur11. »
Par l’observation et l’imitation des autres, et en particulier des adultes qui l’entourent, l’enfant apprivoise le monde. Il en découle, constate le biologiste et neuroscientifique John Medina, « que notre capacité d’apprentissage a une origine profondément relationnelle. Dans ce cas, nos performances dans ce domaine dépendent étroitement de l’environnement émotionnel de l’apprentissage. La qualité de l’enseignement dépend en partie de la relation entre l’apprenant et l’enseignant12. »
Dans son Voyage au-delà de mon cerveau, la neuro-anatomiste Jill Bolte Taylor, victime d’un accident cérébral dont le récit est troublant, insiste sur le fait que « [notre] système limbique colore d’un état affectif particulier les informations que nous transmettent nos sens »; c’est pourquoi elle préconise de « créer dans les salles de classe un environnement rassurant et familier dans lequel l’amygdale [structure du cerveau agissant comme un système d’alerte] ne déclenchera aucune réaction de peur ni de colère. Le rôle de l’amygdale consiste à passer en revue les stimuli extérieurs qui lui parviennent en permanence afin de déterminer le niveau de sécurité de la situation présente. […] Quand les stimuli extérieurs ne présentent aucune anomalie, l’amygdale n’a aucune raison de s’affoler. L’hippocampe voisine [laquelle joue un rôle primordial dans la mémorisation] emmagasine alors de nouvelles connaissances sans trop de difficultés. Toutefois, dès que des stimuli inhabituels ou menaçants parviennent à notre amygdale, notre anxiété augmente et nous ne pensons plus qu’à nous protéger, au détriment des facultés de mémorisation de notre hippocampe13. »
Les professeurs tyranniques ou insouciants, les cours inutilement stressants ou mal structurés, les consignes obscures ou les examens trop ardus nuisent à l’apprentissage. L’élève a besoin d’être un tant soit peu rassuré. Il développe ainsi un sentiment de compétence qui lui permettra d’affronter ensuite des apprentissages plus difficiles. Il acceptera alors plus aisément une certaine période de vulnérabilité, qu'il considérera inhérente à toute quête de savoir. Pendant cette période, Daniel Favre, docteur en neurosciences et professeur en sciences de l’éducation à l’IUFM de Montpellier, suggère aux enseignants d’inviter « les élèves à préciser leur pensée, à faire des hypothèses, à se tromper, recommencer, tâtonner, utiliser les erreurs comme des informations pertinentes. De cette façon, l’abandon des idées préalables n’est plus vécu comme angoissant, mais comme un moyen de progresser14. »
Or la science exige un tel effort de la pensée que les encouragements doivent être aussi chaleureux et constants que ceux prononcés à l’endroit des jeunes athlètes. L’endurance n’est pas qu’une attitude sportive, elle reste indispensable à l’apprentissage des sciences. Encore faut-il qu’auprès des jeunes les sciences jouissent d’un statut aussi enviable que celui des sports. Il y a les dieux du stade, quand parlerons-nous des dieux du laboratoire? Mais lorsque tant de jeunes, remarque le physicien Étienne Klein, « se destinent de moins en moins aux études scientifiques », on est en droit de poser les questions suivantes : « La libido sciendi aurait-elle pris la tangente? Ou bien serait-ce que la science, au lieu d’être présentée comme une authentique aventure intellectuelle, avec son histoire, ses héros, ses problèmes, ses méthodes, est enseignée comme un simple savoir-faire, une suite plate de résolutions d’exercices, une friche morte où pâturent des équations sans âme15? » Platon, rappelle Edgar Morin, disait déjà que « pour enseigner, il faut de l’éros16. » Un savoir devient répulsif à force d’être incarné par des professeurs repoussants.
À chaque savoir, son langage
J’ai cité de nombreux auteurs en neurosciences pour la simple raison qu’il m’apparaît étonnant que dans les écoles, les collèges, et jusqu’à l’université, l’on ignore à ce point les recherches scientifiques dans ce domaine. Encore récemment, alors que fait toujours rage en éducation ce débat entre les connaissances ou les compétences, je crois plutôt qu’un « et » serait de mise; plusieurs études de psychologie cognitive mettent en lumière que les connaissances encyclopédiques augmentent les chances de succès à l’école « et sous-tendent les capacités de raisonnement, y compris en mathématiques17. » D’où l’importance des mots, des concepts, des structures de la pensée dans tout apprentissage. Racine ou Anne Hébert sont « plates » pour quiconque ne dispose pas d’un langage suffisant. Il en est de même pour les mathématiques, pour la physique, pour la chimie, pour toutes les sciences, puisque là aussi s’impose une bonne maîtrise du langage propre à une discipline, sinon toute science devient « plate ».
Donnez-leur l’exemple, encouragez-les
Sébastien Bohler, responsable d’un dossier publié dans Cerveau & Psycho sur la motivation des élèves, note avec justesse que « les neurosciences nous apprennent que nous sommes biologiquement faits pour apprendre, qu’apprendre procure du plaisir (sous forme de dopamine) […]18. » Ce que souligne à son tour Roland Jouvent, professeur de psychiatrie et directeur du Centre Émotion du CNRS à la Salpêtrière : « La dopamine, neurotransmetteur initialement associé aux comportements moteurs de satisfaction [à titre d’exemple, faire de l’exercice augmente le taux de dopamine, la « molécule du plaisir »], est ainsi devenue progressivement [avec l’évolution de l’espèce humaine] en charge des comportements de découverte, de curiosité à l’égard de l’environnement, de désir19. » C’est ici que pour l’élève des exercices intellectuels sont nécessaires, tout comme sont nécessaires pour l’athlète des exercices physiques. Il faut cependant accepter que le plaisir ne sera pas un point de départ, mais plutôt le résultat d’un effort continu. La dopamine n’arrive pas dans l’immédiat. Elle a son rythme. Elle doit être désirée.
Diderot, le père de l’Encyclopédie, disait en son temps que « c’est du désir que naît la volonté ». C’est pourquoi, aujourd’hui encore, ce désir d’apprendre, d’être curieux, de découvrir, doit être constamment nourri. Surtout dans cette période charnière qu’est l’adolescence. Un âge où se forge la personnalité, un âge où le cerveau prend peu à peu sa forme définitive. Mais attention à l’élagage. Jean-Pierre Bourgeois, de l'Institut Pasteur, rappelle que « [j]usqu’au début de la puberté, la densité de synapses [les connexions entre neurones] est maintenue à son niveau le plus élevé. Jamais l’individu ne possédera autant de synapses. À partir de la puberté, commence le grand élagage », que Bourgeois appelle la « cata-synaptique pubertaire ». Le cerveau se débarrasse alors des connexions qui ne semblent plus utiles à son développement ou à son adaptation au milieu. Et Bourgeois de conclure : « Durant cette phase très plastique, les meilleures choses à apporter à l’adolescent, ce sont des interactions riches avec un environnement sensoriel et socioculturel structuré et largement ouvert à l’altérité20. »
Le poète et essayiste québécois David Solway, longtemps professeur de littérature anglaise au collégial, insiste pour dire que « [d]evant l’insuffisance de lectures, de conversations, d’études dirigées, ‘d’étrangers cultivés’ à notre table (pour citer l’universitaire américain E.D. Hirsch), pouvons-nous vraiment nous surprendre du manque de vigueur verbale et de force intellectuelle qui freine les progrès de nos jeunes? La disette favorise rarement la bonne santé et la vitalité21. » Moins on entraîne les élèves vers le haut, plus on les tire vers le bas.
Dans mes cours, j’entends faire respecter la devise de tout apprentissage : une coche au-dessus. Faire de son mieux afin d’éviter le n’importe quoi. L’autorité en classe signifie aider les élèves à s’élever au-dessus d’eux-mêmes. La plupart ne savent pas qu’ils sont capables de plus. La tâche d’un professeur consiste à leur en faire prendre conscience. Mais pour cela un professeur doit avoir à l’esprit qu’étudier nécessite des efforts et qu’apprendre exige des encouragements. Tout comme l’art de gouverner, j’aimerais dire que l’art d’enseigner se résume à ces quelques lignes tirées des Entretiens de Confucius : XIII. 1. Zilu interrogea Confucius sur l’art de gouverner. Le Maître dit : « Donnez-leur l’exemple, encouragez-les. » Zilu lui demanda de développer. Il dit : « Sans relâche22.»
En troisième année du primaire, l’institutrice nous avait fait écouter en classe Le Petit Prince, enregistré par Gérard Philipe : « C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » Enseigner, c’est cultiver un esprit; apprendre, c’est fleurir.
Références :
- 1. MAILER, Norman. Bivouac sur la lune, traduit de l’américain par Jean Rosenthal, Paris, Robert Laffont, 1971, p. 35.
- 2. Risk is our business
- 3. LÉVY-LEBLOND, Jean-Marc. La science en mal de culture. Paris, Futuribles, Perspectives, 2004, p.57.
- 4. SEGUIN, Fernand. Fernand Seguin rencontre Jean Rostand. Montréal, les Éditions de l’Homme Ltée, 1969, p.27.
- 5. ROSTAND, Jean. Carnet d’un biologiste, Paris, Stock, Le Livre de poche, 1971, p.56.
- 6. ROSTAND, Jean. Hommes de vérité, Paris, Stock, 1968, p.60.
- 7. BARUK, Stella. Dictionnaire de mathématiques élémentaires, Paris, Seuil, 1992, p.13.
- 8. Ibid.
- 9. VIDAL, Catherine. Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie? Paris, Le Pommier, collection Les Petites Pommes du Savoir, 2009, p.1
- 10. Ibid.
- 11. JEANNEROD, Marc. Le cerveau intime, Paris, Odile Jacob, 2002, p.20
- 12. MEDINA, John. Les 12 lois du cerveau, Paris, LEDUC.S Éditions, 2010, p.57
- 13. BOLTE TAYLOR, Jill. Voyage au-delà de mon cerveau, Paris, éditions Jean-Claude Lattès, 2008, p.29-30
- 14. FAVRE, Daniel. Les neurosciences inspirent l’enseignement, magazine Cerveau & Psycho, collection l’Essentiel, no 11, août-octobre 2012, p.44
- 15. KLEIN, Étienne. Galilée et les Indiens, Paris, Flammarion, Café Voltaire, 2008, p.11
- 16. MORIN, Edgar. Dialogue sur la connaissance, entretiens avec des lycéens, Éditions de l’Aube, 2011, p.28
- 17. À titre d’exemple : LIEURY, Alain. La mémoire, du cerveau à l’école, Paris, Flammarion, collection Dominos, 1993, p. 96-103, « Des mots pour réussir ». Plus récemment : LIEURY, Alain. FENOUILLET, Fabien. « Les racines de la démotivation », Cerveau & Psycho, L’Essentiel, no 11, août – octobre 2012, p.66-69.
- 18. BOHLER, Sébastien. Pourquoi apprendre? Cerveau & Psycho – no 41, septembre-octobre 2010, dossier « Comment motiver les élèves? Ce que l’étude du cerveau apporte aux sciences de l’éducation », p.40
- 19. JOUVENT, Roland. Le cerveau magicien, de la réalité au plaisir psychique, Paris, Odile Jacob, 2009, p.102
- 20. Sciences et Avenir, dossier « Les 5 âges du cerveau », février 2010, p.52
- 21. SOLWAY, David. Le bon prof, Essais sur l’éducation, Montréal, Bellarmin, 2008, p.153
- 22. Les Entretiens de Confucius, traduction du chinois, introduction et notes par Pierre Ryckmans, Paris, Gallimard, Folio 2€, 2008, p.75
- Christian Bouchard
Collège Laflèche
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre