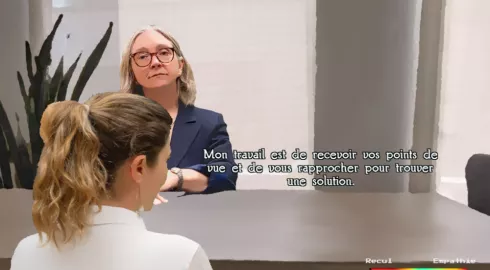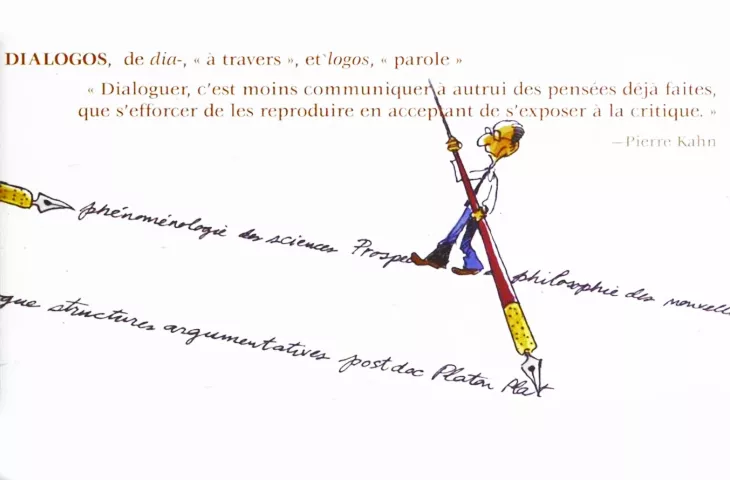En France comme au Québec, plusieurs chercheurs jugent qu’ils consacrent davantage de temps à chercher du financement qu’à effectuer leurs recherches.

Dans le contexte d’économie moribonde à l’intérieur duquel nous vivons depuis quelques années, on ne cesse d’entendre que « l’économie du savoir » constitue l’avenir des pays occidentaux sur l’échiquier mondialisé. Pourtant, il semble que partout les universités traversent des crises intellectuelles et financières importantes, et que leurs rôles et leurs façons de les remplir soulèvent des questions.
De passage en France pour quelques mois dans le cadre de ma cotutelle de thèse, force m’est de constater que, tant au Québec qu’ici, les universités sont plongées dans la tourmente. Dans les deux cas, l’une des premières actions politiques des gouvernements de centre gauche nouvellement élus (Parti socialiste et Parti québécois) a été de mettre sur pied un large processus de consultations publiques sur l’avenir des universités, les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche en France et le Sommet sur l’enseignement supérieur au Québec. Tour d’horizon des controverses en cours des deux côtés de l’Atlantique.
Des difficultés financières des universités à la critique généralisée de leur administration défaillante
Nul ne sera surpris d’apprendre qu’au Québec comme en France, le budget des établissements d’enseignement supérieur se trouve dans un piteux état, de nombreuses universités de part et d’autre affichant des déficits. Autre point en commun, les deux principaux argumentaires formulés à partir de ce constat : la question de l’augmentation des frais de scolarité et la mauvaise gestion qui caractérise les universités.
Les précédents gouvernements au pouvoir au Québec et en France avaient signalé comme un problème dérangeant le manque de transparence, de reddition de comptes et d’indicateurs de performance des universités, et avaient choisi comme solution l’introduction dans leur administration de principes de gestion inspirés du nouveau management public. En France, cela s’est traduit notamment par l’adoption en 2007 de la Loi sur la liberté et les responsabilités des universités, tandis qu’au Québec le gouvernement Charest a déposé en 2008 le projet de loi sur la gouvernance des universités. Plus récemment, les leaders étudiants québécois ont suggéré à plusieurs reprises lors du printemps 2012 que le problème des universités ne résidait pas dans leur manque de financement, mais dans leurs mauvaises décisions budgétaires (notamment sur la question des campus dits satellites).
À droite comme à gauche, un consensus semble émerger sur l’administration déficiente des universités. En revanche, plusieurs défendent les principes distinctifs de la gestion universitaire, dont l’autonomie et la collégialité forment les pierres angulaires depuis le Moyen-Âge. Le contexte contemporain aura-t-il raison de ces principes?
La quête effrénée du financement : heurs et malheurs de la recherche
Le manque récurrent de ressources financières et l’augmentation limitée (jusqu’à présent) des frais de scolarité ont eu pour effet d’entraîner une valorisation considérable de la recherche. Des établissements d’enseignement qu’elles étaient d’abord prioritairement, les universités se sont présentées de plus en plus au fil des ans comme des institutions de recherche. Les subventions de recherche et les brevets intellectuels se révèlent pour elles une source de financement non négligeable, laquelle peut, de plus, être augmentée selon la « performance » des chercheurs.
De façon paradoxale, ce mouvement de valorisation de la recherche provoque des effets pervers sur la conduite des universités. Dans le premier bilan dressé à partir de la première ronde de consultation des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, le comité de pilotage rapporte que plusieurs chercheurs critiquent le financement à court terme de la recherche, en total contraste avec le temps long qu’elle exige pour être réalisée avec rigueur. Ainsi, plusieurs jugent qu’ils consacrent davantage de temps à chercher du financement qu’à effectuer leurs recherches. Une situation qui fait écho au monde de la recherche universitaire québécoise.

Une offre de formation mouvante et de plus en plus axée sur ses retombées professionnelles
La situation financière des universités a évidemment des effets sur l’enseignement. D’abord sur l’embauche croissante de chargés d’enseignement contractuels plutôt que de professeurs permanents, ce qui contribue en outre à la précarité institutionnalisée des jeunes chercheurs. Ensuite sur l’offre de formation universitaire, que des intervenants français ont qualifiée de pléthorique. En effet, on assiste au Québec comme en France à une multiplication des programmes offerts, les universités espérant ainsi augmenter leur « clientèle » grâce aux formations de plus en plus spécialisées et personnalisées qu’elles proposent. À l’opposé, d’autres interrogent la pérennité des disciplines à faible effectif. Autrement dit, que faire des programmes « non rentables »?
De manière plus insidieuse, l’enseignement supérieur se métamorphose aussi sous l’effet du désormais impératif de débouchés professionnels que doit assurer un diplôme universitaire. Les étudiants, de plus en plus endettés et confrontés à un marché du travail stagnant, exigent eux-mêmes que leurs études les conduisent à un avenir professionnel meilleur. En regard de quoi les universités adaptent leur formation pour les mettre au diapason des besoins de l’entreprise. De fait, plusieurs insistent sur la nécessité de sensibiliser les étudiants à la culture entrepreneuriale tout au long de leur cursus. Les universités ne deviennent-elles pas du même coup de simples écoles techniques supérieures?
Vers une société de la connaissance ou une économie de la connaissance?
Dans son document d’orientation inaugurant les Assises de l’enseignement supérieur et la recherche, la ministre française affirmait qu’« une société de la connaissance qui décide de ne pas être inféodée à des perspectives économiques à court terme ne choisit pas la même politique scientifique qu’une société qui a opté pour l’économie de la connaissance ». Cela semble juste, mais le contexte plus large dans lequel s’inscrivent les débats entourant les missions, l’administration et le financement des universités, tant au Québec qu’en France, permet de constater que le refus de l’inféodation s’annonce bien ardu.
- Maude Benoit
Université Laval et Université Montpellier 1
Maude Benoit est candidate au doctorat en science politique à l’Université Laval (Québec) et à l’Université Montpellier 1 (France). Ses recherches portent sur les politiques publiques en agriculture au Canada et dans l’Union européenne. Elle s’intéresse plus particulièrement à l’intégration des préoccupations de développement rural et d’environnement dans l’action publique agricole.
Note de la rédaction : Les textes publiés et les opinions exprimées dans Découvrir n’engagent que les auteurs, et ne représentent pas nécessairement les positions de l’Acfas.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre