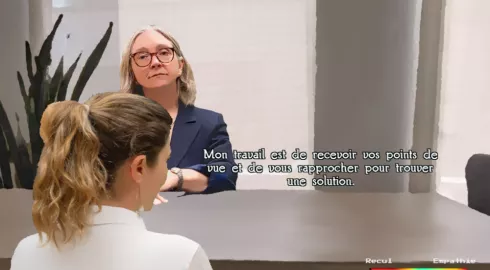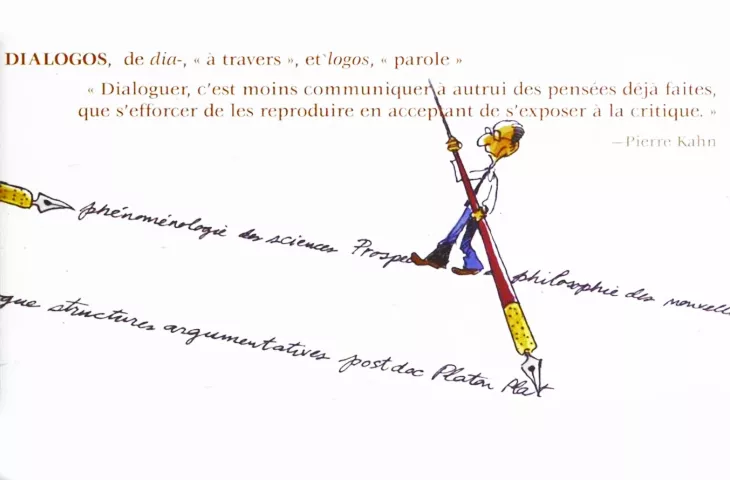La présence de centaines de scientifiques dans le processus d’évaluation est ce qui donne à l'ensemble du système national de recherche, au Canada comme ailleurs, sa crédibilité.
Le gouvernement fédéral a annoncé dans son dernier budget une série de réinvestissements dans le système de recherche canadien, y compris le financement des trois conseils subventionnaires (IRSC, CRSNG, CRSH), des Chaires de recherche du Canada et de Génome Canada. Ce sont là les organismes habituels qui, généralement année après année, reçoivent des fonds fédéraux pour les distribuer aux chercheurs canadiens au moyen d'un système d'examen des demandes par les pairs.
Ces décisions gouvernementales nous offrent l’occasion de voir comment les élus, au nom de la légitimité démocratique, investissent dans le développement scientifique du pays. La présente analyse nous permettra de distinguer deux modes de gouvernement de la science : l’un qui tient compte de la spécificité de la recherche scientifique et l’autre qui, au contraire, transforme le champ scientifique en champ politique.
La république des sciences
Qu'il s'agisse du projet d'un chercheur universitaire ou d’une équipe de scientifiques qui demandent un octroi au CRSNG, au CRSH ou aux IRSC, ou encore, d’un projet d'infrastructure d'une université ou d’un collège soumis à la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), toutes les décisions de ces organismes, autonomes par rapport au gouvernement, passent par des comités d’experts scientifiques qui procèdent à un examen approfondi de la valeur de chaque projet avant de choisir les meilleurs dans un cadre de compétition ouverte basée sur la qualité scientifique et l’originalité. Dans tous les cas, des évaluateurs externes, provenant en général d’autres pays, écrivent (gratuitement!) des rapports pour aider ces comités dans leurs délibérations et prises de décisions.
La présence de centaines de scientifiques au cœur du processus d’évaluation est d’ailleurs ce qui donne à l'ensemble du système national de recherche, au Canada comme ailleurs, sa crédibilité : même les « perdants », qui, une année donnée, se verront refuser leur octroi acceptent généralement le verdict, toujours douloureux. C’est qu’ils savent, souvent pour y avoir siégé déjà, que le comité de sélection a dû faire des choix difficiles parmi de nombreuses idées intéressantes, les ressources disponibles ne permettant jamais de satisfaire à toutes les demandes présentées.
Ce processus d’évaluation par les pairs, fondé sur l’idée centrale d’autonomie de la recherche scientifique, est en fait plus que centenaire : on peut en effet le faire remonter à la création des sociétés savantes au milieu du 17e siècle. Ainsi, lors de l’édition de la première revue scientifique par le secrétaire de la Société royale de Londres, il fut immédiatement décidé que toute publication devrait d’abord être revue par un membre de la Société avant d’être imprimée. On inventait ainsi, sans faire de bruit, « l’évaluation par les pairs ».
Avec l’émergence au 20e siècle de mécanismes d’octrois financiers de plus en plus importants pour soutenir des projets de recherche devenus de plus en plus coûteux, on a naturellement étendu ce mode d’évaluation aux projets eux-mêmes : tout comme pour les publications, ne seront alors retenus que les projets jugés les meilleurs par des comités de scientifiques, eux-mêmes éclairés dans leurs décisions par des évaluateurs externes spécialisés dans le domaine de la demande d’octroi.
Il est important de noter que ce processus d’évaluation qui place la communauté scientifique au cœur du processus de décision se fonde sur l’idée, largement partagée malgré certaines critiques persistantes, que la science est en principe objective et universelle. Car si la sociologie des sciences a depuis longtemps montré que la dynamique réelle du développement scientifique est traversée de conflits, il demeure que la visée d’objectivité constitue un idéal régulateur. On ne peut en somme décider si Einstein a raison ou non ou si tel phénomène existe sur la seule base de ses opinions personnelles ou de ses préférences idéologiques et politiques. De ce point de vue, la science n’est pas démocratique. D’un autre point de vue bien sûr, celui des grandes orientations et des priorités de développement, c’est bien aux élus que revient la décision, prise à la lumière des informations disponibles, de fixer les priorités pour distribuer des ressources financières limitées : un État pourra ainsi miser sur la génomique et les nanotechnologies et y concentrer une partie de ses ressources alors qu’un autre penchera plutôt pour privilégier des recherches sur l’énergie solaire. De telles décisions ne relèvent bien sûr pas de la science proprement dite, mais plutôt de la politique de la recherche qui, au sens large, inclut tant les sciences, les technologies que l’innovation comme visée ultime.
Mais une fois ces grands objectifs définis par les élus, on a toujours tenu pour acquis que les décisions visant les projets de recherche eux-mêmes restaient dans l’orbite des comités scientifiques. Ainsi, après que le gouvernement fédéral a créé en 1996 l’organisme Génome Canada et lui a octroyé des ressources, ce sont des comités scientifiques qui ont choisi parmi les projets soumis par les chercheurs, et non le ministre lui-même ou son personnel. Il est de même pour la FCI, qui finance de son côté des infrastructures de recherche.
Lobbyisme et électoralisme scientifique
Jusqu’au milieu des années 1980 environ, la recherche scientifique était rarement dans le collimateur des politiciens, qui se contentaient encore de couper des rubans de couleur lors de l’inauguration d’une route ou d’un bâtiment. Cependant, depuis l’avènement de la rhétorique de « l’économie du savoir », la « politique politicienne » s’est emparée du monde scientifique et universitaire. Les ministres ne ratent plus une occasion d’émettre un communiqué et d’organiser une conférence de presse pour annoncer, avec la mise en scène appropriée, l’octroi de subventions de recherche ou de bourses et montrer ainsi que le gouvernement investit dans la recherche de pointe. Encore récemment, le 3 août 2011, le premier ministre Stephen Harper annonçait publiquement le nom des 167 lauréats des bourses d’études supérieures du Canada Vanier – jeunes chercheurs, disait-il, « dont les idées contribueront aux percées de demain et maintiendront l’économie du Canada sur la voie de la croissance ». Cette nouvelle logique électoraliste appliquée à l’enseignement supérieur ne pouvait que faire émerger des « lobbyistes universitaires » prêts à tout (ou presque) pour s’attirer les faveurs des élus et leur soutirer quelques millions de dollars. Une telle logique de plus en plus politique du champ universitaire commence d’ailleurs à se refléter dans les choix de la haute direction des établissements (rectorat et vice-rectorat) qui, au Canada, commence à accueillir d’anciens politiciens et autres personnages proches des cercles du pouvoir. Mais cela est une autre histoire.
À côté des décisions habituelles touchant les organismes subventionnaires, dont les octrois assurent la stabilité à long terme du système canadien de la recherche, le dernier budget fédéral fait place dans le contexte canadien à une pratique nouvelle – et plutôt inquiétante – que l’on pourrait appeler « électoralisme universitaire et scientifique ».
Ainsi, beaucoup ont applaudi, d’autres ont ignoré l’annonce que le gouvernement allait octroyer 50 millions de dollars, répartis sur cinq ans, à l'Institut Perimeter de physique théorique, une organisation privée située à Waterloo en Ontario, créée par le fondateur de la firme Research in Motion (qui a mis en marché le fameux Blackberry) et qui se présente curieusement comme un « partenariat public-privé ». Or on devrait faire une pause pour mesurer toute l'importance de cette décision, qui vient appuyer des recherches dans un domaine pourtant ésotérique (la physique théorique) au moment même où le gouvernement ne semble avoir d’argent que pour l’innovation industrielle.
On pourrait bien sûr se féliciter de voir un gouvernement « éclairé » investir ainsi dans la « science pure et désintéressée ». Mais avant de le faire, regardons de plus près les conséquences d’une telle manière de procéder, et ce sans même faire référence aux tendances créationnistes de certains ministres. Pour bien saisir tout ce que recouvre cette décision d’apparence anodine, comparons-la à la création, annoncée dans le même budget, de 10 chaires d'excellence en recherche totalisant 53,5 millions de dollars. D’un côté, le choix des titulaires de ces chaires se fera au moyen d'un concours ouvert et les candidatures retenues auront passé l’étape d’une évaluation par les pairs destinée à s’assurer de la qualité du programme de recherche du titulaire retenu. De l’autre côté, les 50 millions octroyés à l’Institut Perimeter atterrissent directement dans les coffres de cet organisme privé sans aucune concurrence ouverte ni évaluation scientifique des projets de recherche par des comités d’experts indépendants! Ce même institut avait d’ailleurs reçu un montant initial de 50 millions dans le budget fédéral de 2007.
Pour avoir une idée encore plus précise des conséquences de ce choix surprenant, notons que si le même montant, soit 10 millions par année, avait été versé au budget annuel du CRSNG, qui, on l’a dit, octroie ses subventions après concours et évaluation par les pairs, il aurait permis de financer environ 280 chercheurs canadiens – si l’on prend comme base la subvention annuelle moyenne par chercheur en physique théorique au cours des deux dernières années, soit environ 35 000 $. Ou encore, ce montant aurait permis de multiplier par cinq la subvention moyenne des chercheurs universitaires déjà sélectionnés par le CRSNG dans le domaine de la physique théorique!
Évidemment, le « pauvre » chercheur universitaire qui prépare une demande de subvention pour le CRSNG ne peut faire de lobbying auprès du président du CRSNG, car ce dernier n’a en fait aucun pouvoir sur l’octroi des subventions aux chercheurs. C’est le comité de pairs qui décide et la composition de ce comité change chaque année. Par contre, le président d’un organisme peut faire ce lobbying directement auprès des ministres lors de cocktails ou rencontres privés. Ainsi, le fait que Perimeter a réussi à obtenir 50 millions de dollars dans le budget de 2011 suggère fortement que la direction de cet organisme a su nouer les contacts politiques nécessaires ayant permis de contourner le chemin habituel qui passe par les organismes subventionnaires, route sur laquelle on rencontre inévitablement les comités de pairs, qui scrutent les projets individuels et en font une analyse détaillée avant de choisir les « gagnants ».
Des questions de gouvernance
Ce que les Américains appellent pork barrel et ear marking, et que leurs scientifiques dénoncent depuis longtemps comme une manière arbitraire et non optimale de sélection de projets de recherche, a maintenant traversé la frontière.
Les scientifiques canadiens veulent-ils vraiment que les investissements fédéraux (ou provinciaux) suivent cet exemple et que les ministres octroient des fonds de recherche directement à des organisations, sans passer par l’étape cruciale d’évaluation par les pairs? En outre, les priorités d’un gouvernement devraient-elles être dictées par les choix personnels de quelques « philanthropes » autoproclamés qui décident d'investir dans leur violon d’Ingres ou passion personnelle, qu'il s'agisse de physique théorique, de médecine naturelle ou « complémentaire », ou encore, comme dans le cas de la puissante fondation Templeton aux États-Unis, des « relations entre science et religion »?
Certains décideurs universitaires semblent penser que l'appariement de tels choix privés avec l'argent public est un excellent moyen de stimuler la philanthropie scientifique. Ils oublient toutefois que cette approche est évidemment soumise aux caprices changeants de quelques millionnaires qui, au gré de leur humeur, «investissent » (ou brûlent) les millions dont ils ne savent que faire dans leur passion du moment pour ensuite venir « quêter » un complément au public, sans que cela soit mis en balance avec les priorités nationales discutées publiquement. Et qu’arrive-t-il quand le « philanthrope » change d’idée et passe à un projet plus « sexy », ou, tout simplement, fait faillite? Les politiques publiques en général, et la politique scientifique en particulier, peuvent-elle sérieusement être fondées sur le hasard de tels « partenariats »?
En fait, une telle approche opportuniste de financement de la science va à l'encontre de la bonne gouvernance d'une politique scientifique nationale largement discutée et visant des objectifs à moyen et à long terme. Si la voie politique peut conduire à des gains à court terme pour certaines institutions, il y a peu de doute que cette stratégie ne pourra à la fin qu’être délétère pour tous. Les sensibilités et idéologies des gouvernements peuvent se modifier facilement, tandis que l’excellence scientifique a besoin d'investissements à long terme fondés sur de saines politiques publiques. Une fois que les gouvernements ont défini les grandes priorités scientifiques, ils ne devraient pas intervenir dans la microgestion du contenu même de la science, et encore moins choisir qui devrait obtenir une portion spécifique de cet argent. Les examens des projets, tout comme les décisions les concernant, devraient être laissés aux experts, choisis par les agences existantes créées à cet effet, à savoir les organismes indépendants que sont Génome Canada, la FCI, le CRSNG, le CRSH et les IRSC – et leurs homologues provinciaux –, organismes qui sont l'incarnation de ces principes d'excellence qui ont toujours mis la crédibilité scientifique bien au-dessus des connexions politiques.
Malgré ses limites – l’erreur est humaine –, l’examen par les pairs ou par des comités d'experts scientifiques est encore la meilleure façon d'empêcher la politique de dicter ce qu’est l’excellence scientifique. Quoique coûteux en temps, ce mode de gouvernance permet de s'assurer que l'argent public est investi dans les meilleurs projets de recherche et non pas donné directement et sans évaluation scientifique à des organisations qui ont les relations sociales nécessaires pour faire cheminer leurs demandes directement au sein du petit monde politique alors au pouvoir. Ce capital social est certainement utile dans le domaine politique, mais cette monnaie ne doit pas remplacer le capital scientifique accumulé de façon légitime dans le champ scientifique à travers une compétition ouverte basée sur le mérite scientifique passé et actuel.On devrait donc y réfléchir à deux fois avant d'accepter tout type d'investissement sous prétexte que l'argent n'a pas d'odeur et est toujours le bienvenu. Les règles du jeu en vigueur dans le champ politique n’ont rien en commun avec celles qui ont normalement cours dans le champ scientifique. Appliquer les premières au second ne pourra que détruire la crédibilité dont la science, quoi qu’on dise, jouit encore parmi l’ensemble de la population et semer le doute sur la qualité scientifique de la recherche conduite par des chercheurs qui font tout pour éviter d’être évalués par leurs pairs.
- Yves Gingras
UQAM - Université du Québec à Montréal
Yves Gingras est professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 1986. Sociologue et historien des sciences, il est aujourd’hui directeur scientifique l’Observatoire des sciences et des technologies et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre