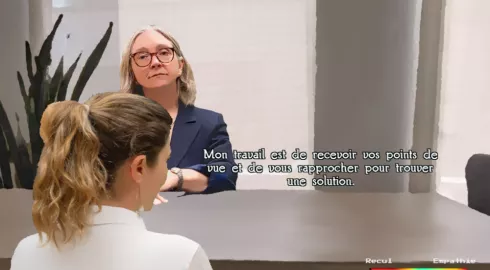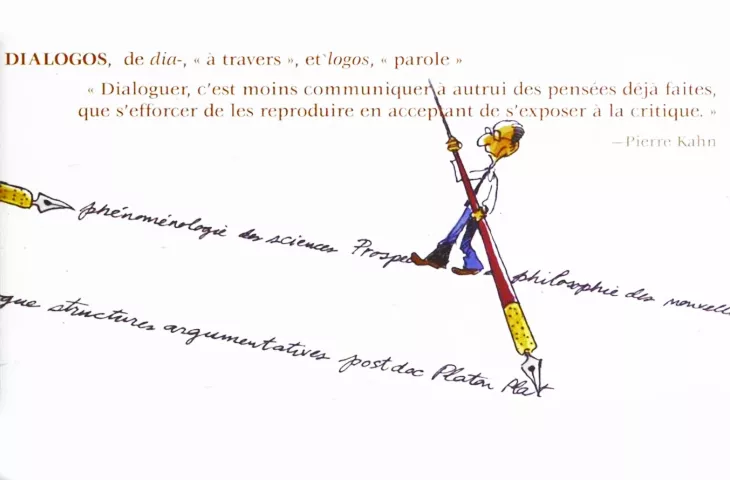Penser scientifiquement, ce n’est pas seulement résoudre des équations. C’est comprendre la portée de ses choix. C’est saisir les enjeux technologiques, environnementaux, sociaux. C’est être lucide, curieux, informé.

Johanne Lebel1 — Martin, vous terminez votre première année à la présidence de l’Acfas. Quel regard portez-vous sur ces douze mois?
Martin Maltais — Une année bien remplie! J’ai participé aux congrès, galas, prix, concours, publications…, mais surtout, j’ai rencontré la communauté, les partenaires, les gens du terrain — du monde de la recherche jusqu’aux milieux politiques, en passant par les médias et les acteurs de la culture scientifique.
Mon premier constat? L’Acfas est une association exceptionnelle! Elle joue un rôle unique dans l’écosystème de la recherche. On est présents auprès de celles et ceux qui font et vivent la recherche scientifique en français, mais aussi auprès des personnes et des institutions qui la financent, qui la diffusent, qui en parlent. Et on occupe ce rôle depuis un siècle, ce qui est, en soi, remarquable.
Aujourd’hui, l’Acfas accompagne les chercheur·euses dès la rédaction de demandes de subvention jusqu’à la formation en vulgarisation. On est bien reconnus par les universités, soutenus par les deux ordres de gouvernement, et sur la scène internationale francophone, on a non seulement une notoriété, mais une crédibilité réelle.
Et bien sûr, ce qui traverse tout ce travail, c’est notre engagement indéfectible envers les sciences en français. C’est pour ça qu’on se bat. Et je dois dire que je savoure ce mandat, parce qu’il est collectif, stimulant, et qu’il s’inscrit dans un environnement beaucoup moins conflictuel que certains autres projets auxquels j’ai pu participer par le passé!
On fait des choses extraordinaires avec des moyens modestes. Ce n’est possible que parce qu’on a une équipe mobilisée, engagée et profondément investie dans la mission.
JL — Les sciences en français ont visiblement été au cœur de votre première année…
MM — C’est peu dire! Une semaine après la confirmation de mon mandat, j’étais déjà en commission parlementaire avec notre directrice générale, à Québec, pour présenter notre mémoire sur la nouvelle Loi modifiant principalement la Loi sur le ministère de l'Économie et de l'Innovation en matière de recherche. Un large pan de nos recommandations ont d'ailleurs été intégrés dans cette Loi.
Par la suite, en avril, c'est à Ottawa que nous présentions un mémoire au Comité permanent de la science et de la recherche. Notre première recommandation? Dédier des fonds spécifiques à la production et à la diffusion de la recherche en français.
En juillet, on déposait un autre mémoire, cette fois sur la création d’une nouvelle organisation-cadre pour chapeauter les trois grands conseils subventionnaires fédéraux. On y plaidait, après avoir effectué une consultation auprès de nos membres, pour une stratégie pancanadienne de soutien à la recherche et à la publication scientifique en français. En novembre, la directrice générale et moi-même étions de nouveau invités auprès du Comité permanent de la science et de la recherche pour faire une intervention sur cette question.
Aussi, en novembre, l’Acfas prenait la parole pour la première fois devant le Sénat. C’est Valérie Lapointe-Gagnon, membre du conseil d'administration, membre du comité directeur de notre section régionale Acfas-Alberta et présidente du Comité pancanadien sur la recherche en français, qui portait notre voix devant le Comité des langues officielles, dans le cadre de l’étude de ce dernier sur les services de santé en français. Une première, mais certainement pas une dernière.
JL — L’Acfas est aussi active au sein des autres province à travers son réseau de sections régionales?
MM — Oui, et c’est important de le dire. Notre réseau régional s’étend de l’Acadie à l’Alberta, avec six sections en francophonie minoritaire. Il existe depuis les années 1960 et continue à se renouveler. Récemment, je suis allé en Ontario pour rencontrer nos collègues de Sudbury et de Toronto. Ce tissu régional est une richesse. Il donne une épaisseur humaine et territoriale à notre mission.
JL — Tout cela s’inscrit aussi dans la continuité du rapport de 2021 sur la recherche en français en contexte minoritaire…
MM — Absolument. Ce rapport a eu un retentissement important. Depuis, on a déposé 14 mémoires, rapports et autres témoignages auprès des gouvernements. Plus concrètement, on a mis en place le Service d’aide à la recherche en français (SARF), qui achève sa deuxième année d’existence. Ce service appuie les professeur·es et les étudiant·es, informe les universités sur les programmes accessibles et rejoint un bassin potentiel de quelque 30 000 chercheur·euses d'expression française en contexte minoritaire. On a changé d’échelle. Et on ne reviendra pas en arrière.
JL — Parlons politique. L’Acfas est de plus en plus présente dans ces arènes…
MM — C’est un travail exigeant. Ce sont les membres du conseil d’administration, avec la direction générale et l’appui du comité Affaires publiques et gouvernementales, qui rédigent l’essentiel de nos positions — pas des consultant·es. Ça demande rigueur, réactivité, et surtout, ça nous donne une légitimité forte auprès de nos membres et de nos interlocuteur·trices.
Dans nos rapports avec le politique, il y a un équilibre à maintenir. La science ne doit pas remplacer la démocratie. Elle doit l’éclairer. Le politique nous ouvre des espaces : à nous de les habiter intelligemment, sans confusion des rôles.
C’est le sens de notre participation au comité d'orientation du Forum sciences et politiques du Québec, piloté par le bureau du scientifique en chef. Autour de cette table, chercheur·euses et décideur·euses publics dialoguent. Des projets comme les résidences scientifiques dans les ministères ne peuvent exister que si les fonctionnaires y voient une valeur ajoutée. Il faut construire cette confiance.
JL — Ce forum me fait penser au parcours L'interface.
MM — Oui, et on a là un bijou. Cette formation pratique, issue d'une collaboration Acfas et FRQ, est un pont entre le monde de la recherche et celui des décideurs. La deuxième cohorte de 20 personnes est en cours pour comprendre le système politico-adiministratif et l'élaboration des politiques publiques, et pour apprendre à mener des initiatives auprès des décisionnaires. On sort du mythe de la tour d’ivoire.
JL — Pour la suite, où souhaitez-vous investir votre énergie?
MM — Aller vers le Canada anglophone. Sortir de notre bulle. Engager la conversation. Faire valoir que la science en français n’est pas un repli, c’est un levier. Pour le pays, pour ses relations internationales, pour sa souveraineté.
Deux langues officielles, ce n’est pas un handicap, c’est un capital. Dans un monde où la diplomatie scientifique prend de l’importance, parler français, c’est avoir un accès direct à l’Europe, à l’Afrique et à d'autres régions du monde. C’est stratégique...
Il faut que cette idée fasse son chemin dans tout le pays. C’est un chantier, et on s’y attelle. On plaide d'ailleurs de plus en plus pour que la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec s'engage à élaborer une réelle stratégie d'internationalisation de l'enseignement supérieur.
JL — Parce que la langue dans laquelle on fait de la science, ce n’est pas anodin…
MM — Ce n’est pas qu’une question de culture ou d’identité, c’est une question de capacité à penser. À former des citoyen·nes capables d’analyser, d’innover, de prendre des décisions.
Si on n’a plus accès à une vie scientifique en français, c’est notre autonomie intellectuelle qui est en jeu. Et ce n’est pas juste une question de publications. Le vrai défi, c’est la formation de la relève, c'est d'offrir aux jeunes francophones une vie scientifique riche et prospère dans leur langue. Un PowerPoint de cours entièrement en anglais, ce n’est pas neutre. Ça façonne des habitudes mentales, des rapports au savoir.
Les sciences en français, ça concerne tous les ministères : Santé, Éducation, Économie, Culture… Si on veut des hôpitaux, des firmes de génie, des ingénieur·eures qui offrent des services, pensent et innovent en français, il faut que les filières de formation tiennent la route.
JL — En terminant, que diriez-vous de la pensée scientifique, de ce qu’elle peut apporter?
MM — La vraie liberté, c’est la capacité de juger par soi-même. De prendre des décisions éclairées, pour soi, pour sa communauté, pour la planète.
Penser scientifiquement, ce n’est pas seulement résoudre des équations. C’est comprendre la portée de ses choix. C’est saisir les enjeux technologiques, environnementaux, sociaux. C’est être lucide, curieux, informé.
Mais c’est aussi cultiver sa subjectivité. Être sensible au monde. Avoir de l’amour et du respect pour celles et ceux qui nous entourent. Parce que c’est là que tout commence. Et peut-être, aussi, là que tout peut encore se transformer.
Si on n’a plus accès à une vie scientifique en français, c’est notre autonomie intellectuelle qui est en jeu. Et ce n’est pas juste une question de publications. Le vrai défi, c’est la formation de la relève, c'est d'offrir aux jeunes francophones une vie scientifique riche et prospère dans leur langue.
- 1
Johanne Lebel est rédactrice en chef du Magazine de l'Acfas.
- Martin Maltais
Université du Québec à Rimouski
Nommé pour un mandat de deux ans, Martin Maltais est président de l’Acfas depuis le 14 mars 2024.
Martin Maltais est professeur en financement et politiques d’éducation au campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski. Gestionnaire de proximité, il a été conseiller de quatre ministres issus de trois gouvernements différents et directeur adjoint pour deux d’entre eux. Au sein du gouvernement du Québec, il a principalement eu la responsabilité de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie. Auteur de plusieurs articles, rapports et communications en lien avec les politiques et le financement de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation à distance et de la recherche scientifique, il est un acteur clé de l’élaboration des politiques d’enseignement supérieur et du numérique au Canada. Il fait partie du conseil d’administration depuis 2021.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre