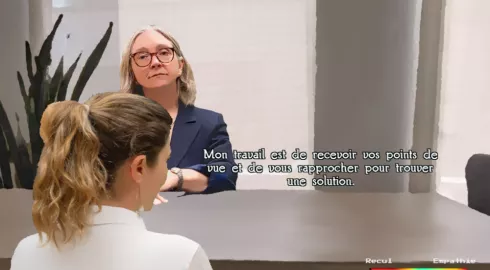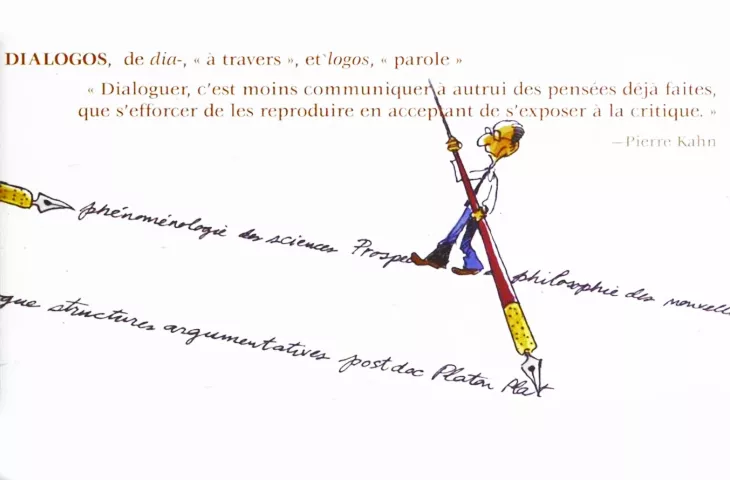Juin 2013 : je suis embauchée dans un petit département de philosophie (mon premier « vrai » poste de professeure). J’étais alors bien consciente que de joindre une équipe d’environ sept professeurs et quelques chargés de cours ponctuels impliquerait d’être polyvalente et d’accepter des mandats variés, souvent hors de mes zones de confort. Je ne pensais pas être aussi bien servie.
À peine quelques mois plus tard, on nous demandait d’actualiser notre offre de cours et de dynamiser nos activités afin d’assurer un meilleur rayonnement départemental, en vue d’augmenter le nombre d’inscrits dans nos programmes.
Ça tombait bien : j’adore les défis.
Pour renouveler les contenus des cours offerts, j’ai proposé un cours de 1er cycle intitulé Philosophie et féminisme. J’avais fait mes devoirs. D’abord, par un sondage informel auprès de collègues œuvrant dans d’autres universités, question de jauger les cours comparables au sein d’autres départements ou d'autres disciplines. Ensuite, par une consultation des étudiant(e)s de nos programmes pour évaluer l’intérêt. Résultat : une réponse majoritairement positive.
De plus, un mouvement de prise de parole des femmes en philosophie déplorant leur peu de visibilité dans ce milieu masculin se concrétisait par la mise sur pied de comités d’équité dans les associations savantes et de groupes d’étudiantes en philosophie, de même que dans les milieux académiques en général (à lire dans le New York Times, et Feminist philosophy). Inspirée par cette initiative et forte de cet enthousiasme partagé, j’ai voulu en faire une proposition plus formelle. Et pourquoi pas alors un sigle et un descripteur officiel pour que le cours soit donné régulièrement et intégré à notre baccalauréat?
« Pas une priorité »
C’est là que ça s’est un peu gâté. Car même si je conçois le féminisme comme la défense inclusive et ouverte d’une équité hommes-femmes qui reste à atteindre de facto (revendication légitime et raisonnable s’il en est), il se trouve des gens pour affirmer que puisqu’une certaine égalité en regard de la loi est atteinte, le dossier est réglé (ce qui est loin d’être le cas).
J’ai alors fait face, à ma grande surprise, non pas à de l’hostilité (bien qu’il se trouve beaucoup de gens pour s’opposer à l’enseignement de ce sujet souvent mal compris et politiquement sensible), mais à pire encore : à de l’indifférence. Je semblais être seule à concevoir comme essentiel de combler ce créneau, alors que les autres départements de philosophie comptaient en général au moins une spécialiste de ces questions dans leurs rangs.
Pouvions-nous, en n’assurant aucune expertise dans ce domaine, risquer de perdre d'emblée un potentiel d'inscriptions et surtout, faire comme si cet important courant de pensée n’avait jamais existé?
D’un autre côté, il était normal de prioriser certains dossiers, l’équipe est petite, les ressources limitées. Comment plaider alors ce dossier, dans un contexte de restrictions financières où les projets-pilotes du genre sont rarement prioritaires? Il était illusoire d’espérer qu’on accorde le budget pour enseigner un cours qui n’existait même pas au programme. J’étais par ailleurs, comme toute nouvelle professeure, littéralement « accablée d’enseignement », ce qui, en plus d’hypothéquer le temps que j’aurais dû pouvoir consacrer à mon dossier de recherche et publication, me laissait peu d’énergie pour défendre ce projet.
Comme les chercheurs ne croient pas en la magie, il fallait trouver une façon pragmatique d’y remédier (la patience est une vertu, certes, mais il n’en reste pas moins qu’elle a pour cousine la passivité). J’ai donc décidé, dans un téméraire élan prométhéen, d’arracher ce cours des limbes de l’inexistence d’une façon ou d’une autre, pourvu que ce soit dans le plus total respect des procédures, bien sûr, et tout en assumant la part de risques — on se rappellera que le titan Prométhée est connu pour avoir volé le feu aux Dieux pour le donner aux humains, attirant ainsi les foudres de Zeus, qui le fit enchaîner...
Mais comment faire? « Je donnerai le cours moi-même, s’il le faut! », avais-je lancé à la blague à un ami, sans prendre au sérieux son « et pourquoi pas? »
L’idée a fait son chemin, malgré que je n’étais pas spécialiste ni des théories féministes ni de la philosophie politique : mon intérêt pour ces questions s’était certes manifesté à titre de citoyenne ou, à la limite, en tant que « femme dans un milieu d’homme », mais ce n’était pas encore explicite dans mes travaux.
Cependant je possédais sur le sujet une brassée de plaquettes glanées au hasard des ballades dans les bouquineries, et j’avais été invitée à participer à la table ronde « Femmes et philosophie » de l’État des lieux de la philosophie, qui avait attiré l'attention d'une foule nombreuse sur le fait que les femmes sont hélas encore trop peu visibles dans la discipline. C’était un début modeste, mais c’était déjà ça.
Situation cocasse sur un chemin sinueux
J’ai toujours considéré que l’enseignement était le moyen idéal pour développer de nouvelles avenues de recherche, pour trois raisons.
- d’abord, le rythme hebdomadaire ne laisse aucune place pour la procrastination dans la recherche, donc les résultats sont observables rapidement;
- aussi, monter un nouveau cours implique de produire trois heures de nouveau matériel par semaine et cette stimulante pression est fort productive;
- finalement, quoi de mieux que la responsabilité de bien vulgariser un contenu pour arriver à la maîtrise de ses fondements théoriques.
J’ai toujours considéré que l’enseignement était le moyen idéal pour développer de nouvelles avenues de recherche.
À cela s’ajoute le plaisir lié à l’acte de découvrir, plaisir communicatif qui permet d’intégrer les étudiants au processus et de bénéficier des échanges stimulants qui ont lieu en classe; de plus, le contact avec leur sens critique et leur intelligence s’avère une source de motivation constante, tout en offrant un regard neuf sur des questions de recherche.
Par chance, le moment d’établir l’offre de cours pour l’année à venir arrivait et parmi les propositions se trouvait un séminaire dont le sigle était très général, ce qui me permettait d’avoir une liberté totale sur le contenu. Je l’ai fait mettre à mon horaire, et j’ai entrepris la préparation du contenu avec, je l’avoue, des relents du « syndrome de l’imposteur » entremêlés de beaucoup d’enthousiasme.
Actualité du cours en cours
Les mois ont passé et les évènements d’actualité de l’automne 2014 ont tristement confirmé que la question de l’équité hommes-femmes était plus que jamais d’actualité, dans le grand public comme au sein de la communauté de chercheurs. Pensons par exemple à la commémoration des 25 ans de l’attentat de Polytechnique, à l’affaire Gomeshi ayant mené au mouvement #AgressionNonDenoncee, ou encore au dossier des femmes autochtones disparues.
Les évènements d’actualité de l’automne 2014 ont tristement confirmé que la question de l’équité hommes-femmes était plus que jamais d’actualité, dans le grand public comme au sein de la communauté de chercheurs.
Alors que j’assemblais le corpus théorique et fréquentais les textes, attendant avec impatience la période d’inscriptions, non sans stress (car on ne s’improvise pas spécialiste comme ça!), le caractère « titanesque » — c’est le cas de le dire — de l’entreprise s’est confirmé. Il était quasi-impossible de maîtriser en si peu de temps tout le contenu théorique requis pour donner un séminaire à la hauteur de mes exigences. Les théories féministes sont un vaste champ d’études qui présuppose la maîtrise préalable de plusieurs champs de recherche : philosophie politique, épistémologie des sciences humaines, histoire de la pensée, sociologie, etc.. Tel que je l’avais anticipé, chaque texte que je lisais était un arbre qui cachait une forêt.
C’est là que j’ai eu l’idée qui m’a permis de ne pas céder au découragement et de reprendre confiance : pourquoi ne pas partir de ce que je savais déjà, plutôt que de tenter la mission impossible de devenir spécialiste ex nihilo? Il s’agissait simplement d’établir des zones de rapprochement entre ce sujet nouveau et mon domaine de spécialité principal, soit la philosophie contemporaine de l’art. Le compromis était donc de ne pas faire en tant que tel un « cours de féminisme », mais bien de prendre la question du genre comme thème. Pour offrir une expertise complémentaire, j’ai résolu d’inviter de jeunes chercheures spécialisées dans le domaine, collaboration précieuse qui leur permettait en retour de mettre en valeur leur expertise.
Suivre deux fils
Le cours serait partagé en deux blocs. Il s’imposait que le premier soit d’ordre politique. Le second bloc devait être plus proche de la création et des préoccupations esthétiques, ce qui me permettait de compter sur mes acquis de recherche. En choisissant deux fils directeurs d’intérêt universel, pouvoir et beauté, j’allais donc pouvoir greffer une lecture féministe à mon champ d’expertise principal en esthétique contemporaine (ce qui permettait aussi de mettre à jour mes connaissances pour mes recherches) tout en ajoutant une lecture esthétique aux problématiques féministes, en intégrant des thèses développées par des féministes issues du champ de la recherche-création en littérature. Par exemple, les travaux d’auteures comme Nancy Huston, Martine Delvaux et Nelly Arcand du côté de la création permettaient de faire le lien entre les divers thèmes. Du côté plus politique, il s’agissait de partir de textes d’auteures qui avaient à la fois un intérêt pour les arts et les problématiques féministes, par exemple, ceux de Martha Nussbaum, que j’avais abordée lors de recherches antérieures.
Bref, cette responsabilité qui, à première vue, semblait alourdir ma tâche d’enseignement allait en fait me permettre de propulser ma recherche et d’élargir le champ couvert par celle-ci.
Cette responsabilité qui, à première vue, semblait alourdir ma tâche d’enseignement allait en fait me permettre de propulser ma recherche et d’élargir le champ couvert par celle-ci.
Philosophie féministe et public masculin
Le cours est passé à deux doigts d’être emporté par les compressions financières imposées suite aux coupures gouvernementales quelques semaines avant de débuter. Allez savoir pourquoi, le titre « Séminaire de recherche en sciences humaines » ne semblait pas très sexy de prime abord et nos étudiants, déjà peu nombreux, hésitaient à s’inscrire dans un cours portant sur une problématique qui leur était totalement inconnue, puisqu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’aborder le sujet dans un cours d’introduction de premier cycle. Mais, heureusement, il a « résisté » et allait être offert, à ma plus grande surprise, à un public… exclusivement masculin.
Comment allais-je rendre la problématique « parlante » pour eux, qui, bien que concernés par la question, n’en voyaient peut-être pas l’importance? Allaient-ils réagir négativement? En fait, une fois les premières inquiétudes dissoutes, j’ai constaté à quel point j’étais privilégiée : c’était d’autant plus pertinent d’aborder la question devant un groupe de jeunes hommes. Pour un groupe de militantes féministes hardcore , j’aurais été, à toute fin pratique, inutile.
C’était d’autant plus pertinent d’aborder la question devant un groupe de jeunes hommes. Pour un groupe de militantes féministes hardcore , j’aurais été, à toute fin pratique, inutile.
Pour une professeure qui conçoit la philosophie essentiellement comme un outil de transformation sociale par le biais d’une meilleure compréhension des enjeux contemporains, c’était une occasion en or et je n’allais certainement pas me priver d’une pareille tribune.
L’autre difficulté à surmonter était de réussir à vaincre la méfiance générale envers ce sujet. Et je pèse mes mots : toute personne qui a osé dire « je suis féministe » vous dira à quel point cela suscite des réactions pouvant être très négatives. Car le terme est polysémique. Galvaudé. Mal-aimé. Il fallait clarifier les choses pour éviter tout malentendu. Je pouvais voir par la réaction de certain(e)s que la légitimité de ma démarche (et des recherches féministes en général) n’avait rien d’acquis.
Le plus urgent était de faire comprendre aux étudiants à quel point la vision du féminisme que je portais était inclusive et ouverte, conformément à la formule qui affirme que « le féminisme est un humanisme » et que la question les touchait tout aussi directement que les femmes. N’avons-nous pas tous, que nous soyons femmes ou hommes, à gagner dans la défense de la justice et de l’équité?
Mes étudiants ont répondu positivement à cet appel, faisant preuve d’une ouverture d’esprit exemplaire (j’en profite pour les remercier de m’avoir fait confiance dans cette aventure). De plus, j’ai pu nouer de nouveaux contacts propices au développement de la recherche en établissant des liens avec des chercheures extrêmement dynamiques et prolifiques dont je n’aurais pas eu vent des recherches, n’eût été ces circonstances.
Épilogue
Au moment d’écrire ces lignes, le séminaire n’est pas terminé, mais déjà, il est clair que la démarche valait la peine. On aurait pu très bien me dire : « On ne t’a pas embauchée pour ce créneau-là ». Mais personne ne l’a fait, du moins, pas devant moi. Certes, j’ai essuyé quelques railleries en tant que nouvelle « féminis’ de service ». Peut-être s’est-on simplement rendu à l’idée que ces questions sont importantes et que d’avoir un domaine de spécialité de plus à offrir était bénéfique pour notre département?
Quoi qu’il en soit, j’ai eu la chance de gagner en compréhension d’un important phénomène d’actualité et de partager ce nouveau savoir avec un groupe extrêmement collaboratif, ce qui devrait se matérialiser dans quelques publications à venir. Je ne sais pas précisément où ce séminaire me mènera, mais je peux désormais offrir un encadrement aux étudiant(e)s qui voudraient s’initier à la recherche dans ce champ, ce qui s’avère un « bénéfice net » pour notre département. Et de simplement avoir tenté le coup, c’était déjà une victoire en soi : qui aurait cru que d’une insatisfaction initiale pouvait ressortir une expérience si constructive?
Peu importe la suite : si je me fie à ce qui est arrivé à Prométhée, ça ira, car d’après la légende, il aurait eu l’aide d’Athéna – patronne de la philosophie! – pour entrer dans l’Olympe et commettre son larcin, mais… surtout celle d’Hercule pour être libéré du châtiment de Zeus. Et moi, non seulement je n’ai rien volé, mais la seule chose à laquelle je serai enchaînée bientôt, ce sera à une pile de copies à corriger et croyez-moi, ça ne sera pas une punition, mais c'est bien une responsabilité que j’assumerai avec le plus grand intérêt.
J’ai eu la chance de gagner en compréhension d’un important phénomène d’actualité et de partager ce nouveau savoir avec un groupe extrêmement collaboratif, ce qui devrait se matérialiser dans quelques publications à venir.
- Mélissa Thériault
Université du Québec à Trois-Rivières
Mélissa Thériault est diplômée de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université de Provence. Elle se consacre à l’enseignement collégial et universitaire de la philosophie depuis 2003. Collaboratrice ponctuelle au magazine Spirale, elle dirige le Laboratoire de recherche en esthétique de l’Université du Québec à Trois-Rivières et s’implique au sein de la Société de philosophie du Québec. Ses travaux actuels portent sur les pratiques populaires, sur l’industrie culturelle et les représentations éthiques et politiques dans le cinéma québécois, sur les liens entre littérature et philosophie ainsi que sur les questions féministes. Auteure de Arthur Danto ou l’art en boîte (L’Harmattan, 2010), elle prépare un essai sur les arts populaires, et elle est professeure au Département de philosophie & arts de l’UQTR depuis 2013.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre