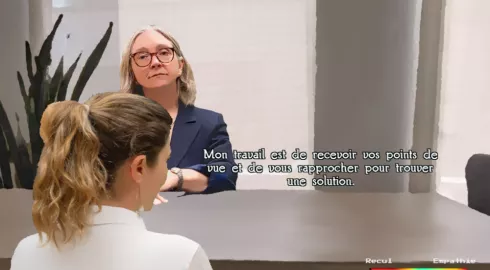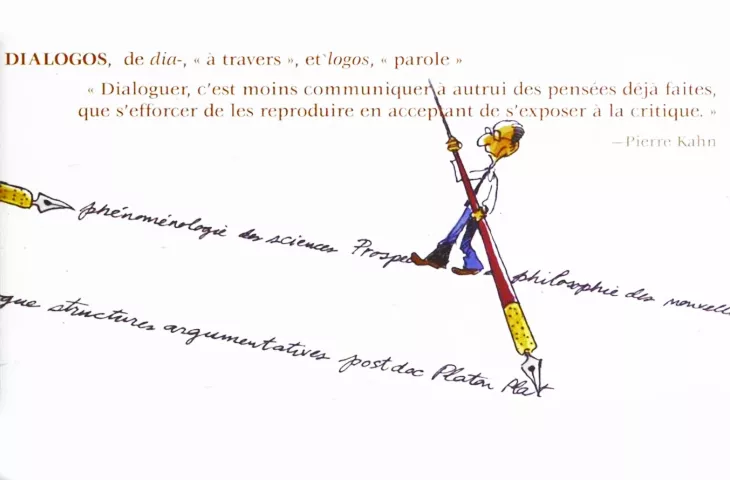Ce n’est pas la maternité en soi qui pose problème, mais plutôt la forte concurrence pour les rares postes universitaires et l’âge auquel survient cette concurrence qui pénaliseraient les femmes.

En 2013, est-il encore pertinent d’aborder la question de la présence et du rôle des femmes dans les universités? Quoi qu’on en pense, cette question s’inscrit d’elle-même dans les débats politiques et universitaires.
Au Canada, lorsque le gouvernement fédéral inaugure en mai 2010 son nouveau et prestigieux programme de chaires d’excellence en recherche, il fait face à un moment de crise plutôt qu’à l’ambiance de coquetel attendue : c’est que les 19 premiers titulaires de ces chaires sont tous des hommes.
En France, au terme des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’automne 2012, une charte pour l’égalité femmes/hommes dans le monde universitaire est signée conjointement par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la ministre des Droits des femmes. Entre autres motifs : bien que fortement présentes dans la population étudiante universitaire, les femmes ne représentent que 23 % au plus des professeurs d’université et 10 % des présidents d’université (l’équivalent des recteurs québécois) .
Féminisation en dégradé
Cent ans après la première nomination d’une femme à titre de professeure d’université au Canada (Carrie Derick a été nommée en 1912 professeure titulaire en morphologie comparative et en génétique à l’Université McGill ), la place et surtout le rôle des femmes au sein des établissements d’enseignement supérieur restent toujours précaires. On assiste à ce que Camille Froidevaux-Metterie , blogueuse à Philosophie Magazine, nomme une « féminisation en dégradé » : Peu importe la variable – étudiant, enseignement, recherche ou administration universitaires –, la tendance est la même : plus on gravit les échelons dans le cursus ou dans la carrière, moins il y a de femmes.
Peu importe la variable – étudiant, enseignement, recherche ou administration universitaires –, la tendance est la même : plus on gravit les échelons dans le cursus ou dans la carrière, moins il y a de femmes.
Autrement dit, de majoritaires au baccalauréat, les étudiantes deviennent minoritaires au doctorat. Côté enseignement, le pourcentage de professeures adjointes (premier poste sans permanence acquise) au Canada en 2008-2009 s’élevait à 42,6 %, et dégringolait à 21,7 % pour ce qui est du poste le plus convoité, celui de professeur titulaire.
Du côté de la recherche, entre 2000 et 2003, les femmes québécoises professeures à l’université n’ont obtenu que 32 des 262 chaires de recherche du Canada attribuées au Québec, soit 12,2 %, alors qu’elles représentaient 26,5 % du corps professoral.
Dans la haute administration, les postes de recteur, vice-recteur, doyen, etc., reviennent aussi largement aux hommes. Comment expliquer ce renversement à mesure que l’on s’élève dans la pyramide universitaire et professionnelle?
Un enfant ou un postdoctorat, une agrégation ou une chaire de recherche?
L’une des hypothèses qui semble des plus évidentes, et qui est donc l’une des plus avancées, est d’ordre psychosocial : c’est parce qu’elles auraient des difficultés à mener de front vie familiale et professionnelle que les femmes renonceraient à la carrière universitaire. Aussi controversée soit-elle, cette hypothèse est le point de départ de plusieurs recherches sur la sous-féminisation des emplois universitaires.
Une récente étude approfondit cette hypothèse et propose une perspective beaucoup plus fine : ce n’est pas la maternité en soi qui pose problème, mais plutôt la forte concurrence pour les rares postes universitaires et l’âge auquel survient cette concurrence qui pénaliseraient les femmes. Shelley Adamo, professeure de psychologie et de neurosciences à l’Université Dalhousie, dont les résultats de recherche sont publiés dans le numéro de janvier 2013 de BioScience, en arrive à cette conclusion en comparant deux disciplines, la médecine et la biologie. Son postulat est que si les femmes délaissaient effectivement la carrière universitaire en vertu du stress, de la lourde charge de travail et des obstacles à concilier travail-famille, elles délaisseraient également la profession de médecin, ce qui n’est pas le cas.
À cet égard, la professeure Adamo observe deux caractéristiques qui distinguent les parcours des médecins et des professeurs universitaires en biologie : dans le premier cas, un processus de sélection très compétitif a lieu dès l’admission au programme universitaire et le nombre d’étudiants admis coïncide avec les postes de médecin à pourvoir. À l’opposé, les critères d’admission en biologie sont relativement peu exigeants, mais le nombre de diplômés de doctorat est beaucoup plus important que le nombre de postes universitaires disponibles. La concurrence que se livrent les aspirants médecins a lieu au début de la vingtaine, tandis que celle des aspirants enseignants-chercheurs universitaires se déroule plutôt au début de la trentaine, à un âge où plusieurs femmes ont de jeunes enfants ou songent à en avoir. Le « vide » de productivité professionnelle généré par un congé de maternité peut, dans ces circonstances, expliquer la persistance de la disparité hommes-femmes dans l’embauche de professeurs ainsi que dans l’obtention de l’agrégation ou de la titularisation universitaire.
La concurrence que se livrent les aspirants médecins a lieu au début de la vingtaine, tandis que celle des aspirants enseignants-chercheurs universitaires se déroule plutôt au début de la trentaine, à un âge où plusieurs femmes ont de jeunes enfants ou songent à en avoir.
En outre, la concurrence accrue entre de nombreux diplômés pour un même poste convoité participe à un rehaussement des critères de sélection des aspirants professeurs. Par exemple, un postdoctorat à l’étranger et une insertion dans des réseaux internationaux de recherche sont désormais des caractéristiques « usuelles » recherchées pour de nouveaux professeurs. La mobilité qu’elles requièrent peut toutefois désavantager les doctorantes en train de fonder une famille. À cela s’ajoute le fait que l’embauche à titre de professeur adjoint ne constitue que le début d’une phase déterminante ou, pour reprendre les mots d’une étude de Statistique Canada, d’une « période critique dans la progression de carrière de la plupart des universitaires, une période qui se caractérise par des exigences importantes et une grande insécurité d’emploi » – bref, d’une période où « il faut faire ses preuves ». D’où la lancinante question : faire un enfant ou obtenir un postdoctorat, une agrégation ou une chaire de recherche?
Au-delà de la maternité : les stéréotypes associés aux femmes
D’autres jugent commode l’hypothèse de la maternité, car elle permet de ne pas remettre en question les critères de sélection et d’avancement professionnel. Comme le mentionne Camille Froidevaux-Metterie , « si tant de jeunes femmes font le choix de se lancer dans le long et tortueux parcours de la thèse, si elles sont de plus en plus nombreuses à postuler et à obtenir leur nomination comme maîtresses de conférence ou chargées de recherche, ce serait pour s'arrêter là? ». Ce « choix personnel » surviendrait soudainement, sans que le milieu universitaire n'y ait une quelconque incidence?
La ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso , cite sur ce sujet une étude démontrant que les stéréotypes associés aux femmes sont plus influents que la maternité dans la disparité de genre observée dans les universités. En effet, la proportion des femmes chargées de recherche sans enfant n’est pas meilleure que celle des femmes qui ont des enfants quand il s’agit de devenir directrice de recherche. En l'occurrence, ce ne serait pas la maternité, mais bien les stéréotypes, qui freineraient les carrières des femmes.
Le débat rejoint alors celui plus général du fameux « plafond de verre » auquel se butent plusieurs femmes, par exemple dans le monde économique ou dans les milieux de « décision », comme en témoigne le peu de femmes présentes aux conseils d’administration ou à la tête des organisations privées au Québec . Les critères de sélection et d’avancement ainsi que la culture organisationnelle favoriseraient implicitement les hommes, selon un modèle de la réussite androcentré.
Un débat ancien, des solutions nouvelles
La présence et le rôle des femmes dans la vie professionnelle en général et dans la carrière universitaire en particulier ne sont pas des sujets nouveaux. D’ailleurs, de nombreuses universités ont adopté des politiques d’équité en emploi qui, à dossier égal, peuvent favoriser le recrutement de candidats de sexe féminin, autochtones, handicapés, etc.
À la lumière des résultats jusqu’à présent mitigés, on peut se demander si de telles politiques constituent un instrument adéquat. D’autant plus que ces mesures de « discrimination positive », à l’opposé de la stricte compétence et du mérite, en irritent plusieurs, hommes comme femmes, et seraient difficiles à appliquer au sein des universités.
Les mesures de "discrimination positive", à l’opposé de la stricte compétence et du mérite, en irritent plusieurs, hommes comme femmes, et seraient difficiles à appliquer au sein des universités.
D’autres avenues peuvent être envisagées. Dans un rapport publié en 2012 et commandé par le gouvernement fédéral à la suite de l’absence remarquée de femmes parmi les titulaires des nouvelles chaires d’excellence en recherche, le Conseil des académies canadiennes recense une série de bonnes pratiques mises en œuvre par différents établissements d’enseignement supérieur au Canada. Parmi ces pratiques, plusieurs renvoient à des modèles de progression de carrière plus flexibles, par exemple des postes à temps partiel menant à la permanence, des accommodements pour que les partenaires ou des gardiennes d’enfants accompagnent l’universitaire à une conférence, une priorité d’horaire de cours accordée aux jeunes parents, etc. Selon les universités qui ont implanté ces pratiques, le pourcentage des femmes dans les postes professoraux permanents et dans la haute administration universitaire a sensiblement augmenté.
On en revient donc à l’incontournable question de la maternité chez les femmes universitaires, par l’entremise du développement de mesures de conciliation travail-famille. Cette timide évolution observée dans quelques établissements n’est toutefois en rien comparable à la vigueur de la culture productiviste, qui prend sans cesse de l’importance dans les universités et qu’illustre notamment l’expression « publish or perish » (publier ou périr).
- Maude Benoit
Université Laval et Université Montpellier 1
Maude Benoit est candidate au doctorat en science politique à l’Université Laval (Québec) et à l’Université Montpellier 1 (France). Ses recherches portent sur les politiques publiques en agriculture au Canada et dans l’Union européenne. Elle s’intéresse plus particulièrement à l’intégration des préoccupations de développement rural et d’environnement dans l’action publique agricole.
Note de la rédaction : Les textes publiés et les opinions exprimées dans Découvrir n’engagent que les auteurs, et ne représentent pas nécessairement les positions de l’Acfas.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre