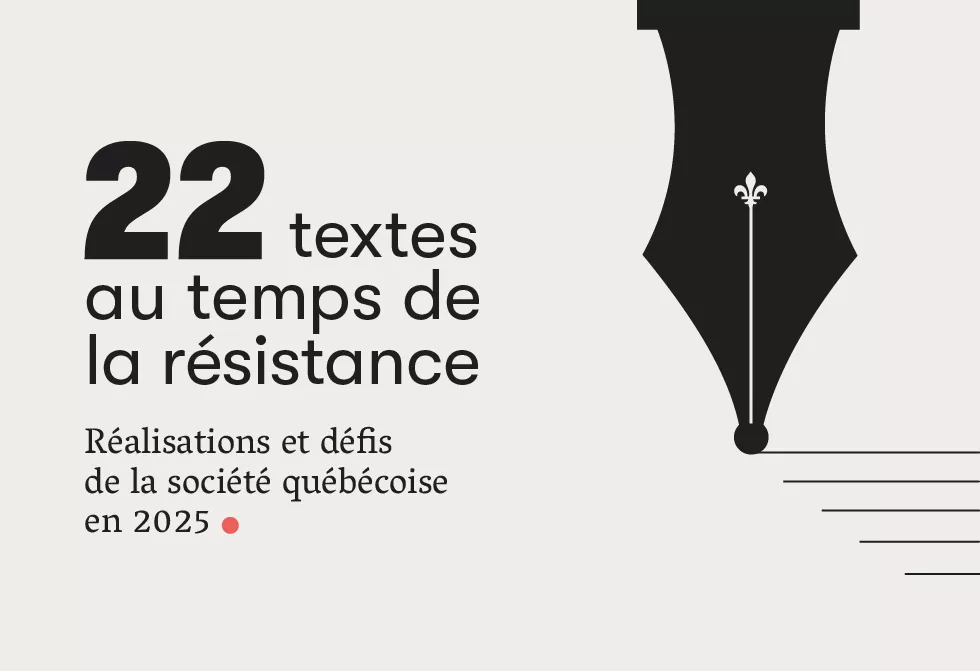Le Québec traverse, une fois de plus, une période d’incertitudes avec l’arrivée d’une nouvelle administration fédérale étasunienne plus imprévisible que jamais. Si l’allié d’hier est l'adversaire d’aujourd’hui, comment pouvons-nous garder le cap dans un monde où les certitudes semblent éphémères et les crises une normalité? Vers quoi se tourner pour naviguer hors de la tempête? Nous répondons : vers ces institutions publiques dont nous nous sommes dotés depuis la Révolution tranquille et qui ont démontré à maintes reprises leur influence notre capacité collective à la résilience.
Les crises se suivent et se ressemblent, du moins en certains points. Elles sont propices aux « bruits » en tout genre, ce qui nous éloigne parfois d’une information fiable et de qualité dont nous avons besoin pour faire des choix éclairés. Déjà, en 2020, nous soulignions l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la propagation de fausses nouvelles et autres désordres informationnels1. Dans le contexte actuel, rien ne porte à croire que la situation ne se soit pas véritablement améliorée.
En 2024, le Forum économique mondial désignait d’ailleurs, de concert avec la polarisation, la désinformation (l’action de partager volontairement des informations erronées, parfois créées de toutes pièces) et de la mésinformation (l’action de partager de mauvaises informationsqui ne sont pas délibérément conçues pour tromper) comme étant les principaux risques mondiaux à surveiller2. Des phénomènes dont la création et le partage sont facilités par les médias sociaux, féroces concurrents des grands médias d’information dits « traditionnels », sans oublier, désormais, l’intelligence artificielle générative.
Cette situation bénéficie à celles et ceux qui remettent en question les fondements de nos sociétés démocratiques, dont les acteurs populistes qui cherchent aussi à miner les contre-pouvoirs. Au Québec, la pandémie leur avait été bénéfique. En raison d’un relatif mécontentement envers les actions gouvernementales, une certaine droite populiste s’était coalisée pour exprimer sa colère3. Depuis, le réalignement de la scène politique québécoise, en cours depuis le début des années 2000 et confirmée lors du scrutin de 20224, entraîne de nouveaux clivages saillants auprès de l’électorat, lesquels sont susceptibles d’être exploités à des fins populistes. Pensons au clivage gauche-droite, à l’immigration, ou encore à la question des changements climatiques.
À la gauche comme à la droite de l’échiquier politique, les institutions politiques sont prises à partie. Elles sont tantôt accusées de faiblesse, tantôt de zèle. Instruments reproducteurs d’inégalités pour les uns, elles seraient plutôt inefficaces et incompétentes pour d’autres. Parfois jugé ringard, leur rôle social est parfois contesté à cette époque où l’individualisme et l’entreprise privée ont la cote.
S’ajoute à ces remises en question individuelles et militantes une intense couverture médiatique où la performance institutionnelle est d’abord traitée sous l’angle des conflits, des ratés et des abus. C’est bien connu : les bonnes nouvelles ne font pas la une. Cette veille journalistique est essentielle en démocratie. Or, en contexte de crise du modèle économique des médias dédiés à l’analyse de l’actualité sociopolitique, elle flirte parfois avec le sensationnalisme pour quelques clics de plus. La ligne est parfois mince entre le rôle de « chien de garde » et l’usage de rhétorique populiste5, dont certains chroniqueurs et stations radiophoniques ont fait leur marque de commerce. En ressort donc une impression d’inefficacité chronique de l’État qui ne permet pas d’apprécier à leur juste valeur le travail réalisé par les institutions publiques et les conséquences de celui-ci pour le bien-être général.
Des indicateurs encourageants
Heureusement, tout n’est pas sombre. Au Canada, selon les données d’Environics Institute, c’est au Québec où l’on retrouve le plus haut taux de satisfaction envers la démocratie6. La confiance envers les gouvernements, les médias et les ONG est également plus grande au Québec, selon les données du Baromètre de confiance Edelman 20257. Par conséquent, bien qu’une certaine frange de la population soit vocale par rapport à son insatisfaction, voire à son cynisme envers les institutions politiques, ce n’est pas l’état d’esprit qui caractérise l’opinion générale.
S’il s’agit d’une bonne nouvelle sur le plan démocratique, cela ne veut pas dire que cette situation est stable. L’exemple des États-Unis montre bien comment les institutions d’une société jugée exemplaire sur le plan démocratique peuvent être attaquées, voire démantelées à vitesse grand V.
Les institutions au cœur du modèle québécois
Dans un contexte de chamboulements, autant sur la scène nationale qu’internationale, le Québec peut miser sur une force souvent sous-estimée que sont ses institutions. Jusqu’à ce jour, ces dernières ont joué un rôle central dans notre développement de la vie sociétale et politique.
En effet, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec viennent spontanément en tête lorsque l’on pense au déploiement du Québec moderne. Il en va de même pour le réseau des CPE, des cégeps, ainsi que celui de l’Université du Québec. La liste pourrait continuer longtemps encore. Pour s’organiser et exister, le Québec a misé sur des institutions phares qui caractérisent aujourd’hui notre « modèle » de société. Elles ont certainement encore un rôle à jouer pour traverser l’actuelle tempête.
Comme le souligne le politologue Stéphane Paquin8, les institutions québécoises ont notamment permis de faire du Québec « le champion de la redistribution en Amérique du Nord », ce qui entraîne des inégalités sociales et économiques moins prononcées qu’ailleurs. C’est aussi un avantage en période de bouleversement économique, comme ce fut le cas lors de la crise financière de 2008. L’auteur souligne aussi que nous formons l’un des peuples les plus heureux au monde. Sur le plan politique, cela n’est pas anodin, sachant que les inégalités et l’insatisfaction alimentent la division et les extrêmes.
Faire société : valoriser nos institutions publiques, sans complaisance
Le développement du Québec moderne s’est fait, particulièrement depuis la Révolution tranquille, en misant sur les institutions phares qui continuent de jouer un rôle important dans la vie sociale et politique. Le passé a permis de constater qu’en grande partie, la résilience du Québec face aux chocs s’explique par leur solidité et leur rôle actif dans plusieurs pans de la société.
En dépit de leur bilan enviable et d’un taux de confiance supérieur à leur égard, elles ne sont toutefois pas exemptées de remises en question. Bien que ces dernières soient évidemment bénéfiques sur le plan démocratique, elles peuvent aussi apporter de l’eau au moulin des mouvements populistes et illibéraux.
Pour faire face à cette nouvelle période d’instabilité, il semble nécessaire de valoriser les institutions et d’en assurer leur développement. Cela commande de rester critique et de chercher à mieux faire les choses. À ce chapitre, s’appuyer sur la science et les données empiriques est plus prometteur que les effets de mode et les croyances. Cela commande aussi de mieux faire connaître les institutions, notamment à travers l’éducation à la citoyenneté, mais aussi par une communication gouvernementale qui fait la pédagogie de l’action publique. Cela passe également, inévitablement, par la valorisation du service public et des personnes qui font vivre ces institutions.
Le développement du Québec moderne s’est fait, particulièrement depuis la Révolution tranquille, en misant sur les institutions phares qui continuent de jouer un rôle important dans la vie sociale et politique. Le passé a permis de constater qu’en grande partie, la résilience du Québec face aux chocs s’explique par leur solidité et leur rôle actif dans plusieurs pans de la société.
- Philippe Dubois
École nationale d’administration publique
Philippe Dubois est professeur adjoint à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) à Québec, une université québécoise de 2e et 3e cycles spécialisée en administration publique. Ses intérêts de recherche portent notamment sur la communication publique et politique, le marketing public ainsi que sur la professionnalisation des communications numériques. Plus largement, il s’intéresse aux défis et enjeux contemporains de gouvernance en contexte politique municipal, québécois et canadien. www.philippedubois.ca
- Katryne Villeneuve-Siconnelly
Université Laval
Katryne Villeneuve-Siconnelly est candidate au doctorat en science politique à l’Université Laval. Ses intérêts de recherche portent sur les concepts d’antisystème, de nationalisme et de populisme, particulièrement en contexte québécois. Elle s’intéresse aussi à leur influence sur les enjeux politiques contemporains et la gouvernance. Ses travaux ont été récompensés notamment du Prix du livre politique de l’Assemblée nationale (2020). www.katrynevs.com
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre