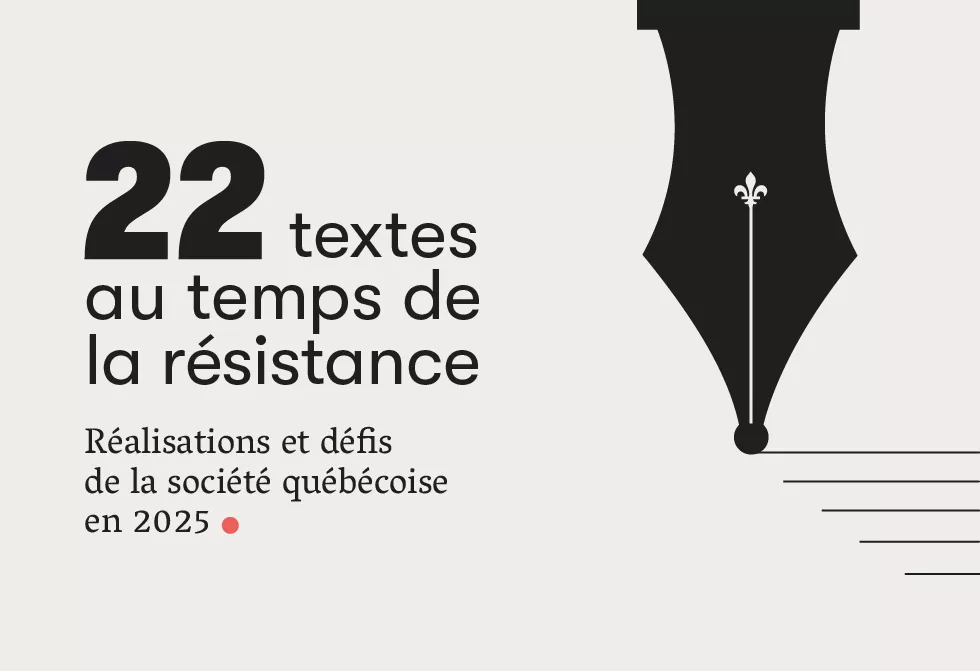La spécificité québécoise par rapport aux professions est remarquable. Peu de juridictions donnent autant de leviers et d’opportunités aux professionnels. C’est tout à notre honneur d’avoir réglementé autant d’occupations critiques pour la collectivité. Les ordres et leurs membres doivent se montrer à la hauteur de leurs statuts. En retour, les prérogatives des ordres doivent être bien comprises par le grand public. Comme société, nous avons intérêt à bien réfléchir aux conditions dans lesquelles il est souhaitable d’encadrer un groupe professionnel.
Une proposition séduisante...
Le 11 octobre 2024, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville dévoile un rapport d’enquête sur l’école Bedford, située dans l’arrondissement Côte-des-Neiges à Montréal. Le rapport fait la lumière sur les pratiques d’un groupe d’enseignants, exposant leurs pratiques antipédagogiques ainsi que le climat de peur et d’intimidation qu’ils ont instauré dans l’école. Cette controverse a remis sur le tapis la proposition déjà ancienne d’avoir recours au système professionnel québécois pour mieux encadrer le métier d’enseignant. Dans la foulée de cette affaire, plusieurs experts ont suggéré la création d’un ordre professionnel des enseignants1.
Cette proposition est séduisante. Bien qu’il soit difficile de comparer rigoureusement toutes les juridictions entre elles, et de déclarer un « champion » du système professionnel, le Québec est l’une des juridictions dans le monde ayant le plus recours à ce mécanisme. Fort de ses 46 ordres comptant plus de 400 000 membres, il a largement recours aux ordres professionnels, que ce soit pour réguler la pratique des notaires, des médecins ou des ingénieurs.
Un ordre, c’est une institution reconnue par la loi qui veille à encadrer une profession, notamment pour s’assurer qu’elle protège le public. Plutôt que d’obéir à des impératifs de rentabilité ou de loyauté envers l’employeur, les professionnels sont d’abord et avant tout au service de la collectivité. Les ordres sont généralement constitués pour encadrer les occupations nécessitant une expertise de pointe.
Alors, pourquoi ne pas étendre cette législation au système d’éducation?
Devrions-nous créer un ordre professionnel des enseignants?
À première vue, le cas de l’école Bedford semble justifier la création d’un ordre professionnel. N’est-il pas clair que l’enseignement nécessite des compétences de pointe, et que les lacunes de certains enseignants peuvent facilement compromettre le développement des enfants? Les enfants ne sont-ils pas l’un des groupes les plus vulnérables de la société?
En théorie, tous les ingrédients justifiant la professionnalisation semblent donc réunis. Mais en pratique, la traduction de ces constats en mécanismes légitimes du système professionnel soulève d’importants enjeux.
Un problème souvent négligé dans de telles propositions concerne les droits exclusifs qui reviendront aux membres de l’ordre. Pour qu’un ordre professionnel soit pleinement fonctionnel, il doit y avoir des activités ou des titres réservés à ses membres. Mais quelles activités pouvons-nous réserver à des enseignants, sans toutefois aller trop loin?
Depuis 1973, cette question est particulièrement importante au Québec. Avant cela, au Québec, on ne se posait pas vraiment la question de savoir si les activités réservées étaient légitimes. C’est parce que le système de l’époque était corporatiste : la pratique exclusive servait notamment à défendre les intérêts des professionnels. Comment peut-on rendre les ingénieurs plus prospères? Réservons-leur l’inspection et la supervision des grands travaux sur les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, et ainsi de suite2. Comment peut-on rendre les médecins plus prospères? Réservons-leur les accouchements, le suivi du traitement des maladies et les chirurgies3. La question philosophique de savoir si une action relève spécifiquement du génie, de la médecine ou de toute autre profession n’était pas primordiale.
Depuis 1973, les choses ont changé. On cherche désormais à établir, dans les lois professionnelles, des activités réservées qui correspondent spécifiquement à l’expertise des professionnels, et qui auront pour effet de mieux protéger le public. Comme mon collègue Thomas Mekhaël et moi l’expliquons dans le livre L’éthique et le génie québécois, des actes réservés qui ne respectent pas ces critères sont une source d’injustice. Si une personne est pleinement compétente pour accomplir certains mandats, le système ne devrait pas l’empêcher d’agir.
Pour revenir au cas des enseignants, une des premières questions qu’il faudrait donc se poser, c’est : que veut-on empêcher les non-enseignants de faire, exactement? Ou encore, quels actes devraient être réservés à des enseignants? Par exemple, il ne semble pas souhaitable de réserver l’activité « transmettre un savoir à une personne de moins de 17 ans » aux enseignants. Si cette activité était réservée aux enseignants, cela signifierait que tout parent qui éduque ses enfants fait de l’exercice illégal de l’enseignement. Ce n’est pas le résultat souhaité!
Dans le même esprit, la tâche « diriger une activité dans une classe composée d’élèves de moins de 17 ans » pourrait facilement brimer la liberté de travail de certaines personnes. Prenons un exemple simple. Si un enseignant est malade, et que l’on peine à trouver un autre professionnel pour le remplacer, est-il acceptable de demander à un surveillant de l’école de faire jouer un film en classe, ou de superviser une séance de lecture? Devrait-on interdire de telles pratiques? On voit mal en quoi de telles activités occasionnelles nécessitent le recours à un professionnel.
Le modèle ontarien pourrait dénouer l’impasse entourant les activités réservées aux enseignants. Dans la province voisine, ce ne sont pas les activités des enseignants qui sont réservées, mais les postes. Grosso modo, un poste permanent dans une école publique primaire ou secondaire doit revenir à un membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
Or, il faudrait évaluer si cette option est cohérente avec le système professionnel québécois. Au Québec, selon l’article 26 du Code des professions, les droits exclusifs d’une profession sont intimement liés à ses activités critiques pour la protection du public. Cela nous ramène donc directement à la question précédente : quels actes devraient être réservés à des enseignants?
Même le fait de réserver un titre aux enseignants peut soulever des questions. Si vous avez recours à un professeur privé de piano pour vos enfants, mais que cette personne n’a pas suivi une formation en enseignement, doit-on empêcher cette personne de s’annoncer comme un enseignant ou un professeur? Veut-on réserver certains titres spécifiques dans l’enseignement, ou tous les titres?
La spécificité québécoise
La spécificité québécoise par rapport aux professions est remarquable. Peu de juridictions donnent autant de leviers et d’opportunités aux professionnels. C’est tout à notre honneur d’avoir réglementé autant d’occupations critiques pour la collectivité. Les ordres et leurs membres doivent se montrer à la hauteur de leurs statuts.
En retour, les prérogatives des ordres doivent être bien comprises par le grand public. Comme société, nous avons intérêt à bien réfléchir aux conditions dans lesquelles il est souhaitable d’encadrer un groupe professionnel.
Car, pour reprendre une expression populaire, le diable est dans les détails…
Références
- Daoust, Marc-Kevin et Thomas Mekhaël. 2024. L’éthique et le génie québécois. Presses de l’Université du Québec
- Goulet, Denis. 2022. Histoire du Collège des médecins du Québec. Septentrion
- Séguin, Charles. 2024. « Faut-il un ordre professionnel des enseignants au Québec? » Radio-Canada.ca, 27 octobre 2024, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2115400/ordre-professionnel-enseignants-bedford-education-syndicat>
- Marc-Kevin Daoust
École de technologie supérieure
Marc-Kevin Daoust est professeur d’éthique à l’École de technologie supérieure. Il est également membre régulier du Groupe de recherche interuniversitaire sur la normativité (GRIN) et de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval (IDÉA). Ses recherches actuelles portent sur l'éthique des institutions québécoises du génie, les enjeux philosophiques entourant l'élaboration de recommandations dans le secteur public, et la pertinence des idéaux en éthique et en épistémologie.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre