À un moment donné, je me suis demandée : « Qu’est-ce que je raconte tout le temps? » Et je l’ai mis par écrit. J’ai cumulé les répétitions de remarques, qui sont devenues des « principes de rédaction », jusqu’à en faire un guide. Il n’y avait pas ou il y avait peu, à l’époque, d’ouvrages pour aider les chercheurs et chercheuses à vulgariser.
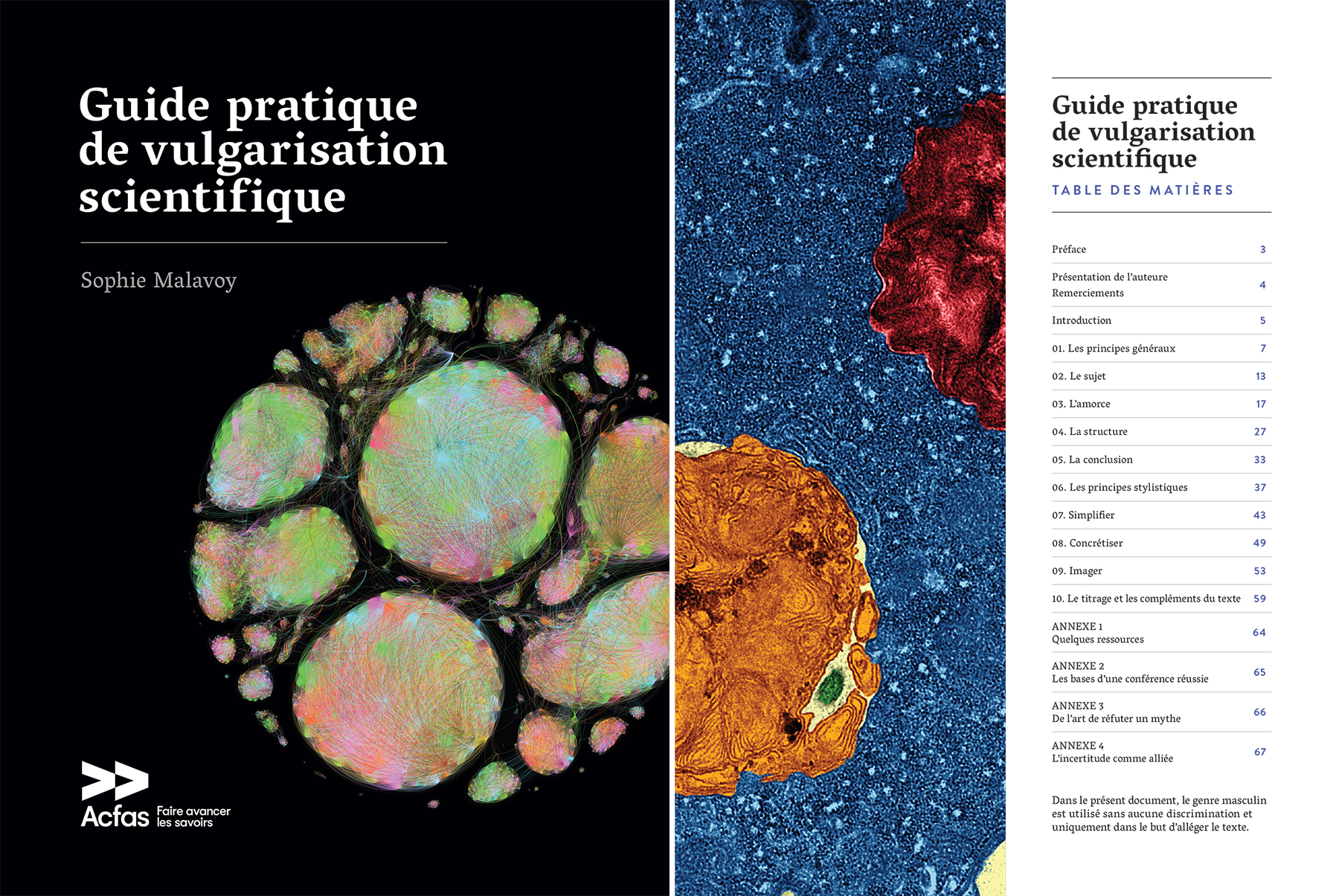
Ce guide très concret s'adresse à plusieurs publics. Aux étudiant-e-s qui ont à rédiger des travaux efficacement, aux chercheur-se-s qui ont à rendre leurs travaux intelligibles et à toute personne désireuse de communiquer un savoir avec fluidité. Qu’il soit question d’un article, d’un texte court destiné au Web et même d’une présentation orale, l’ouvrage fournit des conseils, toujours illustrés d’exemples, tant sur la manière d’accrocher dès la première ligne que sur celle de conclure avec une chute qui ne laissera pas tomber. Publié pour la première fois en 1999, l’ouvrage n’a pas perdu, vingt ans plus tard, un gramme de sa pertinence, et il en aurait même gagné en ces temps où les connaissances sont abondantes et l’attention, sursollicitée. De plus, la nouvelle édition profite d’une révision de l'auteure, d'une mise en page améliorée, avec la présence de caricatures de l’illustrateur Jacques Goldstyn et d’images de sciences issues du concours La preuve par l’image de l’Acfas.
À lire aussi : « La force de l'amorce! », par Sophie Malavoy sur RaccourSci.com.
Johanne Lebel : La 2e édition du Guide pratique de vulgarisation scientifique a été lancée le 21 janvier 2020, mais c’est en 1999, alors que vous étiez rédactrice en chef du présent magazine, que le guide a vu le jour. Qu’est-ce qui vous a initialement motivée à rédiger cet ouvrage très concret et toujours pertinent?
Sophie Malavoy : J’ai participé en 1984 à la création du magazine de l’Acfas, alors dénommé Interface, avec le directeur général d'alors, Guy Arbour. Mon travail consistait, entre autres, à éditer les textes en collaboration avec leurs auteurs : des journalistes ou des chercheurs. Avec ces derniers, c’était beaucoup de travail. Des fois, on faisait jusqu’à neuf versions d’un texte. Et c’était souvent les mêmes choses qui revenaient : les textes manquaient d’exemples, d’éléments concrets, entre autres. Si le chercheur écrivait : « Beaucoup d’énergie a été relâchée… », je demandais : « Mais quelle quantité? », ou encore, pour une « grande superficie détruite par les incendies de l’été… », je voulais que l’on précise la dimension. L’amorce du texte souvent n’en était pas une, alors que c’est elle qui fait vivre ou mourir le texte. Les chercheurs ont parfois le réflexe d’y exposer leur programme de recherche, alors que pour accrocher le lecteur, il faut y aller directement avec les idées fortes, les résultats, les questionnements.
À un moment donné, je me suis demandé : « Qu’est-ce que je raconte tout le temps? » Et je l’ai mis par écrit. J’ai cumulé les répétitions de remarques, qui sont devenues des « principes de rédaction », jusqu’à en faire un guide. Il n’y avait pas ou il y avait peu, à l’époque, d’ouvrages pour aider les chercheurs et chercheuses à vulgariser.
Johanne Lebel : Quels sont les défis particuliers pour les chercheurs quand ils passent d’un écrit savant à un texte de vulgarisation scientifique?
Sophie Malavoy : Changer d’univers! Ils ne saisissent pas toujours toute l’ampleur du travail de reformulation, ils sous-estiment l’effort de communication que cela représente. On ne s’adresse pas de la même façon à un public généraliste qu’à une assemblée de pairs réunie dans un colloque; les motivations sont complètement différentes. L’objectif dans le premier cas n’est pas de défendre sa crédibilité et la validité de ses travaux, mais d’être capable de s’exprimer efficacement auprès des profanes. La crédibilité et surtout l’impact que l’on aura auprès du grand public dépendront plus des aptitudes à communiquer que du fait d’avoir publié dans une revue prestigieuse.
Souvent, les chercheurs pensent maîtriser les règles de la communication parce qu’ils donnent des cours ou prennent régulièrement la parole dans des séminaires et des congrès. Mais c’est beaucoup plus complexe que ça. D’abord, il faut prendre le temps d’apprendre à communiquer autrement. Cela demande du temps, oui [rires], ce que beaucoup de chercheurs n’ont pas. Et puis, il faut aimer ça. On ne peut et on ne doit pas faire de la vulgarisation scientifique par devoir. Pour bien vulgariser, il faut y prendre du plaisir, et pour y prendre du plaisir, il faut être suffisamment efficace pour obtenir un minimum de retour positif du public. Quand certains chercheurs entendent parler de vulgarisation, ils soupirent, ils disent que c’est compliqué. Mais c’est souvent parce qu’ils n’ont jamais de retour positif sur ce qu’ils font, et ils considèrent alors l’exercice comme un fardeau. Résultat : ils ne seront jamais bons, jamais. À l’inverse, pour ceux qui sont bons ou juste assez bons, un engrenage se met en marche : ils produisent des effets, ils se sentent appréciés, donc ils cherchent d’autres moyens d’améliorer leur communication pour accrocher encore plus les gens. Et ainsi de suite.
Pour bien vulgariser, il faut y prendre du plaisir, et pour y prendre du plaisir, il faut être suffisamment efficace pour obtenir un minimum de retour positif du public. Quand certains chercheurs entendent parler de vulgarisation, ils soupirent, ils disent que c’est compliqué. Mais c’est souvent parce qu’ils n’ont jamais de retour positif sur ce qu’ils font, et ils considèrent alors l’exercice comme un fardeau.
En fait, ceux qui deviennent de bons vulgarisateurs, ce sont ceux qui tripent, ceux qui développent des idées de vulgarisation. Ça devient comme une passion. Certains, par exemple, vont utiliser des accessoires! Je me souviens de cette main de chimpanzé en peluche qu’une vétérinaire a montrée lors de sa conférence pour nous faire réaliser sa taille par rapport aux mains humaines. Impressionnant!
Vulgariser, à première vue, ça n’a l’air de rien, mais cela exige un important changement de perspective.
Johanne Lebel : C’est-à-dire?
Sophie Malavoy : Déjà, il faut que les chercheurs abandonnent l’idée qu’ils parlent à leurs pairs, et ils doivent comprendre qu’ils ne sont pas là non plus pour enseigner. La vulgarisation, c’est une « discussion » pour essayer de donner du sens à ses travaux de recherche, dans un contexte beaucoup plus large, dans le contexte de la société.
Prenons l’exemple d’un chercheur qui travaille sur les matériaux moléculaires et qui veut s’adresser au grand public. Hum! « L’agencement moléculaire à l’échelle du nanomètre », ça ne touchera pas grand monde [rires]. Il doit faire en sorte que ça intéresse. Par exemple, en racontant une anecdote de laboratoire sur la « fabrication » de ces molécules, ou encore, en trouvant une bonne analogie avec un jeu de blocs. Essayer de capter l’attention, faire des liens pour toucher, créer un contact avec ce nouveau public. C’est ce changement de perspective qui est difficile. Il faut abaisser ses défenses.
Johanne Lebel : Comment en arriver à bien raconter?
Sophie Malavoy : Bien raconter, c’est construire une bonne histoire. D’abord, il faut y mettre de l’humain. Quand je dis que le style est aussi important que le contenu, j’y crois vraiment. Une histoire de recherche utilise la matière scientifique : hypothèse, données, résultats. Mais on doit y ajouter d’autres éléments qui l’entourent : les anecdotes, le travail avec les collègues, les problèmes de financement, le terrain qui résiste, la compétition, les incertitudes. C’est tout ça qui fait une histoire. La couleur! L’enrobage!
C’est un tout! Pour qu’une histoire m’intéresse, il faut qu’on me rejoigne. Une chercheuse qui travaille sur un sujet très pointu ne m’atteindra pas d’emblée. Elle doit m’amener à écouter son histoire, donc me capter. Il faut susciter une réaction, une émotion. Sinon, on n’ouvre pas la porte.
L’auditoire ou le lecteur veulent connaître plus que les résultats du chercheur. Ils veulent savoir que, pendant des années, il s’est battu parce que personne ne voulait l’écouter. Ou alors, que tout le monde voulait l’écouter, mais qu’il s’était trompé totalement. C’est ça qui fait l’histoire. Les chercheurs n’ont pas l’habitude de communiquer ces histoires, ils présentent les données scientifiques... comme dans un article scientifique. Je dirais aussi qu’il faut y aller par petites bouchées.
L’auditoire ou le lecteur veulent connaître plus que les résultats du chercheur. Ils veulent savoir que, pendant des années, il s’est battu parce que personne ne voulait l’écouter. Ou alors, que tout le monde voulait l’écouter, mais qu’il s’était trompé totalement. C’est ça qui fait l’histoire.
Johanne Lebel : Que voulez-vous dire?
Sophie Malavoy : Il faut alterner, tricoter : un peu de science, un peu de contexte; une donnée de recherche, une anecdote de « laboratoire ». Et ainsi de suite. On fait du montage, on découpe l’histoire pour maintenir l’attention. Et ne surtout pas copier le type de montage d’un article scientifique – introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion. Non.
Le chercheur Philippe Archambault vulgarise très bien, c’est un maître en la matière. Laissez-moi vous donner un exemple de sa façon de faire. Dans le cadre d’études sur la biodiversité, il part un jour en Antarctique pour étudier les effets du vêlage d’un glacier sur la biologie marine. Une chance incroyable! Le vêlage, en glaciologie, c’est l’accouchement d’icebergs par un glacier. Un gros glacier, donc, s’était cassé, et la partie qui s’était détachée avait raboté tout le fond de mer. Philippe commence ainsi : « J’imagine que vous pensez qu’en Antarctique, un spécialiste de la biodiversité ne sert à rien parce qu’il n’y a rien pour lui… Au contraire, il y a beaucoup de choses. Parce que c’est de cette biodiversité que dépendent toutes les pêches des eaux plus chaudes. Ce qu’on ne sait pas forcément. » Dès le départ, il nous a accrochés. Un art.
Il enchaîne : « Je vais vous raconter une aventure. J’ai eu la chance d’aller en Antarctique, donc, sur un bateau de recherche, une mission internationale. Il y avait 60 pays et 120 chercheurs, imaginez! ». Puis, il nous amène sur le bateau, en vidéo, pendant quelques minutes. Il narre : « Là, on approche, et on voit les glaces. Il fait très froid. » Il nous fait visiter les labos. Après, il revient sur sa recherche et expose brièvement son questionnement : ce grand glacier qui a raclé le fond de la mer... quels sont les impacts? Est-ce que ce sont des évènements fréquents?
Ensuite, il revient sur le côté humain. L’équipage russe du navire, et l’apprentissage de quelques mots dans cette langue. Puis, retour à la science. On se rend compte que sa mission n’est pas évidente. Il travaille presque jour et nuit. Et il nous le fait vivre et sentir! Il nous emmène avec lui dans l’unité de pilotage du submersible robotisé qu’il utilise et évoque sa fébrilité devant ce qu’il découvre. « J’y ai passé 16 heures. »
Un récit intrigant, instructif, divertissant.
Tout le monde n’a pas eu des aventures aussi « chaudes » qu’un voyage au pôle Sud, mais la recherche est faite par des humains, pour des humains, et tous les chercheurs ont de l’humain à raconter. Des récits d’équipes de travail, des réactions d’autrui à ses résultats, des moments où ça marche, des moments où on se trompe complètement, des moments où on part sur une autre piste. Ce n’est pas compliqué, finalement, mais il faut d’emblée le comprendre, s’y engager.
...la recherche est faite par des humains, pour des humains, et tous les chercheurs ont de l’humain à raconter. Des récits d’équipes de travail, des réactions d’autrui à ses résultats, des moments où ça marche, des moments où on se trompe complètement, des moments où on part sur une autre piste.
Après, il faut trouver des éléments pour « imager ». C’est l’expression que j’emploie dans le guide. Imager pour introduire du concret, pour rendre le texte plus vivant. Ainsi, chaque fois qu’on mentionne un terme technique, c’est important de donner quelques exemples. Sinon, tu fournis du contenu, mais sans « contenant ». Marais et marécages, étangs et tourbières sont comme des reins pour la nature… J’aime bien ce type d’analogie, par exemple.
Johanne Lebel : Et à un moment donné, il faut bien passer du guide et à la pratique…
Sophie Malavoy : Dans certaines formations que je donne, il y a trois heures de théorie le matin et trois heures de pratique l’après-midi. L’après midi, c’est fascinant, parce tout a été expliqué le matin, et là, il faut expérimenter les difficultés de la pratique. Je dis au chercheur : « Tu veux expliquer tel truc? Tiens, on pourrait utiliser une amorce comme ça. » On peut souvent trouver assez aisément trois ou quatre amorces possibles. C’est ainsi qu’on découvre concrètement ce qu’est la vulgarisation. Un guide, c’est bien, il expose les bases, mais après, il faut aller nager fréquemment.
Johanne Lebel : Vous mentionnez souvent l’importance d’être concret, et si votre guide possède un atout, c’est bien celui-là : il est abondamment illustré d’exemples!
Sophie Malavoy : Je répète sans cesse que la base de la vulgarisation, justement, ce sont les exemples. Il fallait donc que j’en donne dans mon propre guide (pas le choix!) et beaucoup [rires]! Quelques illustrations sur des sujets variés, et déjà, les lecteurs et lectrices peuvent se lancer en vulgarisation. Mais le mieux, c’est qu’ils suivent des formations où ils peuvent échanger entre eux, en parler.
Johanne Lebel : Accoucher de l’écrit par la parole… cela peut sembler contre-intuitif.
Sophie Malavoy : Mais c’est ça le truc! Pour vulgariser, il ne faut pas se mettre à lire et à écrire. Il faut parler. C’est pour ça que je dis « d’utiliser » son entourage! Ce n’est pas difficile, ça ne demande pas beaucoup de temps : tu ne discutes pas avec tes pairs, mais avec ta famille ou avec des amis, idéalement des personnes qui ne sont pas complaisantes! Et là, tout naturellement, on fait ressortir des éléments. Il faut parler!
Un autre grand défi, c’est de ne pas trop en mettre, de trouver un angle. Les chercheurs pensent que pour vulgariser, ils doivent résumer leurs travaux. Mais il faut élaguer, et élaguer, ce n’est pas évident. Il faut isoler le message principal et ce qui est pertinent. Pour moi, vulgariser, c’est l’art du compromis. On omet certains trucs, on choisit un terme courant même s’il est moins exact que le terme scientifique, etc.
Les chercheurs pensent que pour vulgariser, ils doivent résumer leurs travaux. Mais il faut élaguer, et élaguer, ce n’est pas évident. Il faut isoler le message principal et ce qui est pertinent. Pour moi, vulgariser, c’est l’art du compromis.
Une histoire, c’est une sélection. Raconter, c’est choisir, couper, découper. Mettre de l’avant certains éléments, et en retirer d’autres. C’est comme si je te croisais dans la rue : « Qu’est-ce que tu fais de bon? » Et là, tu commences le verbatim : « Ah bien, mardi dernier, j’ai fait ci, j’ai fait ça, je suis allée là, je suis allée manger ceci. Mercredi, j’ai fait ça. » Je ne veux pas savoir ça. Je veux connaître un élément phare, un élément marquant de ta semaine. Je ne veux pas tout savoir. Je veux une bonne histoire, quelque chose qui t’a marquée.
Johanne Lebel : Et c’est important, la vulgarisation scientifique, pour vous?
Sophie Malavoy : J’aime beaucoup la méthode scientifique, et j’ai d’ailleurs une formation scientifique. Ma mission, c’est de diffuser la science et la méthode scientifique. Mais, par moments, je vais me lancer dans des trucs un peu plus irrationnels… et tant mieux! Il faut que les scientifiques comprennent ce qu’il y a dans la tête des gens, pourquoi ils ont des idées si arrêtées. Ils doivent trouver l’argument pour entrer en discussion avec ces personnes, évoquer les valeurs sur lesquelles ils se basent. Et ça, c’est essentiel, parce qu’il faut rejoindre les gens en passant par ce qui les touche. Mais il y a des personnes que tu ne pourras jamais changer : les climatosceptiques, les conspirationnistes, les antivaccins, tout ça, tu ne feras rien avec elles.
Oui, il y a l’absence de connaissances, l’ignorance des gens, mais ce qui m’inquiète plus, c’est notre indifférence face à l’ignorance. C’est grave, parce que c’est une attitude. Ce n’est plus juste un état d’être ignorant, c’est l’attitude « je m’en sacre! » Il faut casser ce comportement, sinon on ne changera rien. Il y a comme une carapace qui s’est créée, parce que, a priori, tu n’as pas besoin de science pour vivre. Mais la science, c’est quand même pas mal utile. Et puis, surtout, tu découvres un autre monde. Ça suscite l’émerveillement!
Johanne Lebel : Il faut peut-être parler de connaissances au lieu de science? Parce que les connaissances aident à mieux vivre.
Sophie Malavoy : Oui! Connaître, c’est comprendre le monde, comprendre comment ça fonctionne. En fait, avec la science, c’est comme si on te mettait des lunettes et que tu voyais autre chose. Donc, tu élargis ton monde. Un recul au niveau macroscopique qui permet de mieux saisir le microscopique. Tu penses voir telle chose et on t’explique que ce n’est pas ça, que c’est une illusion, que ce qui se passe en réalité, c’est autre chose. C’est enchanteur dans le sens où ça ouvre vers du fantastique, vers quelque chose d’incroyable.
En fait, avec la science, c’est comme si on te mettait des lunettes et que tu voyais autre chose. Donc, tu élargis ton monde. Un recul au niveau macroscopique qui permet de mieux saisir le microscopique.
Découvrez toutes les actions en vulgarisation scientifique proposées par l'Acfas : https://www.acfas.ca/activites/vulgarisation
- Sophie Malavoy
Coeur des sciences, UQAM
Ingénieure diplômée de l’École nationale supérieure de chimie de Paris et de l’École Polytechnique de Montréal, Sophie Malavoy a cumulé plus de 30 ans d’expérience en vulgarisation scientifique. Depuis 2005, elle dirige le Coeur des sciences, un centre culturel scientifique mis sur pied par l’Université du Québec à Montréal. Elle fut auparavant réalisatrice à l’émission de télévision Découverte de Radio-Canada et rédactrice en chef/journaliste/réalisatrice des émissions Zone Science et Zone X à Télé-Québec. De 1984 à 1998, elle a occupé le poste de directrice et rédactrice en chef du Magazine de l’Acfas.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre




