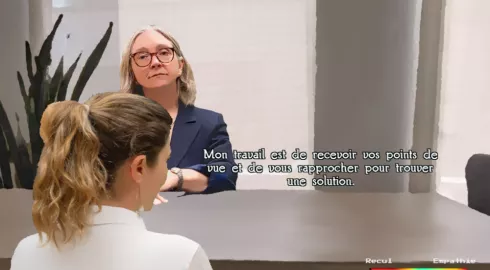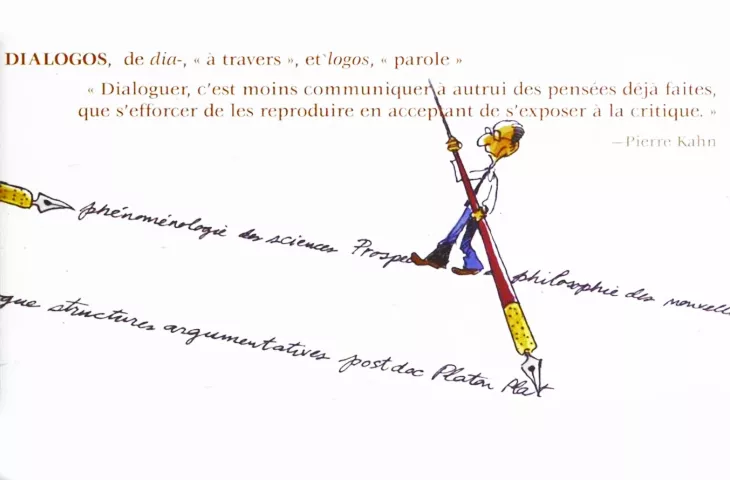Le gestionnaire du futur ne pourra être celui qui licencie en masse tout en se préparant un atterrissage doré, ni l'omnipotent stratège conducteur « scientifique » d'organisations passives. Ou il sera l'humble catalyseur de la synergie des compétences entre employés et experts cadres, ou il fermera boutique devant ceux qui sauront l’être.

Dans les années 1970, le gestionnaire rêvé est encore celui de Frederick Taylor, d’Henri Fayol et de Peter Drucker : le personnage pétri de gestion scientifique, le leader dynamique oscillant entre planifier, organiser, coordonner, décider et mobiliser les foules d'employés subjugués par son savoir.
Puis vient la « révolution » menée par les Henry Mintzberg et Cie dans les années 1980. Il est alors question de « régler son compte » au gestionnaire rationnel, travaillant scientifiquement à planifier – organiser – décider. Le gestionnaire se voit alors comme un pourvoyeur non seulement de ressources et d'informations, mais aussi d’une culture cimentant les employés comme membres « enthousiastes et actifs », visant l’excellence et participant d'une aventure commune.
Avec les années 1990 et leur cortège de nouveaux creux de vague attribués à la crise mondiale, puis à la mondialisation… et obligeant, s'écrie-t-on, à prendre des virages dramatiques, apparaît le gestionnaire « de la compétitivité ». Non plus celui qui sait planifier, organiser, décider… ou créer une bonne culture d'entreprise, mais maintenant celui qui sait prendre les décisions difficiles et jouer sur le seul terrain de compétition que le management de type US (celui du « how to make money ») connaît bien : guerres des prix et réductions des coûts. Commence alors l'ère des gestionnaires-tronçonneuses, qui cherchent à satisfaire la boulimie infinie des nouveaux rois du business mondialisé : les actionnaires. C’est le règne du gestionnaire « financier », dont l'apothéose culmine dans les scandales Enron et consorts, avant de se confirmer avec le tsunami de produits financiers toxiques de haute spéculation.
Ces cadres sont bien plus des « actionnaires principaux » que des gestionnaires salariés mandatés par des propriétaires pour bien… gérer, c’est-à-dire se soucier autant de faire de bons produits que de faire de l'argent. Leur intérêt premier est plutôt de gonfler au maximum et au plus vite, par tous les moyens (en particulier les licenciements et les délocalisations) la valeur de l'action, puis de se retirer. Avec des salaires et primes se chiffrant en centaines, voire en milliers de fois les revenus de l'employé moyen, on est loin des exhortations de Henry Ford I estimant comme acceptable à un maximum de 20 p. 100 la différence entre le salaire des patrons et celui des employés!
Un très gros problème de légitimité se pose aujourd'hui pour cette nouvelle espèce de gestionnaire. Et ce, bien plus que pour ses collègues du « modèle » nippon et européen du Nord, modèle où les différences de revenus sont considérablement moindres et où l'objectif strictement financier passe après celui de l’harmonie entre employés et dirigeants ou de la qualité des produits et services.
Le gestionnaire du futur ne pourra être celui qui licencie en masse tout en se préparant un atterrissage doré, ni l'omnipotent stratège conducteur « scientifique » d'organisations passives. Ou il sera l'humble catalyseur de la synergie des compétences entre employés et experts cadres, ou il fermera boutique devant ceux qui sauront l’être. Et pour en arriver là, il nous faudra revoir de fond en comble ce que nous enseignons dans nos écoles de gestion.
L’essentiel sera de moins fournir l’illusion de détenir des connaissances scientifiques et des certitudes, de moins mathématiser, et d’intégrer davantage les sciences humaines et sociales, qui, elles, donnent plus à penser : prudence, sens, finalité, humilité… ce que la prestigieuse d’entre les plus prestigieuses écoles de business, la Harvard Business School, entre autres, a déjà commencé à faire en annonçant la refonte de ses contenus. Mais les écoles de gestion auront-elles le réel courage d’une autocritique fondamentale?
- Omar Aktouf
HEC MontréalPrésentation de l’auteurOmar Aktouf est professeur titulaire à HEC Montréal. Son expertise est du côté du management comparé (international et interculturel) tout comme des questions de management dans les sciences de la vie, en économie et dans la gestion par projet.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre