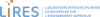L’enseignement supérieur (ES) est un champ d’études et de pratique qui s’est développé au fil des siècles notamment grâce aux collaborations internationales (Lafont, 2016) et à la mobilité des savoirs et des savants (Spychala, 2022). Même si, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les collaborations et la mobilité encouragent l’utilisation de l’anglais (Bégin-Caouette et coll., 2023), le français demeure une langue d’enseignement et de communication scientifique qui rassemble 321 millions de locuteurs, dont 132 millions de personnes apprenantes (OIF, 2022). Les États francophones et leurs établissements multiplient d’ailleurs les ententes de coopération et de mobilité (Burgun, 2023) afin de contribuer à l’émergence d’une Francophonie scientifique (AIFS-AUF, 2022). La consolidation de cet espace doit reposer sur des collaborations réciproques entre le Sud et le Nord, ce qui constitue un défi alors que l’on note que les collaborations sont marquées à la fois par des déséquilibres structurels (Garneau et Bouchard, 2013) et des dynamiques néocoloniales (Haag, 2012). Malgré la fracture numérique (Lythreatis et coll., 2022), les technologies émergentes pourraient encourager des mobilités internationales plus accessibles et inclusives (Selmer et coll., 2021). Le présent colloque vise à explorer les dimensions et enjeux des collaborations internationales en ES. L’on invite les chercheur·ses, les étudiant·es et les praticien·nes à communiquer les résultats de leurs travaux et leurs réflexions sur l’un ou l’autre des thèmes suivants : l’importance de l’ES pour le développement des sociétés francophones; les dynamiques de pouvoir dans les collaborations scientifiques et les mobilités, notamment Sud-Nord; les mécanismes favorisant une internationalisation éthique et transformatrice de l’ES; la promotion du français en ES et en recherche; les collaborations transnationales au service de la formulation de réponses aux grands défis du 21e siècle.
Du mardi 6 au jeudi 8 mai 2025