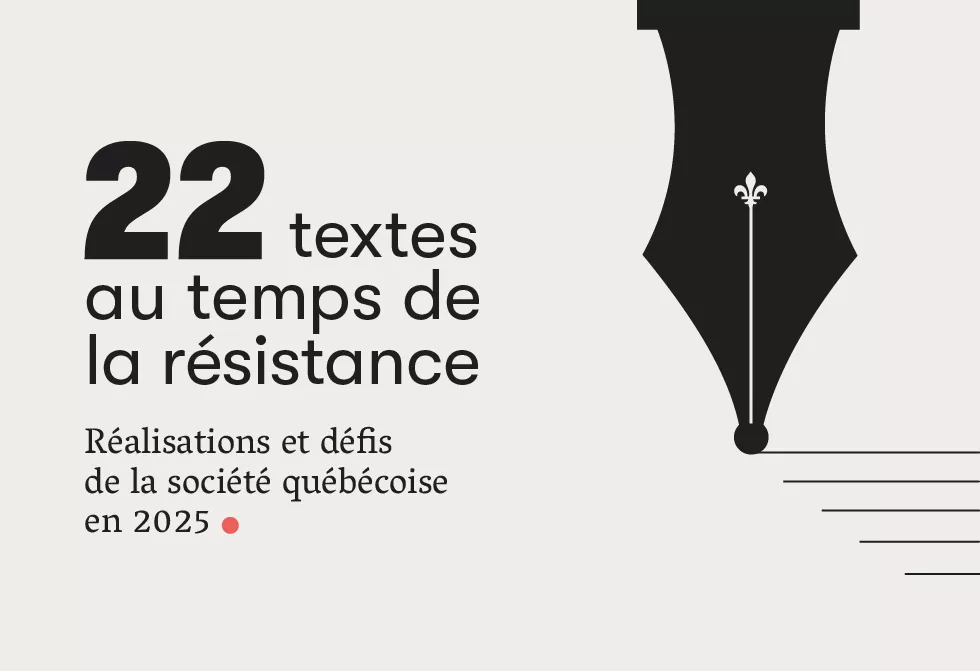L’année 2023-2024 a marqué la « découverte » de l’immigration temporaire dans l’espace politique québécois. À grands traits, font partie de cette catégorie les travailleurs immigrants détenant des permis de travail ouverts ou fermés, les étudiants internationaux, les demandeurs d’asile en attente de détermination de statut et les visiteurs. Pendant longtemps, c’étaient les organismes d’intégration et tous les autres acteurs de l’écosystème de l’immigration qui portaient attention à cette population. Puis, la croissance du nombre de résidents temporaires est devenue particulièrement visible à la fin de la pandémie de COVID-19, et elle a mis cette population à l’ordre du jour politique et médiatique.

Pour le gouvernement et plusieurs acteurs politiques, la croissance de l’immigration temporaire est le signe d’une perte de contrôle du Québec en matière migratoire, duquel découle le besoin de la province de rapatrier encore plus de pouvoirs en provenance d’Ottawa. Pourtant, les acteur·trices de terrain, les chercheur·euses et les personnes immigrantes elles-mêmes entendent un autre son de cloche : cette croissance est le signe que le Québec est bel et bien devenu une des provinces où se vit le plus de précarité migratoire au pays.
La précarité migratoire se profilant au Québec englobe : des permis temporaires à conditionnalité élevée, des changements rapides aux rares programmes permettant d’accéder à la résidence permanente et un accès différencié aux droits sociaux en fonction des statuts migratoires. Cette réalité, encore trop invisibilisée dans les débats publics, remet en question les bases du contrat social de notre société distincte.
Une croissance marquée des permis fermés
Partout au pays, les recherches ont montré que les travailleurs étrangers détenant des permis de travail fermés – à savoir des permis les liant à un seul employeur – sont parmi les plus précarisés. On ne compte plus les témoignages, les études et les rapports, y compris celui du rapporteur spécial de l’ONU, qui montrent les effets délétères de ce type de permis sur les droits des travailleurs et, de façon plus générale, sur les conditions de travail dans certains secteurs d’emploi, tels que l’agriculture ou la transformation alimentaire.
Les débats récents sur l’immigration temporaire au Québec ont souvent fait abstraction du fait que la province dépasse maintenant l’Ontario dans cette catégorie. En 2024, ce sont 52 320 nouveaux permis fermés qui ont été accordés au Québec, une augmentation de 354 % par rapport à 2015. En comparaison, en Ontario, longtemps le principal utilisateur de ce programme et accueillant généralement bien plus d’immigrants, ce nombre atteignait 47 840 et a augmenté de 75 % pour la même période.
Rappelons que le gouvernement du Québec possède des leviers pour réguler ces flux migratoires. D’abord, les permis de travail fermés requièrent que les employeurs obtiennent une étude d’impact sur le marché du travail, délivrée par les gouvernements fédéral et québécois, montrant la nécessité d’embaucher un travailleur étranger temporaire pour pourvoir les postes vacants. De plus, les travailleurs étrangers doivent obtenir un Certificat d’acceptation du Québec de la part du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec pour être autorisés à travailler et séjourner temporairement dans la province.
La majorité (68 % en 2023) de ces travailleuses et travailleurs sont recruté·es pour occuper des emplois considérés comme peu qualifiés, offrant peu de possibilités pour accéder à la résidence permanente dans le cadre des programmes d’immigration offerts au Québec. Les « postes à bas salaires » représentent 95 % des emplois des travailleurs sur un permis de travail fermé (moins de 44 000 $/an). Ils sont ainsi figés dans un statut migratoire précaire, limitant leurs possibilités d’intégration complète à la société québécoise.
Des portes vers la résidence permanente qui se ferment
En parallèle, le Québec a également accueilli ces dernières années des dizaines de milliers d’étudiants internationaux et de travailleurs étrangers temporaires, tous des détenteurs d’un permis ouvert. Si ces groupes de résidents temporaires sont, en principe, moins vulnérables que les travailleurs détenteurs d’un permis de travail fermé, le resserrement des voies d’accès à la résidence permanente par le gouvernement québécois contribue à la précarisation de leur statut. Pour celles et ceux souhaitant demeurer au Québec pour y bâtir leur vie, cela implique de cumuler les statuts temporaires dans l’espoir de voir les portes de la résidence permanente s’ouvrir à nouveau. Au-delà du risque d’exploitation économique, ce séjour dans les limbes du système d’immigration entraîne de lourdes conséquences psychologiques et remet en question leur sentiment d’appartenance au Québec.
Au-delà des seuils, quelle société ?
L’an dernier, il y avait plus de nouveaux résidents temporaires que de nouveaux résidents permanents au Québec. Ce fait soulève beaucoup de questions sur l’avenir du modèle d’immigration dans la province, tout comme sur le rôle de différents acteurs (gouvernements, employeurs, universités et établissements d’enseignement) dans la planification des seuils d’immigration.
La réalité dramatique de la précarité inhérente à ces statuts migratoires doit être au centre de nos réflexions sociétales à cet égard.
Il faut regarder les faits en face : le Québec est devenu une terre de précarité pour les personnes immigrantes. Ainsi, des populations aux droits différenciés cohabitent de plus en plus dans la province, créant des hiérarchies et compromettant le principe d’égalité, central au modèle québécois. Tolérer des politiques qui favorisent l’exploitation et restreignent la mobilité sociale et l’intégration civique entraînera des répercussions à long terme pour l’ensemble de la société québécoise.
Gouverner l’immigration ne se résume pas à fixer des seuils d’immigration. Pour reprendre les propos déjà tenus par le premier ministre, cela exige aussi de « prendre soin » de ceux et celles qu’on accueille.
Gouverner l’immigration ne se résume pas à fixer des seuils d’immigration. Pour reprendre les propos déjà tenus par le premier ministre, cela exige aussi de « prendre soin » de ceux et celles qu’on accueille.
- Mireille Paquet, Mylène Coderre et Marie-Jeanne Blain
Institut de recherche sur les migrations et la société, Université Concordia
Mireille Paquet est politologue et professeure agrégée au Département de science politique de l’Université Concordia, où elle détient la Chaire de recherche universitaire sur les politiques d’immigration. Directrice de l’Institut de recherche sur les migrations et la société (IRMS) de l’Université Concordia, elle dirige la réalisation de plusieurs projets dans le cadre du programme de recherche Apogée : Réduire les clivages : intégration des personnes immigrantes au 21e siècle. Membre de l’Équipe de recherche sur l’immigration au Québec et ailleurs (ERIQA) et de l’Initiative de recherche sur l’immigration (IRI), Mireille Paquet contribue à de nombreuses équipes interinstitutionnelles et multidisciplinaires. Elle est également la codirectrice du Réseau de recherche sur l’immigration, l’intégration et les relations interculturelles au Québec (RQ3I), qui vise à connecter la recherche académique et les politiques publiques au Québec.
Mylène Coderre est chercheuse associée à l’IRMS et titulaire d’un doctorat en développement international de l’Université d’Ottawa (2023). À titre de professionnelle de recherche, elle a contribué à plusieurs projets, autant dans le milieu universitaire qu’institutionnel, visant à documenter les conditions de travail et d’immigration des personnes à statut précaire au Canada. Ses travaux s’intéressent entre autres aux rôles des intermédiaires de la migration et du travail dans les parcours d’(im)migration. Ses recherches ont été publiées dans différentes revues spécialisées en immigration.
Marie-Jeanne Blain, anthropologue sociale diplômée de l'Université de Montréal, réalise depuis plus d'une dizaine d'années des recherches sur l'inclusion des personnes immigrantes et réfugiées au Québec, en particulier les processus d'insertion socioprofessionnelle. Ses thèmes de recherche portent sur les aspirations professionnelles de migrant·es de différents statuts d'immigration, leurs ressources de soutien, et la mise en place de politiques et programmes dans ce champ. Porteuse d'une vision dynamique de l'inclusion, elle s'intéresse tout autant aux expériences des personnes migrantes elles-mêmes, mais aussi à celles d'intervenant·es ou professionnel·les les accompagnant ainsi qu'aux décideurs et employeurs par exemple.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre