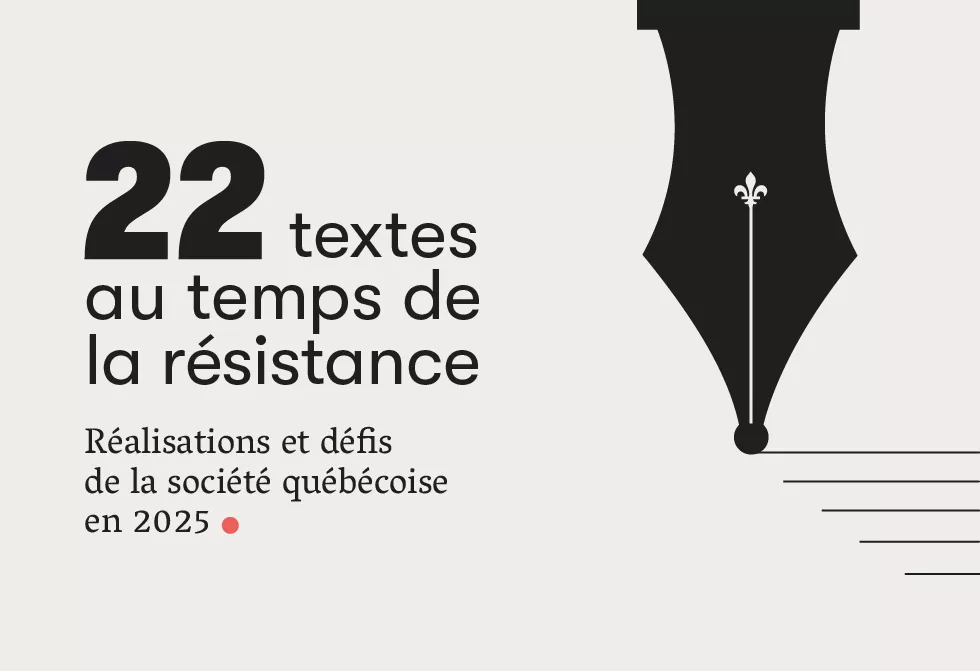Nous pensions connaitre les différents enjeux liés à l’immigration. Après tout, le Québec a atteint un niveau de maturité en la matière. Une maturité liée à la capacité de l’État québécois à élaborer de nombreuses politiques publiques et programmes sociaux, et au milieu de la recherche à produire une multitude d’enquêtes montrant tantôt le déclin des uns, tantôt la discrimination des autres. Sans nier la validité de ces recherches, je soulèverais deux enjeux m’apparaissant être à l’avant-garde de nos défis présents et à venir en matière de diversité ethnoculturelle.
Deux enjeux actuels
Tout d’abord, la réalité démographique du Québec montre que sans l’apport de l’immigration il est de plus en plus difficile d’assurer notre prospérité socio-économique collective. Or, l’enjeu ici n’est pas tant, ou si peu, de déterminer les seuils et plafonds d’immigration. Il faut sortir du débat de chiffres pour mieux réfléchir à la manière d’adapter nos politiques publiques à des réalités migratoires de plus en plus complexes. Les statuts migratoires sont mouvants, dynamiques et transitoires. Et la vitesse à laquelle les individus passent, volontairement ou non, d’un statut à l’autre (ex. temporaire à permanent; étudiant international à demandeur d’asile…) s’accélère. Le Québec doit se doter de mécanismes d’adaptations multiples pour poursuivre sur la voie de l’inclusion tout en s’inscrivant dans le contexte qu’il lui est propre; un contexte particulier à bien des égards. Les solutions miracles n’existent pas, mais certaines choses peuvent être faites. Il faut pérenniser la régionalisation de l’immigration et délaisser les approches « mur à mur » pour des problèmes conjoncturels et situés, d’où la nécessaire agilité. J’en ai pour exemple l’épineuse question de l’immigration temporaire qui reflète à la fois l’orientation que prennent les politiques publiques sur un ensemble d’aspects (éducation, développement économique, posture humanitaire…) et la réaction des pouvoirs publics à des conjonctures sujettes à de multiples et rapides changements. À cet égard, une vision et une stratégie claire m’apparaissent garantes de notre capacité collective à affronter des crises et incertitudes en tout genre avec assurance et pragmatisme.
Le second enjeu est celui de l’insertion des personnes immigrantes dans nos organisations et institutions. Si la littérature regorge de best practices (sciemment en anglais), elles proviennent majoritairement de contextes peu comparables au québécois. Tout·e bon·ne gestionnaire le dira, une pratique n’est efficace que si elle est remise en son contexte. Et nous peinons à trouver la manière de parler – les discours sont si importants – adéquatement de ce fameux vivre-ensemble sans débattre (le mot est faible) souvent inutilement autour de la notion d’EDI (équité, diversité, inclusion). Le contexte actuel est peu propice à maintenir les pratiques en vigueur en matière de EDI. Les programmes qui y sont liés sont mis à mal dans différents secteurs d’activités et ce qui se passe au sud de notre frontière ne fait qu’alimenter un discours qui n’attendait qu’une caution pour s’autolégitimer davantage. Mais ce serait une erreur que de rejeter totalement certains arguments critique à l’égard des politiques et pratiques EDI dans les organisations. Un message souvent mal énoncé et instrumentalisé contribue à polariser davantage les positions des uns et des autres. Au Québec, nous nous sommes dotés d’un cadre, l’interculturalisme, qui, me semble-t-il, porte en lui l’espoir d’une redéfinition viable et pérenne d’un vivre-ensemble mettant en exergue tout autant notre histoire que notre présent et notre avenir à tous et à toutes. Malheureusement il est souvent mal compris, mal aimé et décrié pour n’être qu’une pâle copie du multiculturalisme canadien ou du modèle républicain à la française.
Au Québec, nous nous sommes dotés d’un cadre, l’interculturalisme, qui, me semble-t-il, porte en lui l’espoir d’une redéfinition viable et pérenne d’un vivre-ensemble mettant en exergue tout autant notre histoire que notre présent et notre avenir à tous et à toutes.
L’interculturalisme comme approche globale
Des travaux auxquels j’ai été associé, j’en retiens que la volonté et les d’efforts sont au rendez-vous. Ce qui freine le développement d’une approche interculturelle viable, vivante et porteuse de cohérence, ce sont les pertes de repères des diverses composantes d’une société qui, faisant face à trois défis majeurs (climatique, démographique et numérique), se referment en petits groupes où les intérêts et pratiques des uns empiètent sur ceux et celles des autres tel un jeu à somme nulle. Il ne faut pas chercher bien longtemps pour trouver des exemples qui sapent les bases communes d’une société fragmentée. Ici, la question linguistique, le « fait français », est à la fois une force centrifuge et centripète qui sert à définir les frontières de nos appartenances et qui montre notre [in]capacité à trouver des points d’ancrage communs.
Le français comme langue commune d’usage peut et doit être un vecteur d’intégration et le moteur de cet interculturalisme assumé. Pour cela, il faut prendre acte des transformations et tensions qui le traversent et considérer la francisation pour ce qu’elle est, le pilier d’un projet de société. Cette prise en compte pourrait éviter les amalgames entre langue(s) parlée(s) et autres marqueurs identitaires tout autant que les aprioris quant au bon usage de cette langue qui, au-delà de sa complexité, doit être rassembleuse, même si cela passe par une forme ou l’autre de multilinguisme. Écoutons pour voir et il y a fort à parier que nous entendrons non pas le français OU une autre langue, mais bien le français ET une autre langue.
La quête d’un équilibre entre la protection, la valorisation et l’adaptation de nos usages linguistiques à l’égard d’une réalité de plus en plus complexe doit s’effectuer au sein de paramètres posés par une démarche objective qui confronte des perspectives et des analyses distinctes, voire opposées. Cela relève assurément d’une « vérité de La Palisse », mais nous vivons à une ère de forte polarisation et le seul moyen pour décloisonner les positions est, du moins je le crois, de poursuivre les recherches et études pour mieux comprendre les transformations, menaces et opportunités qu’offrent la situation du Québec au sein de différents contextes (régional, continental et international).
Des études, il y en a, et plus que moins, mais nos difficultés à confronter ces multiples sphères de vérités ne font que trop souvent cantonner les uns et les autres dans des positions fermes et hermétiques.
La recherche au service du bien commun
Ce que je constate dans mes activités de recherche, d’enseignement et de formation, c’est que tout un chacun somment à la recherche d’une boussole à travers les méandres de cet interculturalisme inachevé. Il est temps que nos savoirs accumulés servent à trouver cette boussole. Même si beaucoup est fait, beaucoup reste à faire.
Ambitionnons une recherche au service du bien commun qui confronte des idées sans être des chambres d’écho au service de ceux et celles qui la produisent. Pour cela, il faudra au minimum s’entendre sur ce que nous devrions chercher, sur le pourquoi nous le ferions et sur le comment nous pourrions identifier des voix/voies innovantes. Oui, beaucoup reste à faire et nos institutions sont-elles prêtes et disposées à faire face à ce défi d’inclure les uns sans exclure les autres? Rien ne sert de nous culpabiliser ou de nous victimiser, il faut trouver. Et pour trouver, il faut d’abord chercher c’est pourquoi il est toujours bon, voire nécessaire, de nous rappeler l’importance de la recherche et du rôle crucial des instances de soutien dont elle dépend.
...beaucoup reste à faire et nos institutions sont-elles prêtes et disposées à faire face à ce défi d’inclure les uns sans exclure les autres? Rien ne sert de nous culpabiliser ou de nous victimiser, il faut trouver.
- Sébastien Arcand
HEC Montréal
Sébastien Arcand est professeur titulaire à HEC Montréal, co-titulaire de la Chaire de recherche du Québec sur la situation démolinguistique et les politiques linguistiques du FRQ-SC et directeur associé au Pôle sports de HEC Montréal. Il est présentement directeur du département de management. Il s’intéresse à la gestion de la diversité ethnoculturelle au sein des institutions et organisations, aux inégalités socio-économiques dans les pratiques sportives ainsi qu’aux difficultés d’insertion socio-professionnelle des personnes issues de l’immigration. Il a siégé au comité de suivi sur l’évolution de la langue française de l’OQLF ainsi qu’au Comité consultatif sur la statistique linguistique de Statistique Canada. Il intervient fréquemment auprès de gestionnaires pour les conseiller sur les pratiques en gestion interculturelle au Québec, en Europe et en Amérique latine (Colombie) et a collaboré à des rapports pour différents organismes locaux, nationaux et internationaux Il fait partie des «100 most influent academics in government» de l’organisme britannique Apolitical, section Employement and skills, pour 2021.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre