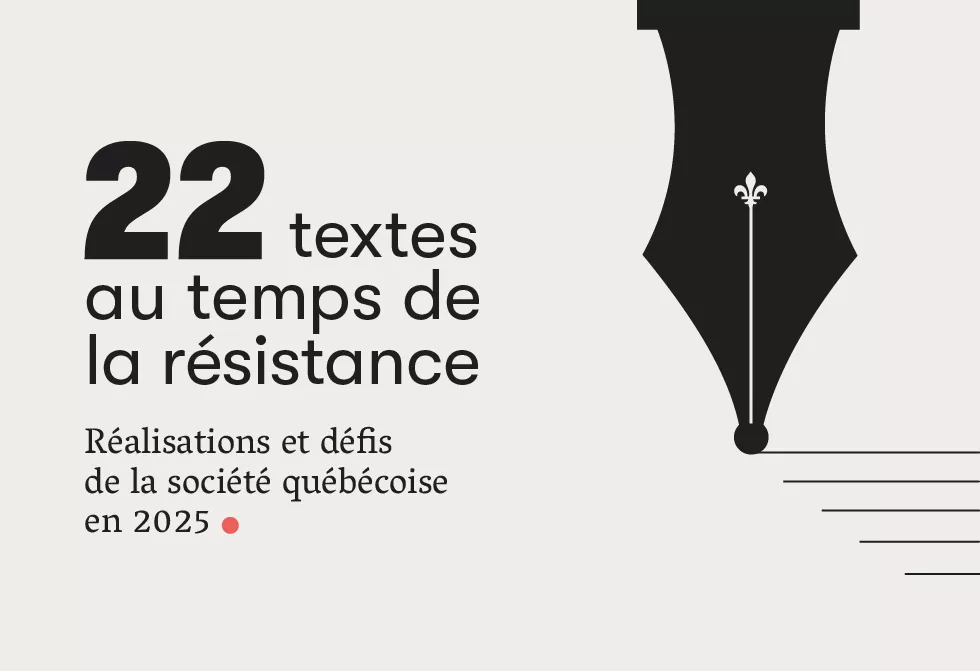Dans Le monde d’hier, l’écrivain Stefan Zweig décrivait l’effacement du monde qui avait été le sien dans la ville de Vienne, l’Empire austro-hongrois et l’Europe du début du siècle. Évoquer Stefan Zweig me semble pertinent alors que l’administration Trump 2.0 rompt radicalement avec l’ordre international libéral, avec les alliances militaires et les ententes commerciales d’après 1945. Notre monde d’hier, c’est l’ère 1945-2025. Pour le Québec, ce bouleversement impose de douloureux recadrages notamment dans le champ des relations intergouvernementales avec Ottawa et les partenaires de la fédération canadienne.
Les idées esquissées dans le présent texte ont été soumises dans un mémoire au Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne, lequel a remis son rapport en novembre dernier. Celles et ceux qui veulent s’informer davantage peuvent consulter le lien suivant : Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la fédération canadienne | Gouvernement du Québec.
Il y a certes plusieurs tendances dans le gouvernement de la CAQ, comme il y en avait plusieurs dans l’ADQ qui l’a précédée et où j’ai milité. Cependant une tendance me semble dominante dans les deux configurations partisanes, c’est celle que j’appelle l’ultra-autonomisme comme substitut de souveraineté, où le Québec se comporte comme s’il était souverain, traitant Ottawa comme une capitale étrangère, consacrant bien plus de ressources à ses représentations dans le monde qu’à celles déployées au Canada. Qu’on me comprenne bien : le Québec a raison de vouloir consolider son autonomie dans une pluralité de dimensions, par exemple dans la loi sur la laïcité, la loi sur la langue française ou dans le projet de loi sur l’intégration nationale. Le Québec est une société nationale distincte dans le Canada et il a tous les droits d’agir pour protéger et promouvoir cela. Ce qui est inacceptable, depuis plusieurs décennies, c’est le refus de nos gouvernements d’occuper tout le terrain à la disposition du Québec pour qu’il pèse de tout son poids dans le système politique qui compte le plus pour lui, celui du Canada. Récemment, le gouvernement du Québec a démontré qu’il est capable de concevoir une approche de moyen et long terme dans le développement économique avec la nouvelle entente avec Terre-Neuve sur l’hydro-électricité. Il est temps de faire quelque chose de semblable dans le champ des relations intergouvernementales.
Que constate-t-on quand on va régulièrement à Ottawa? Le Québec y est totalement invisible. Son bureau administratif est réduit à quelque 5 employés (la délégation du Québec à Paris en a plus de 40). Le gouvernement du Québec ne suit pas de près le travail des ministères fédéraux et celui des comités parlementaires. On se fie essentiellement à la médiation des élus du Bloc Québécois. Il faudrait au moins tripler le personnel du bureau du Québec à Ottawa, et développer une véritable intelligence du fonctionnement des ministères fédéraux. Nous avons besoin de quelque chose comme une Maison du Québec à Ottawa, comme la Bavière le fait à Berlin et à Bruxelles, pour rendre visibles dans la capitale fédérale la force et les ressources de notre société distincte. Le Québec devrait être présent sur toutes les tribunes et dans tous les réseaux à Ottawa, pour que sa voix soit davantage prise en compte dans l’élaboration des projets de loi. Avec ses partenaires, le gouvernement du Québec devrait encourager le Conseil de la fédération, l’instrument de coopération des provinces et des territoires, à occuper lui aussi davantage d’espace à Ottawa, où il ne se réunit jamais. On l’a vu, depuis l’installation de la nouvelle administration Trump, les dirigeants des provinces et des territoires se parlent plus souvent. Mais tout cela se prépare par une diplomatie de longue haleine, par des relations qui s’entretiennent sur plusieurs années. En Ontario et dans l’ouest, mais en fait partout au Canada, les représentations du Québec sont trop réduites. Leurs opérations ne répondent pas à un dessein global. Le rapport du comité consultatif co-présidé par Guillaume Rousseau et Sébastien Proulx l’a également recommandé, les députés de l’Assemblée nationale du Québec devraient avoir des rencontres interparlementaires avec leurs collègues à Ottawa et ailleurs au Canada.
Dans le nouveau monde de 2025, où sont les alliés du Québec? En Chine ou en Russie? Dans les États-Unis de Donald Trump? Dans une Europe et une France en désarroi? Le Québec n’a qu’une bonne carte à jouer, celle du Canada. Il est urgent que notre gouvernement cesse de tergiverser à ce propos.
Un Québec qui se servirait de son imagination pour jouer à plein la carte du Canada trouverait, j’en suis profondément convaincu, des interlocutrices et des interlocuteurs très attentifs. Car les menaces américaines provoquent à Ottawa et ailleurs au Canada de nombreuses réflexions sur les caractéristiques fondamentales du pays façonnées par notre histoire commune et sur les voies qui s’offrent à nous pour l’avenir. J’en veux pour preuve les propos tenus par le nouveau Premier ministre du Canada, M. Mark Carney, le 14 mars dernier à Ottawa, à l’occasion de son assermentation et de celle de son cabinet. Il a notamment évoqué la triple fondation du Canada, par les peuples autochtones, par les Français et par les Britanniques, tout en notant l’identité bilingue du pays. Il y a un peu plus de 25 ans, dans l’ouvrage collectif Sortir de l’impasse1 que je dirigeais avec le regretté politologue albertain Roger Gibbins pour le compte de l’IRPP, j’avais développé l’idée que l’on pourrait définir le Canada comme une union partenariale, faisant de la place en son sein pour une pluralité de visions, chacune appuyée sur une forme d’authenticité. Il est regrettable que depuis deux décennies, les gouvernements du Québec ont pour l’essentiel omis d’incarner, dans leurs discours comme dans leur présence à Ottawa et ailleurs au Canada, une vision du pays appuyée sur les contributions et les intérêts du Québec. Comme il y a quelque 25 ans, je pense que l’idée de dualité – deux sociétés globales, deux langues officielles, deux régimes juridiques, deux communautés scientifiques et deux réseaux communicationnels, deux configurations culturelles –, devrait occuper une grande place dans cette vision. Je cite un passage du livre :
« Il y a bel et bien une société canadienne, un réseau de réseaux, opérant principalement en anglais et accueillant des minorités francophones. Il y a bel et bien aussi, une société québécoise, un réseau de réseaux, opérant principalement en français et accueillant une minorité anglophone. Ces deux sociétés, nous l’avons dit antérieurement, sont prises l’une dans l’autre. Culturellement riches, ouvertes sur le monde, terres d’accueil pour l’immigration, elles se sont nourries l’une de l’autre dans le passé et elles vont continuer de le faire dans l’avenir. Leur partenariat représente un destin absolument unique dans l’histoire des Amériques et une grande richesse pour le monde.2 »
Face aux dérives autoritaires et à une certaine forme de néo-expansionnisme américain, le destin du Québec est lié à celui de l’ensemble du Canada. Nos dirigeants doivent assumer cela et agir en conséquence.
- Guy Laforest
Université Laval
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre