L’histoire des sciences nous rappelle comment la persévérance, l’intuition et l’entêtement de nombre de chercheuses et chercheurs ont été des moteurs essentiels de la quête de nouveaux savoirs. Il y a là des récits d’aventures et d’explorations aussi invraisemblables que passionnants. C’est le cas de la vie de Félix D’Hérelle, un microbiologiste doué, avant-gardiste et globe-trotter du début du siècle dernier, dont j’ai tenu à raconter le parcours.
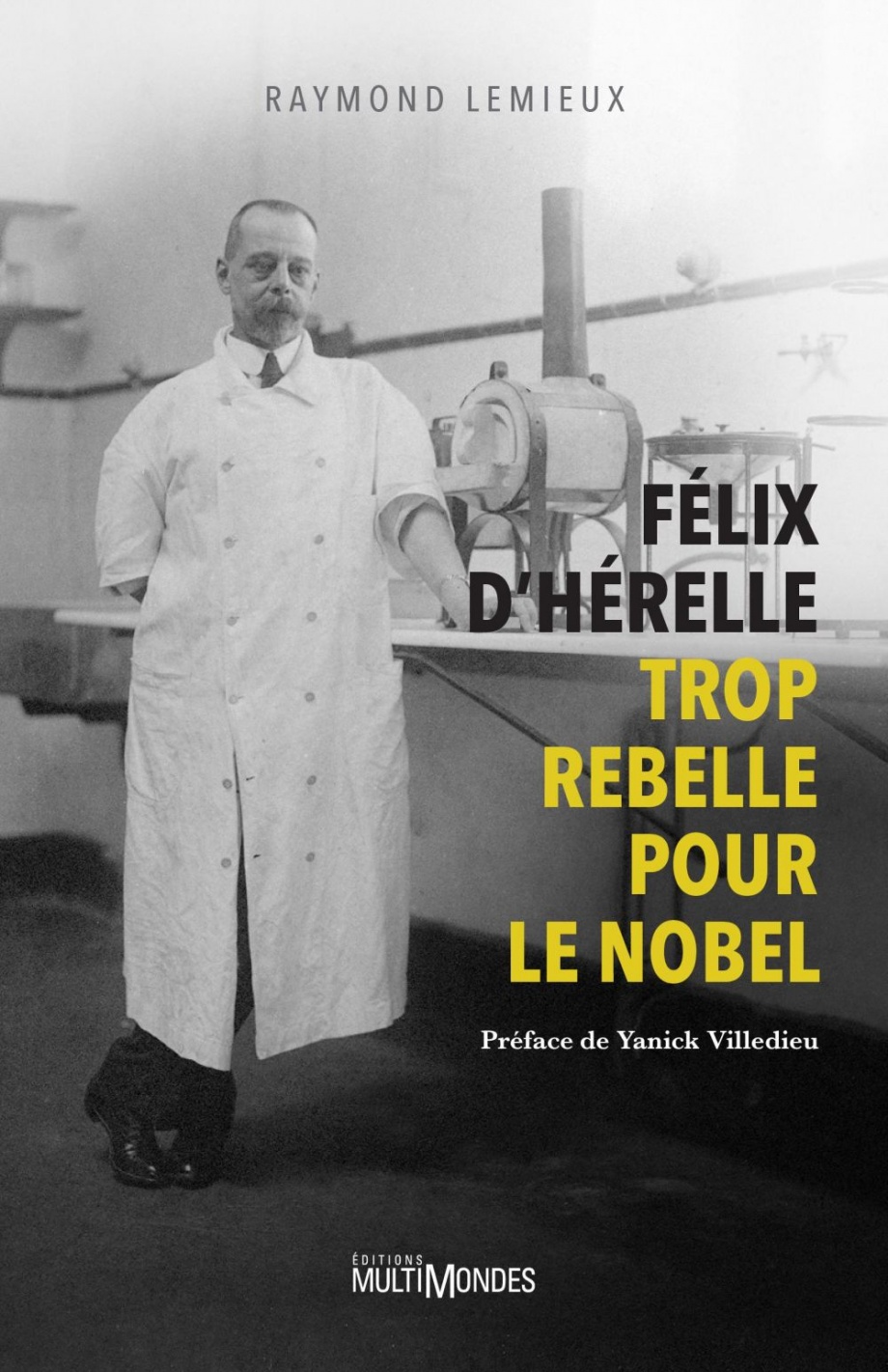
Dans plusieurs dictionnaires, on mentionne que Félix D’Hérelle est né à Montréal et qu’il a découvert, en 1917, les bactériophages, ces virus qui s’attaquent spécifiquement aux bactéries. Ma curiosité a été piquée. Qui est donc ce Montréalais? Qu’est-ce que cette affaire de bactériophages? Et rapidement, les énigmes et les questions se sont accumulées. Montréalais? Baliverne : il est né à Paris! Microbiologiste? Il a réussi de peine et de misère l’équivalent d’une dixième année de scolarité! Pourtant oui, il a fait une découverte majeure quand il s’est penché sur les cas de dysenterie, une maladie provoquée par les shigellas, des bactéries fréquemment retrouvées chez les soldats revenus des tranchées de la Première Guerre mondiale. En essayant de comprendre pourquoi certains d’entre eux guérissaient de cette infection mieux que d’autres, il a mis en lumière le rôle des bactériophages s’attaquant notamment aux shigellas.
Rappelons que les bactériophages ciblent de façon spécifique certaines bactéries : pour les uns ce sont les salmonelles, pour les autres Escherichia coli, etc. On peut consulter leur classification dans la collection Félix D’Hérelle conservée à l’Université Laval. Ainsi, dans l’esprit de notre chercheur, afin de combattre une maladie causée par une bactérie, il faut sélectionner le bon bactériophage, le cultiver et l’inoculer à la personne malade. Cela dit, les bactériophages se trouvent aussi dans la nature, constate D’Hérelle. Quand les malades sont exposés en même temps à ces virus et à la bactérie nuisible, ils peuvent guérir. Dans le cas du choléra, D’Hérelle avait remarqué que le redoutable microbe se répandait dans un milieu quand les bactériophages n’y étaient pas présents.
Pour ce qui est de la bactérie causant la dysenterie, le chercheur avait noté que les convalescents en étaient porteurs, mais non les personnes qui venaient d’entrer en maladie. Les convalescents ou les malades en transition vers la guérison portaient des « bactériophages en action ». D’Hérelle l’avait constaté en analysant les selles des soldats. De plus, il avait supposé que ces bactériophages pouvaient être aussi contagieux, ce qui l’a poussé à formuler l’idée de « guérison contagieuse » qui se produisait quand on mettait en présence des convalescents avec des malades. C’est à partir des recherches sur ces virus qu’il a ensuite réussi à développer une thérapie, la phagothérapie. Celle-ci a eu un relatif succès et l’a propulsé à l’avant-scène de la science mondiale au point qu’il fut proposé 28 fois pour le Prix Nobel de médecine ou physiologie.
En plongeant dans l’univers de Félix D’Hérelle, on comprend parfaitement son ambition, l’importance qu’il accordait à l’expérimentation scientifique, mais aussi l’intensité des rivalités auxquelles il a dû faire face. Très vite, en effet, un chercheur japonais a voulu reprendre et reproduire les travaux de notre autodidacte sur les bactériophages. Sans réussir. Il fit part de ses résultats dans une publication savante. D’Hérelle, en furie, le blâma d’avoir utilisé du fluorure de sodium pendant ses manipulations alors que l’on n’obtient aucun bactériophage en milieu fluoré. « Je veux bien croire à une erreur, mais il est désagréable de discuter avec un monsieur qui n’a pas de techniques », écrit D’Hérelle. Si ce n’était que ça... Jules Bordet, directeur de l’Institut Pasteur à Bruxelles et fraîchement nobélisé pour ses travaux sur les globules blancs, en remit : si les bactériophages existent, affirma-t-il, ce n’est quand même pas D’Hérelle qui les a découverts! Il en attribua plutôt la paternité à Frederick Twort, de l’Institut Brown à Londres. Outré, D’Hérelle répliqua avoir démontré en premier l’existence des virus en question alors que le Britannique ne l’avait qu’évoquée parmi d’autres hypothèses.
La controverse dans laquelle D’Hérelle se trouva plongé le suivra toute sa carrière. Elle lui laissera un arrière-goût amer. Il classera alors les savants en deux familles : celle des inventeurs et celle des érudits. « L’inventeur, à bien des exceptions près, est un esprit indépendant, un isolé, un logicien qui ne croit qu’à l’expérience et fait fi de la tradition : c’est un révolutionnaire. » Les autres? Il les qualifie de savants officiels bourrés d’une science livresque qui leur a valu « parchemins et situations, chaires et fauteuils, décorations et tous les hochets qui gonflent leur vanité ». Pas très diplomate, ce D’Hérelle!
Il me restait à cerner les motivations d’un chercheur de sa trempe. En plus d’une autobiographie (850 pages tapuscrites) conservée à l’Institut Pasteur de Paris, il a laissé plusieurs documents, de vieux almanachs dans lesquels il avait pris toutes sortes de notes. Beaucoup de matière! Et en plus, quelques secrets entremêlés de nombre d’anecdotes. Bref, il y avait là amplement de matériel pour alimenter l’essai que je décidai d’écrire afin de faire revivre ce Félix D’Hérelle qui, à l’invitation d’un ami de son père (nul autre que Henri-Gustave Joly de Lotbinière, un ancien premier ministre du Québec), a commencé sa carrière à Beauceville, au Québec.
C’est là qu’il fait construire, en 1897, une immense maison dans laquelle il installe une distillerie pour fabriquer du whisky à partir du sirop d’érable. Cependant, il n’évalue pas très bien le contexte social : à cette époque, l’alcool n’a pas bonne réputation en Amérique. Je relate, dans mon essai : « De grandes campagnes de propagande menées par les apôtres de la tempérance mettent les gens en garde contre les périls alcooliques, et réclament purement et simplement l’interdiction de l’alcool. Le diable est dans la bouteille! Le gouvernement canadien se décide à en appeler à la population et annonce la tenue d’un référendum pour trancher la question du commerce de l’alcool. […] Le vote a lieu le 29 septembre : " Êtes-vous favorable à la passation d’une loi défendant l’importation, la fabrication ou la vente de spiritueux, vins, bières, ales, cidres et de toutes sortes de liqueurs alcooliques comme breuvages? " Le oui l’emporte de justesse (51,2 %) coast to coast. Toutefois, de toutes les provinces de la jeune Confédération, seul le Québec se prononce majoritairement en faveur de la libéralisation de l’alcool (à 81,5 %!). »
Cela ne suffit pas à Félix D’Hérelle. Si l’Amérique lève le nez sur les plaisirs de Bacchus, elle ne rechignera peut-être pas devant les tentations du chocolat! Or la concurrence dans ce secteur est forte à l’époque : le chercheur Henri Menier veut trouver une manière de fabriquer industriellement des tablettes de chocolat, Nestlé vient d’élaborer le chocolat au lait à croquer, et le Suisse Rudolf Lindt met au point un procédé d’affinage qui consiste à incorporer des produits comme le sucre et la pâte de cacao au chocolat.
D’Hérelle quitte Beauceville pour s’établir à Longueuil, où il se fait construire une chocolaterie. Mais voilà trop de dépenses trop vite faites... La Cour supérieure décrète un abandon judiciaire de la compagnie. En d’autres mots : c’est la faillite.
C’est là la fin du rêve québécois pour D’Hérelle. Avec en poche 2 000 dollars tout au plus, il part pour l’Amérique centrale, en 1901, avec rien à perdre. « J’étais microbiologiste amateur, je serais dorénavant microbiologiste de profession. »
Déterminé, il mène de multiples projets – dont la mise au point d’une arme bactéricide contre les sauterelles – au Guatemala, au Mexique, puis en Argentine, avant de joindre l’Institut Pasteur de Paris. Sa découverte des bactériophages, des virus que tous les appareils de l’époque n’arrivent pas à voir – il faudra attendre l’invention du microscope électronique vers 1940 pour confirmer leur existence –, est un tournant dans sa carrière. Il a alors 42 ans. Son hypothèse est rejetée par plusieurs chercheurs, mais cela ne l’empêche pas de développer la phagothérapie, une médecine basée sur l’utilisation de ces virus pour soigner des personnes atteintes de la dysenterie, voire de la peste ou du choléra.
Il poursuit ses travaux en Hollande, en Égypte, en Inde avant d’enseigner à l’Université de Yale, aux États-Unis, en pleine crise économique. Il se dit dégouté des forces de l’argent qui corrompent la société américaine et se laisse convaincre d’aller rejoindre un de ses fidèles collègues, George Éliava, en Union soviétique, en pleine ère Staline. Ensemble, ils fondent à Tbilissi un institut de recherche sur les bactériophages (qui existe toujours!). Toutefois, les choses se passent mal. Les deux scientifiques sont dans le collimateur du chef du KGB, le sinistre Lavrentiv Beria. Avec ses sbires, ce dernier fait un jour irruption dans les laboratoires de l’institut. Éliava est exécuté. Par chance, D’Hérelle est alors absent. Il n’y remettra plus les pieds et restera désormais en France jusqu’à son décès en 1949.
Oublié, ce Félix D’Hérelle? Un peu, beaucoup… mais pas ses bactériophages, qui ont servi à établir la forme de l’ADN en double hélice en 1952, et qui inspireront maintes expériences de microbiologie fondamentale – notamment pour la découverte de CRISPR, un outil actuellement prisé en génétique, et d’une piste de solution contre l’antibiorésistance.
J’ai imaginé Félix D’Hérelle m’écrivant des lettres. Dans l’une d’elles, il me dit : « Il faut parfois compter des années et même des décennies pour reconnaître le talent des écrivains, des peintres, des philosophes et pour mesurer la portée réelle de leurs créations ou de leurs œuvres. Il en va de même pour les scientifiques. C’est ça le filtre du temps. […] On ne pourra nier que la science est une fantastique construction, voire le résultat d’une accumulation de connaissances qui se superposent aux essais et erreurs que ce processus implique. N’est-ce pas cela, la véritable aventure du savoir humain? Ainsi, le scientifique doit faire acte d’humilité, car il n’est, en définitive, qu’un maillon dans cette chaîne de la connaissance. »
J’ose espérer que ma modeste contribution en vue de faire redécouvrir ce scientifique remarquable et remarquablement oublié rappellera l’importance de l’intuition et de la persévérance, desquelles découlent de nombreux progrès scientifiques.
- Raymond Lemieux
Éditions Multimondes
Raymond Lemieux est journaliste. Il a couvert pendant de nombreuses années l’actualité scientifique et environnementale pour de nombreux médias. Il a été rédacteur en chef du magazine Québec Science durant plus de 20 ans. Diplômé en communications de l’Université du Québec à Montréal, il est récipiendaire du prix Thérèse-Patry pour sa contribution exceptionnelle à la culture scientifique.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Vous pourriez aimer aussi
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre



