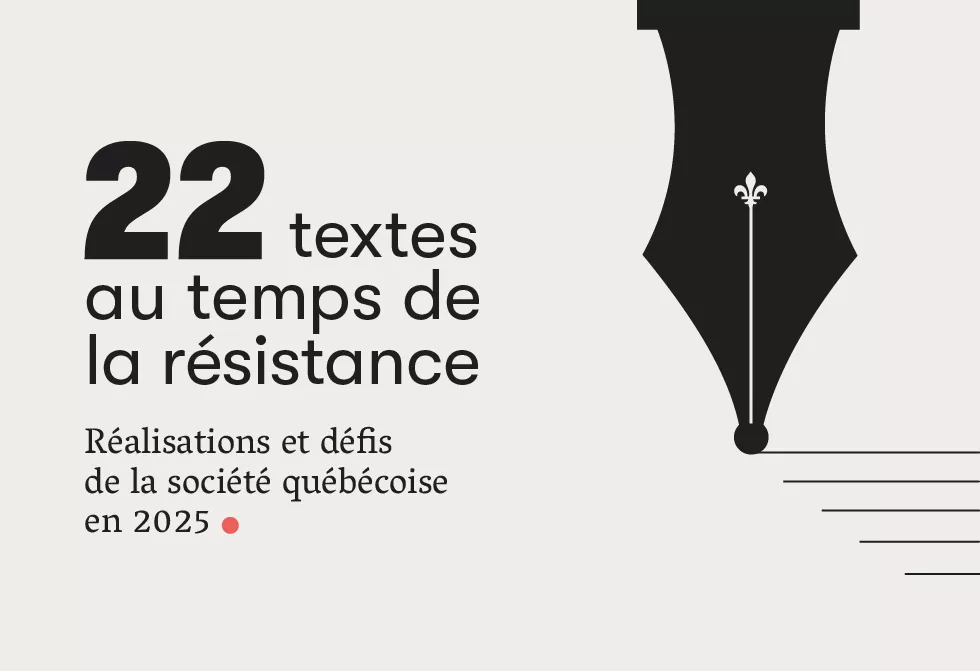Au cœur des enjeux du milieu de l'éducation se loge notre système de valeurs qui met principalement l’accent sur les avoirs matériels et monétaires. Et plus les inégalités de revenus et de prestige seront importantes, plus l’école se transformera en un lieu de compétition et d’angoisse, plutôt qu’un lieu d’épanouissement et de découvertes.
Les inégalités en éducation et sur le marché du travail occupent fréquemment l’espace médiatique, mais on parle rarement du fait que ces deux systèmes sont interreliés. Plusieurs savent qu’il existe un lien entre le niveau d’éducation et le revenu, mais saviez-vous que loin de s’être atténué, le rendement de l’éducation s’est accentué depuis 2000; ce rendement étant la hausse de salaire (entre autres) attribuable à une éducation plus élevée (soit en années, soit en diplôme).
L’autre dimension qui nous échappe bien souvent est que l’éducation se pose en miroir du marché du travail. Les inégalités de revenus influencent les choix d’études des jeunes et leur volonté de s’investir dans leur programme d’études. J’ajouterais même que plus les inégalités de revenus sont importantes, plus l’importance de bien choisir augmente et donc plus la pression qu’on exerce sur les enfants et les jeunes durant leur parcours scolaire augmente. Dans ce contexte, le système d’éducation devient un lieu de compétition plutôt qu’un lieu propice à de nombreuses découvertes enrichissantes.
Concernant les inégalités de revenus avant impôts et transferts au Québec, il est essentiel de savoir qu’entre 1980 et 1995 ces inégalités ont augmenté de près de 20 % et ne se sont jamais résorbées. Cette croissance, loin d’être unique au Québec, a été observée au Canada, chez nos voisins ontariens et même en Finlande – l’eldorado de l’égalité pour certains. Plusieurs facteurs l’expliquent et plusieurs dépassent nos frontières. Cependant, une fois les impôts et les transferts pris en compte, les inégalités au Québec sont demeurées assez stables depuis les années 1980. Le système de redistribution gouvernemental a donc su atténuer la croissance des inégalités avant impôts et transferts. Mais est-ce suffisant?
Sans avoir de preuves quantitatives, j’estime que la satisfaction de recevoir un revenu juste et décent pour son travail ne peut être compensée entièrement par un système de redistribution gouvernemental, mais que cette redistribution demeure essentielle. Pourquoi? Parce que la crainte de se retrouver au bas de l’échelle des revenus, d’avoir un travail qui n’est pas reconnu et de dépendre du système de redistribution suffit à exercer une pression et une angoisse face à l’avenir. Puisque l’éducation ouvre les portes à une majorité d’emplois à haut potentiel d’un revenu décent, et que les écarts s’agrandissent, la pression de « bien » choisir et de performer augmente. Enfin, il est probable que plus l’écart entre le bas et le haut de la distribution des revenus est élevé, plus cette pression augmente.
La littérature scientifique montre que les inégalités de développement chez les enfants sont observables dès la naissance; la gestation et le poids à la naissance étant liés au statut socioéconomique. Au Québec, l’Enquête québécoise sur les enfants de la maternelle (EQDEM) de l’Institut de la statistique du Québec nous permet de quantifier les inégalités de développement des enfants dès l’âge de 5 ans. Ces données quasi populationnelles mettent en évidence l’importance des écarts de développement dès la maternelle et confirment que les enfants ne commencent pas tous l’école sur un pied d’égalité. De plus, ces données révèlent que les garçons ne commencent pas l’école avec le même bagage de connaissances et d’aptitudes que les filles, ils ont donc un retard relatif. Nos travaux, ainsi que ceux d’autres chercheurs, démontrent également que les garçons sont largement plus nombreux à prendre des médicaments en lien avec le TDAH, et que le Québec est, à l’échelle mondiale, parmi les endroits où la prise de médicaments en lien avec les troubles de comportement est la plus forte. Les environnements, tant scolaire, familial que sociétal, doivent être repensés pour réduire cette trop forte dépendance à la médication. De plus, il est important de toujours garder en mémoire que, l’école doit composer avec des inégalités préexistantes à l’entrée à l’école, et des inégalités se maintenant tout au long du parcours scolaire du côté de l’environnement familial des jeunes.
Des travaux scientifiques soulignent que l’école, quand elle est bien organisée, peut réduire en partie les inégalités entre les enfants et assurer une éducation plus équitable.
Des travaux scientifiques soulignent que l’école, quand elle est bien organisée, peut réduire en partie les inégalités entre les enfants et assurer une éducation plus équitable. Plusieurs études démontrent que les grèves, en obligeant les enfants à rester à la maison, augmentent les écarts entre les élèves. De plus, nos travaux sur les fermetures d’école durant la pandémie montrent clairement que l’école québécoise réduit les inégalités de développement. En d’autres mots, quand l’école est ouverte, les écarts ne sont pas nuls, mais ils sont moins grands. C’est une bonne nouvelle dont on parle peu. Pourrait-on faire mieux?
À l’échelle internationale, le Québec fait très bonne figure. Que ce soit PISA (International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ou PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), on voit que la performance des élèves du Québec au primaire et au secondaire est aussi égale ou inégale que celle de l’Ontario ou du reste du Canada. Autrement dit, ailleurs au pays, il y a également des jeunes en difficulté, et ce bien que les systèmes d’éducation varient d’une province à l’autre.
Peut-on se fier à ces données? Oui, car elles sont représentatives des populations visées. Un processus rigoureux de sélection et d’analyse de non-réponse, combiné avec des poids d’échantillonnage, permet d’assurer la représentativité des données. De plus, puisque les microdonnées et les questionnaires sont accessibles aux chercheurs, on peut valider, par exemple, le pourcentage d’enfants fréquentant le privé, le pourcentage d’enfants ayant redoublé, et le pourcentage de garçons dans les données afin de bien caractériser la population représentée et d’établir la représentativité de chaque cycle d’enquête. Ainsi, contrairement à ce qui est véhiculé dans certains médias, les données de PISA, TIMSS ou PIRLS sont représentatives des élèves du Québec.
Ces données nous montrent que les jeunes du Québec font bonne figure, et on observe que les jeunes les moins performants réussissent aussi bien et parfois mieux au Québec. Ces résultats favorables, qu’on observe également chez les jeunes adultes ayant participé au Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), ne se traduisent cependant pas par une meilleure diplomation du secondaire relativement aux autres provinces. De plus, malgré ces résultats favorables, nos garçons sont moins nombreux à obtenir leur diplôme du secondaire à temps (en 5 ans) et à poursuivre à l’université qu’ailleurs au pays. Plusieurs hypothèses circulent, mais aucune n’a été solidement validée.
Enfin, il est important de réaliser qu’au secondaire, les écarts d’apprentissage entre les enfants sont importants et la matière se complexifie et se décuple. Il est donc essentiel d’en tenir compte pour à la fois aider ceux qui ont plus de difficultés et permettent à ceux qui apprennent facilement d’avancer. Il y a ici un choix entre inclusion et parcours adapté, et la meilleure approche est loin d’être évidente.
En conclusion
En résumé, notre système n’est pas parfait, mais il est enviable à bien des égards. De ce fait, il est pressant de reconnaître que le travail des enseignante·es, dans tout le réseau, est remarquable. Elles ou ils ont besoin de notre soutien collectif pour mieux aider les enfants en grandes difficultés, car le système d’éducation à lui seul ne peut pas tout régler. Les services sociaux, les services de santé, le milieu familial et de vie ont aussi une part importante à jouer.
Au cœur des enjeux du milieu de l'éducation se loge notre système de valeurs qui met principalement l’accent sur les avoirs matériels et monétaires. Et plus les inégalités de revenus et de prestige seront importantes, plus l’école se transformera en un lieu de compétition et d’angoisse, plutôt qu’un lieu d’épanouissement et de découvertes.
Je pense que nous sommes à un moment charnière où il serait possible de faire certains changements qui permettraient d’accroître l’équité du système tout en favorisant le développement des enfants selon leurs capacités et leurs intérêts. Enfin, il serait également important de revoir nos valeurs sociétales. La lumière et l’espoir ne naissent pas des avoirs matériels et monétaires démesurés de certains, mais de notre éveil au monde et de nos contributions diversifiées et souvent anonymes à la collectivité.
La lumière et l’espoir ne naissent pas des avoirs matériels et monétaires démesurés de certains, mais de notre éveil au monde et de nos contributions diversifiées et souvent anonymes à la collectivité.
- Catherine Haeck
Université du Québec à Montréal
Catherine Haeck est professeure titulaire au département de sciences économiques de l’Université du Québec à Montréal. Elle est directrice scientifique du Groupe de recherche sur le capital humain (GRCH). Sa recherche se concentre principalement sur le développement du capital humain des enfants et des jeunes, et sur la transmission intergénérationnelle du revenu et de l’éducation.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre