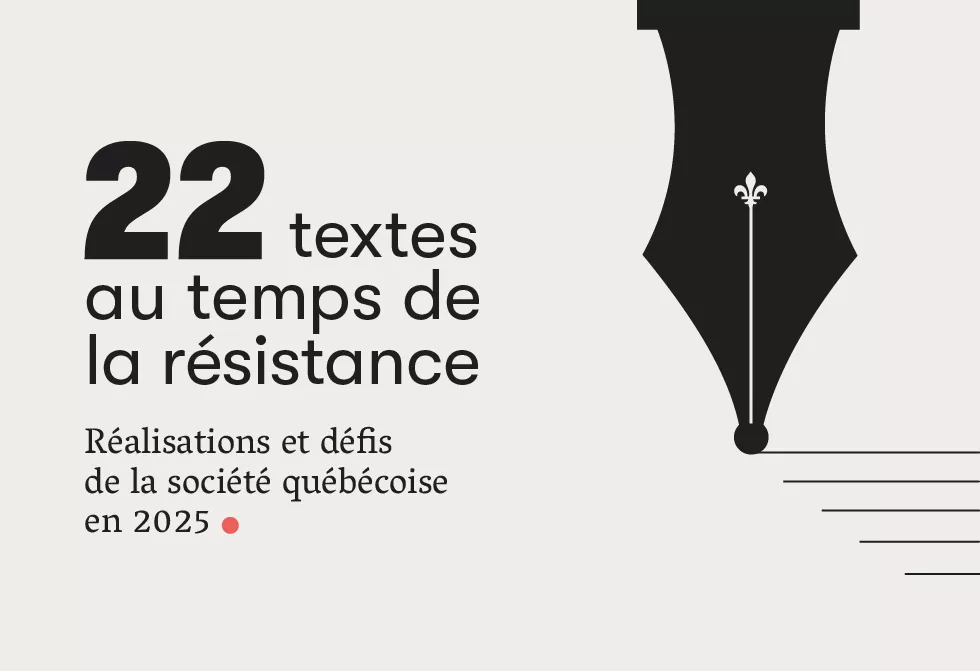Malgré la situation économique qui s’annonce difficile — et le peu de contrôle sur les comportements erratiques du président américain — il faudra s’assurer d’augmenter nos investissements en recherche; le Canada demeure bien en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE.
Cet article est une version adaptée d’une contribution à la page idées du journal Le Devoir, publiée le 10 mars 2025 : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/853267/idees-consequences-scientifiques-demantelement-etat-americain
Les États-Unis ont longtemps trôné au sommet des pays les plus actifs en recherche et développement (R et D) — et ils y sont encore à plusieurs égards. Avec plus de 750 milliards $US investis en 2022 (3.6 % de leur PIB), le pays dépense encore 50 % de plus que la Chine, et quatre fois plus que le Japon. En outre, la majeure partie des universités les plus prestigieuses se trouve aux États-Unis — si on se fie aux classements internationaux — et le pays a produit ou attiré à ce jour presque la moitié des prix Nobel scientifiques attribués. Même si en matière de production savante la tendance est à la baisse, les États-Unis demeurent responsables de près de 20 % de tous les articles scientifiques publiés à l’échelle mondiale1.
Avec l’élection de Donald Trump, les choses pourraient cependant changer, et rapidement, ce qui ne sera pas sans affecter le champ de la recherche au Canada et au Québec.
Une attaque contre l’autonomie de la recherche
L’excellence en recherche des États-Unis est en grande partie basée sur le soutien gouvernemental à la recherche fondamentale, réalisé via des organismes publics — tels la National Science Foundation (NSF) et les National Institutes of Health (NIH). Or, ceux-ci sont dans la mire de Trump et Musk depuis leur entrée en poste. Il s’agit là d’une bien mauvaise nouvelle pour la communauté scientifique — et pas seulement celle des États-Unis.
Les attaques des républicains sont menées sur plusieurs fronts, tant financiers qu’idéologiques. Par exemple, les NIH — dont le budget global avoisine les 48 milliards US — ont réalisé une coupe immédiate de plus de 4 milliards dans les frais indirects versés aux universités, ce qui représente un montant équivalent à l’ensemble du financement fédéral versé aux universités canadiennes!
On a également sabré dans les ressources humaines de ces organismes, en congédiant 1 200 employés sans autres motifs que celui de ne pas avoir encore obtenu leur permanence. À la NSF, on a licencié 168 scientifiques le 18 février — représentant 10 % des employés de l’institution — dont beaucoup étaient en charge des comités d’allocations des financements, ce qui laisse présager des coupures à venir dans les octrois. Une liste de mots-clés woke (diversity, trans, race, ou women, entre autres) a également été établie par l’administration afin de passer au peigne fin les financements déjà octroyés, menaçant de mettre fin à des milliers de projets en cours. Ces coupures ont d’ailleurs été mentionnées par le président Trump lors de son discours au Congrès du 4 mars dernier, alors qu’il s’est félicité d’avoir mis un frein aux travaux sur les souris trans; confondant ainsi la souris transgénique — un modèle animal utilisé pour développer des traitements pour diverses maladies — avec la souris transgenre qui, évidemment, témoignerait de la science woke réalisée dans les universités...
Quelles répercussions pour les communautés scientifiques canadiennes et québécoises?
Pour nos communautés scientifiques, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis n’est pas sans conséquence, malheureusement. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la recherche s’est internationalisée, et les États-Unis sont au cœur des infrastructures sur lesquelles de nombreux pays (dont le Canada) s’appuient.
Par exemple, en 2023, près de 64 % de tous les articles scientifiques canadiens étaient co-écrits avec des partenaires étrangers, et ceux des États-Unis étaient souvent les partenaires principaux. Cette relation est extrêmement forte dans certains domaines : 37 % de tous les travaux de recherche dans le domaine médical sont réalisés avec des collègues américains, tout comme 35 % en sciences de la terre et de l’atmosphère, et 30 % en psychologie. Dans le cas du Québec, les tendances sont similaires, mais les chiffres sont un peu plus bas, compte tenu de la relation privilégiée avec la France : 35 % des travaux en médecine, 32 % en sciences de la terre et de l’atmosphère, et 24 % en psychologie sont réalisés avec des collègues étasuniens.
Avec un déclin des investissements américains dans ces domaines, on peut s’attendre à des effets directs sur les activités de recherche au pays. On peut également supposer que les programmes conjoints entre les organismes subventionnaires canadiens et québécois et leurs équivalents américains — qui existent dans de nombreux domaines — vont disparaitre à court terme. L’accès aux données et à la documentation scientifique est également touché. On a, par exemple, supprimé l’accès à une foule de données publiques associées à des thématiques tels les changements climatiques. Dans la fin de semaine du premier mars, l’outil de recherche documentaire PubMed, géré par les NIH et utilisé à travers le monde était hors d’usage, ce qui a affecté les travaux scientifiques de millions de scientifiques (le site a reçu 3,66 milliards de requêtes en 2023). La situation est toutefois revenue à la « normale » quelques jours plus tard, mais avec une modification majeure au site web des NIH : la recherche des mots transgender, equity ou racism ramenait directement à la page d’accueil de l’institution.
Que faire dans un tel contexte?
Malgré la situation économique qui s’annonce difficile — et le peu de contrôle sur les comportements erratiques du président américain — il faudra s’assurer d’augmenter nos investissements en recherche. Le Canada demeure bien en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE. Les investissements — réclamés depuis longtemps par la communauté scientifique du pays — devront servir à développer la capacité de recherche nationale. On devra également mettre en place des programmes ciblés, permettant à la fois de consolider les postes des jeunes chercheur·euses au sein de nos institutions, mais également d’attirer des scientifiques en début de carrière employés par des institutions américaines. Bien qu’il existe certains programmes ayant cet objectif — telles les Chaires d’excellence en recherche du Canada — ceux-ci sont mal adaptés à la situation actuelle, car ils sont à la fois très coûteux, et ils visent des chercheur·euses établi·es. D'ailleurs, l'Université de Toronto a déjà réussi à embaucher trois chercheurs de haut niveau en provenance de l’Université Yale. Bien qu’encore anecdotiques, ces embauches témoignent d’un revirement de situation important : historiquement, ce sont les universités américaines qui venaient embaucher des scientifiques canadiens...
Enfin, la diversification de nos partenariats internationaux est essentielle. On observe déjà une croissance des collaborations avec partenaires hors États-Unis; une tendance que la participation du Canada au projet Horizon Europe devrait consolider. Ces investissements devront être faits en mettant l’emphase sur les infrastructures collectives, dont le sort sera indépendant d’un changement de gouvernement au sud de la frontière.
La tâche de revoir l’écosystème de la science canadienne s’annonce difficile, mais nécessaire.
- 1
Pour sa part, le Canada est passé de 4.6 % des articles scientifiques mondiaux à 3.7 % au cours de la même période. Ses investissements en R et D font également piètre figure. Le pays investit 32 milliards (1.7 % de son PIB), ce qui représente environ 4 % du montant investi par nos voisins du sud. Autrement dit, pour une population près de 9 fois plus importante, leurs investissements en R et D sont 23 plus élevés.
- Vincent Larivière
Université de Montréal
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre