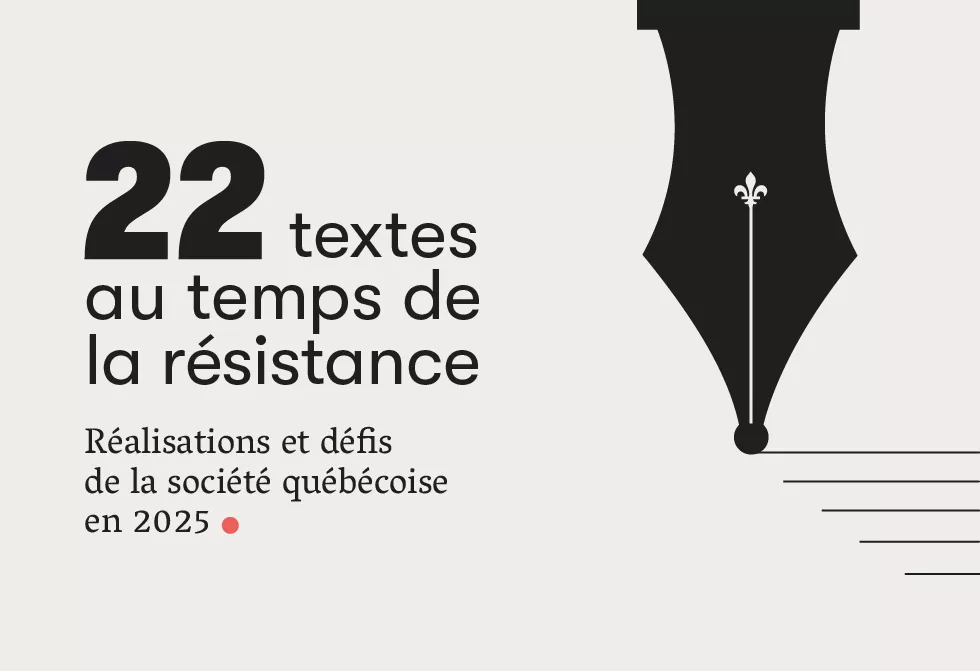La logique de désolidarisation à l’œuvre au Québec, cette société pourtant attachée aux services publics, fragilise le vivre ensemble. La pandémie de Covid-19 a rendu visibles les liens qui existent entre les atteintes aux droits économiques et sociaux et leurs effets sur le collectif. Cette image puissante doit nous rappeler toute leur pertinence face aux vents contraires qui se lèvent. C’est d’ailleurs en ces temps de crise que la mise en œuvre des droits économiques et sociaux s’impose de la manière la plus criante, y compris en forçant l’État à agir.
La pandémie de Covid-19 a révélé au grand jour les graves inégalités sociales qui fracturent la société et accroissent sa vulnérabilité face aux crises, témoignant du besoin de « reconstruire mieux »1, en mettant en œuvre le droit à la santé, à l’alimentation suffisante et à la sécurité sociale2, au bénéfice du plus grand nombre.
Il semble toutefois que le besoin d’un État, – en tant que pouvoir qui incarne la responsabilité collective et qui redistribue la richesse, en priorisant les besoins des personnes les plus « vulnérables » – n’a pas été entendu. La hausse continue des loyers3 se jumelle, au Québec, aux taux d’inoccupation frôlant le 1 %4, à l’insuffisance des logements hors marché et aux expulsions qui perdurent5, sous les traits, notamment, des reprises de logement, des augmentations de loyer et des changements d’affectation des résidences pour aîné·es. En 2022, « l’itinérance à l’extérieur des refuges » a augmenté de 88 %, par rapport à 20186, dans un contexte d’insuffisance de places dans les ressources dédiées et judiciarisation des personnes. Quant à la fréquentation des banques alimentaires, le Bilan-Faim de 2024 fait état d’une augmentation de 13 % en un an.
Face à ces phénomènes, le gouvernement du Québec a posé des gestes qui sont critiquables du point de vue dudans le cadre juridique des droits économiques, sociaux et culturels qui s’imposent à lui en vertu du droit international. En modifiant le Code civil du Québec d’une manière à restreindre le droit de cession de bail7, en maintenant les prestations d’aide sociale à des taux inférieurs à 50 % du minimum requis pour répondre aux besoins de base8, en expulsant des personnes itinérantes de leurs campements et ce, tout en faisant le choix de remettre des chèques individuels de « lutte à l’inflation », aux personnes dont le revenu annuel va jusqu’à 100 000$. Bien que l’État dispose d’une marge d’appréciation lui permettant de choisir les mesures les plus appropriées pour donner effet aux droits, cette distribution de fonds publics dans un contexte de besoins criants semble contraire aux obligations internationales élémentaires que lui impose le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié en 1976 (PIDESC).
Depuis que Donald Trump a été porté au pouvoir chez notre voisin du sud, les menaces à la souveraineté canadienne et à sa frontière, ainsi que les politiques tarifaires états-uniennes plombent la confiance. L’ombre de la récession se dessine et, au Québec, le budget 2025-2026 opte pour l’austérité dans les services publics. Face à cette nouvelle crise qui prend forme, l’État poursuit dans la voie du financement insuffisant des services publics – avec la déshumanisation que cela induit9 –. Ces choix de l’État constituent des mesures régressives qui sont prohibées par le PIDESC et qui fragilisent notre société. Comme le rappelait le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en 2012, dans le contexte de la crise économique et financière de 2008, les atteintes aux droits sociaux et culturels « peuvent aussi être un facteur d’insécurité sociale et d’instabilité politique »10.
...nos recherches nous permettent d’observer que la culture juridique des droits de la personne qui prévaut au Québec et au Canada nuit à une prise en compte sérieuse et effective des droits économiques et sociaux par les juges.
Le portrait n’est pas réjouissant quand on sait, de plus, le peu d’attention que portent les tribunaux judiciaires aux droits économiques et sociaux. En effet, nos recherches nous permettent d’observer que la culture juridique des droits de la personne qui prévaut au Québec et au Canada nuit à une prise en compte sérieuse et effective des droits économiques et sociaux par les juges. Cela fait en sorte que les violations de ces droits demeurent invisibles pour les tribunaux judiciaires. Même un possible « droit à l’abri » pour les personnes itinérantes, bien loin du droit « holistique » au logement, se bute à la fermeture des juges québécois. Cette réserve des tribunaux judiciaires donne les coudées franches au législateur et au gouvernement, pour agir au gré des seules priorités partisanes. Les droits économiques et sociaux n’ont alors de « droits » que leur nom, laissant des pans de la population dans l’exclusion la plus crue et le gouvernement, dans sa toute-puissance.
La logique de désolidarisation à l’œuvre au Québec, cette société pourtant attachée aux services publics, fragilise le vivre ensemble. La pandémie de Covid-19 a rendu visibles les liens qui existent entre les atteintes aux droits économiques et sociaux et leurs effets sur le collectif. Cette image puissante doit nous rappeler toute leur pertinence face aux vents contraires qui se lèvent. C’est d’ailleurs en ces temps de crise que la mise en œuvre des droits économiques et sociaux s’impose de la manière la plus criante, y compris en forçant l’État à agir.
- 1
Christophe Golay, Steven L. B. Jensen, Amanda Lyons, “Research Brief. Building back better with the rights to health, food and social security”, décembre 2022, Genève, en ligne : https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Building%20Back%20Better%20with%20the%20Rights%20to%20Health,%20Food%20and%20Social%20Security%20December%202022%20-.pdf
- 2
Ibid.
- 3
L’augmentation des prix des loyers en 2024, de 8,2% était encore plus importante que celle observée en 2023, qui était de 6,5%. Statistique Canada, Indice des prix à la consommation : revue annuelle, 2024, en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/250121/dq250121b-fra.htm.
- 4
Institut de la statistique du Québec, 22 février 2024. Dans la ville de Québec, le taux d’inoccupation le plus faible de la province est à 0,8%, Ville de Québec, Ibid.
- 5
Le PL-65 a permis l’adoption de la Loi limitant le droit d'éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés, RLRQ, ch.23, qui est entrée en vigueur le 6 juin 2024. Cette loi offre une réponse parcellaire à la crise mais elle a le mérite d’imposer un moratoire de 3 ans sur les évictions, selon certaines conditions. Cela étant, cette loi survient plus de 3 mois après l’adoption du PL-31 qui permet désormais au propriétaire de refuser les cessions de bail sans motif sérieux. Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation, RLRQ, ch. 2, art. 15 qui ajoute l’article 1978.2 au Code civil du Québec.
- 6
« Parmi les 67 communautés et régions qui ont effectué une énumération en 2018 et en 2020-2022, le nombre total de personnes énumérées a augmenté de 20 % ». Gouvernement du Canada, Tout le monde compte 2020-2022 – Résultats du 3e dénombrement ponctuel coordonné de l’itinérance au Canada à l’échelle pancanadienne, Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 2024, p. 11.
- 7
Voir par exemple, l’adoption du PL-31, supra note 5. Voir aussi l’adoption du projet de loi.
- 8
Voir l’adoption du PL-71 le 21 novembre 2024.
- 9
Protecteur du Citoyen, Rapport annuel d’activités 2023-2024, Québec, 2024.
- 10
Ariranga G. Pillay, président du Comité des droits économiques sociaux et culturels, Lettre du 16 mai 2012 adressée par le Président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels aux États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, DOC NU HRC/NONE/2012/76 (2012), en ligne : file:///Users/christinevezina/Downloads/INT_CESCR_SUS_6395_F%20(2).pdf.
- Christine Vézina
Université Laval
Christine Vézina travaille sur les injustices socio-économiques et de santé. Elle mobilise les théories sociojuridiques et la méthodologie empirique pour développer des recherches qui visent à saisir le droit en action, tel qu'il est ou non mobilisé par les acteurs sociaux. Ses questionnements épistémologiques l'amènent à poursuivre des réflexions sur l'engagement de la chercheure et la recherche participative. La professeure Vézina est chercheure principale de COMRADES-Communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux et co-dirige le Centre d’études en droit administratif et constitutionnel (CEDAC). Elle est chercheure au Centre de recherche en droit public (CRDP) et à l’Observatoire sur les profilages.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre