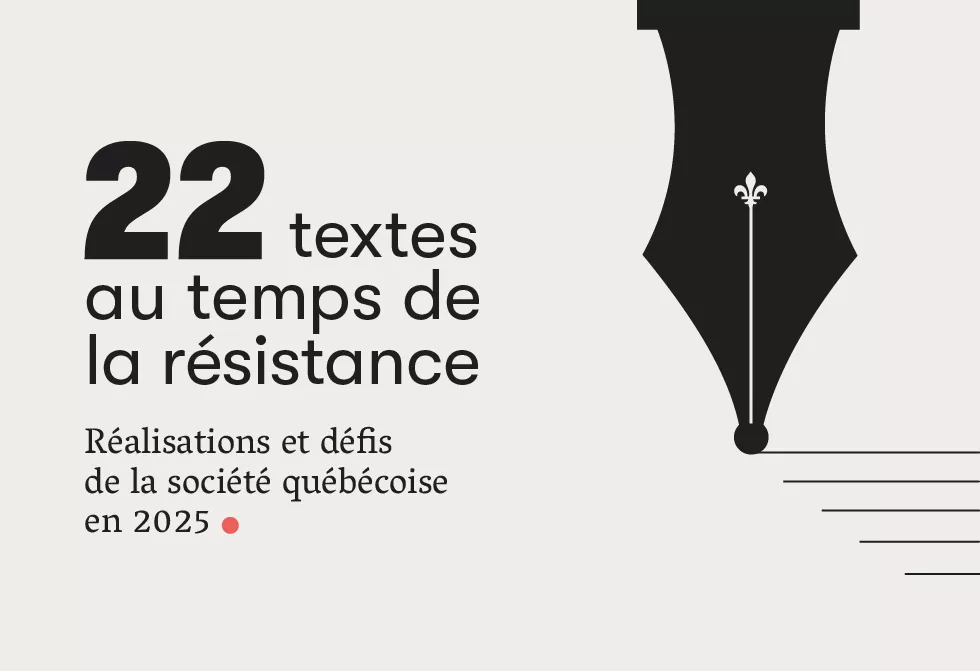Remplies de l’espoir que la pandémie COVID-19 ouvrirait des chemins vers d’autres formes de soins et de solidarités, nous avions écrit en 2020 un texte mettant en relief des valeurs féministes pour l’après-pandémie. Avec un regard sur le vif, analysant un phénomène politique pendant qu’il se développait, nous affirmions que notre « espoir repos[ait] donc sur la possibilité que le Québec et le monde post-COVID-19 soient davantage conscients de la responsabilité partagée et de l’interdépendance profonde qui nous unissent comme populations ». Or, déjà en 2021, cet espoir devenait mitigé. Dans un appel à un changement radical, nous avions souligné que « notre optimisme initial pour une société qui ferait peut-être un retour sur elle-même s’est lentement reconfiguré en désespoir face à la […] la résurgence et l’exacerbation des nationalismes des vaccins, de la nécropolitique des États, de la violence contre les femmes et de la précarité sociale et économique ».
Cinq ans après le début de la pandémie, dont l’ampleur – collective et individuelle – des conséquences est encore difficile à calculer, nous écrivons ces lignes dans un profond état d’incertitude dû à la montée des violences, guerres, et multiples formes de conservatismes, qui touchent particulièrement les vies déjà précarisées, les femmes, les personnes LGBTQIA2S+ et racisées. Dans ce texte, nous « retournerons » sur nos expériences de recherche et d’action avec des féministes latino-américaines pour appeler, encore une fois, à la nécessité des solidarités translocales.
Des vies et des droits encore plus fragilisés
Les incertitudes globales face aux mesures de l’administration Trump, les multiples attaques aux principes fondamentaux des de la personne, le support militaire à des actions d’effacement ethnique et de guerre, les mesures qui s’attaquent à l’essence même des libertés et de la pensée autonome et qui « néolibéralisent » toutes les sphères de la vie, créant une onde de choc par l’intimidation, tout en détruisant toute possibilité de pensée critique : nous sommes devant une des crises politiques mondiales les plus graves de l’époque contemporaine.
Les dernières années ont rendu encore plus explicite ce que les féministes soulignaient depuis des décennies : les acquis sur le plan des droits de la personne et des mesures de réparation historique de protection des groupes subalternisés sont encore fragiles et peuvent être (et ils le sont) constamment démantelés et remis en question.
D’une perspective féministe, nous constatons une montée extrême des discours et des politiques antiféministes. Des chercheur·es et militant·es féministes de partout dans le monde, rencontrent de plus en plus de résistances. Il leur devient difficile de continuer à porter leurs/nos luttes dans un contexte de violences, parfois extrêmes, contre les corps féminins et féminisés. En témoigne la contestation de la reconnaissance des droits des personnes transgenres, les actions contre l’accès sécuritaire à l’avortement, les menaces et violences envers les professeur·es et chercheur·es en études de genre et études féministes, mais aussi dans le champ des études climatiques et le champ des actions en « égalité, diversité et inclusion ».
En ces temps inquiétants, il est révélateur d’analyser – en tant que chercheures travaillant dans les contextes brésilien et colombien – ces phénomènes politiques de fragilisation des droits, mais aussi les luttes sociales qui s’éveillent en réponse.
En ces temps inquiétants, il est révélateur d’analyser – en tant que chercheures travaillant dans les contextes brésilien et colombien – ces phénomènes politiques de fragilisation des droits, mais aussi les luttes sociales qui s’éveillent en réponse. Comme un déjà vu, cela nous fait penser au contexte brésilien lors de la première année du gouvernement de Jair Bolsonaro, en 2019. Tout comme on le voit actuellement avec l’administration de Trump, les promesses de campagne, perçues à l’époque comme absurdes, se sont transformées en actions politiques officielles. Ces actions ont remis en question les études féministes, les politiques en matière d’égalité de genre et sexuelle, ainsi que les mesures de protection de l’environnement. Lors d’un préterrain de recherche, des féministes brésiliennes nous avaient affirmé que, avec le gouvernement bolsonariste, il n’y avait plus d’espace de discussion pour faire avancer les droits des femmes, des personnes LGBTQI+ et faire reculer les discriminations raciales. Les visées de la stratégie politique féministe se sont plutôt tournées vers l’empêchement du recul des droits acquis et du recul de la démocratie.
Six ans plus tard, en 2025, lors d’un terrain de recherche en Colombie, nous avons partagé des espaces avec des féministes qui militent pour les droits des femmes et personnes LGBTIQ+ depuis des décennies. Cette occasion a permis de réaffirmer, au final, l’importance de l’espace que nous donnerons, en ces temps de crises multiples, aux rassemblements des forces contre le recul des droits de la personne et de lutte pour une démocratie qui lutte contre la précarisation des vies. Parmi les batailles menées depuis des décennies, entre autres contre le patriarcat guerrier, ces groupes féministes nous rappellent que nous n’avons pas le temps de baisser les bras ou de nous laisser abattre par le désespoir et l’insécurité croissante imposés par les discours conservateurs et haineux. Plutôt, il est temps de continuer à construire des ponts et des alliances translocales pour bâtir un projet de société globale basé sur la justice sociale.
Solidarités translocales
Nous persistons ainsi dans la réaffirmation de la centralité de la convergence des luttes contre la fragilisation des droits, et dans la recherche permanente de nouvelles formes de solidarités translocales. Nous voulons veiller à ce que notre créativité et notre imagination de possibles futurs non-violents ne soient pas minées par l’incertitude et l’intimidation. La solidarité translocale et l’ouverture à construire collectivement des projets de changements radicaux sont plus pertinentes que jamais.
Grâce aux féministes des Suds globaux, nous avons appris le pouvoir libérateur des luttes sociales de ces régions les plus affectées par l’impérialisme, le colonialisme et la précarisation de la vie. En ce sens, nous avons beaucoup à apprendre des féministes en Amérique latine : elles nous ont enseigné que l’amitié et l’insurrection radicale, face aux oppressions multiples, doivent opérer dans une résonance translocale. Cette résonance s’effectue à travers et au-delà des frontières. Les « collectives » – dont nous faisons partie et celles avec qui nous dialoguons constamment – continuent d’articuler les luttes et, d’une certaine manière, reviennent à l’importance du changement radical dans la manière dont nous nous mobilisons, prenons soin, cocréons des connaissances pour un monde différent, non-violent, féministe.
Dans la collective que nous habitons, Lüvo, nous parlons souvent de l’importance des solidarités féministes translocales et de l’amitié révolutionnaire qui déconstruit ces frontières empêchant d’imaginer un monde non-violent; d’imaginer des mondes autrement comme nous invitent à le faire les théoricien·nes de la décolonialité. Tout d’abord, avec toutes celles avec qui nous luttons pour un monde anti-oppressif, nous voulons guider nos batailles pour la justice sociale à travers l’adoption des principes éthiques et épistémologiques orientant de manière tangible nos luttes contre les systèmes violents. Notre amitié se déploie dans la translocalité, et elle est une réponse collective directe contre les politiques violentes des États-nations qui minent la convergence des luttes. Cette amitié « se dessine » sous des formes de lutte qui remettent les postulats féministes anti-oppressifs au centre et qui réclament une possibilité de penser la militance à partir du soin, de la joie, de la radicalité. C’est « un engagement farouche en faveur des formes de vie émergentes dans les fissures de l’Empire, ainsi que des valeurs, des responsabilités et des questions qui les soutiennent », selon l’invitation de bergman et Montgomery.
Les féministes nous invitent donc au mouvement vers le changement, et nous incitent à l’action collective vers la justice sociale et la résistance translocale. En ces temps de crises, le Québec a beaucoup à apprendre des résistances féministes latino-américaines et des Suds. Plus que jamais, nous avons besoin de possibilités, de chemins théoriques et pratiques ouverts par celles qui nous ont précédées et par celles qui continuent de s’insurger contre les structures oppressives qui fragilisent nos droits et nos vies.
Plus que jamais, nous avons besoin de possibilités, de chemins théoriques et pratiques ouverts par celles qui nous ont précédées et par celles qui continuent de s’insurger contre les structures oppressives qui fragilisent nos droits et nos vies.
- Danielle Coenga-Oliveira
Université de Montréal
Danielle Coenga-Oliveira est professeure adjointe au département de science politique de l’Université de Montréal. Chercheure en genre et politique, ses travaux actuels analysent la participation des politiques antiféministes anti-genre dans le processus de recul démocratique au Brésil. Elle est membre du Réseau québécois en études féministes (RéQEF) et directrice régionale de la Fundación Lüvo.
- Priscyll Anctil Avoine
Swedish Defence University
Priscyll Anctil Avoine est chercheure en études féministes sur la sécurité et professeure adjointe au Département des études sur la guerre à la Swedish Defence University (Suède). Ses recherches portent sur la militance politique des femmes participant dans les insurrections de gauche et dans la consolidation de la paix. Elle est co-auteure du roman graphique Militancia feminista post-lucha armada de las farianas (2024) avec Zulay Carolina Rueda. Priscyll est directrice principale de la Fundación Lüvo, une collective féministe et antiraciste.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre