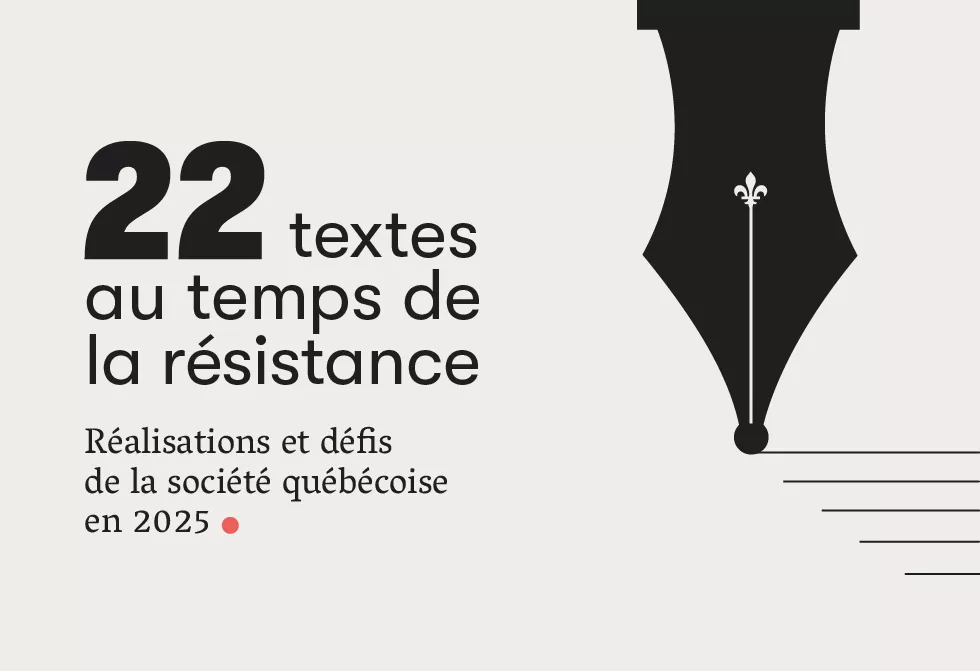Alors que la crise climatique s’intensifie, l’élection de chefs d'État ouvertement climato-sceptiques dans les dernières années a de quoi faire réfléchir. Avec une rhétorique populiste (par exemple, le drill, baby, drill du Parti républicain aux États-Unis) et la politisation du débat (par exemple, le slogan axe the tax du Parti conservateur du Canada), on peut parler d’un « moment populiste » dans la politique climatique (Mouffe, 2018), qui nous force dès lors à repenser la réponse démocratique.
À la question « La montée du populisme pose-t-elle problème à la résolution de la crise climatique? », la réponse est incontestablement « oui ». De manière générale, le populisme de droite politise l’enjeu climatique au sens négatif du terme: il instrumentalise la science et les politiques afin d’empêcher la société d’en arriver à des mesures concrètes pour répondre à la crise climatique. C’est ce que j’appelle ici la « politisation obstructionniste ».
Cette politisation s’opère de deux manières. D’abord, le populisme alimente un antagonisme entre la population et les « élites » du savoir. Ensuite, il utilise ce que j’appelle « l’argument des personnes les plus affectées » afin de ralentir l’action climatique. Bien sûr, toute réponse convaincante à la crise climatique doit tenir compte de cet argument, qui intègre des considérations de transition juste et de justice climatique, mais le populisme utilise cet argument pour faire obstruction à l’action climatique, au lieu de le considérer au sein d’une stratégie climatique.
Le populisme
Une brève typologie des courants populistes révèle l’existence de différentes formes et diverses tendances, de droite et de gauche. On a observé que les populistes peuvent aussi bien émerger de partis traditionnels (comme aux États-Unis et au Canada), mais peuvent également créer de nouveaux partis (comme en Europe). Et le populisme peut être observé au niveau de l’idéologie politique d’un candidat ou d’un parti, de leur stratégie politique, de leur discours ou de leur logique politique1. Néanmoins, il est possible d’identifier trois concepts centraux à la pensée populiste : le peuple (ou la notion d’un peuple unifié), un ennemi extérieur à ce peuple (les immigrants, par exemple), et l’idée des « élites » (un ennemi interne, disons).
Ce sont les tensions entre le nationalisme identitaire et l’immigration qui ont été les plus souvent étudiées jusqu’à récemment. Pourtant, une autre caractéristique fondamentale du populisme, c’est qu’il cherche à opposer « le peuple » à « l’élite »2. Les élites qui sont la cible des populistes sont les experts, qu’ils travaillent dans le monde académique ou la fonction publique – et qui veillent au fonctionnement des démocraties –, et bien sûr, les élus et les médias dits traditionnels. C’est ce qu’on observe avec l’administration Trump aux États-Unis avec le démantèlement d’agences scientifiques comme le NOAA, qui joue un rôle important face à la crise climatique, ou au Canada, avec Pierre Poilièvre, qui demande qu’on arrête de financer CBC.
On devrait être en mesure aujourd’hui de soutenir massivement les politiques de transition énergétique et de lutte aux changements climatiques. Or, on est à l’ère du populisme, et nous ne sommes pas à l’abri des politisations obstructionnistes.
Le populisme et le climat
Les changements climatiques nous demandent de repenser nos modes de vie et l’organisation de la vie en société. Face à un tel effort, les populistes répondent par une mise en accusation électoraliste: « une élite globale exige que nous changions notre façon de vivre », disent-ils. Il devient dès lors facile pour eux de dépeindre l’action climatique comme les demandes d’une élite cosmopolite déconnectée qui veut porter atteinte aux modes de vie traditionnels.
Il y a un élément complémentaire à cette idée : les changements climatiques nous imposent de faire les choses autrement, si nous voulons éviter leurs pires conséquences. Cette imposition fait en sorte qu’agir « n’est pas un choix ». Or, le populiste prône qu’on a toujours le choix, que notre liberté individuelle présuppose ce choix. L’urgence climatique, nous privant de ce choix, devient donc une cible idéale pour les populistes3.
Cette opposition aux élites est d’autant plus problématique que les populistes s’efforcent, en campagne ou au pouvoir, de « démanteler » ceux et celles en position d’identifier les problèmes et de guider notre action collective. Cette opposition aux experts crée un antagonisme qui fragilise la société démocratique en supprimant le savoir qui la sous-tend (les experts) et le contre-pouvoir qui la tient en garde (les journalistes).
C’est pourquoi le populisme pourrait nous amener vers la post-vérité. On ne pourra plus gouverner, voire alimenter la discussion démocratique sur l’enjeu climatique, ou tout autre enjeu, comme la santé ou la fiscalité, sur des bases scientifiques. On démonise le savoir, et on perd la connexion avec la vraie information. Et c’est une des raisons pourquoi le populisme ouvre la porte aux régimes autoritaires.
Comme le disait Hannah Arendt, « le citoyen idéal du totalitarisme n’est pas le nazi convaincu ou le communiste convaincu, mais bien les gens pour qui la distinction entre le fait et la fiction, ou la distinction entre le vrai et le faux n’existe plus »4.
Comme le disait Hannah Arendt, « le citoyen idéal du totalitarisme n’est pas le nazi convaincu ou le communiste convaincu, mais bien les gens pour qui la distinction entre le fait et la fiction, ou la distinction entre le vrai et le faux n’existe plus ».
La politisation de l’action climatique
La politisation peut être définie comme le fait de placer un enjeu (comme celui du climat), qui ne l’était pas auparavant, dans la sphère politique. L’enjeu est mis à l’agenda politique, des intérêts se forment autour de l’enjeu, des décisions collectives peuvent être prises et une polarisation peut être observée1.
La dépolitisation, quant à elle, prend généralement la forme d’une professionnalisation et d’une délégation de l’enjeu à des agences spécialisées. Cette dépolitisation peut être le reflet d’un consensus, en l'occurrence on pourrait parler du consensus autour de la science du climat, qui établit autant la réalité du phénomène que sa cause anthropocentrique.
Enfin, la repolitisation consiste à rouvrir le débat politique sur un enjeu1. C’est dans le sillage de cette tentative de repolitisation qu’intervient le populisme.
Le problème ici est que certains populistes de gauche prétendent que l’on peut entièrement dépolitiser le débat climatique, tandis que les populistes de droite vont politiser le débat dans le but de faire obstruction à l’action climatique.
L’on pourrait croire qu’une partie de l’action climatique devrait être dépolitisée, car il s’agit...
(A) ...d’atteindre des cibles de réductions d’émissions de GES établies scientifiquement...
(B) ...par la mise en place d’une série de politiques publiques.
Or, si on ne politise pas (A), la partie (B) de l’équation aura nécessairement une dimension politique. La question est bien celle-là : les populistes de droite ont politisé non seulement (A) pendant des décennies avec des positions climatosceptiques (ce qui, par ailleurs, profite à l’industrie pétrolière) ou avec l’antagonisation des experts, mais ils ont également politisé (B) en instrumentalisant les politiques climatiques dans un objectif obstructionniste.
Ce qui devrait être la politisation au sens positif du terme d’une ouverture au débat démocratique et non au sens négatif de nous empêcher d’arriver à des solutions, est précisément le point (B), qui touche à l’effet des politiques climatiques sur les populations. C’est ce que j’appelle « l’argument des personnes les plus affectées ». C’est ce que le gouvernement Trudeau avait fait avec la taxe carbone, en redonnant les revenus aux 80 % de la population les moins bien nantis (c’est pourquoi la taxe carbone devrait plutôt être comprise comme un mécanisme de leviers et de dividendes). Et ici, un populiste conservateur comme Pierre Poilièvre a fait de la politisation obstructionniste : au lieu de permettre la politisation positive du débat en dirigeant les revenus de la taxe carbone aux personnes les plus affectées, il a mené une campagne de désinformation sur les effets de la taxe carbone sur le coût de la vie.
On devrait être en mesure aujourd’hui de soutenir massivement les politiques de transition énergétique et de lutte aux changements climatiques. Or, on est à l’ère du populisme, et nous ne sommes pas à l’abri des politisations obstructionnistes.
Et cette élection l’illustre parfaitement. Les populistes conservateurs ont fait de la politisation négative avec la taxe carbone. Mark Carney en supprimant la taxe carbone, nullifie par l’effet même le slogan axe the tax du Parti conservateur. Un coup électoral pour contrer un coup électoral. La taxe carbone, et avec elle la lutte climatique, en sortent perdantes. La lutte climatique est encore une fois ralentie par la politisation de l'enjeu par des candidats populistes.
Si les conservateurs perdent cette élection, que plusieurs croyaient gagner d’avance, l’on pourrait au moins voir une sorte de justice poétique. Or, pour la lutte climatique, il n’y aura pas grande poésie là-dedans.
La crise climatique ne passera pas toute seule. Si nous ne faisons pas face au populisme, elle sera là pour rester.
La crise climatique ne passera pas toute seule. Si nous ne faisons pas face au populisme, elle sera là pour rester.
Références
Arendt, Hannah (1951) Les origines du totalitarisme.
Marquardt, Jens & Lederer, Markus (2022) Politicizing climate change in times of populism: an introduction, Environmental Politics, 31:5, 735-754.
Mouffe, Chantal (2018). For a left populism. London & New York: Verso.
Lockwood, Matthew (2018) Right-wing populism and the climate change agenda: exploring the linkages, Environmental Politics, 27:4, 712-732.
White, Jonathan (2023) What makes climate a populist issue?, Centre for Climate Change Economics and Policy Working Paper 426. London: London School of Economics and Political Science.
- Alexandre Gajevic Sayegh
Université Laval
Alexandre Gajevic Sayegh est professeur agrégé au Département de science politique de l’Université Laval. Il travaille sur les politiques climatiques et la transition juste au Canada. Ses recherches, financées par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et le Fond de recherche du Québec (FRQ), portent sur la politique des changements climatiques, la transition énergétique, la tarification du carbone et l’économie verte. Il est le Directeur scientifique du projet Mouvement Entreprises Vertes Quebec (MEVQ) et sera Directeur du projet qu'il met présentement sur pied: l'Observatoire de la Relance et de l'Économie Verte (OREV). Il collabore régulièrement avec les médias au Québec et ailleurs pour commenter l'actualité environnementale.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre