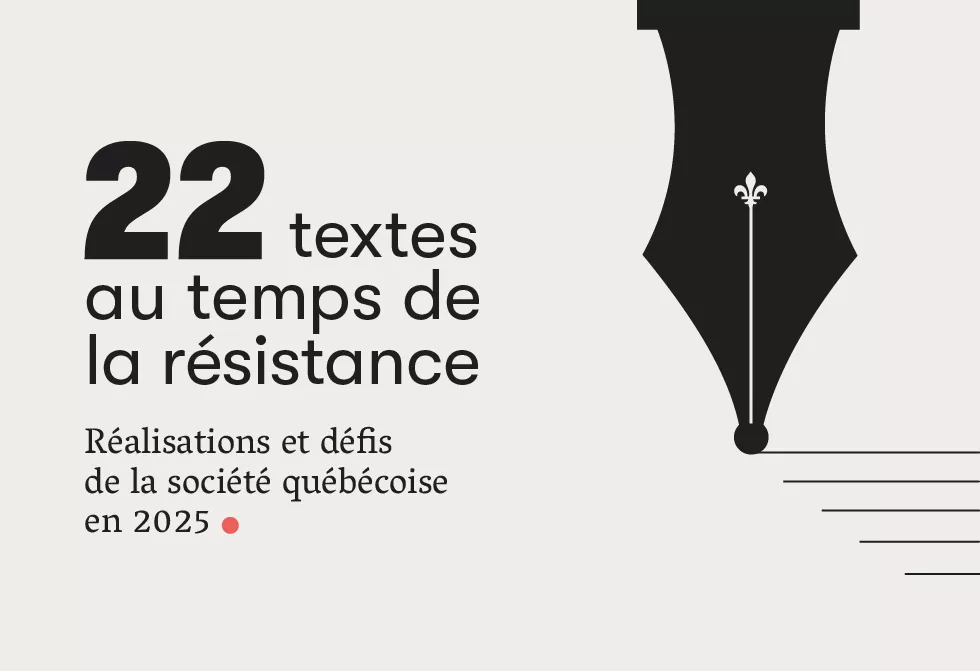L’immigration est devenue ces dernières années un sujet chaud, entre autres dans les médias, et ce phénomène s’est accentué depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui a donné lieu à des actions offensives contre les immigrants. Après plusieurs années d'un discours international en faveur de l'immigration, du respect des ententes avec de nombreux pays pour l’accueil des personnes réfugiées et de l’ouverture au monde, le Canada a durci sa politique d’immigration depuis 2024. Le gouvernement a notamment adopté un Plan frontalier se traduisant en un investissement de 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité. En 2025, le Québec a pour sa part présenté un Plan d'immigration qui contient 4 moratoires temporaires sur des programmes d’immigration permanente, dont le Programme d’expérience québécoise. Sur la place publique, on entend des discours où les personnes immigrantes sont identifiées comme responsables de problèmes multifactoriels (ex. la crise du logement, la difficulté d'accès à des services médicaux, etc.), en ignorant la diversité des causes incluant le rôle des politiques publiques.

Dans ce contexte hostile, du 22 au 24 janvier 2025, une semaine après l'investiture de Donald Trump, 315 personnes (intervenantes, responsables d’organisations publiques, communautaires, municipales, gouvernementales et des membres de la société civile, expertes, scientifiques et universitaires, personnes concernées) provenant de diverses régions du Québec se sont rencontrées pendant trois jours lors du forum Pleine participation des personnes im/migrantes : des pratiques prometteuses au cœur de l’action intersectorielle locale; événement financé par le CRSH.
Ce forum est le résultat de collaborations de longue date entre les milieux académiques – notamment les équipes ÉRASME et REGARDS – et ceux de l’action publique, communautaire et citoyenne. Les projets de recherche réalisés ont permis de documenter l’énorme richesse des initiatives contribuant à la création des communautés inclusives. Étant donné la complexité des enjeux de l’immigration, ces initiatives mobilisent plusieurs acteurs, concernés et interdépendants, dans le cadre d’actions intersectorielles, impliquant le milieu communautaire, le secteur public et le secteur privé.
Une vision commune rassemble donc tous les participant·es au forum : les personnes immigrantes contribuent notablement au développement socioéconomique du Québec. Il importe, d’une part, de valoriser cette contribution et d’autre part d’identifier et de partager les stratégies pour créer un Québec plus inclusif et favoriser la pleine participation des personnes immigrantes.
Au détour de deux jours et demi de panels, d'ateliers-conférences et d’ateliers participatifs, les participant·es ainsi que les 52 conférencier·ières ont discuté, débattu et co-créé des recommandations interpellant différents acteurs de la société. Les panels ont abordé plusieurs enjeux dont l’accès à la protection et à l’exercice des droits et la mise en place des politiques inclusives. Une demi-journée a aussi été consacrée aux défis particuliers touchant les jeunes, notamment l’employabilité faisant écho à de nombreuses recherches en partenariat. Il faut savoir que les jeunes adultes immigrants, en particulier les immigrants récents, font face à des défis tels que la perte de repères, parfois des barrières linguistiques et des enjeux de santé mentale.
Cela étant, le forum a focalisé sur les actions intersectorielles répondant à la complexité des enjeux liés à l’immigration. Dans cette perspective, on a notamment discuté de l’apport des espaces de concertation intersectoriels qui existent au niveau local, régional et provincial, ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés. S’il apparait que les acteurs impliqués dans ces espaces font face à différentes réalités, fonctionnent dans divers contextes et collaborent avec différents partenaires, tous sont confrontés aux mêmes défis : la mobilisation des acteurs concernés et le maintien de leur engagement dans le temps, la gestion des controverses, le développement de capacités d’action collective, la coordination entre les espaces de concertation, l’influence de ces espaces sur la prise de décision politique. À travers les discussions, les panélistes et les participant·es ont nommé des stratégies pour faire face à ces défis. À titre d’exemple, on souligne l’importance d’avoir des mécanismes solides de collaboration entre les décideurs politiques et les espaces de concertation, et donc d’asseoir la légitimité de ces derniers sur la transmission des données probantes et la transmission des préoccupations du terrain.
Au-delà du rôle des espaces de concertation, le forum a aussi permis à des intervenant·es de tout le Québec de partager les enseignements tirés des initiatives locales intersectorielles novatrices qui contribuent à l’inclusion et la participation des personnes immigrantes (voir notamment Labo immigration – inclusion – participation – Laboratoire vivant ÉRASME). Celles-ci peuvent concerner des problématiques particulières, des groupes de population spécifiques ou des éléments structurels pour soutenir l'action intersectorielle. Dans le domaine de l’immigration, par exemple, le ROHMI (Regroupement des Organismes en Hébergement pour les Personnes Migrantes) agit pour prévenir l'itinérance, et pour offrir des portes de sortie aux personnes immigrantes qui tombent en itinérance. Le ROHMI déploie également un travail de plaidoyer auprès des paliers gouvernementaux et acteurs institutionnels pour agir sur les facteurs de la précarité. Le ROHMI agit en intersectorialité, pour créer un écosystème de partage d'expertise et d'expérience parmi les acteurs en immigration, itinérance, et logement au Québec. Des exemples concrets d’actions intersectorielles visant la prévention de l’itinérance ont été présentés : la mise en place du rôle de pair·es migrant·es , le travail de proximité auprès de personnes sans statut, ainsi qu’une campagne de sensibilisation « Rêver à l'essentiel ».
Une autre initiative prometteuse présentée lors du forum est un projet pilote mené entre 2020 et 2023 par une équipe de chercheuses en partenariat avec l’arrondissement de Montréal-Nord en vue de soutenir la collaboration entre organismes. On y a notamment développé un outil de cartographie de l’écosystème informationnel qui permet de bien saisir l’offre de services dans un territoire donné, ainsi que les caractéristiques des populations résidant dans les différents secteurs du territoire. Cet outil interactif peut servir à différentes fins : 1) le référencement des usagers en fonction de leurs besoins, de leur statut migratoire, et de leurs caractéristiques socio-démographiques; 2) l’analyse de l’offre de services, en fonction des besoins des nouveaux arrivants du point de vue de son adéquation; 3) la coordination des services offerts par les différents organismes.
Les initiatives partagées pendant le forum, témoignent d'une volonté forte des milieux de pratique pour créer un Québec plus solidaire et plus inclusif. La recherche peut certainement – grâce à la production de données probantes, l’accompagnement du changement de pratiques et le transfert des connaissances – contribuer à l’émergence, le développement, l’institutionnalisation d’innovations sociales répondant à la complexité des enjeux d’immigration.
La recherche peut certainement – grâce à la production de données probantes, l’accompagnement du changement de pratiques et le transfert des connaissances – contribuer à l’émergence, le développement, l’institutionnalisation d’innovations sociales répondant à la complexité des enjeux d’immigration.
- Nassera Touati
École nationale d’administration publique
Dr Touati est professeure titulaire à l’École Nationale d’administration publique. Durant ces dernières années, elle a développé des projets de recherche qui s’intéressent aux actions intersectorielles, comme réponses aux problématiques sociales complexes, telles que l’accueil des immigrants, la violence conjugale, l’itinérance, etc. Depuis 2018, elle est la Directrice Scientifique de l’équipe REGARDS-Équipe de recherche sur la gouvernance et l’articulation des réseaux de solidarité, équipe en partenariat financée par le FRQSC. L’équipe REGARDS et ses partenaires (organismes communautaires, municipalités, organisations socio-sanitaires) assument un rôle de leadership dans le développement et la mobilisation des connaissances concernant l’action locale en réseau intersectoriel.
- Lourdes Rodriguez del Barrio
Université de Montréal
Lourdes Rodriguez del Barrio, PhD, est professeure titulaire à l’École de Travail social de l’Université de Montréal, directrice du Centre de recherche InterActions et de l’Équipe de Recherche et d’Action en Santé Mentale et culture (ÉRASME). Ses travaux abordent la participation citoyenne, les pratiques collaboratives et dialogiques, et leur adaptation à la diversité, notamment à la situation des personnes immigrantes et réfugiées.
- Marie-Jeanne Blain
Université Concordia
Marie-Jeanne Blain est chercheuse à l’Institut de recherche sur les migrations et la société (IRMS) à l’Université Concordia et chercheuse affiliée au Migrant Integration in the Mid-21st Century: Bridging Divides research program. Elle est aussi professeure associée au département d’anthropologie de l’Université de Montréal et membre du Centre de recherche InterActions. Elle réalise depuis plus d'une dizaine d'années des recherches sur l'inclusion des personnes immigrantes et réfugiées au Québec, en particulier les processus d'insertion socioprofessionnelle. Ses thèmes de recherche portent sur les aspirations professionnelles de migrant·e·s de différents statuts d'immigration, leurs ressources de soutien, et la mise en place de politiques et programmes dans ce champ.
- Naïma Bentayeb
Institut universitaire SHERPA
Naïma Bentayeb est chercheure d’établissement à l’Institut universitaire SHERPA et professeure associée à l'École nationale d’administration publique (ENAP) et à l’école de travail social de l’Université McGill. Dr Bentayeb mène des évaluations et des recherches axées sur les milieux de pratique communautaires et institutionnels. Elle s'intéresse particulièrement aux enjeux structurels et systémiques concernant l'accueil, l'intégration, l’accessibilité des services et l’adaptation des interventions pour les personnes im/migrantes, réfugiées, racisées et/ou s’identifiant à un groupe culturellement minoritaire. Avec une perspective multidisciplinaire, intersectorielle et intersectionnelle, elle met de l’avant une approche développementale et participative axée sur les apprentissages et l’amélioration continue des pratiques.
- Marianne Chiu-Lezeau
Professionnelle de recherche
Marianne Chiu-Lezeau travaille comme professionnel·le de recherche et de transfert des connaissances. Iel s'intéresse à des questions d'identité, d'engagement socio-politique et de justice climatique, et rêve au futur inclusif.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre