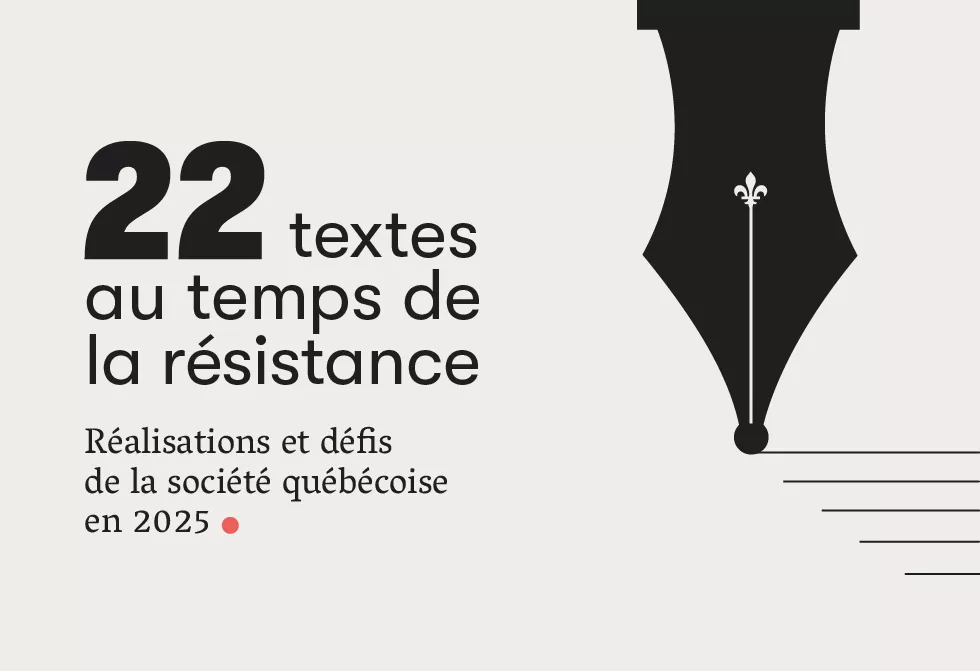Prendre soin des régions minières, les envisager comme elles sont, c’est-à-dire des vies, humaines, animales, végétales, comme un bien collectif, et non comme une ressource déterminée au niveau mondial, nous augmentons à la fois nos chances de s’enrichir collectivement et d’assurer notre sécurité nationale.
Le retour au pouvoir de Donald Trump et les négociations d’un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine transforment la géopolitique des ressources naturelles et plus précisément, celle des minéraux critiques. Le lithium, le magnésium, les éléments de terres rares, le graphite, le nickel, le cobalt – et la liste est longue – sont utilisés notamment pour la production des technologies vertes, comme les éoliennes et les panneaux solaires, servant à produire des énergies renouvelables, nécessaires à la transition énergétique. Ils sont aussi au cœur des technologies soutenant les modes de vie contemporains, comme les téléphones intelligents et le développement de l’intelligence artificielle. Ils sont considérés comme “critiques” essentiellement parce que leur approvisionnement n’est pas sécurisé.
La pandémie de COVID-19 a non seulement exposé la fragilité de nos chaînes d’approvisionnement, mais pousser les gouvernements canadiens et québécois à proposer des initiatives stratégiques et à consolider des alliances pour sécuriser les minéraux critiques face à la Chine. Or, les plans québécois et canadiens annoncés dans les cinq dernières années partaient avec prémisse fausse sur le plan géopolitique. Que ce soit pour « bâtir un Québec à la fois plus vert, plus prospère et plus fier » ou pour offrir « une source d’approvisionnement sûre et responsable », ceux-ci entrevoyaient une étroite collaboration avec les États-Unis. Ironiquement, le même président américain qui a adopté un Plan d’action conjoint entre le Canada et les États-Unis en 2020 pour sécuriser les chaînes logistiques des minéraux critique, nous livre désormais une guerre commerciale et s’inspire de la diplomatie minérale de la Chine.
Face à l’approche prédatrice des États-Unis, l’exploitation des minéraux critiques au Québec nous semble inévitable : la pression pour leur sécurisation viendra de tous les côtés. Penser le Québec de demain, c’est d’assurer que « l’urgence » d’extraire nos richesses soit accompagnée d’une responsabilité de prendre soin de nos régions minières sur les plans socio-environnementaux.
Penser le Québec de demain, c’est d’assurer que « l’urgence » d’extraire nos richesses soit accompagnée d’une responsabilité de prendre soin de nos régions minières sur les plans socio-environnementaux.
Inévitabilité de l’exploitation des ressources pour la sécurité énergétique
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a souligné en 2024 que les transitions énergétiques ont augmenté la demande mondiale pour des panneaux solaires, des voitures électriques et des batteries. Cependant, un important écart se creuse entre l’offre et la demande de ces minéraux critiques. Sur les 34 minéraux critiques de la liste canadienne, six sont considérés « prioritaires » et ce sont les mêmes identifiés par le Forum économique mondial : le lithium, le cobalt, le cuivre, le graphite, le nickel et certains éléments des terres rares. Or, la répartition géographique de ces minéraux critiques est inégale. L’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie de Sud-Est deviennent donc des champs de bataille entre quatre grandes puissances : la Chine, l’Union européenne, la Russie et les États-Unis.
Par chance, le Canada et le Québec disposent en abondance de ces minéraux critiques. Le Québec regorge de ces ressources, telles que du cuivre, du graphite, du zinc, du cobalt, du niobium, du nickel, du titane et du lithium, pour un total de 28 minéraux critiques inscrits sur la liste du gouvernement. Comme l’a souligné en novembre 2024 la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, Maïté Blanchette Vézina, « nous sommes l’un des rares territoires au monde à disposer de tous les minéraux nécessaires à la fabrication des batteries ». Toutefois, l’exploitation des ressources naturelles – ici ou ailleurs dans le monde – reste un processus qui a des impacts socioenvironnementaux locaux disproportionnés. Ainsi, la question est de savoir qui et comment seront exploités ces minéraux critiques sur le territoire québécois ?
...l’exploitation des ressources naturelles – ici ou ailleurs dans le monde – reste un processus qui a des impacts socioenvironnementaux locaux disproportionnés.
Risques socioenvironnementaux locaux élevés des projets miniers
La saga autour de la Fonderie Horne, propriété de la multinationale suisse Glencore, à Rouyn-Noranda, expose le dilemme que plusieurs régions québécoises affronteront dans les années à venir : la sécurité économique ou le droit à la santé et à un environnement sain.
- D’une part, la seule fonderie de cuivre en Amérique du Nord dont le rôle est critique pour la sécurité économique du Canada ;
- D’autre part, le taux d’arsenic supérieur aux normes québécoises qui découlent du processus de recyclage des déchets électroniques qui sont traités par la fonderie.
En raison des menaces qui pèsent sur le Canada, on voit déjà apparaître la rhétorique selon laquelle il est impératif d’exploiter les minéraux critiques pour notre sécurité énergétique. C’est d’ailleurs ce qui justifie depuis longtemps un bon nombre de projets miniers sur la planète et qui permet à plusieurs gouvernements de passer outre certaines réglementations environnementales et certains processus de consultation publique. C’est le cas en Inde, en Afrique du Sud et en Bolivie, où des projets énergétiques sont présentés comme des questions d’intérêt national, octroyant une grande marge de manœuvre aux compagnies extractives au détriment de la santé des sols et des communautés qui vivent dans des lieux riches en ressources.
Si l’on veut assurer la sécurité nationale du Québec par l’exploitation des minéraux critiques, il faut absolument éviter l’irréversibilité des impacts sociaux et environnementaux de ces projets miniers qui rendront notre monde encore moins sécuritaire. Si nous détruisons nos écosystèmes au nom de la transition énergétique et de la sécurité nationale, sans penser à leur régénération, nous serons perdants. Il est profondément incohérent de produire des véhicules électriques en justifiant qu’ils ne polluent pas, si leur conception a à l’inverse détruit une forêt qui captait une quantité inestimable de carbone.
Prendre soin
Face à l’inévitabilité de la pression qui s’exercera dans les mois et années à venir, le Québec est amené à se questionner collectivement sur l’approche qui guidera ses actions dans l’exploitation des minéraux critiques. Dans ce contexte, nous proposons de diriger la réflexion autour de l’idée de prendre soin des régions riches en minéraux critiques. Concrètement, prendre soin inclut de voir dans le contexte géopolitique actuel une opportunité pour faire émerger une reconfiguration sociospatiale de l’extraction pour assurer le développement d’une réelle richesse collective.
Prendre soin, c’est d’être très prudent avec l’approche « par projet » qui nuit souvent à une vision intégrée et holistique du territoire et du développement des régions minières. L’un des défis est de préserver des projets miniers stratégiques au Québec, mais sans laisser une multinationale étrangère outrepasser les normes et les exigences environnementales, et faire des menaces de fermeture ou du chantage de délocalisation. L’identification de projets d’importance nationale doit absolument être accompagnée d’études environnementales rigoureuses et de véritables processus d’acceptabilité sociale. Au Québec, nous disposons d’un mécanisme de démocratie participative qui est reconnu mondialement. Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) doit être présenté par les décideurs comme un outil indispensable pour activer le débat public et non pas comme un mécanisme qui fait obstacle aux projets miniers.
Prendre soin, ça signifiera toujours de respecter et d’honorer les droits des populations locales affectées par les projets miniers, et notamment des peuples autochtones. Lorsqu’on ne respecte pas les communautés affectées par les projets miniers et qu’on ne prend pas soin des écosystèmes, on contribue à réduire drastiquement notre force collective, celle de notre société, de nos terres et de notre économie, pour faire face aux différentes crises.
Enfin, prendre soin des régions minières, les envisager comme elles sont, c’est-à-dire des vies, humaines, animales, végétales, comme un bien collectif, et non comme une ressource déterminée au niveau mondial, nous augmentons à la fois nos chances de s’enrichir collectivement et d’assurer notre sécurité nationale.
Lorsqu’on ne respecte pas les communautés affectées par les projets miniers et qu’on ne prend pas soin des écosystèmes, on contribue à réduire drastiquement notre force collective, celle de notre société, de nos terres et de notre économie, pour faire face aux différentes crises.
- Catherine Viens
Université du Québec à Montréal
Catherine Viens est chercheure associée à l'Institut d'études internationales de Montréal, l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaires (OCCAH) et le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora (CÉRIAS). Elle est directrice du programme de formation en gestion des risques et de la sécurité de l'OCCAH et directrice pour le Québec de la Fundación Lüvo. De 2023 à 2025, elle a été chercheure postdoctorale affiliée à l'Institute of Dévelopment Studies (Université de Sussex), financé par les Fonds de recherche du Québec: Société et Culture. Elle se spécialise sur les enjeux sociaux, politiques et environnementaux de l'extraction des ressources naturelles et sur la gouvernance de l'environnement en contexte fédéral, notamment en Inde, en Afrique du Sud et au Canada. Elle est par ailleurs experte de la politique de l'Inde.
- Marc-André Anzueto
Université du Québec en Outaouais
Marc-André Anzueto est professeur agrégé en développement international à l’Université du Québec en Outaouais. Il est membre régulier de l’Équipe de recherche sur l’inclusion et la gouvernance en Amérique latine (ÉRIGAL), de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires (OCCAH) et du Laboratoire Autodéterminations/Gouvernementalités et ontologies politiques extractives/Démarches enracinées (Lagopède). Il est spécialiste de la politique étrangère du Canada en Amérique latine et des politiques de droits humains au sein des États en situation de post-conflit, notamment au Guatemala, en Colombie et au Honduras.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre