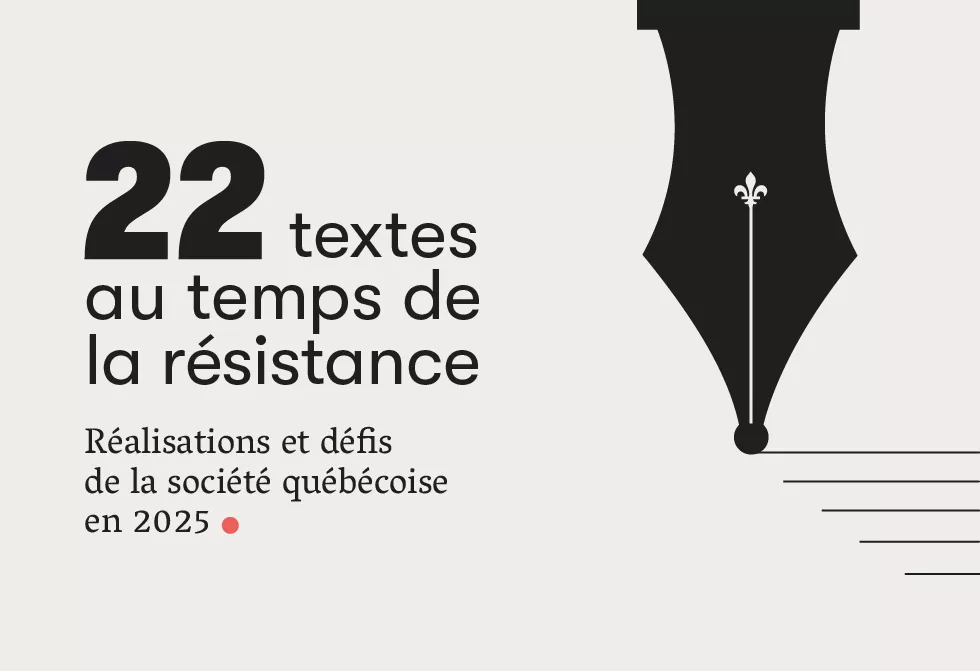« Pourquoi ma rue n’est pas encore déneigée? ». Après chaque tempête, c’est une question que chaque élu reçoit, une question qui est au cœur de l’arc-en-ciel de services que toute municipalité offre.
Quand les flocons commencent à tomber, les équipes des travaux publics les attendent depuis longtemps. Elles savent par où commencer le déneigement et dans quel ordre enchaîner les rues. Est-ce que c’est le bon ordre ? À la fin de la saison, les cols bleus dresseront un bilan de leurs opérations, chaque élu décrira les enjeux vécus dans son quartier et le conseil municipal donnera des orientations pour améliorer (ou pas) les choses en vue du prochain hiver.
C’est le pain et le beurre des villes. Du ramassage des poubelles, à l’installation de bancs de parcs en passant par les cours de natation et le développement des quartiers, elles accompagnent les citoyens dans leur quotidien. Elles livrent les services les plus concrets et construisent les infrastructures les plus proches des gens.
Dans leur article « Paying attention to the mundane policy issues »1, Daniel Béland, Alana Cattapan et Elizabeth Schwartz isolent l’exemple du déneigement pour démontrer le caractère presque banal des décisions municipales, et illustrer les lourdes conséquences qu’elles peuvent avoir sur la population. Leur constat : ce sont souvent les populations plus vulnérables aux plans socio-économique et socioculturel qui en souffrent. Ils avancent l’exemple du trottoir qu’on déblaiera demain pour prioriser les rues. On a tendance à oublier que la personne qui descend de l’autobus dans un banc de neige sera plus affectée que celle qui stationne sa voiture dans un garage chauffé.
Il ne faut pas y voir une opposition ou une contradiction dans les besoins de la population. Il faut retenir que les activités des villes, même les plus fondamentales, se complexifient et se diversifient sans cesse. Le déneigement en est un exemple, mais il y en a tant d’autres. Lors d’une réunion de conseil municipal, il est tout à fait normal d’entendre une intervention sur la crise de l’itinérance, suivie d’une question sur un lampadaire brisé.
Les élus municipaux montent au front avec leurs populations dans les dossiers qui leur tiennent le plus à cœur. C’est pourquoi les décisions municipales résonnent autant chez les gens.
C’est le superpouvoir des villes : elles sont au cœur des communautés.
Au Québec, le « petit plus » qui nous différencie, ce sont les partis politiques municipaux. Comme le souligne le Dictionnaire politique de la scène municipale québécoise, la présence des partis « influence à la fois la conquête et l’exercice du pouvoir, et participe ainsi à l’originalité du fonctionnement de cette scène politique »2.
Alors que le ton monte dans la société et que la charge de travail des conseils municipaux augmente, les avantages des partis pour la démocratie deviennent incontournables : ils dépersonnalisent les débats, améliorent la diffusion de l’information, participent à la professionnalisation des élus municipaux et à la qualité des débats, clarifient les positions, encouragent l’engagement politique, nous rapprochent de la parité et favorisent la participation citoyenne en offrant à la communauté un véhicule pour influencer leur ville.
Bref, les personnes qui vous représentent sont mieux préparées à prendre les décisions qui vous touchent le plus et l’immense charge de travail que représente la gestion d’une ville s’en trouve mieux répartie. Je n’aurais moi-même jamais pu devenir mairesse sans le soutien et l’appui de ma famille politique.
L’Alberta s’est d’ailleurs inspirée de nous cet automne, en autorisant les partis politiques à Edmonton et Calgary, une première canadienne à l’extérieur du Québec.
Nos villes ont tout pour devenir des vraies partenaires des gouvernements du Québec et du Canada. Elles n’attendent qu’une chose pour jouer pleinement ce rôle : des ressources à la hauteur de leurs compétences. En enlignant nos forces respectives, on décuplerait notre potentiel collectif et on pourrait atteindre n’importe quel objectif national. Crise humanitaire en itinérance, crise climatique, crise de l’abordabilité : nous n’avons pas le luxe de nous priver de la plus-value que peuvent offrir les gouvernements locaux.
- 1
Béland, Daniel, Cattapan, Alana et Schwartz, Elizabeth, Paying attention to the mundane policy issues, [En ligne], 2017, [policyoptions.irpp.org] (Consulté le 28 novembre 2024)
- 2
« Partis et équipes politiques », dans Breux, Sandra et Mévellec, Anne (dir.), Dictionnaire politique de la scène municipale québécoise, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2024, p. 296-300. (Études urbaines).
- Maude Marquis-Bissonnette
mairesse de Gatineau
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre