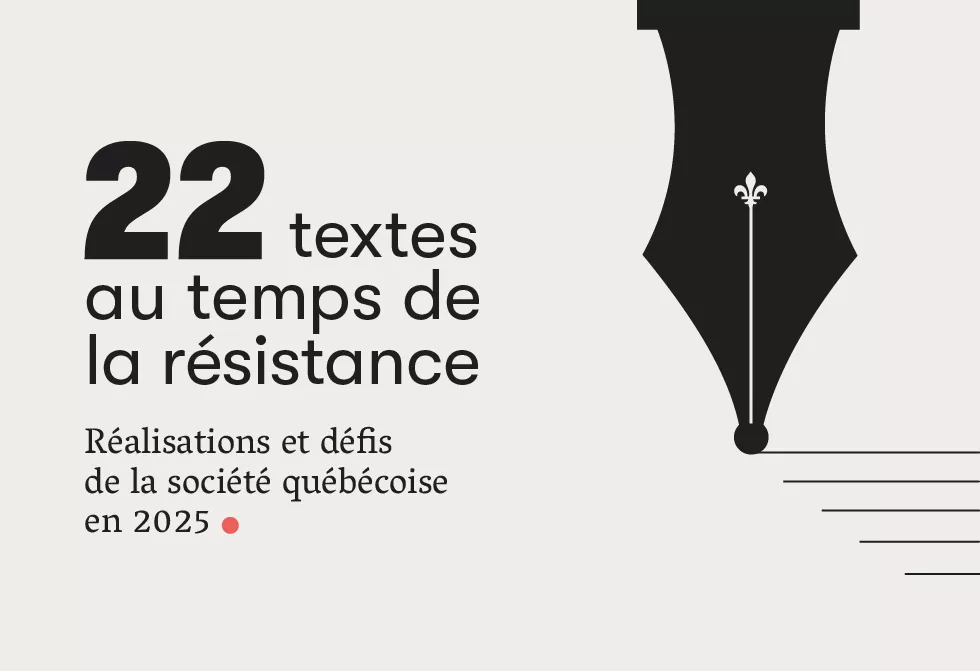La planète se réchauffe de plus en plus, les espèces s’éteignent de plus en plus vite, et les maladies infectieuses sautent de leurs réservoirs animaux aux populations humaines avec une régularité alarmante. Nous vivons une polycrise planétaire, et toutes les disciplines scientifiques doivent se mobiliser pour y répondre.
Une science de crise
Pour les écologistes, ce n’est pas une nouvelle dynamique. Dès 2010, la Convention sur la diversité biologique (CBD) avait fixé 20 cibles ambitieuses, les Objectifs d’Aichi, pour restaurer et préserver la biodiversité partout sur la planète, dans un délai de 10 ans. En 2020, le bilan était mitigé; pour plus de 75% des cibles, nous n’avions soit accompli aucun progrès, soit perdu du terrain. Au-delà du constat d’échec, ce fut un signal d’alarme : il fallait réinventer notre discipline et son arrimage à la société pour agir, rapidement et décisivement, sur la perte de biodiversité.
Après 4 années de délibérations, les parties de la Convention sur la diversité biologique ont adopté, le 19 décembre 2022, le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Ce nouvel accord encadre de beaucoup plus près la façon d’observer la nature pour décrire ses changements, et mesurer l’efficacité des actions. L’année dernière à Cali, en Colombie, les parties de la CBD se sont dotées de mécanismes de financements ambitieux pour assurer que tous les états-membres, et surtout les plus pauvres, puissent contribuer à cet effort global.
Un concept contentieux
Le 1ᵉʳ décembre 2019, le monde a changé. Le premier cas humain de ce qui deviendra rapidement la COVID-19 est identifié, et rapidement se pose la question de l’origine de ce virus. Quelle espèce est « responsable »? Est-ce que la biodiversité est une mauvaise chose? Un monde végan aurait-il évité cette pandémie?
Les sciences de la biodiversité se sont trouvées, en quelques mois, propulsées dans le monde de la santé humaine : un monde qui nous était inconnu, pour lequel nous n’avions ni recul théorique, ni compréhension des enjeux, ni appréciation des dommages que des mots mal choisis ou des résultats mal contextualisés pouvaient causer.
En réponse à la pandémie, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché la rédaction de l’Accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, affectueusement surnommé « le traité » par tous nos collègues impliqué·es dans les négociations. Cette fois-ci, pour les experts œuvrant en santé, c’est la biodiversité qui posait un problème. Une partie des intervenants en biodiversité dans la négociation veulent créer des obligations sur le recours à l’approche Une Seule Santé. Ainsi, cette approche préviendrait les pandémies en harmonisant notre relation avec la nature : si les milieux naturels vont bien, la santé humaine devrait en bénéficier. Cependant, rien ne démontre que les actions de conservation sont un moyen particulièrement efficace de prévenir les maladies zoonotiques.
Les pays du Sud Global, pour leur part, avaient une demande plus simple : des vaccins. Un traité sur la réponse aux pandémies devrait permettre de répondre aux pandémies, et donc obliger le partage équitable des ressources vaccinales et médicales. Cette demande est légitime! Insister pour financer des actions de préservation de la biodiversité, en prétextant un éventuel bénéfice à long terme sur la réduction d’un risque mal défini, est une position débattable. En revanche, débattre de cette question pendant que le taux de vaccination contre la COVID-19 en Haïti reste inférieur à 2 % est odieux.
Qui sommes-nous?
Tout cela formait la toile de fond de ma crise personnelle durant les dernières années : voir ma discipline s’entêter à exiger sa place dans des discussions sur la santé humaine, alors même que cet entêtement se faisait au détriment des populations les plus fragiles.
J’ai obtenu mon doctorat en 2011, l’année de l’adoption des objectifs d’Aichi. Je n’ai jamais connu la biodiversité autrement qu’en crise, et la pratique de la biodiversité comme discipline scientifique, sinon qu’en tant qu’enjeu existentiel. L’anxiété climatique, le deuil écologique, les 36 millions de morts de la COVID-19, évidemment, nous incitent à vouloir agir, partout, tout le temps.
Dans ce contexte, il est parfois trop facile pour les chercheurs en sciences de la biodiversité d’oublier que nous ne sommes pas seuls. Apprenons à identifier nos limites dans ce nouveau contexte, à se refamiliariser avec l’humilité intellectuelle, et à faire confiance à nos collègues. Les discussions en cours à la CDB pour adopter un plan d’action sur la biodiversité et la santé sont un pas dans la bonne direction : en établissant des priorités claires, nous aurons une meilleure compréhension des façons concrètes d’agir en construisant de nouvelles connaissances.
Durant les deux dernières années, j’ai eu l’immense privilège de discuter très fréquemment avec plusieurs négociateurs et ONG qui participaient à la rédaction du traité sur les pandémies. La demande pour ces échanges est immense : avant de céder à la tentation de crier haut et fort que les scientifiques ne sont pas écoutés, nous devrions faire un travail d’introspection, car pour exiger l’écoute, il faut d’abord produire une parole claire.
Les organismes de financement de la recherche ont un rôle majeur à jouer pour nous aider à devenir des ambassadeurs de la science et de la connaissance. En finançant les chercheurs qui joueront ce rôle auprès du monde politique et des décideurs et en reconnaissant l’engagement sociétal au même titre que les activités de publication ou d’encadrement, ils encourageront les universitaires à prendre leur place dans le dialogue entre la science et la société.
...avant de céder à la tentation de crier haut et fort que les scientifiques ne sont pas écoutés, nous devrions faire un travail d’introspection, car pour exiger l’écoute, il faut d’abord produire une parole claire.
- Timothée Poisot
Université de Montréal
Timothée Poisot est professeur associé au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, chercheur au Centre des Sciences de la Biodiversité du Québec, et investigateur au Verena Institute - Viral Emergence Research Initiative. Ses travaux se concentrent sur les interactions entre biodiversité, changements climatiques, et maladies émergentes, avec un intérêt particulier pour les zoonoses virales. En utilisant des méthodes des sciences des données, des statistiques, et du machine learning, son laboratoire réalise des projets de recherche fondamentale, mais produit aussi des outils pour améliorer notre capacité à suivre et mesurer la biodiversité et le risque zoonotique, pour améliorer la prise de décision. Il est également membre du conseil scientifique de Calcul Québec, du conseil scientifique de l'Institut Canadien d'Écologie et d'Évolution, et directeur du groupe de travail sur Une Seule Santé du Group of Earth Observations - Biodiversity Observation Network.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre