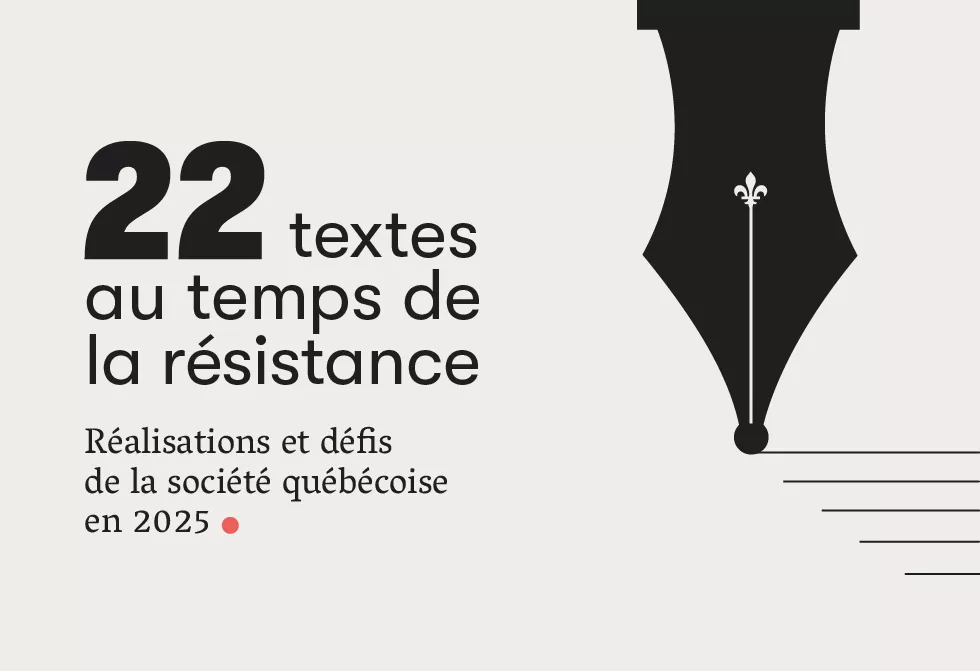Vous connaissez Top gun ? Ce classique du cinéma hollywoodien patriotique des années 1980 mettant en vedette le pilote « Maverick » (Tom Cruise) et son concurrent « Iceman » (Val Kilmer)? Envoyé à l’école de combat aérien après un incident avec des chasseurs soviétiques, Maverick traverse toutes sortes d’épreuves avant de surmonter ses doutes lors d’un combat décisif contre l’ennemi et de devenir… un top gun.
De façon surprenante, l’expression anglaise top gun est réapparue dans l’espace médiatique du Québec depuis quelques mois à la suite de stratégies de communication politique. L’expression est en effet évoquée régulièrement dans le monde des affaires pour désigner les high performers des grandes entreprises. Elle révèle les attentes à l’égard des présidents-directeurs généraux (PDG) perçus comme de potentiels sauveurs. Elle est reprise aujourd’hui par la Coalition Avenir Québec dans une tentative de se montrer à la hauteur des défis de la société québécoise.
Entre autres, le superlatif a été utilisé ad nauseam par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, au moment de nommer la PDG de la nouvelle société d’État « Santé Québec ». Mais il colle aussi bien au profil recherché par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, pour la ou le futur PDG de son nouvel Institut national d’excellence en éducation. Lui aussi cherche un ou une top gun.
Sauveur recherché!
Le 13 février 2025, le cabinet du ministre de l’Éducation a publié le communiqué de presse annonçant une « étape cruciale de la création de l’Institut national d’excellence en éducation (INEE), soit le processus de recrutement pour le poste de présidente-directrice générale ou de président-directeur général de cet organisme». Ce processus marque alors, apprend-on, « le démarrage de ce nouvel institut qui fera une différence dans la réussite de nos élèves ». Il signe aussi, de facto, l’arrêt de mort du Conseil supérieur de l’éducation, un organisme né durant la Révolution tranquille au même moment que le ministère de l’Éducation du Québec. Nous y reviendrons.
Rappelant les grandes missions du nouvel INEE (comme celle d’ « identifier les meilleures pratiques, élaborer et maintenir à jour des recommandations, les diffuser aux intervenants du système d’éducation et les rendre publiques »), l’avis de recrutement trace le profil de la sauveuse ou du sauveur recherché. Élément surprenant, mais qui ne l’est pas réellement lorsqu’on connaît la philosophie du parti au pouvoir, aucune formation ou expérience de travail dans le réseau scolaire n’est exigée. En fait, on exige du top gun de l’éducation qu’il possède un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ d’études dit pertinent parmi lesquels l’éducation figure comme exemple aux côtés de l’administration, de l’administration publique et… de la gestion des affaires ! Qui plus est, si on exige de la personne qu’elle possède une expérience de gestion d’au moins dix années, cette expérience peut avoir pris forme seulement dans un domaine considéré comme « pertinent »… Autrement dit, il est accessoire que le top gun du ministre de l’Éducation provienne du secteur, bien qu’on attende de lui qu’il connaisse le « système éducatif, notamment en contexte de gestion axée sur les résultats » (évidemment !).
Au-delà de sa formation et son expérience, le top gun devra posséder une pléthore de « compétences du 21e siècle » : leadership éthique, capacité à diriger en collégialité, habiletés communicationnelles, capacité à veiller à la conciliation des intérêts parfois divergents, etc. Alors que la mobilisation historique des chercheuses et chercheurs en sciences de l’éducation contre le projet de loi no 23 conduisant entre autres à la création de l’INEE avait conduit à préciser, dans la mission du nouvel organisme, que les synthèses produites par le nouvel organisme devront « refléter la diversité des perspectives de la recherche », ce souci n’apparaît pas dans le profil recherché. En fait, aucune attente relative aux connaissances de la recherche scientifique n’est formulée, sinon celle qu’il soit un « expert de la pédagogie » capable de « recourir aux données probantes ». Sans refaire l’historique du débat sur ce que constitue une « donnée probante » en éducation (ce que d’autres ont fait remarquablement bien avant moi), disons simplement que – sur ce plan – le profil recherché ne semble pas tout à fait en adéquation avec cette volonté de « refléter la diversité des perspectives de la recherche ». Comme quoi, le jupon finit toujours par dépasser…
La fin de la pluralité?
Au-delà du profil recherché, qu’est-ce que ce vaste changement des structures scolaires voulu par la Coalition Avenir Québec annonce-t-il pour le monde de l’éducation au Québec sur le plan de la gouvernance ? Eh bien, lorsque nous combinons les changements législatifs effectués par l’adoption du projet de loi no 40 (en 2020) du ministre Roberge et le projet de loi no 23 (en 2023) du ministre Drainville, il paraît évident que le modèle de gouvernance imaginé traduit une vision extrêmement hiérarchisée, univoque et, même, autoritaire du réseau de l’éducation au Québec.
Depuis au moins la Révolution tranquille, le Québec profitait d’une gouvernance scolaire multijoueur inspirée des idéaux d’une démocratie participative. Ces idéaux visaient à donner une voix au chapitre aux différents acteurs scolaires, mais aussi à la population en général afin de les amener à être partie prenante des grandes décisions relatives à l’éducation. Certes, le pilote du système scolaire devait et doit toujours être le ministre, mais ce dernier était surtout appelé à présider aux grandes orientations du système scolaire sur la base de considérations sociétales. Pour ce faire, les acteurs scolaires et la population en général avaient à portée de main des instances appelées à représenter leurs idées et leurs intérêts, lesquelles pouvaient évidemment – et nous l’espérons même dans une société qui se veut démocratique – présenter un contrepoids, voire un contrepouvoir au ministre. Parmi ces instances figuraient, au premier chef, les conseils des commissaires des commissions scolaires et le Conseil supérieur de l’éducation. Or, la Coalition Avenir Québec a ni plus ni moins éliminé, sous le motif d’une recherche d’une plus grande efficacité, ces lieux d’échanges et de réflexions.
En lieu et place d’instances vouées à amener les acteurs scolaires et la population en général à s’exprimer et prendre part aux décisions relatives à l’éducation au Québec, le modèle de gouvernance scolaire de la Coalition Avenir Québec centralise les pouvoirs autour du ministre et de ses exécutants, dont les directeurs généraux des centres de services scolaires, nommés désormais par lui-même et dont les décisions peuvent à tout moment être invalidées par ce dernier. En lieu et place d’instances vouées à amener les acteurs scolaires et la population en général à s’exprimer et à prendre part aux décisions relatives à l’éducation au Québec, le modèle de gouvernance de la Coalition Avenir Québec propose un INEE dirigé par un top gun chargé d’indiquer aux enseignantes et enseignants quelles pratiques adopter pour « performer », répondre à leurs objectifs et leurs priorités, bref, pour être considérés comme « efficaces ».
À plusieurs égards, ce modèle de gouvernance par la Coalition Avenir Québec n’a plus grand-chose du modèle démocratique et plurivoque pensé au cours de la Révolution tranquille, mais partage beaucoup plus de similitudes avec celui dans lequel évoluent Maverick et Iceman…
Sommes-nous à ce point avides d’efficacité et avons-nous à ce point perdu nos réflexes démocratiques que nous soyons prêts aujourd’hui à démanteler les instances auxquelles nos ancêtres ont réfléchi pour nous prévenir des risques des systèmes autoritaires?
En conclusion
En moins de quatre ans, la Coalition Avenir Québec a renversé le modèle de gouvernance scolaire au Québec. Jugeant ce modèle démocratique désuet et inefficace, elle l’a remplacé par un modèle hiérarchisé et autoritaire dominé par le ministre de l’Éducation et conseillé – s’il le souhaite – par son top gun.
À plus d’un titre, ces importants changements représentent un recul démocratique, un phénomène que nous pouvons définir – comme le suggère l’International Foundation for Electoral Systems – comme un affaiblissement ou une élimination d’institutions publiques qui soutiennent la démocratie. Si le renversement du modèle de gouvernance scolaire au Québec peut sembler anodin en comparaison de tous les reculs démocratiques que nous observons présentement dans le monde, il demeure préoccupant en raison de la relative insouciance, voire de l’inconscience avec laquelle ces changements se sont opérés. La Coalition Avenir Québec a soutiré aux acteurs scolaires et à la population en général des lieux d’expression démocratiques sans grande réaction.
Sommes-nous à ce point avides d’efficacité et avons-nous à ce point perdu nos réflexes démocratiques que nous soyons prêts aujourd’hui à démanteler les instances auxquelles nos ancêtres ont réfléchi pour nous prévenir des risques des systèmes autoritaires? J’espère sincèrement observer un éveil en la matière, car, comme un estimé collègue a coutume de le dire, « la démocratie, c’est un peu comme l’amour… c’est quelque chose qui se cultive sur un temps long et qu’il faut entretenir au quotidien ».
- Olivier Lemieux
Université du Québec à Rimouski
Professeur en administration et politiques de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis), Olivier Lemieux s’intéresse principalement à l’analyse politique de l’éducation et de l’histoire de l’éducation au Québec. Il a obtenu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour ses travaux de maîtrise, le Prix commémoratif Cathy James pour ses travaux de doctorat et le prix Publication en français Louise-Dandurand du Fonds de recherche du Québec – Société et culture pour son ouvrage Genèse et legs des controverses liées aux programmes d’histoire du Québec (1961-2013), publié aux Presses de l’Université Laval en 2021. Il est notamment membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ) et du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE).
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre