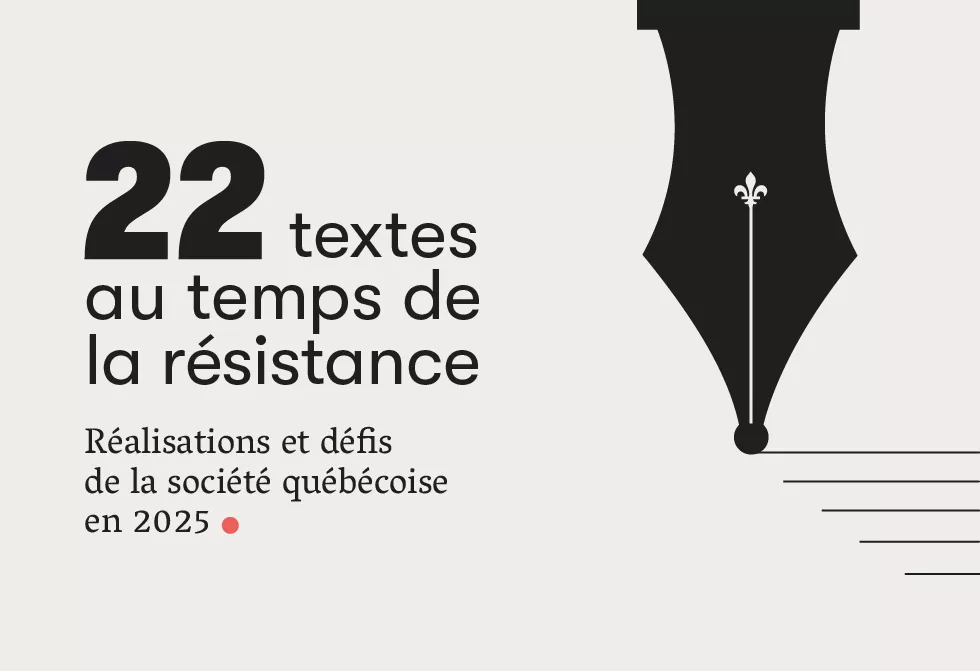Dans le contexte [politique actuel], une préoccupation de longue date refait surface : le Québec et le Canada, plus largement, sont-ils appelés à poursuivre leur trajectoire sociopolitique, comme entités souveraines distinctes d’une Amérique aux intentions impérialistes renouvelées? Le cas échéant, en quoi celle-ci est-elle singulière et distincte de la trajectoire étatsunienne? Formulé autrement : avons-nous toujours quelque chose d’original et de distinct des États-Unis à apporter au monde et à partir duquel nous pouvons nous ancrer pour faire face aux défis de notre époque?
Depuis que Donald Trump a retrouvé les clés de la Maison-Blanche, plusieurs au Québec et au Canada ont vu en lui l’incarnation de l’intimidateur à qui il importe de tenir tête. Dans le sillage de ce qu’on appelle désormais la guerre tarifaire entre les États-Unis et le Canada, le président a aussi multiplié les déclarations chocs dans lesquelles il fait allusion au Canada comme étant un éventuel « 51e État » des États-Unis, tout en présentant le premier ministre du Canada comme le « gouverneur » de celui-ci.
Chose certaine, l’homme à la longue cravate rouge ne laisse personne indifférent de ce côté-ci de la frontière et sa gouverne chaotique bouleverse notre vie politique et économique. Si une faible minorité de Canadiens a pu se réjouir à l’idée qu’on puisse enfin faire partie de l’American Dream, la grande majorité de la population a plutôt été portée par un regain de patriotisme et sentiment d’appartenance à l’endroit du Canada1. La baisse importante d’achat des produits américains en épicerie en est une illustration parmi d’autres. Au Québec même, alors que le Parti québécois, principal véhicule politique de l’indépendantisme, continue de récolter les bonnes fortunes dans les intentions de vote2, on observe aussi une hausse considérable des manifestations du sentiment de fierté canadienne.
George Grant et la fin du Canada
Dans ce contexte, une préoccupation de longue date refait surface : le Québec et le Canada, plus largement, sont-ils appelés à poursuivre leur trajectoire sociopolitique, comme entités souveraines distinctes d’une Amérique aux intentions impérialistes renouvelées? Le cas échéant, en quoi celle-ci est-elle singulière et distincte de la trajectoire étatsunienne? Formulé autrement : avons-nous toujours quelque chose d’original et de distinct des États-Unis à apporter au monde et à partir duquel nous pouvons nous ancrer pour faire face aux défis de notre époque?
Ce sont là des préoccupations du philosophe George Grant (1918-1988) – qui l’animaient, voire le tourmentaient –, rassemblées dans son ouvrage phare Est-ce la fin du Canada?. Publié en langue anglaise en 1965, alors que le Canada vivait un moment charnière dans la reconfiguration de son ADN politique et renforçait son intégration économique avec le géant étatsunien, Grant n’était guère porteur d’espoir. Pour lui, les forces économiques jouaient en défaveur de l’indépendance du Canada.
À ce moment, le Canada vivait sa propre Révolution tranquille, pour reprendre la formule de l’historien José Igartua (2011), et délaissait les référents britanniques au profit d’un symbolisme foncièrement ancré dans la modernité et soigneusement canadien. De l’adoption de l’unifolié (1964-65), et plus tard du « Ô Canada » comme hymne national (1980), sans oublier l’adoption de la loi sur la citoyenneté canadienne (1947) et les autres innovations législatives et constitutionnelles qui allaient suivre (multiculturalisme, chartisme, etc.), Grant était découragé de voir ainsi se dissiper devant ses yeux ce qui faisait jusqu’alors, selon lui, le « génie » du Canada (anglais) en Amérique du Nord : le recours à la source britannique et à l’héritage du conservatisme progressiste (red toryism) qui en découle pour se définir et se projeter.
Dans ses « lamentations sur le Canada », Grant3identifiait trois raisons fondamentales pour lesquelles le projet national canadien était voué à l’échec :
- La modernité tend inévitablement à homogénéiser les cultures locales sous l’impulsion d’un État universel et homogène;
- La proximité du Canada avec les États-Unis, centre névralgique de la modernité culturelle et économique, exerçait une attraction quasi irrésistible;
- La majorité des Canadiens adhéraient sans réserve aux idéaux de la modernité et se détachaient de leur héritage britannique, rendant ainsi caduc tout projet de différenciation culturelle profonde entre le Canada et son voisin du sud.
Loin de s’arrêter à un constat purement fataliste, Grant esquissait aussi une critique du libéralisme capitaliste qui, selon lui, dissolvait les coutumes particulières et les repères moraux ancrés dans la tradition. Pour lui, l’échec du conservatisme canadien était intrinsèquement lié à l’échec du Canada lui-même, puisque ce dernier avait échoué à se doter d’une tradition politique suffisamment forte et originale pour résister aux sirènes de l’américanisation.
Il voyait toutefois dans le nationalisme canadien-français une forme de résistance potentielle à cette homogénéisation culturelle. Les Canadiens français, selon Grant4, avaient longtemps été protégés du phénomène, en raison de leur attachement au catholicisme et à une conception plus organique et traditionnelle de la société, où la vertu et le bien commun primaient sur la liberté individuelle et l’économie de marché. Pourtant, il dressait le constat que cette barrière était elle aussi en train de s’effriter sous la pression du modernisme et du matérialisme anglo-saxon, alors que les Québécois chantaient désormais qu’ils vivaient « le début d’un temps nouveau », pour prendre la célèbre chanson de Stéphane Venne interprétée en 1970 par Renée Claude.
Des craintes plus actuelles que jamais
Or, en 2025, les craintes formulées par Grant semblent plus actuelles que jamais. L’intégration économique et culturelle avec les États-Unis n’a cessé de s’accentuer, et l’on peine à définir ce qui distingue encore le Canada dans un monde globalisé où les références identitaires s’effacent devant des considérations économiques et technologiques5. L’historien Éric Bédard (2025) le rappelait dans un article récent, et cela semble d’ailleurs être un impensé de plus en plus accepté du côté même des forces conservatrices au pays.
L’élection de Donald Trump, en exacerbant les tensions entre le Canada et les États-Unis, a toutefois ravivé un certain sentiment nationaliste canadien, bien que celui-ci semble plus défensif que véritablement enraciné dans une tradition culturelle propre.
Au Québec, la situation est tout aussi complexe. Si le nationalisme québécois a longtemps été une force de résistance face à l’homogénéisation culturelle nord-américaine, il est lui aussi confronté aux défis d’un monde de plus en plus globalisé et interconnecté. Le Québec et avant lui le Canada-français, qui se voulait historiquement un bastion de l’exception culturelle et linguistique, se trouve aujourd’hui pris entre son désir de cultiver son identité distincte et les réalités socio-économiques qui le lient inextricablement au reste du continent, en plus de devoir trouver un équilibre qui soit équitable pour toutes et tous dans ses politiques d’intégration de l’immigration et du vivre-ensemble.
Bref, la question que posait Grant il y a soixante ans demeure pertinente aujourd’hui : qu’est-ce qui distingue encore le Canada (et le Québec) des États-Unis? Plus encore, avons-nous encore la capacité de penser nos identités collectives autrement qu’en opposition à l’américanisation? La montée des tensions politiques entre les deux pays est peut-être l’occasion, paradoxalement, de revisiter ces interrogations et de réfléchir à ce que nous voulons être; non pas en fonction de ce que nous refusons de représenter, mais en affirmant positivement notre propre trajectoire collective.
Un jalon important qui pourrait accompagner cette réflexion est de reconnaître et de célébrer véritablement le caractère plurinational du Canada – mais aussi du Québec – où les communautés politiques minoritaires qui coexistent sur un même espace territorial puissent disposer des leviers institutionnels, politiques, juridiques, fiscaux, qui sont nécessaires à leur pérennité. Mais cela ne signifie pas d’uniquement maximiser les sphères d’autonomies institutionnelles multiples pour ces communautés politiques maintenues ensemble dans la souveraineté canadienne, qu’on pense au Québec, aux peuples autochtones, aux minorités linguistiques en situation minoritaire, mais aussi aux provinces et aux régions plus largement. Si le Canada et le Québec ont le potentiel de s’épanouir dans le XXIe siècle, il est fort à parier que cela nécessitera l’approfondissement de dynamiques partenariales et intergouvernementales, de sorte que le bien commun dans la fédération canadienne puisse être défini de manière dialogique et « par le bas », en tout respect des foyers identitaires multiples, et non pas imposé par les seuls mandarins de l’État central à Ottawa.
Un jalon important qui pourrait accompagner cette réflexion est de reconnaître et de célébrer véritablement le caractère plurinational du Canada – mais aussi du Québec – où les communautés politiques minoritaires qui coexistent sur un même espace territorial puissent disposer des leviers institutionnels, politiques, juridiques, fiscaux, qui sont nécessaires à leur pérennité.
Références
- Angus Reid, 2025, « Pride in Canada Rebounds in Face of Trump Threat », disponible en ligne : https://angusreid.org/pride-in-canada-tariff-trump/
- Bédard, Éric, 2025, « L’American Dream de Pierre Poilievre », La Presse+, disponible en ligne : https://www.lapresse.ca/dialogue/opinions/2025-02-12/l-american-dream-d…
- Igartua, José, 2011, The Other Quiet Revolution. National Identities in English Canada, 1945-71, Vancouver, University of British Columbia Press.
- Grant, George, 1988, Est-ce la fin du Canada ? Lamentation sur l’échec du nationalisme canadien, traduit de l’anglais par Gaston Laurion, Montréal, Hurtubise HMH.
- Kelly, Stéphane, 2001, Les fins du Canada selon Macdonald, Laurier, Mackenzie King et Trudeau, Montréal, Boréal.
- Félix Mathieu
Université de Winnipeg
Félix Mathieu est professeur agrégé au département de science politique de l’Université de Winnipeg et codirecteur de la Revue canadienne de science politique. Il a aussi été professeur invité à la Universitat Pompeu Fabra (Barcelone) et à l’Université Libre de Bruxelles. Spécialiste de la politique québécoise et canadienne, ses recherches portent sur l’aménagement de la diversité nationale et ethnoculturelle dans les démocraties libérales contemporaines, sur le nationalisme, sur le fédéralisme ainsi que sur la politique constitutionnelle dans une perspective comparée. Il est notamment l’auteur de Les Nations fragiles : ces peuples qui affrontent la modernité (Boréal, 2024).
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre