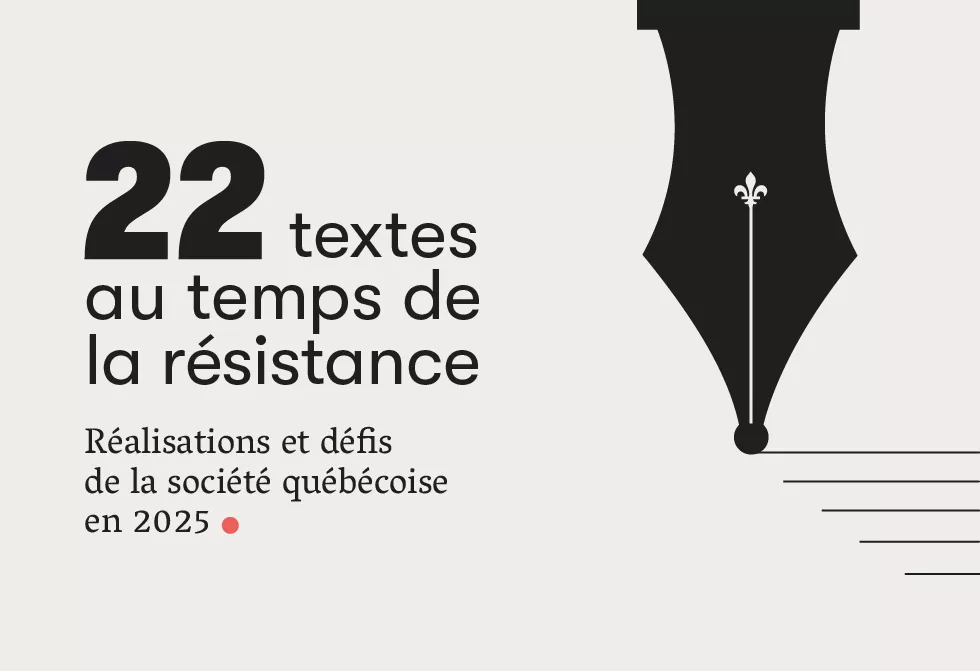... les mesures d’égalité de traitement et de soutien à la réussite en éducation bénéficient à toutes les personnes citoyennes [...], car elles contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance commune et à diminuer l’occurrence de problèmes collectifs, dont la pauvreté, la criminalité, la violence et l’insécurité.
La réussite éducative de tous les élèves préoccupe le Québec depuis les premiers jalons de la réforme Parent dans les années 1960.
Pour les économistes, comme Psacharopoulos et Woodhall1, l’éducation de la population est un investissement rentable, mais aussi, et surtout, un moyen de développement durable. Elle constitue une des conditions essentielles, incontournables pour bâtir une société démocratique et cohésive, prospère et solidaire.
Encore fallait-il, après la réforme Parent, que le système éducatif soit lui-même conçu et adapté pour jouer ces rôles. C’est pourquoi la réussite éducative de toutes et tous et à tous les niveaux d’enseignement a été au cœur d’une nouvelle réforme du système éducatif à la fin des années 1990, intitulée Virage vers le succès, la deuxième la plus importante de l’histoire du Québec à ce jour.
Aujourd’hui, le Québec se trouve parmi les sociétés les plus scolarisées dans le monde, avec un taux élevé de diplômés d’études postsecondaires (58% en 2023), ce qui représente un indicateur indéniable de la démocratisation de l’éducation.
Cependant, quoique largement positif, le bilan du système éducatif depuis la Révolution tranquille est loin d’être parfait. Autant celui-ci s’est-il consolidé depuis 60 ans par de nouvelles mesures d’accessibilité et réussite éducative (création des réseaux d’établissements primaires et secondaires à proximité des familles, régionalisation des cégeps et universités, accès aux prêts et bourses, francisation des immigrants, etc.) au fil des décennies; autant de nouveaux défis sont-ils apparus à la suite de la transformation des enjeux sociaux : l’accroissement rapide de la diversité ethnoculturelle est l’un d’eux, dans un contexte de mondialisation et d’immigration massive.
Une situation encourageante…
Aux yeux de plusieurs, l’école constitue l’ancrage permettant de familiariser les jeunes issus de l’immigration à la culture québécoise et de les intégrer dans la société. Pour ceux nés ailleurs, le ministère de l’Éducation a institué, par sa Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle de 1998, des services de soutien linguistique et diverses autres mesures afin de les soutenir et d’augmenter leurs chances de réussite éducative.
Ces initiatives ont eu des résultats plutôt encourageants. Par rapport à d’autres sociétés occidentales, la situation des élèves québécois – et plus largement canadiens – issus de l’immigration semble même exceptionnelle : de manière générale, leurs résultats scolaires aux niveaux primaire et secondaire sont comparables, voire supérieurs dans certains cas, à ceux de leurs pairs dont les parents sont canadiens de naissance. En outre, il n’y aurait pas de différence en ce qui concerne l’accès et la réussite à l’enseignement supérieur : la 2e génération d’immigration fréquente même davantage l’université que le reste de la population.
… mais un portrait général plus mitigé
Les inégalités scolaires entre les jeunes Québécois de naissance et leurs concitoyens d’origine immigrante seraient-elles réellement inexistantes ?
La situation est complexe, car la réussite exceptionnelle – dans son ensemble – des élèves issus de l’immigration occulte des disparités importantes selon leurs origines ethnoculturelles. D’un côté, ceux d’origine asiatique, européenne et nord-africaine performent et, d’un autre côté, ceux originaires de l’Afrique subsaharienne, de l’Amérique du Sud et des Caraïbes sont plus à risque de parcours scolaires fragiles et sont moins enclins à poursuivre les études postsecondaires. La diversité croissante des immigrants et des réfugiés, et de ce fait, la croissance des diversités ethnoculturelles, pose ainsi continuellement de nouveaux défis d’intégration. Malgré les politiques d’inclusion basée sur le principe d’interculturalité, le système éducatif n’échappe pas à la hiérarchie ethnique que des recherches observent et dénoncent ailleurs dans des sociétés semblables. Ce principe fait plutôt place à un multiculturalisme plus éclaté.
Les élèves faisant partie des groupes racisés (c’est-à-dire assignés à des catégories raciales infériorisées par les groupes majoritaires à partir de marqueurs ou traits réels ou imaginés) se heurtent encore à des barrières systémiques qui les mettent plus fréquemment à risque d’échec et de décrochage, ou à risque d’atteindre des niveaux moindres de réussite et d’accomplissement personnel.
En premier lieu, il faut noter que les caractéristiques du milieu familial sont extrêmement variées. Certains jeunes issus de l’immigration bénéficient davantage de l’appui de leurs familles. Ce « familismo » (emprunt à un terme central et sud-américain qui désigne une forte solidarité familiale) se traduit, entre autres, par de meilleures ressources matérielles et un accompagnement scolaire plus serré, ce qui facilite des parcours de qualité voire l’excellence et la persévérance jusqu’aux études supérieures. En dépit de multiples obstacles d’accès à l’information nécessaire, ces élèves et leurs parents font beaucoup d’efforts et de sacrifices pour se procurer des ressources de façon autonome et pour prendre des décisions éclairées. Ils font preuve de motivation et de résilience et arrivent à inverser l’image négative que certaines personnes enseignantes ont à leur endroit. Bref, ils tentent de se prendre en charge et de « s’en sortir » par eux-mêmes.
En deuxième lieu, il importe de souligner la persistance de ségrégations cachées qui, au niveau institutionnel, prennent la forme de discrimination directe et indirecte. À l’école primaire et secondaire, une partie des élèves et étudiants d’origine immigrée est encore souvent victime de préjugés et de stéréotypes : leur potentiel cognitif est sous-estimé et mis en doute par les personnes enseignantes, et les attentes scolaires à leur égard sont peu élevées. Ils seraient ainsi davantage susceptibles d’être déclassés et relégués par les services d’orientation dans des filières de « bas niveau », telles que l’adaptation scolaire, les formations professionnelles (DEP) et la formation générale des adultes (FGA). Loin d’être fortuits, ces préjugés et stéréotypes qui circulent dans le système scolaire sont ancrés dans ce que les sociologues qualifient de racisme systémique.
Éradiquer les inégalités entre élèves
Afin d’éradiquer les discriminations et inégalités entre élèves, les politiques publiques doivent mettre en place des mesures institutionnelles plus efficaces et centrées sur l’inclusion sociale et scolaire réelle et non seulement formelle.
Ces mesures institutionnelles concernent, entre autres, la diversification du personnel enseignant et administratif des établissements, l’accès égal à l’information et aux services de soutien et d’aide, la formation et la sensibilisation des personnels éducatifs aux inégalités de traitement et à la lutte contre la discrimination, ainsi que le renforcement de la collaboration école-communauté.
D’un point de vue moral et politique, de telles mesures s’inscrivent dans le respect des principes de justice sociale et d’équité auxquels le Québec adhère fortement depuis la Révolution tranquille et qui ont été réaffirmés à travers les réformes scolaires successives. L’égalité de traitement et de réussite en éducation est reconnue à la fois comme un droit commun, enchâssé dans Loi sur l’instruction publique au Québec, et un instrument pour promouvoir le bien-être individuel et collectif et l’inclusion sociale.
D’un point de vue économique, les mesures d’égalité de traitement et de réussite en éducation constituent des investissements rentables, car elles permettraient de repérer, développer, valoriser et optimiser le potentiel de toutes les personnes citoyennes, particulièrement celles appartenant aux milieux socioéconomiquement défavorisés et des minorités racisées à risque d’être marginalisées.
D’un point de vue social, on peut dire que les mesures d’égalité de traitement et de soutien à la réussite en éducation bénéficient à toutes les personnes citoyennes, y compris celles de classes sociales nanties, car elles contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance commune et à diminuer l’occurrence de problèmes collectifs, dont la pauvreté, la criminalité, la violence et l’insécurité. D’un point de vue économique, elles constituent un moyen de valoriser les talents de tous les jeunes Québécois afin que chacun puisse contribuer à la société au meilleur de ses compétences. Certes, cela est plus facile à dire qu’à faire, mais il suffit que tout le monde y croie et que la société et l’État s’y engagent pour accomplir beaucoup en peu de temps.
Pour finir, tout le monde y gagne !
- 1
Psacharopoulos, George et Woodhall, Maureen. L'éducation pour le développement: une analyse des choix d'investissement. Paris : Economica, 1988.
- Pierre Canisius Kamanzi
Université de Montréal
Pierre Canisius Kamanzi est professeur titulaire à l’Université de Montréal. Il est auteur de plusieurs publications sur les inégalités sociales et scolaires. Ses travaux récents portent les pratiques de marché scolaire et l’école à trois vitesses, les politiques de différenciation scolaire et l’équité en éducation.
- Marie-Odile Magnan
Université de Montréal
Marie-Odile Magnan est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal et membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de la Société royale. Elle est titulaire de la Chaire en relations ethniques, et directrice l’Équipe FRQSC Inclusion et diversité ethnoculturelle en éducation. Ses recherches portent sur les politiques et pratiques d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) du personnel éducatif ainsi que sur les inégalités scolaires du primaire jusqu’au postsecondaire telles que racontées par les jeunes et les personnels de groupes racisés.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre