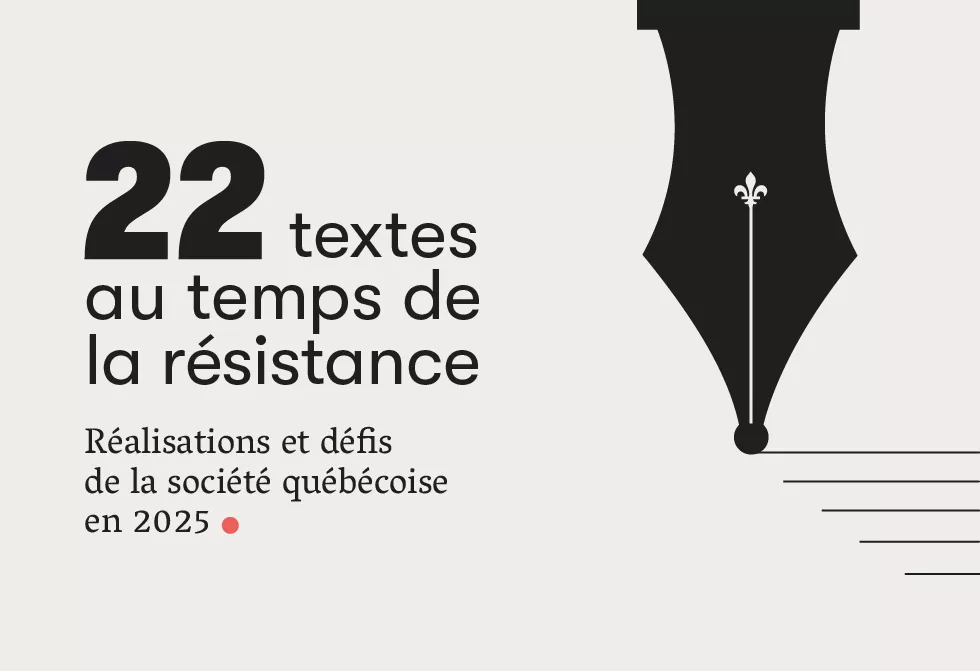Depuis les années 1980-1990, de nombreux spécialistes des sciences sociales avancent que l’État retraite face à la mondialisation néolibérale, qu’il coupe dans les dépenses de protection sociale et qu'en conséquence les inégalités et la pauvreté ont augmenté massivement. Contrairement à ces appréhensions, le modèle québécois n’a pas été la victime collatérale d’un « vent de droite qui provient de l’ouest », pour reprendre les mots de Lucien Bouchard lors de la campagne référendaire de 1995. Le Québec est le champion de la redistribution en Amérique du Nord et cette redistribution a beaucoup augmenté depuis 1995. Le Québec rivalise jusqu’au point où il dépasse même plusieurs pays européens.
La robustesse du modèle québécois
S’il est vrai que Lucien Bouchard a été l’architecte du redressement important des finances publiques à partir de 1996 — le fameux « déficit zéro » — ayant imposé de lourds sacrifices à la fonction publique notamment, son gouvernement a également été à l’origine de la création de nombreux programmes sociaux structurants, dont on ne prend qu’aujourd’hui la pleine mesure. Ainsi, contrairement aux pires scénarios évoqués, le modèle social québécois n’est pas disparu après les années Bouchard, Landry, Charest ou même Couillard et Legault; bien au contraire, il a beaucoup progressé.
Le Québec dispose d’un système de garderies publiques subventionnées unique au Canada, de politiques familiales de type scandinave, d’une assurance médicaments et des droits de scolarité universitaires les plus bas en Amérique du Nord, ou encore d’un récent programme d’aide financière pour l’achat de lunettes pour les enfants de moins de 18 ans.
Plutôt que de s’aligner sur la norme canadienne avec un État providence modeste, pour utiliser un euphémisme – ou encore sur la norme nord-américaine, une crainte formulée par les opposants au libre-échange avec les États-Unis comme du « déficit zéro » dans les années 1990 – le modèle québécois s’est affirmé et différencié encore davantage depuis la seconde moitié des années 1990.
Entre 1996 et 2024, le budget du gouvernement du Québec a augmenté de 114%, en argent constant. Il est passé de 41 milliards en 1996 (ce qui équivaut à 74 milliards de 2024 selon le calculateur d’inflation de la Banque du Canada) à 158 milliards dans le dernier budget 2024-2025. De plus, selon la Chaire en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, les dépenses de protection sociale au Québec ont également connu une hausse de 113% depuis 1996, toujours en argent constant. Elles s’élèvent à 152,3 G$ en 2022. De ce nombre, 64,2 % des dépenses de protection sociale proviennent du gouvernement du Québec contre 35,8 % par le gouvernement du Canada.
Mieux que la Suède et la Norvège!
Puisque le taux de pression fiscale du Québec est plus élevé que la moyenne canadienne, et même que des pays de l’OCDE, il est normal que son niveau de dépenses plus élevé procure aux Québécois des résultats significativement différents. Entre les inégalités selon les revenus de marché (avant l’intervention de l’État québécois et canadien), et après, les inégalités au Québec sont réduites de 39%, c’est-à-dire largement plus que le Canada (33%), mais aussi la moyenne des pays de l’OCDE (36%)!
Lorsqu’on s’intéresse aux inégalités de revenus à partir du coefficient de Gini, on réalise facilement que les inégalités sont beaucoup moins importantes au Québec qu’au Canada dans son ensemble, qu’aux États-Unis, que la moyenne des pays de l’OCDE ou encore que dans les pays du G7. Le coefficient de Gini mesure les inégalités dans la distribution des revenus. Un coefficient de 0 signifie l’égalité totale, alors qu’un coefficient de 1 désigne une inégalité totale. Après impôts et transferts, c’est-à-dire après l’intervention de l’État québécois et canadien, le coefficient de Gini est de 0,26 pour le Québec, ce qui est mieux que la moyenne canadienne ou la France (0,29), que les États-Unis (0,38) et le Royaume-Uni (0,36), mais également mieux que la Suède et la Norvège (0,29), et légèrement mieux que la Finlande et le Danemark (0,27). Le Québec est moins inégalitaire que ces quatre pays nordiques, il faut le faire!
Le taux de pauvreté, selon la mesure du panier de consommation, est également plus faible au Québec avec 6,6% contre 9,9% pour la moyenne canadienne en 2022. Dans le contexte canadien, c’est également au Québec que l’insécurité alimentaire est la plus basse de toutes les provinces avec 15,7% contre 22,9% pour la moyenne canadienne en 2023. Du plus, il y a moins de crimes haineux et d’homicides au Québec que dans le reste du Canada ou qu’aux États-Unis.
Cette exceptionnelle performance sociale s’accompagne d’un marché de l’emploi vigoureux. Depuis les années 1990, le marché de l’emploi québécois a mis fin à une longue tendance historique où le taux de chômage au Québec était structurellement plus élevé que la moyenne canadienne ou que de celui de l’Ontario. Contrairement à la période entre 1980 et 1998, où le taux de chômage au Québec était pratiquement toujours au-dessus des 10%, depuis 1999, il n’est jamais monté plus haut que 9% en 2003. De nos jours, selon Statistiques Canada, malgré les hausses récentes, le taux de chômage au Québec (5,4%) est plus bas que la moyenne canadienne (6,6%), que l’Ontario (7,6%) ou encore que l’Alberta (6,7%) ou de la Colombie-Britannique (6%).
Cette très bonne performance au niveau du marché du travail se reflète également sur le taux d'emploi de la population active. Le taux d’emploi mesure le pourcentage de la population qui ont réellement un emploi. Le Québec, qui était à la traîne par rapport à la moyenne canadienne, rattrape progressivement son retard, pour dépasser durablement la moyenne canadienne et celle du Canada hors Québec depuis bientôt 10 ans. Le moteur de cette performance, c’est la participation accrue des femmes au marché du travail. En effet, le taux d’emploi féminin est exceptionnel au Québec, bien au-dessus des moyennes canadiennes ou américaines et même avant celui des pays nordiques.
De plus, selon l’Institut de la statistique du Québec, le taux d'emploi féminin des « personnes issues de minorités visibles » de 15 ans et plus et même supérieur au taux d'emploi des personnes nées au pays! Ce taux était de 64% contre 58% pour les femmes nées au Canada. La situation est la même pour les hommes. En effet 72% des hommes issus des minorités visibles avaient un taux d'emploi de 72% comparativement à 64% pour les hommes nés au pays. L'explication de ces résultats s'explique notamment par les structures d'âge : les représentants des minorités visibles sont plus représentés dans la tranche d'âge où les gens travaillent. On peut également soumettre l’hypothèse que la raison fondamentale derrière une décision d’immigration est typiquement de nature économique.
Il n'est pas surprenant dans ces circonstances que le Québec soit un des endroits où la population se dit la plus heureuse au monde, selon un sondage de 2023. Dans ce classement, le Québec est 6e, derrière la Finlande, le Danemark et la Suède notamment. Sans le Québec, le Canada arriverait en 20e position, juste au-dessus des États-Unis, qui sont au 23e rang.
Qui dit mieux?
- Stéphane Paquin
École nationale d'administration publique
Stéphane Paquin est titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la confiance et le leadership politique de l’UQTR, en collaboration avec l'ÉNAP. Il a été admis au Cercle d’excellente de l’Université du Québec en 2024, et il a reçu de nombreux prix, dont une Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée et une Chaire Fulbright à State University of New York. Il a également été sélectionné en 2008 dans le cadre de l'International Visitor Leadership Program du gouvernement américain. En 2014, il a été le président du comité organisateur local du Congrès mondial de science politique Montréal-2014 (IPSA). Il a écrit, co-écrit ou édité 45 livres dont Theories of International Political Economy (Toronto, Oxford University Press 2015), et sur la réforme de l’État dans les pays sociaux-démocrates.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre