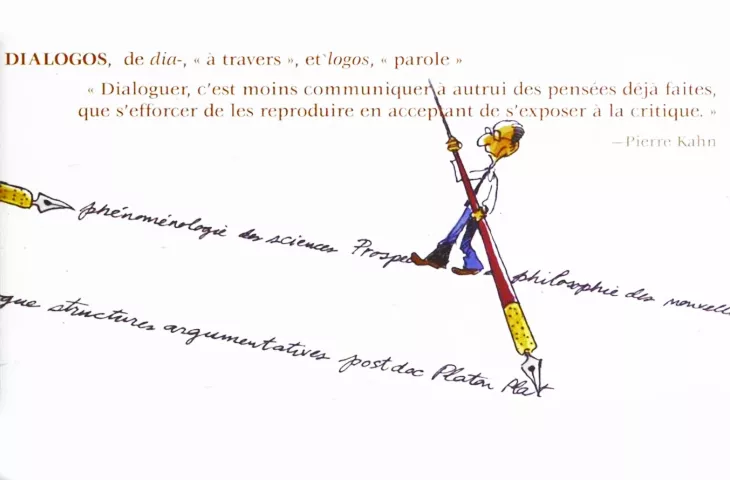Travail? Le mot n’a pas toujours existé. Le travail humain, par contre, a cours depuis que notre espèce habite cette planète. Partant de ce constat, le travail peut être analysé sous son angle à la fois humain et social. L’anthropologie et la sociologie sont probablement les disciplines qui peuvent nous être les plus utiles pour mener à bien une réflexion critique sur le travail. Elles nous semblent adéquatement outillées pour en éclairer les dimensions objectives (l’objet du travail), subjectives (les sujets du travail) et les enjeux normatifs (la norme idéale) qui structurent cet univers d’une pratique sociale qui a indubitablement maintenant un caractère également économique.

Les questions
Socrate nous a légué en héritage l’impérieuse nécessité de définir nos termes (ce qu’il ne faisait pas toujours lui-même comme en témoigne certains dialogues de Platon, mais passons). Par conséquent, toute analyse du travail présuppose, avant d’en parler davantage, une certaine définition.
Dans la vie de tous les jours, le terme possède une signification variable, plus ou moins précise selon le contexte d’utilisation. Il s’agit par conséquent d’une notion polysémique, voire même, selon les autrices et les auteurs appartenant à différents courants théoriques, d’un concept potentiellement polémique.
Ce concept pose problème dès que l’on cherche à distinguer et à définir le travail « économique » par opposition aux usages au sein d’autres activités (activités domestiques, scolaires, etc.). Le problème de définition est également présent dans les analyses et les débats au sujet des origines et des fins du travail. C’est en tenant compte de ces difficultés qu’il est possible d’amorcer une réflexion critique au sujet de l’avenir du travail en cette période de bouleversements sanitaires et environnementaux.
Le travail existe-t-il depuis toujours, et ce, dans toutes les sociétés? S’agit-il d’une contrainte naturelle et indépassable de l’existence ou d’une contrainte imposée socialement? Quels critères doit-on retenir socialement pour délimiter la sphère du « travail » de celle du « non-travail »? La révolution technologique présentement en cours annonce-t-elle réellement, comme l’avancent certains auteurs, « la fin du travail »? Quel avenir pour le salariat et les entreprises dans un contexte de pandémie et de crise écologique qu’on nous présente comme « inédit »? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons non pas nécessairement d’apporter des réponses dans le présent texte, mais qui nous accompagneront encore très longtemps dans notre réflexion au sujet du travail.
Travail : le mot et la chose
Travail? Le mot n’a pas toujours existé. Le travail humain, par contre, a cours depuis que notre espèce habite cette planète. Partant de ce constat, le travail peut être analysé sous son angle à la fois humain et social. L’anthropologie et la sociologie sont probablement les disciplines qui peuvent nous être les plus utiles pour mener à bien une réflexion critique sur le travail. Elles nous semblent adéquatement outillées pour en éclairer les dimensions objectives (l’objet du travail), subjectives (les sujets du travail) et les enjeux normatifs (la norme idéale) qui structurent cet univers d’une pratique sociale qui a indubitablement maintenant un caractère également économique.
Le mot travail est d’apparition assez récente. Le XIe siècle : 1080 pour être plus précis. Le Dictionnaire historique de la langue française nous informe que « travailler […] est issu (1080) d’un latin populaire tripaliare, littéralement tourmenter, torturer avec le […] trepalium […] nom d’un instrument de torture. […] En ancien français, et toujours dans l’usage classique, travailler signifie « faire souffrir » physiquement ou moralement […]. Il s’est appliqué spécialement à un condamné que l’on torture (v. 1155), à une femme dans les douleurs de l’enfantement (v. 1175), […] à une personne à l’agonie (v. 1190) […]. » Ce n’est qu’à partir du début du XVe siècle que le mot sera associé, dans la langue française, à une activité productive dans les domaines manuel et intellectuel.
Le travail humain est une activité inhérente à la condition de l’espèce. Il nous accompagne de la naissance à la mort. Homo n’est pas un être autosuffisant. Il dépend de ressources extérieures (immédiatement disponibles ou à transformer) pour assurer sa vie et sa survie. Homo doit donc intervenir sur les ressources disponibles dans son environnement pour sa reproduction, et ses activités productives manuelles et intellectuelles. Rappelons que dans le cadre du présent texte, nous définissons de manière non limitative le travail comme étant l’intervention de quelqu’un sur quelque chose, dans le cadre d’une activité rémunérée ou non1.
Le travail « économique »
Les humains sont des êtres sociaux, des êtres grégaires qui vivent à l’intérieur d’un regroupement donné. Simplifions à outrance. Il a existé deux grands genres de regroupements humains : le nomadisme (mode de vie fondé sur le déplacement) et la sédentarité (le rattachement à un lieu fixe). C’est dans le cadre de regroupements sédentaires que l’activité productive a véritablement connu de grandes révolutions dans les manières de produire les biens essentiels à la vie et à la survie. Les regroupements sédentaires ont été, pour l’essentiel, de trois grands types : agricole, industriel et post-industriel. Les trois coexistent aujourd’hui dans les sociétés développées dites de haut savoir.
Il y a nécessairement des fondements sociohistoriques au travail. Cette activité varie selon l’organisation sociale des différentes communautés. Les formes de travail ne sont jamais à l’identique, elles sont régulièrement reconfigurées. La nature et la dynamique de la rationalisation qui caractérise cette activité s’accompagnent de divers modes d’organisation et de divers processus de qualification.
D’autres facteurs sont également présents dans l’activité qu’est le travail : des facteurs culturels et idéologiques en lien avec les éthiques du travail et les enjeux de la reconnaissance de la valeur du travail.
Parler du travail c’est aussi regarder ou examiner les régimes de propriété (privé, public ou coopératif) et les types de divisions du travail : économiques, techniques, sexuels et culturels. Dans quel sorte de marché se déploie le travail? S’agit-il d’un marché autarcique (fermé et replié sur lui-même) ou interdépendant (ouvert aux échanges avec l’extérieur)? Qu’en est-il maintenant de sa segmentation et de sa spécialisation professionnelle? La stratification sociale qui en découle nous met en présence de quelle dynamique de la conflictualité2 sociale?
Les perspectives d’analyses anthropologiques et sociologiques posent ces questions. Elles permettent de décoder les rapports sociaux (hiérarchiques ou non), le type de relations sociales (relations fondées sur le sexe, l’âge et relations différenciées selon les populations [autochtones, nationalitaires et ethniques], selon le genre, etc.), ou encore le type de relations entre les actrices et les acteurs sociaux (relations de coopération, de collaboration, de concurrence, de compétition voire même, selon les marxistes, une relation contradictoire d’opposition irréconciliable).
Puisqu’il est question des marxistes, rappelons que Marx et Engels, dans Manifeste du parti communiste ont écrit que « la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment […] les rapports de production. » Qu’en est-il au juste? Le capitalisme est loin d’être un mode de production statique, et de la fin du XVIIIe siècle à aujourd’hui, il nous est possible de synthétiser son évolution en trois temps.
1. La fabrique et la manufacture capitaliste (de la fin du XVIIIe jusqu’à la fin du XIXe siècle) et la négation du droit social
Au départ, nous assistons à la constitution d’un marché supposément « autorégulé ». Les entreprises naissantes, qui produisent des biens, sont détenues par des entrepreneurs privés. Elles ont comme objectif de regrouper, sur leur lieu de travail, la production qui vient des maîtres et des artisans. Les ouvriers qui travaillent dans les usines ou les vastes chantiers de construction sont rémunérés à la pièce ou au temps. Les relations de travail prennent la forme d’un contrat individuel. L’État est présenté par certains auteurs libéraux comme non interventionniste en matière de droit du travail. Ce qui est faux. Les gouvernements des pays engagés dans la première révolution industrielle adoptent des lois du travail qui ont pour effet d’interdire la liberté d’association syndicale, le droit de négociation et le droit de faire la grève.
2. Taylorisme, fordisme et sociale démocratie
Dans un deuxième temps, se développe la grande entreprise monopolistique. Le taylorisme et le fordisme s’imposent comme principes d’organisation du travail dans ces entreprises gigantesques. L’autorégulation du marché est atténuée par la lente mise en place d’un système de relations de travail, qui légalise d’abord la liberté d’association et le droit de grève (1872 au Canada) et, plus tard, le droit à la négociation collective (1944 au Canada et au Québec).
Puis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale s’étendent la production et la consommation de masse. Le salariat s’impose comme le mode de rémunération dominant. Dans les entreprises, les rapports de travail sont hiérarchiques et le salarié est, la plupart du temps, un appendice de la machine. La division du travail entre la conception et l’exécution s’accentue.
L’exécutant exécute, rien d’autres. Durant cette période, par leurs luttes, les salarié-e-s syndiqué-e-s et les organisations syndicales parviendront à faire prendre en charge par l’État ou les entreprises, selon les pays, le coût de certains risques associés à la vie, du berceau au tombeau (assurance-maladie, assurance-chômage, pension de vieillesse, allocation sociale). Les heures de travail et les journées au travail seront limitées. Il en sera de même pour l’âge légal du travail salarié. Dans les économies capitalistes des pays développés, certains gouvernements afficheront, de temps à autre durant cette période (c’est-à-dire pas nécessairement de manière constante et permanente), un « petit côté » réformiste du genre social-démocratie.
3. Changements technologiques, économie du savoir et néolibéralisme (du milieu des années 1970 à aujourd’hui)
Dans un troisième temps, la pensée néolibérale se fixe comme objectif, dans la foulée de la révolution informatique et de l’émergence de l’économie du savoir, de libérer le marché des contraintes réglementaires gouvernementales, de restructurer les lieux de travail pour les rendre plus flexibles et de ronger sur les conquêtes sociales de la période précédente. Les chantres du néo¬libéralisme réclament, rien de moins, que le retour au marché autorégulé et à l’État minimal. Les employeurs, mais aussi les gouvernements, valorisent la précarisation du travail et la négociation contractuelle individuelle. Les droits syndicaux et les programmes sociaux sont remis en question de manière frontale.
À l’ère de la mondialisation et du capitalisme cognitif (fondé sur l’économie du savoir) s’installent donc à demeure la déréglementation, la privatisation des services, les fusions d’entreprises, les restructurations des services, la délocalisation, la désindustrialisation, la négociation des concessions, la stagnation des salaires, etc..
Aujourd’hui
Le marché du travail, issu de la flexibilité, ne répond plus aux besoins de l’ensemble des membres de la société. Il se caractérise de plus en plus par une insuffisance du nombre d’emplois et une piètre qualité des emplois créés. Deux phénomènes particularisent les emplois disponibles sur le marché du travail. En premier lieu, nous pouvons observer une segmentation du marché du travail qui est porteur de discriminations systémiques pour certains groupes de salariés (comme les femmes, les jeunes, les autochtones et les membres issus des groupes ethniques). Ensuite, on constate une segmentation au sein même des entreprises, qui a pour effet de fractionner les statuts d’emploi. Dans les firmes d’aujourd’hui, certains salariés se retrouvent dans une situation de sur travail (les workaholics, les performants et ceux qui ne cessent de cumuler les heures de travail supplémentaires), de travail normal (ceux qui se limitent à leur horaire, qui peut varier de 32 à 40 heures) ou de sous travail (ceux qui travaillent à temps partiel).
La crise sociosanitaire de 2020 et le jeu des prédictions
[Note de la rédaction : cette dernière partie du texte a été publiée initialement dans le cadre du dossier Penser l'après COVID-19, sous le titre Le travail : la seule source de création de la richesse collective.]
Nous sommes présentement en crise. Cette crise de type sociosanitaire a un impact majeur sur l’activité économique. Le taux de chômage au Québec est passé d’environ 5% à 18% en moins de deux mois. La question qui se pose, à ce moment-ci, est la suivante : quel avenir pouvons-nous envisager pour le travail salarié? Pour les fins du présent texte, nous tenons à préciser qu’à l’ère de la mécanisation et de la robotisation, le travail peut se définir comme une intervention de quelqu’un ou de quelque chose sur quelqu’un ou sur quelque chose.
Dans la foulée de la crise économique de 1982-1983 (où le taux de chômage a atteint 14% au Québec), André Gorz et Jeremy Rifkin ont envisagé l’avenir en parlant de la raréfaction de l’emploi et de la nécessité de le partager (Gorz) et même de « la fin du travail » (Rifkin).
Nous sommes d’avis qu’à court terme, nous pouvons nous attendre à un processus de « destruction créatrice » tel que conçu par l’économiste Joseph Schumpeter. Dans la foulée de la présente crise, certaines entreprises périront et d’autres, celles qui sont capables d’innovations, pourront éventuellement tirer leur épingle du jeu et croître. Les rapports de travail seront-ils transformés pour autant? Tant et aussi longtemps que la propriété des entreprises restera de type capitaliste, nous devons nous attendre à des rapports capitalistes de travail, c’est-à-dire des rapports hiérarchiques d’exploitation et de domination. Le télétravail et la robotisation se propageront au sein d’une multitude d’entreprises, mais ne modifieront pas ces relations.
Il y aura possiblement une Commission d’enquête qui s’interrogera au sujet de ce qui a bien ou mal fonctionné durant ce Grand confinement. Cette Commission proposera diverses mesures concernant l’hygiène au travail ou des programmes de soutien du revenu aux personnes salariées, assortis de programmes d’aide financière pour les entreprises.
Mais ce qui serait souhaitable, c’est que le présent désordre mène à une grande réflexion et débouche sur un programme de réformes du type Rapport Beveridge et Welfare State. Soit un programme de restructuration et de réorganisation aussi important que celui mis en place à la suite de la Grande Crise des années 1930 et de la Deuxième Guerre mondiale. Un programme de développement économique, souhaitons-le, plus respectueux de l’environnement accompagné de mesures du genre « flexsécurité danoise ». Un programme menant à la diversification des propriétaires des moyens de production, dont l’amplification des coopératives et de l’économie sociale. Un programme venant aussi sérieusement corseter les acteurs financiers qui désormais ont le dessus sur l’économie réelle et donc sur le travail.
Pourquoi un tel souhait? Parce que dans notre société, il n’y a qu’une seule source de création de la richesse, et cette source réside dans le travail (salarié ou non). Il y a d’autres sources d’enrichissement personnel, mais ces sources n’ajoutent rien à l’enrichissement collectif. Il s’agit des accroissements de richesse attribuable à la spéculation, à un transfert de revenus ou dit plus crûment, au « vol » (pour parler comme Proudhon).
Les nombreuses crises du XXe siècle ont été accompagnées de grandes souffrances et ensuite de grands moments d’enthousiasme collectif, suivi d’un retour à la normale, retour à « l’anormale » également.
Au sujet de l’avenir, il faut se rappeler qu’il sera nécessairement fait du jeu et des rapports de force qui caractériseront la dynamique relationnelle entre les grands acteurs sociaux présents dans la société. Parmi ces grands acteurs, il y a des personnes qui créent la richesse et d’autres qui accaparent cette richesse. Nous continuerons de vivre dans un monde en mouvement et en interminable changement. Or, le changement peut emprunter des voies qui restaurent des aspects du passé ou qui mettent en place des institutions progressistes. Il se peut ensuite que surgissent des remises en question qui déboucheront sur l’adoption de contre-réformes. Il ne faut donc pas s’attendre, selon nous, à la fin de la conflictualité sociale au sortir de la présente crise de la COVID-19. La conflictualité correspond à une situation relationnelle qui se structure autour d’un enjeu qui a pour effet de polariser la position des protagonistes, ce qui est le propre des êtres sociaux que nous sommes.
En matière d’avenir, nous nous en remettons davantage à Marcel Proust qui écrivait : « Mais nous nous représentons l’avenir comme un reflet du présent projeté dans un espace vide, tandis qu’il est le résultat souvent tout prochain de causes qui nous échappent pour la plupart » Marcel Proust, À la recherche du temps perdu
- 1À l’ère de la mécanisation et de la robotisation, le travail peut également se définir comme une intervention de quelqu’un ou de quelque chose sur quelqu’un ou sur quelque chose.
- 2Nous définissons le conflit comme correspondant à une situation relationnelle qui se structure autour d’un enjeu qui a pour effet de polariser la positions des protagonistes.
- Yvan Perrier
Cégep du Vieux Montréal et Université du Québec en Outaouais
Yvan Perrier est professeur de science politique au Cégep du Vieux Montréal et chargé de cours à l’Université du Québec en Outaouais. Il détient un diplôme d’études approfondies (DEA) en sociologie politique de l’École des hautes études en sciences sociales (Paris) et un doctorat (Ph. D.) en science politique de l’Université du Québec à Montréal. Il est l’auteur de textes portant sur les sujets suivants : les rapports collectifs de travail dans les secteurs public et parapublic au Québec; l’État et la constitutionnalisation de la liberté d’association.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre