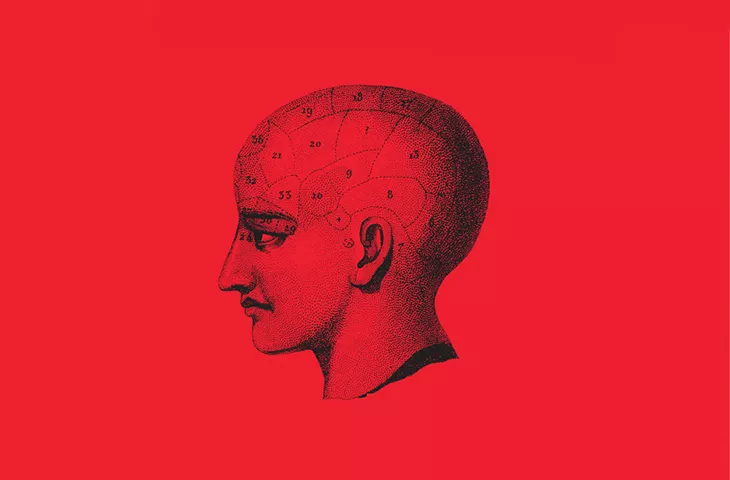Johanne Lebel : Il est deux choses que je retiendrais d’entrée de jeu au moment de publier le dossier. D’abord, l’évidence scientifique démontrant que les différences neuronales et psychologiques entre les deux sexes sont anecdotiques, et que la construction sociale des biais de genre est très profonde, donc impensée, c’est un allant-de-soi. Et il m’apparait que ces biais nous desservent tous, ils encadrent aussi bien les hommes que les femmes dans des rôles attendus.
Johanne Lebel : Il est deux choses que je retiendrais d’entrée de jeu au moment de publier le dossier. D’abord, l’évidence scientifique démontrant que les différences neuronales et psychologiques entre les deux sexes sont anecdotiques, et que la construction sociale des biais de genre est très profonde, donc impensée, c’est un allant-de-soi. Et il m’apparait que ces biais nous desservent tous, ils encadrent aussi bien les hommes que les femmes dans des rôles attendus.
Louise Caroline Bergeron : Les biais sont souvent le fait de généralisations, de raccourcis mentaux. Ils aident à mobiliser rapidement les acquis de nos expériences et ce, pour l’action comme comme pour la conversation. C’est utile pour des questions simples, mais quand il s’agit des rapports sociaux, des genres…
À la base, on a le même cerveau : un cerveau humain. Si on était élevé et éduqué sans prescriptions de genre, on peut supposer que les intérêts et les goûts se répartiraient aléatoirement parmi les membres de notre espèce, sans égard au sexe. L’erreur est de penser que toutes les femmes, parce qu'elles sont femelles, voient les choses différemment de tous les mâles. Ce n’est pas vrai. Les méta-analyses présentées dans l’ouvrage Cerveau, hormones et sexes, et ici présenté par l'auteure Louise Cossette, le montrent clairement. Les différences sont plus importantes parmi la classe des hommes entre eux, ou des femmes entre elles, qu’entre les hommes et les femmes.
Le cerveau humain se développe au départ en établissant d’innombrables connexions, mais aussi en élaguant celles qui ne sont pas utilisées. La culture a une influence sur ce développement puisque selon ce qui est favorisé comme comportement ou comme attitude, le formatage sera différent. Pour raconter très brièvement une histoire très complexe, disons que ce formatage comprendra des mode de penser qui sont biaisées par rapport à la réalité et dont nous ignorons même l’existence puisqu’elles nous sont transparentes. Il y a des biais puissants qui modulent notre perception « instinctive » : par exemple, pour une même attitude, une femme sera vue comme arrogante, et un homme, comme confiant. Si au moins on en a conscience, on est capable d’en jouer et de s’en libérer.
JL : Mais comment se libérer de ce qui est impensé?
LCB : On ne le sera jamais totalement. En fait, on ne réalise pas trop le solide ancrage des biais de genre dans notre culture, et qui de ce fait, en corollaire, nécessiterait un profond changement culturel pour être délogé. Et parce qu’on n’en réalise pas la profondeur, on reste encore trop en surface quand il s’agit de contrer ces biais. On cumule des indicateurs, on mesure la progression des pourcentages, on fait des portraits d'effectifs, on ajuste les procédures, mais cela ne suffit pas. Il faut réaliser des changements substantiels dans nos mentalités, éliminer des habitudes psychologiques et comportementales qui maintiennent les préjugés de genres, comme de races, comme de classes. Au-delà des chiffres, questionner le milieu.
Ces réflexions ont été faites depuis les années 1970, entre autres, dans le monde anglo-saxon. Je pense à Carolyn Merchant, Londa Schiebinger, Evelyn Fox Keller ou encore Sandra Harding. Toutes ont traité des aspects politiques et culturels des rapports ou articulations femmes/sciences et des changements radicaux que ça implique de vouloir éliminer le sexisme en général et la misogynie en sciences, en particulier.
JL : Quels gestes poser alors?
LCB : Il faut contester nos propres « évidences invisibles », selon l'expression de Raymonde Carroll, notamment en déplaçant le foyer de notre attention. Dans notre société, on a fortement tendance à ne demander qu’aux femmes de passer à l’action, plutôt que de solliciter ceux et celles en position de pouvoir, les collègues, les pères, etc. On ne peut pas demander qu’aux femmes de s’adapter sans agir aussi à l’échelle du langage, des structures, etc. L'exclusion des femmes est vécue par les femmes, mais elle n'est PAS leur fait !
Aussi, ce serait bien de rendre visibles les hommes dans les enjeux qui les impliquent, dont la parentalité et la conciliation travail-famille. Le fait d’être parent est souvent présenté comme une embûche pour les chercheures. On dit alors que les femmes en font beaucoup, voire trop. Mais, on ne parle pas ou peu des hommes, des pères, on ne souligne pas qu'eux sans doute n’en font pas assez. Le rôle des pères demeure invisible dans le discours. Cela les dessert aussi, car cela peut être mal vu de les voir se prévaloir longuement du congé parental, par exemple.
Peut-on traiter par des solutions procédurales un problème qui tient d’abord à la culture d’un milieu, du climat ou des dynamiques de groupes? Ces stratégies administratives, si utiles soient-elles, ne touchent en rien aux autres dimensions des sciences ou de la société qui doivent changer pour devenir des milieux où les femmes sont aussi confortables et à leur place que le groupe qui a traditionnellement dominé ces milieux. Je parle des femmes parce que c’est le focus de mes recherches, mais on sait que les mesures qu’on prend pour elles et contre le sexisme améliorent les milieux aussi pour d’autres groupes sous-représentés. À mon avis, si on refuse de traiter le sexisme à la base, les mesures en surface (de nombres et de couleurs de corps) ne vont jamais réussir. Il faut creuser plus loin pour trouver les nœuds où un petit changement peut avoir un grand effet.
JL : De présenter des parcours inspirants de femmes en sciences est-il une bonne approche?
LCB : Il faut travailler sur tous les fronts. Celui de l’imaginaire et de la représentation est important. Avoir des modèles de tous types, des récits de parcours diversifiés, c’est une facette importante et apparemment, qui influence beaucoup de femmes à sentir que les sciences sont un milieu pour elles, et donc à y aller.
Mais le « Go, les filles, passez par-dessus votre syndrome de l’imposteur », ça ne suffit pas. Ce syndrome, il vient de quelque part, il a été provoqué et des femmes l’ont peut-être développé avec raison. Cette fixation sur leur caractère plutôt que sur l’accueil du milieu peut même en ajouter aux obstacles qui se posent sur le parcours des femmes. C’est comme si on faisait l’économie du travail d’éliminer le sexisme systémique, et que l'on espérait qu’il disparaisse de lui-même en convaincant les femmes qu’« elles sont capables », comme si leur confiance en soi était leur seul défi. À mon avis, c’est d’abord à la société, dans chacun des milieux, de se débarrasser de son sexisme et aussi de cesser par mille et un moyens de rendre les femmes prudentes à force de leur faire payer leur audace, leur ambition, leur prise de risque plutôt que de la récompenser, comme on le fait par défaut pour les hommes.
Il faut agir sur la socialisation en amont, et ça c’est un travail de longue haleine. Changer des habitudes exige d’en prendre d’autres, plus en phase avec notre évolution sociale. Vers l’âge de cinq ou six ans, par exemple, il y a des recherches1 qui démontrent que les filles et les garçons ont déjà absorbé certains stéréotypes. Très jeunes, les filles captent déjà le message qui a cours encore et toujours, dans la société québécoise, canadienne, occidentale, celui qui dit qu'il y a des domaines (jeux, valeurs, etc.) masculins et d’autres féminins. On les acculturent dans une construction de genres qui les restreint dans des rôles, des identités, des comportements encore influencés par la tradition qui a pensé l’humanité en hommes et femmes, en deux genres comme autant de planètes distinctes.Il y a lieu de prendre conscience et de déconstruire ces catégories strictes et binaires, notamment parce qu’elles formatent nos attentes et nos attitudes envers les enfants. On sait pourtant que chaque personne humaine est différente des autres selon une foule de dimensions.
Si, en sciences, on vise à défaire les barrages, à colmater le « pipeline qui fuit » pour que les femmes « coulent » plus aisément à travers toutes les disciplines, on ne peut pas seulement ajouter des femmes, et croire que par leur seule présence, les vices du milieu se corrigeront. Cette stratégie, qu’en anglais on appelle add women and stir2, est une impasse. Outre que c’est là déléguer une entreprise collective de justice sociale sur des épaules individuelles, c’est encore s’attendre à ce que les femmes fassent un travail de care, supplémentaire, non reconnu et gratuit : changer les choses tout en faisant leur travail. Il faut faire plus qu’ajouter de l’eau dans le canal pour compenser ses fuites : il faut comprendre comment il est construit et sans doute même, par endroit, refaire la canalisation.
JL : Qu’en est-il de la place des femmes des sciences?
LCB : Disons d’entrée de jeu qu’on ne peut traiter les « sciences » d’un bloc. Les sciences naturelles et génie sont, par exemple, très coupées des sciences sociales, plus que je m’y attendais. Les sciences naturelles sont aussi très différentes entre elles. Les femmes se sentent à l’aise en biologie ou en génie alimentaire ou agricole, mais du côté génie mécanique, des mathématiques ce n’est pas de cas.
La philosophie, ai-je pu constater au premier plan en tant qu’étudiante graduée dans cette discipline, puis en ayant fait des recherches sur ce sujet, possède une culture plus proche des mathématiques que de la psychologie, pour nommer un domaine où il y a beaucoup de femmes et où on se préoccupe de justice sociale et notamment de débusquer le sexisme, le racisme, les déterminants sociaux de la santé mentale
JL : Il y a beaucoup de travaux du côté de ce qu’on appelle les STIM3 pour rendre le milieu plus accueillant?
LCB : En effet. Il y a des initiatives très intéressantes, comme cette Journée internationale des femmes et des filles de science de l'UNESCO. Cependant, en génie, mathématiques ou informatique, les chercheuses qui travaillent sur le sujet ont tendance à n’aborder la question des déséquilibres de genre qu’en ne prenant compte que de leur discipline. Les initiatives prennent forme davantage au sein d’un domaine et en lien avec le milieu professionnel attenant. Il me semblerait productif de prendre un recul de sa discipline pour voir les éléments transversaux à tous les domaines, car il y a un risque réel de sous-estimer le problème et le fait qu’il est structurel et non local.
En sociologie, psychologie du travail, communications, gestion, il y a beaucoup de travaux4 et d’expertises sur les impacts du sexisme ou du racisme dans les milieux de travail, par exemple sur les styles de communication, sur les CV (où deux CV identiques sauf pour le prénom sont évalués différemment, où des personnes se voient offrir des salaires de départs différents selon que le prénom soit masculin ou féminin). En gestion, par exemple, il existe des cas5 d’organisations ayant mis en place des pratiques pour favoriser le recrutement des femmes. Ajoutons les sciences cognitives, où il y a de multiples études sur les biais implicites.
Les sciences ne sont pas un milieu uniforme. Il faut en étudier les pratiques séparément, pour comprendre les différentes cultures, puis comprendre pourquoi les femmes s’y intéressent ou pas. Je dirais que ce n’est jamais vraiment, fondamentalement, un problème dû aux femmes, à leur supposé manque d'intérêt (on sait de mieux en mieux que ce n’est pas la cas), ni à leurs carences de caractère (insécurités, manque de confiance en soi, sentiment d'imposteur, etc.) mais que c’est bien davantage une question de culture du milieu, milieu composé souvent de personnes qui n’ont pas du tout conscience de leurs biais ou comportements sexistes.
JL : Celui ou celle qui fait la science n’est-il pas aussi à risque d’introduire toutes sortes de biais dans ses travaux?
LCB : C’est un fait, et cela commande une continuelle prudence. L’un des biais que les scientifiques devraient avoir à l’esprit est celui d’être un groupe homogène face à un même objet de recherche, particulièrement quand l’objet est aussi complexe que les personnes humaines, ou la société, ou quand les applications transforment nos mondes matériels, nos manières de vivre, comme en ingénierie. Avec une communauté diversifiée de gens, on aura une communauté de perspectives et donc, ce qui sera produit sera plus applicable à l’ensemble de la société.
Ça prend une variété d’expériences sociales, de classes, d’habitus. Idéalement les scientifiques devraient être un sous-ensemble représentatif de l’humanité! C’est le principe d’objectivité forte6, de Sandra Harding, dont je dirais que c’est la meilleure et la plus pertinente des positions épistémologiques actuelles. Éliminer le sexisme, ce n’est pas introduire un biais en sciences mais plutôt en corriger un, et un très gros.
JL : Je pense au sociologue Pierre Bourdieu qui est souvent revenu sur cette question, sur la difficulté pour un sociologue se réfléchir sur un objet dont il est partie prenante. Il parle aussi du fait qu'une des difficultés des sciences sociales réside dans le fait que ses objets sont des enjeux de luttes, et dans le dévoilement de vérités gênantes7.
LCB : En effet, et j’ajouterais que les questions de rapports de genres sont peut-être encore plus « délicates » que les questions de classes, parce qu’elles touchent l’identité d’une personne.
Les critiques féministes de la science exigent de la science d’être encore plus scientifique. Elles n’essaient pas de la biaiser, ce n’est pas de l’idéologie qu’on veut imposer dans un domaine. On cherche plutôt à dégager les sciences, les méthodes scientifiques, des idéologies qui les ont teintées jusqu’à date et limitées dans leur potentiel de généralisation : entre autres l’idéologie de la supériorité du point de vue occidental, ou la croyance en la neutralité ou l’objectivité absolues; ce genre de présomptions, voire de principes, biaisent à la base toute l’entreprise scientifique. Ceci dit, ces critiques reconnaissent qu’elles ne se sont pas à l’abri des biais non plus, personne ne l’est.
Il y a une dimension centrale à l’approche scientifique qui aiderait à poser un regard critique sur sa propre pratique de chercheur : la connaissance de l’épistémologie de sa discipline. En fréquentant l’histoire des sciences, de la Grèce antique jusqu’à Thomas Kuhn et aux critiques féministes, on comprend qu’il y a eu différents moments dans l’évolution de notre tradition scientifique où on a explicitement, activement, exclut les femmes.
Depuis Aristote qui trouve que les femmes sont de nature inférieures aux hommes, en passant par les Béguines, des femmes contemplatives et indépendantes des maris et des prêtres, qui ont vu éroder leur indépendance, récupérer leurs idées, et se faire réduire à une image de femmes délirantes, ayant des visions, là où les visions des hommes (qu’on pense à Boèce qui s’entretient avec la Philosophie, ou aux visions des pères de l’Église) étaient prises au sérieux. Les Lumières, pour leur part, est une période où on a officialisé l'exclusion des femmes du savoir. Au 19e siècle, les médecins8 et les éducateurs considéraient qu’il était nuisible aux femmes de réfléchir, que cela détournait le sang de leur utérus vers le cerveau, et qu'il était donc néfaste pour leurs fonctions naturelles de penser. Au Québec, il y a peu de temps, les femmes étaient exclues des universités, des cours classiques etc.
L’histoire des femmes qui pensent, qui étudient, qui font de la recherche et qui veulent savoir peut être assez triste de fréquentation… ce sont des siècles qui voient se répéter les mêmes harcèlements et questions sur leurs compétences (les réponses varient selon les époques, les lieux, les religions mais reviennent toujours au fait que ce sont les hommes qui décident si les femmes peuvent ou doivent penser), d’invisibilisation, de dénigrements, de récupérations, etc. Je recommande la lecture de Remarkable Creatures de Tracy Chevalier, pour voir de l’intérieur ces réalités.
Quand on accède aux cycles supérieurs, et ensuite aux postes de responsabilités, à un niveau où l'on sera cadre, directeur ou directrice de labo, je pense que c’est fondamental de maitriser le comment se construit la connaissance au cœur de notre expertise. Je me suis rendue compte tout récemment dans ma propre recherche sur les femmes en sciences que cette prise de conscience se fait selon les aléas des intérêts, qu'elle n’est pas systématique.
JL : Qu'en est-il de cette recherche?
LCB : J’ai mené pendant deux ans une recherche à l’IREF sur la place des femmes à la Faculté des Sciences de l'UQAM, et entre autres sur les obstacles à l’atteinte de la parité aux cycles supérieurs. L’une des choses que j’ai observées durant la boulimie de lectures que fut ma revue de littérature, c’est que derrière les meilleures intentions et les solutions qu’elles produisent se terrent et opèrent des biais alors même qu’on croit agir pour les dépasser. L’exemple que j’ai à l’esprit, le plus évident, ressort à l'analyse des discours utilisés pour rééquilibrer les genres dans un domaine. On tend alors à reproduire les inégalités de genre.
Pour que les étudiants considèrent l’enseignement primaire comme carrière, par exemple, on se demande ce qui pourrait les attirer, on ne commente pas leur caractère, on ne fait pas de pressions pour qu'ils modifient leurs intérêts ou leurs valeurs. On ne leur dit pas, par exemple, de moins tenir compte du salaire, de dépasser leur égoïsme ou de corriger leur personnalité en mettant de l’avant la dimension du care. On va même jusqu’à questionner les rémunérations du domaine de l'enseignement primaire, par exemple. Pourquoi ne juge-t-on pas important de bien rémunérer cette profession à sa juste valeur, et pas seulement au moment où l'on veut y attirer des hommes? On prend souvent les hommes comme point de départ, et on se demande comment changer le domaine en fonction d’eux. Quand on dit qu’il est important d’avoir des modèles masculins, on les invite à devenir des modèles pour les petits gars, mais jamais pour les petites filles, comme si cela n’avait aucune importance que les filles aient aussi des modèles masculins non-toxiques. D’ailleurs, on se demande rarement quel type de masculinité est un modèle sain pour les adultes de demain. Plutôt que de dépasser le système de genres, on voit un appel aux vieux tropes dépassés : tous les petits garçons sont comme ci, toutes les petites filles sont comme ça. Tout ce qui dévie est déviant. Point. Ce n’est pas ainsi qu’on va éduquer les enfants à la société qui est en train d’advenir, et qui sera bien au-delà d'un système binaire de genres.
En contrepartie, quand on parle de sciences aux filles, on leur dit qu’elles doivent se transformer, avoir confiance en elles, de ne pas avoir peur, et ce, sans même vérifier si le milieu dans lequel on les envoie est accueillant. On présume aussi qu’il suffit d’ajuster les procédures d’embauches ou d’anonymiser des CV, par exemple, pour que l’égalité se fasse. Il faut pourtant penser que quand on oblitère les caractéristiques des personnes, on ne tient plus compte des obstacles systémiques ou des défis élevés que ces personnes ont eu à dépasser. Pourquoi ne pas dire aux filles, aux personnes noires ou autochtones : allez en sciences parce que vous allez contribuer à déterminer les axes de recherche, vous allez vous émanciper, vous allez agir à transformer la société ? Pourquoi ne pas leur parler du pouvoir qu’elles auront sur elles-mêmes, sur le monde?
Dès qu’on creuse au niveau du ressenti, au-delà des apparences, les filles qui vont en sciences, ne manquent pas de confiance en elles. Elles performent très bien. Ce dont elles témoignent, se situe au niveau, dirais-je, du joint d’étanchéité entre plusieurs pressions. Par exemple, si elles ont un enfant, si elles font un retour aux études, les attentes et les responsabilités s’accumulent sur leurs épaules, sans compter comment on les accueille dans les milieux : les collègues masculins ou les professeurs peuvent ne pas réaliser parfois comment un type d'humour ou de propos peut fait sentir les femmes comme malvenues.
JL : Les genres hommes-femmes, est-ce vraiment utile?
LCB : À mon avis, on n’a pas ou peu besoin des genres dans notre société dorénavant. Ces catégories sont encore utiles dans le sens où cette catégorisation a été à la base de notre société, voire de notre civilisation, depuis des millénaires. Ces catégories nous permettent de comprendre comment on en est arrivé ici. Elles permettent aussi, comme dans l'analyse de discours présentée précédemment, ou dans les analyses différenciées selon le sexe et le genre (ADS/G) de trouver des solutions asymétriques pour rétablir la symétrie dans une structure sociale encore inégale.
Fondamentalement, si on a une réelle égalité de droit, distinguer les personnes selon le genre est inutile et ne porte à aucune conséquence puisque homme ou femme ou autre, on a des capacités similaires. Ceci sans nier que les distinctions biologiques, comme la sexuation des individus, peut avoir une pertinence dans certains domaines, notamment quand on sait que les symptômes de l’attaque cardiaque diffèrent selon les sexes. Mais ceci devrait avoir la même importance que de savoir si quelqu’un.e est allergique à la pénicilline ou souffre d’un diabète. Quand tout le monde est traité également, toutes nos différences font partie de notre unicité.
JL : Cette question des catégories est d’ailleurs au cœur de votre thèse?
LCB : Oui, avec la logique floue. Le mot catégorie viens de cata, du haut vers le bas, et de goria, la parole. Une parole sanction, un jugement qui classe. On peut représenter la catégorie comme une boite : on est dedans ou dehors. J’en traite d'une façon formelle et sociosémiotique dans ma thèse, mais ceci s’applique facilement aux genres qui ont une forme catégorique stricte. J’étudie et déconstruis cette forme dans ma recherche pour présenter une autre forme de classement, notamment plus adéquate aux réalités dynamiques du monde vivant.
Les genres sont donc comme une parole d’en haut qui tombe comme une injonction : « Toi tu es un homme, toi tu es une femme ». Les genres ont été construit à partir d'une conception naïve des corps humains que la science a dépassée depuis. Ce sont des catégories arbitraires au sens où elles se fondent sur une perception de la réalité dont on n’a pas vérifié la validité, et à partir de laquelle on construit des cases, dont le nombre peut varier selon les cultures. On y associe des rôles, un ensemble de comportements, d’attitudes, etc.
Il n’y a pas si longtemps, être catégorisée femme signifiait qu’on n’avaient pas le droit de porter des pantalons. Il était très mal vu pour une personne mise dans la catégorie homme d’avoir des cheveux longs. Et on sait combien une autre habitude héritée de notre société catégorique a été celle de punir très sévèrement les personnes qui ne se conformaient pas aux prescriptions de genres. Que de personnes furent heurtées dans leur individualité et injustement privées de vivre librement à cause de ce système de contraintes arbitraires! Je dis parfois à la blague dans des conférences que je préfère l’astrologie aux genres, car elle offre au moins douze catégories dans laquelle classer les gens.
JL : Un mot pour conclure.
LCB : J’ai l’impression qu’on a tous les morceaux pour comprendre l’ampleur des changements à opérer pour que notre société et ses différents domaines, notamment celui des sciences, se transforment. Mais il manque la volonté et parfois le courage de les relier ensemble… Les recherches, les études, les résultats sont là, nombreux, qui nous indiquent des pistes. Mais si on les interrelie, on est obligés d’en arriver à la conclusion qu’il faut changer profondément notre culture.
- 1The Development of Children's Gender-Science Stereotypes: A Meta-analysis of 5 Decades of U.S. Draw-A-Scientist Studies - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cdev.13039, et Stereotypic images of the scientist: The draw-a-scientist test - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sce.3730670213
- 2“Add Women and Stir” Won’t Keep Women In Tech - http://authenticorganizations.com/harquail/2012/05/16/add-women-and-stir-wont-keep-women-in-tech/#sthash.s9qI0Xiz.2fIgK0C0.dpbs
- 3Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques
- 4Gender Bias and Sexism in Language - http://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-470, Study examines links between workplace sexism and women's mental health, job satisfaction - https://www.news-medical.net/news/20190206/Study-examines-links-between-workplace-sexism-and-womens-mental-health-job-satisfaction.aspx
- 5Stephen Colbert on the ‘Extraordinary’ Steps It Took to Get a Diverse Writers Room - https://www.thecut.com/2018/08/stephen-colbert-late-show-diverse-writers-room.html
- 6"Strong Objectivity": A Response to the New Objectivity Question - http://thehangedman.com/teaching-files/svd-phd/2-gender/harding.pdf
- 7Pierre Bourdieu, Questions de sociologie. Éditions de minuit, 1984, p.21.
- 8L'idéologie du corps médical français au XIXe siècle - https://www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1993_num_47_1_1871
- Louise Caroline Bergeron
Université du Québec à Montréal
Louise Caroline Bergeron est une chercheure féministe au parcours multidisciplinaire. Ses sujets de spécialité et de recherche se situent aux interstices des savoirs, faisant le pont entre les échelles personnelle et culturelle. Détentrice d’un baccalauréat honours en psychologie expérimentale et d’une maitrise en enseignement de la philosophie, elle a également fait des études graduées en psychologie interculturelle, épistémologie des sciences, logique modale et études féministes. Elle s’intéresse depuis quinze ans aux problèmes liés à la sous-représentation des femmes dans les disciplines intellectuelles et les STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques). Elle a notamment mené des recherches sur la sous-représentation des femmes en philosophie et s’est impliquée pendant six ans comme membre du C.A. de Les Scientifines, un organisme faisant la promotion des sciences auprès des jeunes filles. Tout en poursuivant un doctorat en sémiologie, elle collabore depuis 2017 à l’Institut de recherche et d’études féministes (IREF) où elle termine présentement une enquête sur les obstacles à la venue et au maintien des femmes aux cycles supérieurs à la faculté des sciences de l’UQAM.
- Johanne Lebel
Acfas
Rédactrice en chef du Magazine de l'Acfas.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre