Nous entendons le commun comme un principe politique d’action. Il ne s’agit pas de simplement désigner en tant que commun des biens ou des ressources, ce qui est le sens habituel. Il s’agit plutôt de définir le commun comme action, comme un système qui régirait la relation entre des individus égaux et les choses. C’est en instituant des communs qu’on les fait exister, il est donc question d’un geste politique.
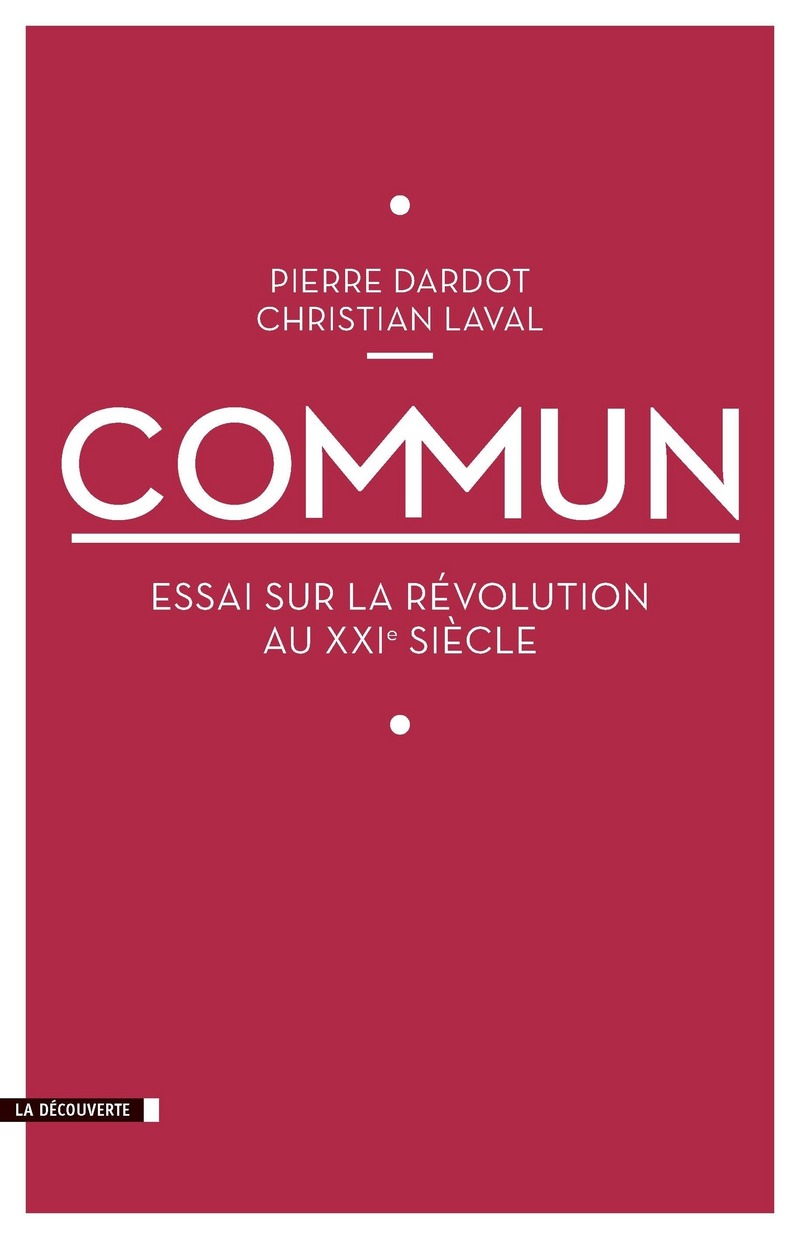 [Note de la rédaction : L'entretien a été réalisé avec Pierre Dardot. Christian Laval a réalisé une relecture de la version écrite.]
[Note de la rédaction : L'entretien a été réalisé avec Pierre Dardot. Christian Laval a réalisé une relecture de la version écrite.]
Eve Seguin : Pr Dardot, nous aimerions vous entendre sur les liens possibles entre le commun et le monde de la recherche. Et, les chercheurs étant aussi des citoyens, nous avons pensé qu’il serait intéressant d’échanger par la suite sur le commun en lien avec l’actualité politique. Mais avant toutes choses, pourriez-vous nous donner votre vision du commun tel que porté par votre ouvrage fondamental, publié avec Christian Laval en 2014, Commun : Essai sur la révolution au 21e siècle.
Pierre Dardot : Nous entendons le commun comme un principe politique d’action. Il ne s’agit pas de simplement désigner en tant que commun des biens ou des ressources, ce qui est le sens habituel. Il s’agit plutôt de définir le commun comme action, comme un système qui régirait la relation entre des individus égaux et les choses. C’est en instituant des communs qu’on les fait exister, il est donc question d’un geste politique. Une communauté de personnes construit, réalise des choses, pose ensemble des gestes, et établit ses règles. Il n’est pas ici question d’un communisme d’État auquel il faut renoncer, mais sans abandonner l’idée de la communauté, dont la communauté « économique » telle que l’illustre la communauté de communs du Bâtiment 7 à la Pointe-Saint-Charles de Montréal. Il s’agit de co-obligation, de co-appropriation, de coconstruction. Refonder, en fait, le concept de commun pour en faire un principe réel d’action permettant de sortir de la trappe socioéconomique où nous sommes enfermés.
Eve Seguin : Le commun, il me semble, se trouve au cœur de beaucoup de pratiques du milieu de la recherche, comme du milieu universitaire. Le premier élément qui me vient à l’esprit, c’est évidemment la collégialité universitaire, une notion entourée d’un flou artistique. J’en distinguerais trois dimensions. La collégialité comportementale qui renvoie aux relations de soutien mutuel entre les collègues, la collégialité culturelle qui désigne les valeurs partagées entre universitaires, et la collégialité structurelle, celle qui nous intéresse ici, qui renvoie à l’autogouvernance professorale des universités. Est-ce que vous pensez que cette autogouvernance est réelle? Je pense que vous êtes au courant que beaucoup de gens la questionnent, et j’en fais partie. D’après vous, est-ce qu’elle relève du commun?
Pierre Dardot : Ouf, vaste question! Autogouvernement ou autogouvernance? Je préfère, avec Christian Laval, le terme d’autogouvernement pour des raisons politiques. Mais attardons-nous plutôt à cette notion d’auto, à cette idée d’une institution qui se gouverne par elle-même.
Il y a une tradition de collégialité très ancienne au sein des universités, qui concerne d’abord et avant tout les professeurs. Et aujourd’hui, cette collégialité est en crise. Dans un contexte de néolibéralisme, l’institution universitaire est devenue une université entrepreneuriale, ce qui va à l’encontre de sa logique profonde, de son fonctionnement historique. Le contexte de raréfaction des moyens où l’on demande aux universités, dans le meilleur des cas, d’en faire plus avec des moyens constants produit des effets assez négatifs. Concurrence exacerbée, guerre entre laboratoires, rivalité entre collègues autour de l’avancement des carrières, etc.
On peut toujours invoquer le principe de collégialité, et considérer que c’est un principe éminemment positif, mais en même temps, il ne faut pas méconnaître l’état de l’institution dans laquelle ce principe opère. Cela fait maintenant près de quarante ans que le néolibéralisme politique comme gouvernementalité s’est mis en place. Dans le champ universitaire, on peut parler des années 1990, et d’une situation s’aggravant toujours un peu plus d’un projet de réforme à l’autre. Les refontes qui, par exemple, introduisent des administrateurs issus du monde de l’entreprise sont une forme d’assaut contre le principe de collégialité et qui, de plus, viennent de l’intérieur. Il faut lier ce qui se passe à l’interne et à l’externe. Une présence affirmée de l’idée de croissance, une managérialisation et une augmentation de la concentration des pouvoirs, sont des forces très puissantes qui traversent nos sociétés et qui vont à l’encontre de l’idée de collégialité.
En France, les recteurs sont des représentants des ministères d’État, et les présidents et vice-présidents des universités constituent les autorités universitaires locales. Il y a d’un côté, la managérialisation de la gestion interne et de l’autre, une subordination de plus en plus grande aux ministères, comme si une certaine forme de bureaucratisation allait de pair avec la transformation managériale. On peut y voir une contradiction, mais ce n’est pas le cas. En fait, la bureaucratisation correspond parfaitement aux objectifs du néolibéralisme. Ainsi, il y a des présidents et vice-présidents d’université qui deviennent des agents, plus ou moins zélés, de la mise en œuvre des réformes néolibérales venant des ministères.
Eve Seguin : J’observe aussi une introduction massive du principe managérial au sein des universités, mais dois-je comprendre que vous pensez qu’avant l’hégémonie du néolibéralisme, la collégialité existait?
Pierre Dardot : Oui! Elle existait, bien qu’imparfaite. Je prends l’exemple des universités françaises que je connais relativement bien. Avant 1968, la collégialité était réservée strictement aux professeurs d’université. Avec la Loi Faure, il y a eu un élargissement aux maîtres de conférences. Puis, on a discuté de l’extension de ce principe aux étudiants. Pour autant, on ne peut pas dire que cette collégialité fonctionnait parfaitement, parce qu'on devrait y accorder les mêmes pouvoirs à tous les membres d’un « collège », afin d’empêcher la capture par des intérêts particuliers.
Il y a eu des collèges à l’époque médiévale en parallèle aux universités. Dans ces institutions destinées aux étudiants boursiers, il y avait une organisation démocratique. Mais je crois que ce n’est pas un modèle auquel il faut revenir, cela n’aurait strictement aucun sens. La collégialité n’est pas une chose appartenant au passé et vers laquelle il faut se retourner avec nostalgie. C’est quelque chose que nous avons à instituer, une tâche qui relève complètement, justement, des acteurs de l’université.
La collégialité n’est pas une chose appartenant au passé et vers laquelle il faut se retourner avec nostalgie. C’est quelque chose que nous avons à instituer, une tâche qui relève complètement, justement, des acteurs de l’université.
Eve Seguin : On pourrait dire que la collégialité est un idéal toujours à atteindre, mais qu’effectivement, il est parfaitement compatible avec le commun tel que vous l’envisagez?
Pierre Dardot : Oui, bien sûr.
Eve Seguin : Si on parlait maintenant de ce qu’on appelle la slow science. Le virage néolibéral des universités dont vous parlez impose aux chercheurs un rythme de travail et de publication absolument démentiel, le tout, évidemment, au nom de la prétendue excellence devenue un véritable mantra. Cet impératif de publication fait en sorte que certains chercheurs refusent même de réviser les travaux de leurs pairs. La qualité de la recherche, évidemment, finit par s’en ressentir. Cette cadence infernale a engendré un contre-mouvement, lancé par des chercheurs allemands en 2010 par le Slow Science Manifesto. Ralentir, prendre le temps de réfléchir et de mener des recherches de qualité. Il y a même des chercheurs qui prônent ce qu’ils appellent la désexcellence. Ce mouvement irait-il dans le sens du commun?
Pierre Dardot : Il ne faut pas l’enrôler comme mouvement relevant du commun, mais il va dans le même sens, c’est indubitable, parce qu’on y refuse, entre autres, le stress de l’impératif du publish or perish. Ce qui me semble le plus important ici, c’est le rapport au temps, et vous avez très justement pointé la question de l’accélération. Le philosophe et sociologue allemand, Hartmut Rosa, a publié il y a quelques années un livre remarquable sur le sujet, Social Acceleration : A new theory of modernity. Il y parle non seulement de l’accélération de l’innovation technologique, mais également de l’accélération du temps de nos vies. Cela se manifeste d’une manière très sensible à l’université en raison de tout ce que vous avez évoqué. Cela pèse sur les chercheurs, sur les plus jeunes en particulier. Il y a des universités comme c’est le cas à Nanterre où on a voulu ouvrir des comptes-crédit de temps pour les chercheurs. Et ça, c’est terrible! Il y a en France des tentatives répétées pour introduire une différenciation des services des enseignants-chercheurs avec la mise en place de ces comptes-crédit, mais elles rencontrent encore de fortes résistances. À Nanterre, le dispositif a été abandonné en raison de fortes résistances, c'était une sorte de ballon d’essai.
Eve Seguin : Je n’étais pas au courant.
Pierre Dardot : On aboutit ainsi à la création de nouvelles catégories. Plus les chercheurs publient, plus ils ont le droit d’être dispensés des tâches d’enseignement, et ceux qui enseignent ayant moins d’opportunité de publier, enseignent encore plus. Tout à fait dans le sens de votre remarque.
Il faut reconquérir un nouvel horizon temporel. Le commun social ou universitaire exige de libérer du temps. Il faut pouvoir penser et réaliser des projets de long terme, des actions pérennes. Alors que généralement, on a des contrats courts, de quatre ou cinq ans, plombés par des obligations de résultats chiffrés.
Il y a aussi des implications sur le mode de recrutement. On embauche de plus en plus sur la base d’articles plutôt que sur celle des livres. Pour les gens de notre génération, c’est assez troublant parce que les articles se font souvent dans l’urgence pour répondre à une demande extrêmement ponctuelle, et ce habituellement au détriment de la qualité de la recherche menée au long cours.
Il faut reconquérir un nouvel horizon temporel. Le commun social ou universitaire exige de libérer du temps. Il faut pouvoir penser et réaliser des projets de long terme, des actions pérennes. Alors que généralement, on a des contrats courts, de quatre ou cinq ans, plombés par des obligations de résultats chiffrés.
Eve Seguin : J’aimerais également évoquer la question du copyleft, du Creative Commons. Ce sont, en fait, des restrictions du droit de propriété intellectuelle puisqu’ils posent que les usagers ont le droit d’utiliser, de copier, de modifier et de diffuser une production intellectuelle, tel un article scientifique. Pensez-vous que ce copyleft constitue une brèche dans la logique du capitalisme?
Pierre Dardot : Une brèche, oui. Il ne faut pas non plus, comment dirais-je, exagérer. Ce n’est pas un élément qui est immédiatement de l’ordre du commun, au sens de l’autogouvernement. Cependant, même si les Creative Commons n’ont pas pour objectif de constituer un commun numérique, ils aboutissent à ce résultat. Les œuvres distribuées par le biais de ces licences deviennent des ressources mises en partage. Toutes les œuvres sont placées sous les mêmes conditions générales, et des règles d’accès particulières sont sélectionnées par les auteurs à travers des licences. Par contre, le modèle de gouvernance des Creative Commons est assez discutable. On est très loin de l’autogouvernement. Un conseil de directeurs fixe des orientations générales, et une entité managériale applique. Cette structure se situe entre la gouvernance privée et l’encadrement étatique dont relève le droit d’auteur. Mais, cela reste tout de même quelque chose d’assez intéressant comme retournement.
Eve Seguin : Et comment expliquez-vous justement ce retournement, le fait que les puissants aient laissé ce Creative Commons se développer?
Pierre Dardot : Je pense qu’ils ont été pris au dépourvu, car cela s’est produit assez rapide. C’est en 1989, je crois, que le copyleft devient quelque chose de tout à fait libérateur, et on doit attendre dix ans avant que les premières licences de Creative Commons voient le jour. Ça va très, très vite, et c’est une période avorable à ce développement jusqu’au début des années 2000. Ensuite, il y a une réaction avec la codification des droits de propriété intellectuelle, les accords mondiaux de 1994. Il y a donc eu une sorte, comment dirais-je, d’intervalle temporel où un certain nombre de possibilités seront assez judicieusement exploitées par des acteurs, souvent des juristes. C’est le cas de Lawrence Lessig et de James Boyle, fondateurs des licences Creative Commons. Il y a des remises en cause, mais il n’en reste pas moins que ce sont des acquis qu’il faut défendre.
Encore une fois, ce n’est pas la négation de la propriété, mais c’est une brèche, et par conséquent, c’est un point d’appui pratique. C’est tout de même un surprenant retournement contre la logique de propriété exclusive. C’est ça qui est fantastique.
Eve Seguin : Oui, effectivement, c’est assez remarquable. Côté science ouverte, vous savez que les grands éditeurs de revues scientifiques, comme Elsevier, vendent aux bibliothèques universitaires, notamment, des ensembles de revues à des prix astronomiques. Ils ne font plus, ou peu, de travail d’édition sur les articles, et réalisent cependant des taux de profits de l’ordre de 30 à 40 %, tout en restreignant l’accès aux résultats scientifiques pourtant financés par les fonds publics. En réaction à ces pratiques, il y a un mouvement de chercheurs qui dénonce et met en œuvre des stratégies alternatives de diffusion. Je pense au Public Library of Science dont les articles sont en accès libre. Est-ce que vous pensez que cette revendication d’une science ouverte est conforme au projet d’une société du commun?
Pierre Dardot : Là encore, cela va dans le même sens. Cependant, il faut faire attention à cette notion d’ouverture parce que vous n’êtes pas sans savoir que très souvent, le lexique managérial utilise abondamment et abuse même de cette notion. Je prends un exemple tout simple, celui de la politique dite d’innovation ouverte – qui n’a strictement rien à voir avec la science ouverte – consistant à partager l’innovation tout en misant sur les mécanismes du marché. Ou encore, ces licences accordées à des laboratoires génériques dans les pays en voie de développement, et dont les concessions accordées pour répondre aux urgences de santé, par exemple, ne remettent pas du tout en cause l’idée d’une appropriation exclusive des connaissances.
Dans la science ouverte, il y a à la fois l’idée d’accessibilité, d’ouverture et de partage. C’est l’idée fondamentale d’un patrimoine scientifique commun qui n’est pas approprié par un nombre restreint de personnes. Et comme vous l’avez dit, il faut s’assurer de la plus large diffusion possible des résultats... et aller au-delà. De fait, il faut aussi postuler la production « ouverte » de connaissances à travers les pratiques collaboratives. Ainsi, ce qui s’ouvre, c’est la production tout comme l’accès aux résultats. Ça, c’est totalement dans le sens de la logique du commun. La production des connaissances en mode ouvert est susceptible de favoriser la constitution du commun scientifique, et pas seulement la large diffusion des connaissances. Bien sûr, cela s’oppose à la logique des brevets, des monopoles d’exploitation et autres pratiques d’appropriation.
...il faut aussi postuler la production « ouverte » de connaissances à travers les pratiques collaboratives. Ainsi, ce qui s’ouvre, c’est la production tout comme l’accès aux résultats. Ça, c’est totalement dans le sens de la logique du commun. La production des connaissances en mode ouvert est susceptible de favoriser la constitution du commun scientifique, et pas seulement la large diffusion des connaissances.
Eve Seguin : Et comment expliquez-vous que les présidents d’université et les recteurs soient favorables à cette science ouverte alors qu’ils ont tendance à appliquer des méthodes managériales?
Pierre Dardot : C’est difficile de se mettre à leur place et de réfléchir à leur manière. Il faudrait distinguer deux dimensions du néolibéralisme universitaire qui ne se recoupent pas toujours. D’un côté, il y a bien une managérialisation de l’organisation qui correspond à la mise en concurrence des établissements universitaires entre eux, au niveau régional, national ou international. Cette managérialisation liée à la concurrence utilise certaines formes « d’ouverture », partenariats avec des entreprises privées ou avec d’autres institutions de recherche, cours ou conférences en ligne, qui sont autant d’atouts concurrentiels.
Eve Seguin : Il y a quand même quelque chose de paradoxal puisqu’ils acceptent de plus en plus d’introduire des méthodes managériales au sein des universités, et en même temps, ils protestent contre les grands éditeurs et ils sont, ou ils se disent, favorables à cette science ouverte. Est-ce qu’on n’est pas en train, autrement dit, de pervertir les présidents et recteurs?
Pierre Dardot : Si on les pervertit bien on pourrait l’espérer... Mais en réalité, il y a une autre logique, ou une autre face du néolibéralisme universitaire, qui est celle de la marchandisation, laquelle transforme les supports de connaissance, dont les articles scientifiques, en véritables produits marchands. Cette « enclosure » de la connaissance profite aux éditeurs que vous citez, mais pas nécessairement aux universités.
Eve Seguin : Donc vous n’avez pas d’explication?
Pierre Dardot : Non, je n’en ai pas et d’autant que cela peut beaucoup varier. En France, par exemple, il y a des gens qui, tout en appuyant la science ouverte, sont obsédés par la valorisation des résultats de la recherche à partir des instruments de la propriété intellectuelle et ce, dans toutes les sphères du savoir, pas seulement en génie. Ils défendent la mise en place de méthodes managériales empruntées au privé, et le partenariat entre les établissements publics et les entreprises privées. Ils reprennent, notamment des éléments de la Convention de Lisbonne en 2002, une entente qui porte sur « la reconnaissance des qualifications [des personnes] relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne a été élaborée par le Conseil de l’Europe et l’UNESCO ». Ce qui est repris en fait, c’est l’idée que la connaissance est d’abord et avant tout un résultat qui peut être commercialisé, sous-entendu cette idée d’une connaissance devenue capital.
Et de l’autre côté, en effet, il y a une sorte d’agrément, d’acceptation de cette revendication de la science ouverte. Est-ce un effet de la pression exercée par les collègues? D’autant que cette idée de science ouverte est tout de même assez partagée. Il faut rappeler que Robert Merton en 1940 parlait du communisme de la science.
Eve Seguin : On peut dire que l’université est traversée par tous ces courants, et que le courant managérial ne vient pas tout balayer.
Pierre Dardot : L’université comme champ de luttes, voilà.
Eve Seguin : Un champ traversé de contradictions.
Pierre Dardot : Et dans ce jeu, le commun permet d’ouvrir vers des enjeux auxquels on n’aurait pas songé.
Johanne lebel : Comment les chercheurs justement peuvent-ils s’inscrire dans ce champ de luttes et contribuer à instaurer cette société du commun à partir de leur position particulière?
Pierre Dardot : Je dirais que c’est à travers la ré-institution de l’université et de la société. Ce qui compte, c’est ce rapport de l’université à la société. Le chercheur, la chercheuse doit avoir en vue les liens entre la recherche et les autres activités sociales, et il ou elle doit être capable d’audace.
Dans la prise de conscience de la société sur elle-même, l’université et les chercheurs sont l’élément moteur. L’université doit être ou devenir ce lieu d’exercice d’autoréflexion de la société. Il ne faut pas penser à une restauration de la corporation médiévale, à un retour à l’université à la Wilhelm von Humboldt ou à un renouvellement du modèle intégralement piloté par l’État, comme certains en rêvent. Ce qui est en jeu, c’est le type de relations que les chercheurs établissent avec des acteurs sociaux engagés dans une grande diversité d’activités. Comme chercheurs, cela suppose que l’on se remette en question, que l’on s’inquiète du monopole de la production des connaissances et que l’on coconstruise un monde viable avec les autres acteurs.
Ce qui est en jeu, c’est le type de relations que les chercheurs établissent avec des acteurs sociaux engagés dans une grande diversité d’activités. Comme chercheurs, cela suppose que l’on se remette en question, que l’on s’inquiète du monopole de la production des connaissances et que l’on coconstruise un monde viable avec les autres acteurs.
Il y a quelqu’un qui me vient à l’esprit, un pionnier en la matière, qui n’est autre que Michel Foucault. En 1971, il publie Surveiller et punir, un ouvrage absolument remarquable sur la prison comme institution. Et dans un même geste, il fonde, avec d’autres, le groupe d’information sur les prisons, le GIP. Il fait alors place à une pratique d’enquête assez différente de celles qui prévalaient dans l’enceinte universitaire. Cette enquête, comment dirais-je, articulée à la voix des détenus et des autres acteurs de la prison, est devenue un commun, un construit partagé.
Nous avons tenté à Nanterre de faire la même chose, en tout cas d’ouvrir une brèche, au moment de Nuit Debout. Dans le cadre du séminaire Pratiques utopiques tenu au laboratoire Sophiapol dont nous dépendons, on a fait en sorte de favoriser la coproduction de savoirs. Une coproduction impliquant les participants du séminaire et les acteurs de Nuit Debout. Le tout a été facilité par le fait que plusieurs chercheurs étaient eux-mêmes engagés dans le mouvement. Le récit de cette expérience, qui a connu une extension jusqu’au Brésil, est en train d’être rédigé.
Cela nous ramène à la question de l’objectivation scientifique. Il y en a deux types. L’objectivation qui réduit les acteurs à des agents « produits » à partir de régularités statistiques, sans demander leur avis. Et l’autre, une objectivation par coproduction des savoirs entre chercheurs et acteurs. Cette approche ouvre l’institution sur la société, et elle permet d’accueillir les acteurs dans ce qu’ils ont de singulier. En résumé, je dirais qu’il faut que l’université et les chercheurs se posent la question pratique de l’articulation de leurs recherches aux acteurs et aux mouvements sociaux.
Il y en a deux types [d'objectivation]. L’objectivation qui réduit les acteurs à des agents « produits » à partir de régularités statistiques, sans demander leur avis. Et l’autre, une objectivation par coproduction des savoirs entre chercheurs et acteurs.
Eve Seguin : Il y a trois pratiques de coproduction des savoirs qui me viennent à l’esprit, et qui tiendraient du commun. La science citoyenne où des gens de l’extérieur de l’université cumulent des données pour les chercheurs; des observations de populations de papillons ou d’oiseaux, par exemple. Ensuite, il y a ces fameuses boutiques de science apparues en Hollande, apparemment en perte de vitesse, ce qu’on peut déplorer, et dont il faudrait interroger les causes. Et finalement, j’aimerais vous entendre sur les pratiques de recherche-action.
Pierre Dardot : La science citoyenne me semble être tout à fait essentielle à la production d’une certaine forme de savoir. Par exemple, le recensement des populations végétales et animales est approprié, voire indispensable. Mais cela ne peut évidemment pas s’étendre à tous les savoirs. Pour les boutiques de sciences, là, j’avoue ne pas connaitre. Quant à la formule de « recherche-action », on peut y mettre des choses très différentes. Qu’entendez-vous par là?
Eve Seguin : En général, la recherche-action est produite par des chercheurs en collaboration avec des groupes communautaires qui se battent, par exemple, pour le droit au logement. Cette recherche vise alors à produire des résultats qui contribueront à un mieux-être, à plus de justice.
Pierre Dardot : En ce sens, cela ressemble à s’y méprendre à cet objectif du commun visant à tourner le dos à ce qu’on a appelé la science pure ou désintéressée. Les savoirs validés par l’approche scientifique contribuent alors à l’émergence de certains mouvements, à leur capacité de se renforcer. Cela me semble tout à fait irremplaçable.
Eve Seguin : Si on abordait maintenant le commun par le biais de l’actualité politique. Le premier sujet sur lequel on aimerait vous entendre, c’est le dégagisme qui s’est manifesté en France avec l’élection de Macron, la quasi-disparition du Parti socialiste et le plomb dans l’aile qu’ont pris les républicains. Au Québec, où nous avons un système britannique qui favorise le bipartisme, on a également eu une forme de dégagisme. À l’automne 2018, c’est un troisième parti qui a été élu. Les deux partis qui se partageaient le pouvoir en alternance sont eux aussi plutôt mal en point.
Ce dégagisme marquerait une profonde insatisfaction des citoyens lambda envers les partis politiques traditionnels. Pensez-vous que les motivations qui le sous-tendent pourraient être canalisées dans le sens de l’instauration d’une société du commun?
Pierre Dardot : C’est un point qui est assez complexe, et qui n’est pas propre au Québec ou à la France. Les formes politiques sont un peu différentes selon les pays, mais on observe que les dirigeants portés au pouvoir par cette vague de dégagisme ne sont pas des dirigeants de gauche, mais souvent des dirigeants de centre droit ou même carrément de droite, et pour certains d’entre eux, de droite assez extrême.
Il y a eu l’installation du néolibéralisme dans les années 1980, la chute du mur de Berlin en 1989, l’ouverture des marchés à l’échelle mondiale et la financiarisation de l’économie. Et puis, il y a eu quelque chose d’assez brutal qui s’est produit, notamment à travers la spéculation boursière, qui a éclaté en 2008, et qui dépasse la crise économique. De fait, on peut parler d’une crise politique de très grande ampleur. En 2011, le « dégage, Ben Ali dégage » – d’où provient d’ailleurs le terme dégagisme – du printemps tunisien, en est une expression. Globalement, il y a un mécontentement voire une colère, à l’égard des 35 années de politique néolibérale, et un grand ressentiment à l’égard des partis traditionnels. Cependant, il faut différencier entre d'une part ce ressentiment, ce rejet extrêmement massif, et d’autre part l’instrumentalisation politique qui consiste à dire « maintenant, on fait place nette, on élimine les partis traditionnels, et vous allez voir, je suis l’homme de la situation, etc. ». Il faut être capable s’adresser aux personnes qui ne sont pas nécessairement gagnées, justement, à des idéaux et à des objectifs comme ceux du commun. Il faut leur parler précisément à partir de cette manifestation de rejet qui est très profonde.
Eve Seguin : Mais qui peut leur parler? Qui peut, justement, empêcher cette instrumentalisation? Et qui peut canaliser cette colère dans le sens de l’instauration d’une société du commun?
Pierre Dardot : J’ai un peu de mal à voir comment les partis tels qu’ils existent, et qui ne constituent pas des formes alternatives, peuvent agir. Le ressentiment éprouvé par de nombreuses couches de la population s’adresse en particulier à ce qu’on appelle la représentation politique, une des formes qui permet à une petite minorité de s’arroger le droit de parler et d’agir à la place des autres.
Il n’y a pas de parti du commun, et il ne serait pas souhaitable qu’il y en ait un dans le sens que l’on donne à ce mot de « parti », celui d’une formation politique qui se coopte intérieurement dans le but de conquérir le pouvoir à la tête de l’État. Je ne pense pas que ce soit de ce côté qu’il faille chercher une quelconque alternative. Sur ce point, je ne suis pas pessimiste, mais réaliste.
Eve Seguin : Il y a des aspects du mouvement des « gilets jaunes » qui sont tout à fait singuliers et qui semblent remettre en question le capitalisme, cette accumulation infinie dans un monde fini, et la démocratie représentative qui lui est associée. Il y a deux choses qui me frappent dans ce mouvement. D’abord la revendication du pouvoir d’achat qui pose clairement que le capitalisme ne permet pas d’assurer un revenu décent à une grande partie de la population, et d’autre part, le refus complet de toute forme de représentation. Ne pensez-vous pas qu’il y a, dans ce mouvement, quelque chose qui s’approche du commun?
Pierre Dardot : Si, bien sûr. Christian Laval et moi avons écrit sur le sujet dans Médiapart, le 12 décembre dernier, un article intitulé Avec les gilets jaunes : contre la représentation, pour la démocratie. Nous y disions, entre autres, que les « gilets jaunes », que ça plaise ou non, sont parvenus à faire ce que trente ans de luttes sociales n’ont pas réussi à produire : mettre au centre du débat la question de la justice sociale. Mieux, ils ont imposé on ne peut plus clairement la question du lien entre justice sociale et justice écologique, un enjeu fondamental pour toute l’humanité, voire pour l’ensemble de la biosphère.
[Les "gilets jaunes"] ont imposé on ne peut plus clairement la question du lien entre justice sociale et justice écologique, un enjeu fondamental pour toute l’humanité, voire pour l’ensemble de la biosphère.
Eve Seguin : Est-ce qu’il y a, pour conclure, d’autres phénomènes, des tendances, des orientations, des mouvements politiques qui existent en ce moment et dont vous pensez qu’ils seraient susceptibles de favoriser l’instauration d’une société du commun?
Pierre Dardot : Oui, il y a des foyers d’expérimentation, mais dispersés, il n’y a pas de coordination entre eux. Certains sont politiquement plus parlants que d’autres, tel le municipalisme. En Espagne notamment le municipalisme du commun se traduit par une volonté de contrôle des élus par des assemblées populaires. Ce n’est pas une mise en application scolaire des préceptes de l’écologiste américain Murray Bookchin, c’est beaucoup plus inventif, et ça mérite, justement, d’être considéré avec beaucoup d’attention.
La dernière fois que je suis allé au Québec, j’ai discuté de la question avec Jonathan Durand Folco, auteur de À nous la ville! Traité de municipalisme, et cela me semblait être une piste tout à fait intéressante. En effet, l’échelon des municipalités, qui ne sont pas de simples projections de l’État central, offre des possibilités dans la mesure où il existe des marges plus ou moins étroites, mais réelles, pour expérimenter des formes inédites d’autogouvernement. En témoignent en particulier les municipalités « rebelles » en Espagne, dont « Barcelone en commun » est un exemple parmi d’autres, qui ont permis dans certaines circonstances de surmonter le blocage de l’État central en réalisant une alliance transversale entre elles (je pense en particulier à la question de l’accueil des migrants et au rôle joué par Barcelone et Valence).
Prenons aussi la région autonome du Rojava, le Kurdistan occidental, où des gens combattent à la fois l’État islamique, ce qu’il en reste, le régime syrien de Bachar el-Assad, et l’armée turque. C’est une expérience démocratique là aussi. Il y a l'autogouvernement populaire du Chiapas, depuis 1994, n’oublions pas. On a commémoré les 25 ans de cette expérience zapatiste en 2018. On peut aussi penser à l’écologie radicale pour certains aspects, à l’économie sociale et solidaire qui est l’enjeu, d’ailleurs, d’une sorte de lutte entre la logique du commun et la logique de l’entreprise.
Ce sont des expérimentations qui ont une force d’appel incroyable parce que, justement, elles montrent qu’on peut dès aujourd’hui mettre en place des formes alternatives d’autogouvernement et qu’on n’est pas condamnés à vivre sous domination de l’État managérial et néolibéral. Ce n’est pas coordonné, mais en même temps, cela promet.
Johanne Lebel : Et si l’on expérimente maintenant ces formes alternatives de pratique politique, au moment où des effondrements se produisent dans le système actuel – parce qu’il n’est pas durable et qu’il frôle plusieurs points de rupture – ces formes autres pourraient prendre l’avant-scène.
Pierre Dardot : On va, en effet, vers des situations conflictuelles où il y aura des effondrements qui se produiront, qui se produisent déjà, localement ou plus largement. C’est le sociologue américain Erik Olin Wright, décédé au mois de janvier, qui parlait des « interstices » dans lesquelles des pratiques différentes peuvent se loger pour creuser des brèches dans le système capitaliste. Ces ruptures produiront un vide, et on peut en effet se saisir de ces occasions pour mettre en place de nouvelles formes de vie et d’organisation collectives. Ça me paraît tout à fait juste. Il n’y a pas du tout à désespérer.
Eve Seguin : Donc c’est faux de dire que vous êtes un pessimiste.
Pierre Dardot : Avec Christian Laval, on essaie d’être optimistes, mais sans se laisser griser, on essaie d’analyser notre monde pour y repérer des possibilités. Ouvrir des brèches, enrayer un peu la logique néolibérale, et ce à toutes les échelles. Il ne faut pas, sous prétexte qu’on ne réussit pas d’emblée à se situer dans le cadre d’une coordination globale, se mettre à désespérer en disant « ah, c’est local, cela n’a pas d’importance ». Les actions locales ont une très grande importance.
Avec Christian Laval, on essaie d’être optimistes, mais sans se laisser griser, on essaie d’analyser notre monde pour y repérer des possibilités. Ouvrir des brèches, enrayer un peu la logique néolibérale, et ce à toutes les échelles. Il ne faut pas, sous prétexte qu’on ne réussit pas d’emblée à se situer dans le cadre d’une coordination globale, se mettre à désespérer en disant « ah, c’est local, cela n’a pas d’importance ». Les actions locales ont une très grande importance.
Cet article est sous licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Note de la rédaction : Les textes publiés et les opinions exprimées dans Découvrir n’engagent que les auteurs, et ne représentent pas nécessairement les positions de l’Acfas.
- Pierre Dardot, en entretien avec Eve Seguin
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense et Université du Québec à Montréal
Pierre Dardot est chercheur au laboratoire Sophiapol de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, et professeur honoraire de Première Supérieure (philosophie). Christian Laval est aussi chercheur au laboratoire Sophiapol, et il est professeur émérite de sociologie. Ensemble, ils ont publié, entre autres, Sauver Marx? (avec El Mouhoub Mouhoud), La Nouvelle raison du monde, Marx, prénom : Karl, et Commun : essai sur la révolution au XXIe siècle.
Eve Seguin détient un doctorat en sciences politiques et sociales de l’Université de Londres (Royaume-Uni). Spécialiste du rapport entre politique et sciences, elle est professeure de science politique et d’études sociales sur les sciences et les technologies à l’UQAM. Ses recherches portent sur les controverses technoscientifiques publiques, l’interface État/sciences/technologies, et les théories politiques des sciences.
Johanne Lebel : rédactrice en chef du magazine Découvrir
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre




