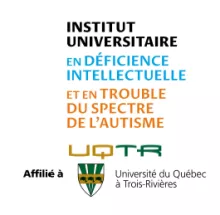Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :Selon l’Organisation mondiale de la santé (2001), la participation sociale est l’un des éléments les plus importants pour le bien-être de la personne. Pour développer leur potentiel et s’intégrer pleinement à la société, les personnes autistes* ou présentant une déficience intellectuelle (DI) mais également celles qui les côtoient quotidiennement doivent pouvoir compter sur du soutien et de l’accompagnement (Cappe et al., 2016; Couture et al., MSSS, 2001; MSSS, 2017; Prata et al., 2018; Rousseau et al., 2016; Turgeon et al., 2019). Prenant appui sur l’approche écologique de Bronfenbrenner (1979), qui situe l’individu au centre des préoccupations tout en tenant compte de ses interactions avec son environnement, dont ses milieux de vie, les projets concernés s’inscrivent dans une perspective de soutien et d’accompagnement aux personnes autistes ou présentant une DI, à leurs proches et aux intervenant.e.s œuvrant dans leurs différents milieux de vie.
Dans un contexte où les besoins sont en constante évolution, des changements dans les pratiques sont réalisés et se déclinent sous différentes formes (programmes, formations, ateliers, outils, etc.) et dans diverses modalités de dispensation (en ligne, en présentiel, hybride). Il importe de faire connaître et de diffuser ces pratiques. Cette activité de transfert de connaissances s’adresse aux personnes intéressées par la déficience intellectuelle et l’autisme. Elle mettra en valeur des travaux menés de concert avec les parties prenantes. Ce colloque offre l’occasion de partager les résultats de travaux et de recherches portant sur les démarches de soutien et d’accompagnement au bénéfice des personnes autistes ou présentant une DI de tous les âges, et ce, dans leurs différents milieux de vie. Il sera une occasion pour les chercheur·se·s, les étudiant·e·s, les intervenant·e·s, les personnes ayant un TSA ou présentant une DI et leur entourage de prendre connaissance, de réfléchir et de discuter des différentes démarches en lien avec ces pratiques issues des divers milieux représentés.
Le colloque aura lieu le 10 mai 2023. Des personnes issues du milieu de la recherche et clinique, ayant des expertises complémentaires, traiteront des résultats de leurs travaux. Des présentations par affiches permettront aux étudiant·e·s des cycles supérieurs d’exposer leur projet et de discuter avec les chercheur·se·s et les intervenant·e·s.
* Inspirée par la littérature (notamment Botha et al., 2021), les expressions « personnes autistes » et « personnes ayant un TSA » sont utilisées en alternance dans un souci de reconnaître à la fois les différentes perspectives et les préférences identitaires liées à l’autisme.
Remerciements :Nous remercions l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, rattaché au CIUSSS MCQ, pour le soutien à la réalisation de ce colloque. Nous tenons à remercier les enfants, adolescents et adultes autistes ou présentant une DI, leurs parents et les intervenants pour leur contribution inestimée à l’avancement des connaissances en TSA et en DI.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Suzie Mckinnon (CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean, CISSS Bas-St-Laurent et CISSS Côte-Nord)
- Myriam Rousseau (CIUSSS MCQ)
- Stéphanie-M. Fecteau (UQO - Université du Québec en Outaouais)
- Jacinthe Bourassa (CIUSSS MCQ - Institut universitaire en DI et en TSA)
- Valerie Desroches (UQ - Université du Québec)
Programme
Mot de bienvenue
-
Communication orale
Vocabulaire à privilégier : sommaire des résultats de l’étude Diversité de paroles en autisme.Valerie Desroches (UQ - Université du Québec)
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou autistes
-
Communication orale
Mise en application du programme d'intervention sur les fonctions attentionnelles et métacognitives (PIFAM) pour les enfants présentant un TSA : contribution pour l’inhibition.Élisabeth Dupont (Université du Québec à Trois-Rivières), Myriam Rousseau (IU DI-TSA CIUSSS MCQ), Annie Stipanicic (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
Une hausse importante de la prévalence du trouble du spectre de l’autisme (TSA) est constatée mondialement dans les cinquante dernières années. Le TSA est caractérisé par des déficits dans la communication et les interactions sociales en plus de comportements et intérêts répétitifs et stéréotypés. Nombreuses études ont permis de mettre en lumière des déficits exécutifs chez les personnes ayant un TSA affectant leur fonctionnement adaptatif, social, scolaire et comportemental. Or, aucun programme d’intervention ciblant spécifiquement les fonctions exécutives (FE) n’est disponible et éprouvé pour les jeunes d’âge scolaire au Québec. L’objectif de la recherche est de vérifier si la mise en application du Programme d’intervention sur les fonctions attentionnelles et métacognitives (PIFAM), conçu initialement pour une clientèle ayant un trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDA/H), permet d’améliorer l’inhibition, de jeunes entre 10 et 14 ans ayant un TSA. Au total, huit participants ayant un TSA ont complété le programme PIFAM de 12 semaines. Des analyses de permutation ont permis de soulever une amélioration de l’inhibition des jeunes suivant le PIFAM. Cette amélioration a été constatée via des mesures neuropsychologiques, alors que les résultats aux questionnaires d’observation complétés par les parents ne sont pas significatifs. Ces résultats suggèrent qu’un tel programme d’intervention sur les FE est prometteur pour les jeunes ayant un TSA.
-
Communication orale
Conception et validation de capsules vidéo pédagogiques pour la familiarisation au travail en épicerie de personnes autistes.Juliette Bertrand-Ouellet (Université Laval), Laurence Blouin (Université Laval), Chantal Desmarais (Université Laval), Frédéric Dumont (Cirris), Tiffany Hu (Université Laval), Francine Julien-Gauthier (Université Laval), Jocelyne Kiss (Université Laval), Alexandra Lecours (Université du Québec à Trois-Rivières), Valérie Poulin (Université du Québec à Trois-Rivières), Claude Vincent (Université Laval)
Afin de faciliter l’intégration des personnes autistes sur le marché du travail, notre recherche visait à concevoir, valider et tester des capsules vidéo pédagogiques permettant la familiarisation de personnes autistes à plusieurs tâches dans une épicerie, tout en sondant leur intérêt et leurs connaissances à l’aide de questions post-visionnement. Quant aux vidéos pour les mentors en épicerie, elles ciblent la familiarisation de ces derniers aux caractéristiques de l’autisme. La méthode consiste à l’utilisation de la recherche-développement et de la validation pour la conception des capsules vidéo. Onze employés d'une épicerie ont été filmés effectuant des tâches dans sept départements. Du texte a été inséré afin d’ajouter des informations concernant la sécurité, l’hygiène, les habiletés sociales et les stimuli sensoriels. Chaque vidéo est suivie de 3-4 questions. La validation a été réalisée auprès de cinq chercheurs de domaines différents, deux personnes autistes, une gestionnaire en formation au travail et deux spécialistes de l’apprentissage et de l’intégration au travail en autisme. Applicabilité et praticabilité ont été démontrées auprès de quatre jeunes autistes. Les 21 vidéos pédagogiques incluent des tâches dans 7 départements et ont été conçues à l’intention des personnes autistes et de leurs mentors. Ce matériel pédagogique de familiarisation pour les personnes autistes et les épiceries inclusives est disponible sur YouTube ainsi que sur un site web.
-
Communication orale
La formation intégrée dans la communauté au secondaire : pour favoriser la participation sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.Chantal Desmarais (Université Laval), Marie Grandisson (Université Laval), Steve Jacob (Université Laval), Francine Julien-Gauthier (Université Laval), Marie-Ève Lamontagne (Université Laval), Sarah Martin-Roy (Université du Québec), Marie-Catherine St-Pierre (Université Laval)
Le passage à l'âge adulte est un défi majeur pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, avec des implications pour leur vie personnelle, familiale et sociale. La formation intégrée dans la communauté, développée dans plusieurs milieux scolaires québécois, favorise l’accès de ces élèves à un travail et une vie active dans leur collectivité après la scolarisation. Cette étude fait partie d’une recherche plus large, portant sur les pratiques prometteuses développées au Québec pour faciliter la transition de l’école à la vie adulte des personnes en situation de handicap. La partie présentée ici porte sur l’éducation intégrée dans la communauté, regroupant des pratiques prometteuses en DI. Il s’agit d’une étude qualitative, exploratoire et participative impliquant 15 personnes ayant une DI et leurs intervenants scolaires et sociaux. L’étude s’appuie sur le cadre théorique de l’approche écosystémique axée sur la résilience, mobilisant des acteurs scolaires, sociaux et communautaires autour de la personne. L’éducation qui lui est offerte consiste à l’aider à consolider ses habiletés de communication et d’interaction sociale, identifier ses forces, ses talents et ses intérêts, développer son autonomie dans la vie quotidienne, apprendre des habiletés sociales pour le travail, et surtout pratiquer ces habiletés de travail dans des domaines qui l’intéressent. Des instruments et programmes d’intervention qui favorisent l’atteinte de ces objectifs sont présentés et discutés.
-
Communication orale
Une maison adaptée aux besoins d’adultes autistes et des technologies accessibles pour tous : Phase 1.Karine Ayotte (Université du Québec à Trois-Rivières), Dany Lussier-Desrochers (Université du Québec à Trois-Rivières), Laurence Pépin-Beauchesne (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Rosalie Ruel (Université du Québec à Trois-Rivières)
Bien que la littérature suggère que les technologies puissent favoriser le développement de compétences liées aux activités de vie quotidienne (AVQ) de personnes autistes, peu se sont intéressés aux conditions à déployer pour assurer le succès de cette initiative dans le temps. Dans un milieu de vie innovant, cette étude pilote vise donc à documenter la trajectoire d’utilisation de technologies lors d’AVQ par les résidents (OB1) et celle d’acceptation de ces outils par les acteurs (OB2). Des données mixtes sont recueillies à trois reprises, soit une fois avant l’implantation et deux fois après. À ce jour, seulement la phase 1 a été réalisée. Pour l’OB1, les résultats indiquent que la technologie est déjà utilisée par la majorité des 12 résidents, mais davantage pour le loisir. Quant aux besoins identifiés, la gestion des émotions semble être le principal défi, suivi de l’hygiène, la communication et les rappels. Pour l’OB2, les intervenants et gestionnaires (n = 15) présentent des attitudes favorables envers les technologies et croient qu’elles pourront leur être utiles dans leur pratique. Cependant, une majorité est préoccupée quant à leurs connaissances et compétences pour en faire un bon usage. En somme, ces données permettent de dresser un bon profil des participants et de leurs besoins. Une fois les outils implantés, les résultats des phases 2 et 3 permettront de voir si leur utilisation peut soutenir les résidents et si la perception des acteurs varie dans le temps.
Familles et intervenants
-
Communication orale
Adaptation transculturelle d’un programme d’habiletés parentales destiné aux parents d’enfants gabonais ayant un trouble du spectre de l’autisme.Line Massé (Université du Québec à Trois-Rivières), Christel Nadine Nguema-Ndong (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Annie Paquet (Université du Québec à Trois-Rivières)
Cette recherche vise à procéder à une adaptation culturelle du programme éducatif Au-delà du TSA : des compétences parentales à ma portée (Hardy et al., 2017) au Gabon. S’appuyant sur le modèle du processus d’adaptation culturelle de Kumpfer et al. (2008), les adaptations se sont déroulées en deux phases. La première phase a été élaborée avec les responsables de la version originale du programme et la deuxième phase avec les membres du comité d’adaptation culturelle à Libreville au Gabon. L’échantillon se compose de 15 participants parmi lesquels cinq parents ayant participé au programme, trois personnes responsables de son implantation et sept experts (trois parents et quatre professionnels). Un devis mixte a été utilisé alliant des données quantitatives et qualitatives. Les données qualitatives issues d’entretiens ont permis de recueillir les perceptions des participants sur le programme et d’obtenir l’avis d’experts sur les adaptations apportées et sur la mise en place du programme. De façon générale, les adaptations de surface proposées ont reçu un écho favorable de la part des parents, des personnes responsables de l’implantation du programme et des experts.
-
Communication orale
Adaptation et dispensation en mode hybride du programme Prévenir-Enseigner- Renforcer auprès d’enfants de 6 ans et moins ayant une DI et/ou un TSA.Jacques Forget (Université du Québec à Montréal), Christine Lefebvre (Université du Québec à Montréal), Zakaria Mestari (Université du Québec à Montréal), Diane Morin (Université du Québec à Montréal), Mélina Rivard (Université du Québec à Montréal), Grace Tusevo (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Les comportements défis [CD] sont un trouble concomitant fréquent chez les enfants ayant un Trouble du spectre de l'autisme [TSA] et/ou une Déficience Intellectuelle [DI]. Les CDs ont des effets négatifs sur les enfants eux-mêmes ainsi que sur l'ensemble de leur entourage. Familles comme intervenants ont besoin de soutien pour intervenir sur ce type de comportements. Ainsi le programme Prévenir Enseigner Renforcer [PER], un programme d’intervention sur les CDs et difficultés socio-émotionnelles, a été implanté auprès de familles d’enfants ayant 0-6 ans recevant des services DI-TSA du CISSSMO. Le PER a été appliqué par les parents et soutenus par des intervenants. En raison du contexte pandémique, notre équipe de recherche a adapté le PER en format télépratique et soutenu les intervenants lors de l'application auprès des familles. Parmi les adaptations, la formation des intervenants a été réalisée en ligne. Les interventions ont eu lieu en format hybride (en ligne et personne). Le contenu des entrevues qualitatives fait ressortir les facilitateurs et barrières rencontrés par les familles et intervenants lors de l'application du programme. Ainsi, le PER délivré en format hybride bénéficie d'une bonne validité sociale pour les intervenants et familles. Néanmoins, pour les parents, la présence des intervenants sur le terrain pour le coaching reste perçue comme étant bénéfique. Des adaptations futures suivant les recommandations émises sont prévues.
Dîner libre
Intervenants et organismes
-
Communication orale
Implantation du Rapid Interactive Screening Test for Autism in Toddlers pour l’amélioration de la trajectoire de services pour les familles d’enfants ayant un TSA.Nadia Abouzeid (IU DITSA, CIUSSS MCQ), Jacinthe Bourassa (IU DITSA, CIUSSS MCQ), Andrée-Anne Lachapelle (UdeM - Université de Montréal), Suzie McKinnon (CIUSSS SLSJ, CISSS BSL et CISSS Côte-Nord), Myriam Rousseau (IU DITSA, CIUSSS MCQ)
La prévalence du trouble du spectre de l’autisme (TSA) est en constante croissance occasionnant des délais d’attente pour une évaluation diagnostique pouvant aller jusqu’à 3 ans. Différentes initiatives ont été développées afin de contrer cette problématique, dont l’utilisation d’un outil de dépistage de deuxième niveau pour le TSA, le Rapid Interactive Screening Test for Autism in Toddlers (RITA-T). La présentation vise à 1) décrire les liens entre le RITA-T et les outils de dépistage et d’évaluation et 2) documenter la satisfaction des intervenants face à l’outil et son implantation. L’échantillon est constitué de 31 enfants francophones âgés de 27 à 47 mois ayant été référés pour une évaluation pour le TSA. Les outils utilisés sont : RITA-T, M-CHAT-R et ADOS-2. De plus, sept intervenants pivot d’un CIUSSS ayant administré l’outil ont participé à une entrevue. Des analyses quantitatives et qualitatives ont été réalisées. Les résultats indiquent des corrélations positives entre le RITA-T et le M-CHAT-R ainsi qu’entre le RITA-T et l’ADOS-2. Ces corrélations suggèrent que le RITA-T est un outil fiable pour détecter les caractéristiques similaires à celles observées à l’aide du M-CHAT-R et de l’ADOS-2. Tous les intervenants soulèvent que l’outil est clair, fiable, objectif et facile d’utilisation. Les résultats corroborent avec les conclusions d’études antérieures nommant la pertinence d’inclure le RITA-T dans la trajectoire diagnostique.
-
Communication orale
Étapes de développement de l’outil de réflexion clinique « Soutien à la pratique orthophonique en contexte de comportements problématiques ».Anne-Édith Dumais-Buist (CIUSSS MCQ), Noémie Michel (CIUSSS MCQ), Nadia Abouzeid (IU DITSA, CIUSSS MCQ), Louis-Simon Maltais (IU DITSA, CIUSSS MCQ), Julie Mcyntyre (Université de Montréal), Priscilla Ménard (IU DITSA, CIUSSS MCQ), Marianne Paul (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
Les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) peuvent présenter un trouble du comportement concomitant. Comme les difficultés comportementales sont souvent fortement associées à des faiblesses langagières, les orthophonistes sont impliquées dans les équipes interdisciplinaires en comportements problématiques dans les Centres intégrés de santé et des services sociaux et les Centres de services intégrés universitaires de santé et des services sociaux. Deux orthophonistes travaillant dans ces équipes ont constaté : 1) un manque d’outils cliniques spécialisés dans ce contexte et 2) que leur rôle dans l’équipe interdisciplinaire n’est pas clairement défini. Elles ont donc créé une équipe pour développer un outil d’aide à la réflexion clinique afin de les soutenir dans leur pratique, l’outil «Soutien à la pratique orthophonique en contexte de comportements problématiques ». Cet outil vise deux objectifs de soutien à la pratique des orthophonistes: 1) l’analyse et dans la mise en place d’interventions en contexte de comportements problématiques auprès de la clientèle présentant un TSA et/ou une DI et 2) mieux définir et faire valoir leur rôle dans les équipes interdisciplinaires spécialisées en comportements problématiques en contexte de DI ou de TSA. Les différentes étapes de développement qui ont conduit à la version actuelle de l’outil seront présentées, ainsi que les étapes de validation en cours ou à venir.
-
Communication orale
Processus d'accompagnement du déploiement de technologies pour soutenir l'employabilité des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autismeKarine Ayotte (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Danny Lussier-Desrochers (Université du Québec à Trois-Rivières)
Avoir un emploi dans sa communauté est, pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles, un moyen de favoriser leur reconnaissance et leur exercice de la citoyenneté (MSSS, 2001). Toutefois, cela représente, encore à ce jour, un défi (OPHQ, 2009). Les entreprises adaptées doivent trouver des solutions novatrices pour assurer des emplois favorisant l’autonomie des personnes présentant une DI ou un TSA. Des recherches suggèrent que les technologies sont parmi les modalités à envisager pour soutenir leur accessibilité et leur maintien à l’emploi (Mihailidis et al., 2016; Randall et al., 2020). Cependant, peu de recherches ont traité des conditions de réussite pour accompagner les organisations dans un tel projet (Godin-Tremblay, 2020). Une étude qualitative a permis d’observer les besoins et les enjeux rencontrés par les participants de trois entreprises adaptées désirant implanter des technologies dans leur milieu (Ayotte, 2022). Les intervenants et gestionnaires ont été accompagnés durant le processus de déploiement technoclinique et l’ensemble du processus a été documenté. Ainsi, il a été possible d'identifier les étapes et les conditions pouvant favoriser la réussite du projet de déploiement. Finalement, une trousse a été élaborée pour accompagner les organisations désireuses d'amorcer le virage technoclinique pour soutenir l'employabilité des personnes présentant une DI ou un TSA.
-
Communication orale
La fin de vie des adultes ayant une déficience intellectuelle : un examen de la portée sur les expériences des intervenant.es.Romane Couvrette (Université Laval), Gabrielle Fortin (Université Laval), Élise Milot (Université Laval)
Dans les pays développés, une hausse de la longévité des adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) est constatée. Lors des dernières étapes de leur vie, ces personnes présentent des besoins spécifiques en matière de soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) qui doivent être mieux compris pour offrir une réponse adaptée. Afin de développer une meilleure compréhension de cette situation et d'accompagner l'évolution des pratiques, cet examen de la portée visait à identifier les facteurs influençant les SPFV pour les adultes ayant une DI selon les intervenant.es. Sept bases de données ont été consultées. Une analyse thématique inductive des 63 articles retenus a été réalisée à l’aide du logiciel NVivo. Trois principaux facteurs d’influence: le lieu des soins et du décès; l’implication de la personne ayant une DI ainsi que la collaboration intersectorielle, interprofessionnelle et avec la famille. Les personnes ayant une DI semblent vivre de nombreuses iniquités dans leur trajectoire de fin de vie. Elles seraient peu impliquées dans les processus décisionnels, ce qui génère des difficultés considérables pour les intervenant.es et les proches concerné.es. Des défis sont également attribuables au lieu des soins et du décès, ainsi qu’à la collaboration interprofessionnelle, intersectorielle et avec la famille. Entre autres, des tensions entre les intervenant.es de ressources d’hébergement et des proches quant à la prise de décisions étaient rapportées par plusieurs études.
Mot de clôture
Communications par affiche
-
Communication par affiche
Portrait de la participation familiale et en intervention de dyades parentales d’enfants ayant un TSA recevant de l’intervention comportementale intensive (ICI)Nadia Abouzeid (Université du Québec à Montréal), Marjorie Morin (Université du Québec à Montréal), Diane Morin (Université du Québec à Montréal), Shaneha Patel (Université du Québec à Montréal), Mélina Rivard (Université du Québec à Montréal), Carlos Sanchez-Meza (UQAM - Université du Québec à Montréal)
L’intervention comportementale intensive (ICI), offerte aux familles d’enfants ayant un TSA à travers le réseau public, améliore un ensemble de sphères de développement de ces derniers (communicationnel, adaptatif, etc.). Alors que la participation parentale constitue un élément central dans le succès de l’ICI, peu de données probantes décrivent et mesurent celle-ci dans les écrits scientifiques. Trois limites complémentaires et fondamentales s’ajoutent : les données existantes (1) ne sont pas fondées sur une méthode mixte; (2) ne considèrent peu ou pas le contexte familial; et (3) ne distingue pas la participation entre les parents (pères/mères). Cette étude cherche donc à répondre à ces trois limites. Vingt et une dyades de parents (pères/mères) d’enfants ayant un TSA ont été recrutées au sein d’un bassin d’échantillon d’un plus grand projet de recherche évaluant l’implantation de la clinique évaluative « Voyez les choses à ma façon » (VCMF) de 2015 à 2020. Les participants ont complété (a) le Questionnaire d’Implication Parentale– Intervention Comportementale Intensive (QIP-ICI), (b) le Questionnaire de Satisfaction du Consommateur (CSQ-8-VF), et (c) un entretien semi-structuré (parent en individuel) portant sur la participation paternelle et maternelle dans la famille et en ICI. Des analyses thématiques et descriptives ont été effectuées.
-
Communication par affiche
Détection automatique de l'autostimulation et des comportements de jeu chez les enfants ayant un trouble du spectre de l'autismeMarc Lanovaz (Université de Montréal), Philippe Leroux (UdeM - Université de Montréal)
L'évaluation et l'observation sont des éléments clés d'une intervention efficace auprès des personnes neurotypiques. Pour les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), ces opérations doivent être réalisées de manière systématique. L'intelligence artificielle offre des options rigoureuses d'évaluation et d'observation des personnes ayant un TSA, qui mènent à des stratégies d'intervention plus efficaces. Nous proposons des données d'efficacité sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour recueillir des informations comportementales d’autostimulation et ludiques provenant d’enregistrements vidéo chez des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme dans des milieux naturels tels que le domicile familial et les centres cliniques. Les enregistrements vidéo proviennent d’une étude aux États-Unis à l’Université Auburn en Alabama. Au total, l’équipe de recherche en psychologie prévoit récolter 250h d’enregistrement vidéo chez 100 participants différents âgés de 12 à 16 ans. Notre équipe de recherche estime que le modèle d’intelligence artificielle évalué atteindra de 70 à 80% de précision des comportements d’autostimulation et des comportements de jeu sélectionnés. Ce premier pas vers la création d’un outil de collecte d'informations des comportements d'autostimulation et des comportements de jeu en milieu naturel améliora l'efficacité et l'efficience des interventions chez les cliniciens œuvrant auprès d’une clientèle autiste.
-
Communication par affiche
Un programme de formation parentale offert en télépratique : qu’en pensent les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme.Angélique Blier (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Jacinthe Bourassa (IU DI-TSA, CIUSSS MCQ), Suzie McKinnon (CIUSSS SLSJ, CISSS BSL et CISSS Côte-Nord), Marie-Hélène Poulin (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue), Myriam Rousseau (IU DI-TSA, CIUSSS MCQ)
Des programmes de formation parentale destinés aux parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme sont disponibles au Québec. La majorité d’entre eux sont offerts en présentiel, ce qui peut présenter une limitation pour certains parents. Par ailleurs, le contexte sanitaire associé à la pandémie vécue dans les dernières années a mis en évidence que les besoins de soutien et d’apprentissage persistent, pouvant également s’accentuer pour certains. En ce sens, la mise en place de la télépratique représente une alternative à la prestation de services traditionnels. Ainsi, un guide complémentaire du programme L’ABC du comportement des enfants ayant un TSA: des parents en action! (Ilg et al, 2016) a été développé pour l’adaptation en télépratique. L’ajout de cette modalité à celles de groupe, individuelle et en ligne permet de varier les modalités de dispensation et de faciliter l’accès malgré certaines contraintes pouvant être vécues par les parents. Reposant sur un devis qualitatif, l’objectif de la présentation est de décrire l'expérience des parents (22F et 7H). Une analyse thématique des propos des parents rencontrés a été réalisée en utilisant la procédure en six étapes de Braun et Clarke. Les résultats montrent que la télépratique est facile d’accès, facilite la conciliation travail-famille en plus de permettre le partage et le soutien. Offrir une formation dans une variété de modalités est cohérent avec la variété des besoins et des réalités des parents.
-
Communication par affiche
Étude de l’adaptation du programme Dé-stresse et progresse© pour les parents d’enfant à profil multiproblématique complexe.Edith Dubé (UQO - Université du Québec en Outaouais), Stéphanie-M. Fecteau (Université du Québec en Outaouais)
Plusieurs études rapportent que les parents d’enfants ayant un trouble neurodéveloppemental, dont les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle, rencontrent de hauts niveaux de stress. Le CIUSSS MCQ a adapté le programme Dé-stresse et progresse© pour les parents d’enfant à profil multiproblématique complexe admis à leur unité de réadaptation intensive. Les adaptations comprennent trois ateliers d’une durée de deux heures et offerts une fois aux deux semaines. Les ateliers sont aussi offerts aux intervenant.e.s de l’unité afin que les principaux acteurs entourant l’enfant réfèrent aux mêmes concepts. La présente étude consiste à explorer les effets potentiels des ateliers sur la perception du stress des parents et des intervenant.e.s. Nous avançons que plus les parents sont habiles à reconnaître les signes de stress et les facteurs de stress vécus par leur enfant, plus ils.elles emploient des stratégies saines et adaptées pour réduire leur stress. Le protocole de recherche sera présenté puisque le recrutement est en cours. Selon un devis quasi-expérimental, nous évaluerons la perception du stress chez les participant.e.s par des questionnaires et une mesure physiologique, soit un échantillon capillaire. Les stratégies d’adaptation employées ainsi que le sentiment de compétence seront aussi à l’étude.
-
Communication par affiche
Grandir avec un frère ayant un trouble du développement et des troubles graves du comportement : le récit d’une sœur.Alison Paradis (Université du Québec à Montréal), Mélina Rivard (Université du Québec à Montréal), Corinne Rochefort (UQAM - Université du Québec à Montréal), Carlos Sanchez-Meza (Université du Québec à Montréal)
Grandir avec un frère ou une sœur ayant un trouble du développement (TD) et des troubles graves du comportement (TGC) peut présenter des aspects positifs, mais aussi plusieurs défis. Un précédent examen de la portée des écrits (Rochefort et al., soumis) a mis en lumière que le contexte dans lequel grandissent les fratries de ces enfants ayant un TD et des TGC présente plusieurs similarités avec celui décrit par la théorie de l’exposition au trauma à l’enfance (Herman, 1992). Ce même examen de la portée a également relevé plusieurs symptômes concordant à ceux décrits par cette théorie chez les fratries. Toutefois, bien que des éléments en lien avec la théorie du trauma aient été relevés par les études, aucune d’entre elles n’a exploré l’expérience de ces fratries en utilisant cette théorie comme cadre de référence. Suite à l’examen de la portée des écrits, une deuxième étude a été entamée afin d’explorer plus largement leur expérience. Pour ce faire, des frères et sœurs d’enfant ayant un TD et des TGC sont invités à répondre à une batterie de huit questionnaires ainsi qu’à participer à deux entretiens semi-structurés. La présente affiche vise à présenter les résultats préliminaires de cette deuxième étude en détaillant le cas d’une de ces personnes. Ceux-ci relateront des événements du contexte familial actuel et passé en plus de mettre de l’avant les conséquences (positives et négatives) ainsi que les facteurs discriminants (facilitateurs et obstacles) de son expérience.
-
Communication par affiche
Présentation d’une grille d’observation directe des comportements sociaux chez l’enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)Nadia Abouzeid (Université du Québec à Montréal), Mélina Boulé (Université du Québec à Montréal), Jacques Forget (Université du Québec à Montréal), Claudia Guay (UQAM - Université du Québec à Montréal)
L’observation directe des comportements est une méthode permettant d’obtenir des informations précises et objectives sur les comportements sociaux (CS) des enfants qui présentent un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il a été démontré que les CS de l’enfant ayant un TSA peuvent augmenter en présence d’un chien d’assistance. Cependant, peu de chercheurs ont évalué directement les effets du chien d’assistance sur le développement de ceux-ci. Dans ce contexte, les objectifs de cette communication affichée sont de 1) documenter le développement d’une grille d’observation des CS chez l’enfant ayant un TSA 2) présenter l’application de cette grille. Le développement de la grille a été inspiré de la méthode de Boateng et ses collègues (2018). D’abord, les items ont été déterminés à partir d’une recension des écrits. Ensuite, la grille a été révisée par trois experts. Puis, plusieurs modifications ont été réalisées afin d’obtenir une version prête à être expérimentée. La grille finale permet l’observation de 26 CS décrits de façon opérationnelle. Les résultats montrent que la grille a permis de colliger 4732 unités d’observations. En outre, les comportements de 14 catégories ont été manifestés moins de 3 % du temps. Les données de cette étude mènent à des modifications qui permettraient d’appliquer cette grille à divers contextes. Cette grille pourrait aussi être utilisée dans le cas d'enfants présentant d'autres problématiques neurodéveloppementaux.
-
Communication par affiche
Profils des enfants évalués pour un trouble du spectre de l’autisme selon le M-CHAT-R et le Rapid Interactive Screening Test for Autism in Toddlers (RITA-T) et l'ADOS.Nadia Abouzeid (IU DI-TSA CIUSSS MCQ et Université du Québec à Montréal), Jacinthe Bourassa (IU DI-TSA CIUSSS MCQ), Andrée-Anne Lachapelle (Université de Montréal), Noémie Plante (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Myriam Rousseau (IU DI-TSA CIUSSS MCQ)
Le diagnostic précoce des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) permet à ces derniers de bénéficier notamment d’interventions précoces permettant de maximiser leur développement et réduire les effets de leurs difficultés sur leur fonctionnement. Toutefois, il existe des enjeux au niveau des délais d’attente en ce qui concerne l’évaluation diagnostique, ce qui ralentit considérablement le processus. Afin de diminuer ces délais, l’outil de dépistage ciblé, le test Rapid Interactive Screening Test for Autism in Toddlers (RITA-T) a été introduit dans la trajectoire d’évaluation diagnostique. Cet outil, bref et interactif, a été développé pour dépister la présence du niveau de risque du TSA chez les jeunes enfants. L’objectif de cette affiche est de présenter le profil des enfants évalués pour un TSA. L’échantillon est composé de 31 enfants (22 garçons et 9 filles) recevant des services d’un CIUSSS. Ils sont âgés de 27 à 47 mois au moment de la passation du RITA-T. Ils ont été évalués à l’aide de l’anamnèse, le M-CHAT-R, le RITA-T et l'ADOS-2. Cette présentation contribue à une meilleure connaissance des profils d’enfants évalués pour un TSA à l’aide de l’outil de dépistage interactif, le RITA-T.
-
Communication par affiche
Dis-moi ce qui te stress, et nous en ferons une réalité virtuelle : la photo-élicitation comme méthode d’entretien auprès de la clientèle autisteStéphanie-M. Fecteau (Université du Québec en Outaouais), Laurence Fournier (UQO - Université du Québec en Outaouais)
Il est prouvé que le vécu d'un stress répété et prolongé, aussi appelé stress chronique, accroit la vulnérabilité à diverses pathologies physiques et psychologiques. Compte tenu de leur statut social minoritaire et de leurs caractéristiques pouvant engendrer une régulation émotionnelle inadéquate, la clientèle autiste est vulnérable au vécu de stress chronique. Ainsi, le projet actuel découle de l’adaptation du programme Déstresse et progresse© destinée aux élèves autistes du secondaire et vise à remédier aux lacunes d’application et de généralisation des acquis soulevés par les participants. L’objectif est d’élaborer un environnement et scénario de réalité virtuelle (RV) qui sera intégré au programme Déstresse et progresse© en tant qu’exercice pratique accompagné. La RV fût sélectionnée comme solution potentielle grâce à l’aspect sécuritaire, au potentiel clinique auprès de la clientèle autiste et à l’intervention basée sur les intérêts. La présentation fera état de notre niveau de progression dans le projet. Les résultats préliminaires des entrevues semi-dirigées par voie de photo-élicitation seront présentés, ainsi que la pertinence et les avantages de cette méthode d’entretien auprès de la clientèle autiste, soit son aspect concret, son caractère auto-rapporté et la stimulation de la mémoire qu’engendre un support visuel.
-
Communication par affiche
Évaluation d'un outil d’analyse et d’intervention en contexte de trouble du comportement chez la clientèle autiste ou présentant une déficience intellectuelle.Nadia Abouzeid (UQAM - Université du Québec à Montréal), Anne-Édith Dumais-Buist (CIUSSS MCQ), Louis-Simon Maltais (IU DITSA, CIUSSS MCQ), Julie McIntyre (Université de Montréal), Noémie Michel (CIUSSS MCQ), Priscilla Ménard (IU DITSA, CIUSSS MCQ), Josianne Parent (Université du Québec à Trois-Rivières), Marianne Paul (Université du Québec à Trois-Rivières)
La déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l’autisme sont des troubles développementaux dont les manifestations peuvent être variées. Ces spécificités doivent être évaluées lors d’une prise en charge clinique individualisée, adaptée et flexible, visant à réduire les impacts fonctionnels et à promouvoir leur développement et leur participation sociale. Dans les établissements du réseau public de la santé et des services sociaux, les orthophonistes sont souvent impliquées dans le travail d’équipe interdisciplinaire pour intervenir auprès de cette clientèle. Par contre, il existe encore peu d’outil pour soutenir l’individualisation de leurs services. C’est pourquoi un outil d’aide à la réflexion clinique a été développé par et pour les orthophonistes pour les soutenir dans leur pratique clinique. L’objectif est d’évaluer la validité de contenu de l’outil. Six orthophonistes ont participé à cette étude. Leurs perceptions ont été recueillies par le biais d’un questionnaire. Des analyses quantitatives et qualitatives ont été réalisées. Les résultats indiquent que les orthophonistes apprécient l’outil dans sa forme globale. Des commentaires et suggestions ont été formulés entrainant des modifications mineures à l’outil. Cette première étape de validation de l’outil démontre sa pertinence pour soutenir la pratique des orthophonistes. Il s’avère judicieux de poursuivre l’évaluation afin de l’implanter et d’en faire bénéficier les cliniciens et les usagers du réseau.
-
Communication par affiche
Profils des parents d’enfants de moins de 8 ans inscrits au programme L’ABC du comportement d’enfants ayant un TSA : des parents en action ! version en ligne.Jacinthe Bourassa (IU DI-TSA, CIUSSS MCQ), Suzie McKinnon (CIUSSS SLSJ, CISSS BSL et CISSS Côte-Nord), Mathieu Mireault (HEC Montréal), Myriam Rousseau (IU DI-TSA, CIUSSS MCQ)
L’importance de former les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) est reconnue. L’ABC du comportement d’enfants ayant un TSA : des parents en action ! (L’ABC-TSA) en ligne est un programme de formation destiné à ces parents. Il permet à ces derniers de développer leurs compétences et connaissances spécifiques aux besoins de leurs enfants. L’objectif de la présentation est de décrire le profil des parents qui se sont inscrits à la formation L’ABC- TSA en ligne. L’échantillon est composé de 140 parents d’enfants ayant un TSA âgés de moins de 8 ans (117 garçons et 23 filles). Les données sociodémographiques de ces parents et de leurs enfants, celles sur les connaissances en TSA des parents, leur sentiment de compétences parentales ainsi que celles sur les comportements défis et comportements adaptatifs des enfants sont analysées. Les résultats permettent de mieux connaitre le profil des parents d’enfants ayant un TSA inscrits au programme. Il est souhaité qu’une meilleure connaissance de leur profil permettra aux intervenants du milieu de la santé et des services sociaux d’identifier les parents pour lesquels le programme pourrait être intéressant.