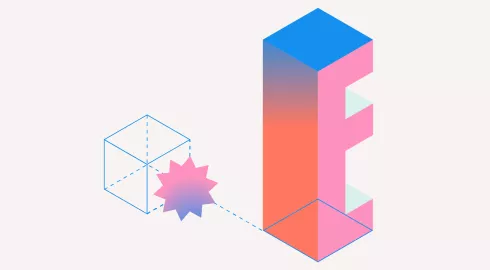J’ai toujours considéré mon parcours universitaire et mon engagement social comme étant inextricablement liés. Je m’inscris en effet pleinement dans la tradition aristotélicienne qui conçoit tout être humain comme un animal politique (zoon politikon) qui ne peut accomplir sa nature qu’en prenant part aux affaires de la Cité.

Du militantisme politique et syndical
À partir de la fin des années 2000, au moment où la dernière grande crise financière éclatait, cet engagement s’est traduit par un militantisme politique et syndical contre les politiques d’austérité néolibérales. Dans la même période, je m’intéressais aux thèses de l’écologie politique, notamment celles du courant de la décroissance, qui venait alors de prendre de l’ampleur et de se structurer en France. Il y avait cependant déjà une contradiction assez évidente entre les appels à une relance économique juste et solidaire, et le constat que la crise écologique planétaire nécessitait une réduction massive de la production.
Il faut enfin noter, pour mémoire, que les théories de l’effondrement gagnaient déjà en popularité à l’époque – seul le terme « collapsologie » n’était encore pas à la mode. Jamais je ne prétendrai avoir alors été un militant exemplaire, qui aurait usé tout de son temps libre en réunions et en actions sur le terrain. Étant préoccupé de longue date par l’intuition que ce modèle d’action était devenu ineffectif, j’en suis essentiellement resté au rôle d’un observateur donnant un coup de main ici et là, pour telle ou telle cause.
D'un doctorat autour de la critique radicale de la civilisation industrielle
Me détachant peu à peu de la vie militante, je me suis alors concentré sur mes projets intellectuels, ma thèse de doctorat en premier lieu. Cette dernière est une étude de ce que je nomme la critique radicale de la civilisation industrielle, qui prend ses racines dans les contestations initiales des intellectuels et des artistes romantiques contre la première révolution industrielle, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. Cette civilisation est une organisation sociale fondée sur l’extraction, la production et la consommation de manière toujours plus intensive – c’est le sens d’industria en latin – de matière, d’énergie, de travail humain et d’objets techniques. Au fil des siècles s’est constitué un système technicien, une mégamachine, incroyablement complexe, et qui s’est de nos jours substitué à la nature pour devenir le milieu où vit, ou survit, la majeure partie de l’humanité. Seule une petite poignée d’intellectuels a entrepris, au XXe siècle, chacun de son côté, le travail d’édifier une théorie critique de cette organisation sociotechnique; parmi eux, j’ai retenu Lewis Mumford (1895-1990), Günther Anders (1902-1992), Jacques Ellul (1912-1994) et Ivan Illich (1926-2002).
Mon objectif sur le plan intellectuel est de tirer des leçons de leur réflexions, qui sont très souvent convergentes malgré leurs parcours biographiques fort différents et leur adhésion personnelle à telle philosophie ou telle confession religieuse. (Ce travail de thèse est bien sûr également un projet scientifique, soulevant des enjeux pour la histoire et la sociologie des idées, mais ce n’est pas ici mon objet.)
De l'engagement dans le milieu associatif environnementaliste québécois
Au fur et à mesure que j’avançais dans mes lectures, je me suis, en parallèle, de nouveau engagé, cette fois-ci dans le milieu associatif environnementaliste de Québec, et plus spécifiquement sur les questions de la décroissance. Conservant mon habituelle posture d’observateur, j’ai été vite frappé par le décalage entre le récent regain d’activité militante, en particulier dans la jeunesse, et l’absence de perspectives politiques cohérentes. J’ai alors mis à plat quelques-unes mes impressions dans un article pour la revue Relations, dans le cadre du concours « Jeunes voix engagées ». L’année qui s’est depuis écoulée n’a fait que renforcer mes constats, qui sont précisément ceux des intellectuels que j’étudie. Nous sommes, depuis quelques décennies déjà, entrés dans le « temps de la fin » (Anders), l’ère de « l’homme post-historique » (Mumford) et de « l’illusion politique » (Ellul); notre « société hyperindustrielle, électronique et cybernétique » se précipite vraisemblablement en direction d’un « holocauste écologique » (Illich). Pour autant, le danger à moyen terme est moins celui d’un effondrement total de la biosphère que d’un raidissement autoritaire, si ce n’est totalitaire, de nos institutions politiques, au nom de la survie de l’humanité.
La seule voie de sortie réaliste serait un regrès technologique et économique des sociétés dites développées du Nord; un regrès démocratiquement planifié, et impérativement accompagné de progrès moraux, intellectuels et sociaux. C’est une voie étroite, qui nécessite présentement à la fois de rejeter un certain ultra-pessimisme (qui conduit généralement au repli sur soi et sur les loisirs électroniques), ainsi que le culte de l’action pour l’action du militantisme contemporain. Dans ces conditions, notre mission spécifique comme chercheurs et chercheuses reste, encore et toujours, de maintenir notre esprit critique, et de préserver l’autonomie du champ scientifique, celle-ci étant ces derniers temps fort malmenée par divers intérêts externes.
...notre mission spécifique comme chercheurs et chercheuses reste, encore et toujours, de maintenir notre esprit critique, et de préserver l’autonomie du champ scientifique, celle-ci étant ces derniers temps fort malmenée par divers intérêts externes.
- Simon Chaunu
Université Laval
Détenteur d'un diplôme de l'Institut d’Études Politiques de Toulouse et d'un Master 2 de recherche en sociologie de l'Université Paris-Ouest-Nanterre, Simon Chaunu est doctorant en sociologie à l'Université Laval. Sa thèse porte sur la critique radicale de la civilisation industrielle au XXe siècle, et s'inscrit ainsi dans son intérêt plus large pour l'histoire des idées et la sociologie des intellectuels.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre