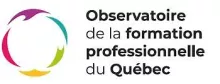Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 500 - Éducation
Description :Le secteur de la formation professionnelle est marqué par la diversité sociale et scolaire des élèves (âge, origines sociales et économiques, parcours scolaires antérieurs, expériences de vie et de travail, etc.) (Beaucher et al., 2021). La non-linéarité des parcours et la pluridimensionnalité de l’expérience en formation professionnelle sont souvent la norme (Coulombe et al., 2019; Mazalon et Bourdon, 2015; Molgat et al., 2014). Afin de favoriser l’accompagnement de ces élèves, il est impératif de bien les connaître, y compris leur parcours et la façon dont ils apprennent. Cette meilleure compréhension permet d’adapter les mécanismes, les conditions d’apprentissage professionnel et les contextes d’études à leurs besoins.
Les parcours d’apprentissage sont compris comme les processus liés au développement identitaire des personnes (Bourgeois, 2009) et concernent tant les apprentissages informels acquis dans les tâches et les interactions quotidiennes que les apprentissages formels faits à même des programmes de formation (Alheit et Dausien, 2005). L’apprentissage est donc conçu « en tant que (trans)formation d’expériences, de savoirs et de structures d’action dans l’inscription historique et sociale des mondes-de-vie individuels » (Alheit et Dausien, 2005, p. 11), les mondes-de-vie faisant référence aux différentes sphères de vie (ex. : famille, école, loisirs). Ces parcours s’étendent donc tout au long et au large de la vie, représentant la situation de plusieurs élèves de la formation professionnelle. Ils ne sont pas le produit unique de choix rationnels, mais sont influencés par l’origine sociale des personnes, ses représentations sociales, son réseau et ses relations, de même que par les contraintes institutionnelles et situationnelles (Bloomer et Hodkinson, 2000; Supeno et al., 2022). Ainsi, l’étude des parcours des élèves de la formation professionnelle permet de mieux cerner leur réalité et leurs besoins dans une perspective de mieux y répondre. Ce faisant, les apprentissages de ces derniers s’en trouveront bonifiés. Puisque les apprentissages professionnels sont marqués par des logiques de développement de compétences chez l’adulte et d’insertion régies par le marché du travail (Billett, 2001; Pastré, 2011), l’ensemble des sphères de vie sont susceptibles d’influencer la formation et la qualification des élèves de la formation professionnelle, dont le support du réseau social de l’élève lors d’une transition scolaire (Germain et Marcotte, 2019; Cournoyer et Bourdon, 2012), notamment lorsqu’il a des difficultés d’apprentissage (Lombardi et al., 2016; Rahat et Ilhan, 2016).
Ce colloque souhaite contribuer à l’enrichissement des connaissances quant aux élèves de la formation professionnelle par la création d’un espace de partage entre personnes chercheuses, étudiantes et praticiennes, et ce, à partir de l’axe des parcours et des apprentissages.
Remerciements :L'équipe du colloque remercie le Centre d'études et de recherches sur les transitions et l'apprentissage (CERTA) pour son soutien financier dans l'organisation de cette activité scientifique.
Dates :Format : Sur place et en ligne
Responsables : Partenaires :Programme
Session 1
-
Communication orale
Caractéristiques et parcours d’élèves de formation professionnelle recrutés à l’étrangerChantale Beaucher (UdeS - Université de Sherbrooke), Pierre Bégin (Éducation internationale), Claudia Gagnon (Université de Sherbrooke), Andrea Gisele Mongelos Toledo (Université de Sherbrooke)
Les élèves de formation professionnelle (FP) constituent une population particulière dans la constellation des apprenants québécois. La forte hétérogénéité des âges, origines socio-économiques, des parcours scolaires, des parcours personnels et professionnels, des motivations, est de mieux en mieux documentée (Beaucher et al, 2021; Gagnon et al., 2023). À mesure que progresse la connaissance des caractéristiques et des parcours de ces élèves se dessinent les contours de certains agrégats d’effectifs. Les élèves internationaux en font partie, et plus précisément, les élèves recrutés à l’étranger pour venir au Québec réaliser un programme de FP. Ce sont notamment des considérations économiques liées la pénurie de main-d’œuvre (Institut du Québec, 2022; Gouvernement du Québec, 2022) qui motivent ce recrutement. Une étude de Gagnon et al, (2023) a brossé un portrait statistique des élèves de FP (N = 15 021) de laquelle ont été tirées des données sur ces élèves recrutés à l’étranger (n = 722). Cette communication présente les caractéristiques de ces personnes selon notamment le pays d’origine, le genre, l’âge, le parcours scolaire, le choix de programme. La visée de l’analyse est de mieux connaître ce groupe et de répondre plus adéquatement à leurs besoins. Ces connaissances sont nécessaires puisque leur nombre (de même que celui des élèves internationaux en général) est susceptible d’augmenter au fil des ans.
-
Communication orale
Portrait des élèves anglophones en formation professionnelleNolan Bazinet (UdeS - Université de Sherbrooke), Sébastien Beauséjour (Université de Sherbrooke), Claudia Gagnon (Université de Sherbrooke), Lauren Stark (UdeS - Université de Sherbrooke)
Parce qu’elle vise à former la main-d’oeuvre québécoise, la formation professionnelle (FP) au secondaire joue un rôle clé au sein du système d’éducation, et contribue à l’atteinte de la mission de l’école québécoise d’instruire, de socialiser et de qualifier (Gouvernement du Québec, 2020). Au Québec, plus de 120 000 élèves âgés de 16 ans et plus poursuivent chaque année une FP dans un des 21 secteurs économiques (Banque de données des statistiques officielles sur le Québec [BDSO], 2022a). Malgré une clientèle étudiante fortement hétérogène, encore peu d’études décrivent les caractéristiques des élèves de la FP au Québec (Beaucher et al., 2021; Gagnon et Beaucher, 2016). Encore moins se sont intéressées de façon plus spécifique aux élèves inscrits dans les centres de formation professionnelle anglophones. Dans le cadre de l’enquête nationale auprès des élèves de FP (Gagnon et al., 2022), plus de deux milles participants étaient inscrits dans un centre de formation professionnelle anglophone. Cette communication dresse un portrait de leurs caractéristiques démographiques et de leur parcours de formation avant d’entrer en FP et au cours de leur formation professionnelle. Les résultats mettent en lumière le fait que l’anglais n’est pas la langue première pour bon nombre de ces élèves et révèlent certaines difficultés pouvant nuire à leur réussite.
-
Communication orale
Finir son secondaire tout en apprenant un métier : les élèves inscrits dans un programme de concomitance FG-FPStéphanie Breton (UdeS - Université de Sherbrooke), Patricia Dionne (Université de Sherbrooke), Claudia Gagnon (Université de Sherbrooke), Thomas Rajotte (Université du Québec à Rimouski)
La formation professionnelle (FP) est un moyen reconnu pour pallier le manque de main-d’œuvre et est considérée comme un levier pour la justice sociale. Le dispositif de formation qu’est la concomitance de la FP et de la formation générale (FG-FP) vise à augmenter la fréquentation à la FP des jeunes de moins de 20 ans. Des élèves du secondaire peuvent entreprendre des études en FP et poursuivre ces deux formations jusqu’à la double diplomation. S’inscrivant dans une perspective d’apprentissage tout au long et tout au large de la vie, cette étude explore les caractéristiques d’élèves inscrits en concomitance FG-FP sous l’angle des parcours d’apprentissage. Dans le cadre d’une enquête auprès des élèves de FP (Gagnon et al., 2022), ce sont plus de 700 élèves qui étaient inscrits en concomitance avec la FG. Les analyses quantitatives univariées suggèrent qu’ils ont un cheminement distinct des autres élèves de la FP du même âge (20 ans et moins). Tant leur parcours d’apprentissage antérieur que leur parcours actuel indiquent des difficultés persistantes, sans toutefois que ces obstacles soient associés à un risque plus élevé de détresse psychologique. D’ailleurs, les élèves sondés inscrits en concomitance disent avoir reçu plus d’encouragement de la part de leurs enseignants et de leur entourage. Ainsi, cette étude des parcours d’apprentissage des élèves inscrits en concomitance FG-FP révèle des besoins d’accompagnement et de soutien qui diffèrent des autres élèves de la FP.
-
Communication orale
Caractéristiques et parcours des élèves inscrits en formation professionnelle en alternance : quelles spécificités par rapport aux autres élèves de la FP?Stéphanie Breton (Université de Sherbrooke), Yves Chochard (Université du Québec à Montréal), Annie Dubeau (Université du Québec à Montréal), Claudia Gagnon (UdeS - Université de Sherbrooke)
Dans cette « ère du plein emploi », la formation professionnelle (FP) joue un rôle essentiel de qualification de la main-d’oeuvre au regard des enjeux concernant l’avenir économique du Québec. Alors que les écrits montrent que les stages favorisent une intégration en emploi des jeunes (Savoie-Zajc et al., 2010), améliorent « leurs compétences techniques […] et génériques au niveau social et émotionnel (attitudes, comportements) » (RQUoDE, 2016, p. 16), en plus d’augmenter « leur motivation à acquérir certaines compétences et connaissances » (ibid, p. 43), le gouvernement du Québec valorise les parcours de formation en alternance travail-études (ATE) en FP en vue d’offrir des programmes mieux arrimés aux emplois ciblés et de favoriser la rétention des élèves jusqu’à l’obtention du diplôme (MEES, 2019). Dans le cadre d’une enquête nationale auprès des élèves en FP (N = 15 021) (Gagnon et al., 2022), près de 1000 élèves étaient inscrits dans un programme en ATE et plus de 200 en ATE accrue ou Programme d’apprentissages accrus en milieu de travail (PAAMT). Cette communication vise à dresser un portrait des élèves inscrits dans un programme en alternance et à identifier des spécificités par rapport aux autres élèves de la FP. Elle permettra également de montrer les distinctions entre les trois groupes d’élèves (ATE, PAAMT et les autres) en ce qui a trait à leurs parcours d’apprentissage antérieur et actuel, leurs motifs d’inscription et leur motivation.
Dîner libre
Session 2
-
Communication orale
L’effet de la détresse psychologique sur la qualité de la relation enseignant-élève chez les élèves autochtones et LGBTQ+ en formation professionnelle au QuébecSébastien Beauséjour (Université de Sherbrooke), Freddy Franco Molares (Université de Saint-Boniface), Claudia Gagnon (Université de Sherbrooke)
La qualité de la relation enseignant-élève (REÉ) des élèves issus des diversités est peu étudiée au niveau secondaire (Franco Morales, 2021) et presque inexistante au secteur de la formation professionnelle (FP) où la diversité des élèves pourrait représenter un défi pour les personnes enseignantes (Beaucher et al., 2021). Étant donné qu’une REÉ positive pourrait servir comme facteur de protection pour les élèves à risque (Fallu et Jasnoz, 2003), dont les élèves issus de minorités, cette communication vise à examiner la relation entre la détresse psychologique et la qualité de la REÉ signalaient par les élèves autochtones et LGBTQ+ dans le cadre d’une enquête nationale auprès d’élèves en FP (Gagnon et al., 2023). Les résultats Anova montrent une différence significative (F(3,540)=8,74; p=0,001) entre les élèves disant avoir une bonne REÉ (Profil 1) (x=8,75; é.t.=4,9) et les élèves disant avoir une REÉ assez bonne (Profil 2) (x=10,7; é.t.=5,7) et les élèves disant avoir une REÉ plus ou moins bonne (Profil 3) (x=12,75; é.t.=3,9). Plus spécifiquement, le taux de détresse psychologique des élèves des profils 2 et 3 est plus élevé que celui des élèves du profil 1. À partir de ces résultats, il est possible d’identifier des stratégies pour les personnes enseignantes afin d’améliorer la qualité de la REÉ avec leurs élèves autochtones et LGBTQ+.
-
Communication orale
Nanitameueiau. Parcours d’élèves issus des Premières Nations en formation professionnelle : histoire, valeurs et cultureAndréanne Gagné (Université de Sherbrooke), Jo Anni Joncas (Université de Sherbrooke), Jessie Lepage (UdeS - Université de Sherbrooke)
D’après le recensement de 2021, 75 % des Autochtones ont un diplôme inférieur au baccalauréat, dont 22,4 % ont un diplôme d'apprenti ou d'école de métiers. La formation professionnelle (FP), populaire chez ces derniers, pourrait être un levier pour leur réussite (Joncas et al., 2022 ; Dougherty et Harbaugh Macdonald, 2020), mais les études spécifiques sur le parcours des Autochtones en FP manquent. Ce projet se concentre donc sur le parcours de vie (Picard et al., 2020) des élèves Autochtones en FP.
Cette communication présentera une recherche qualitative, menée selon une approche interprétative qui a pour objectifs de 1) décrire les différents parcours de vie des élèves autochtones ayant suivi une FP délocalisée en communauté autochtone (FPDCA) et de 2) documenter l’apport d’une FPDCA dans leur parcours de vie. Les modèles de Mannigham et al. (2011), qui intègre les aspects historiques des Autochtones, et celui de Loiselle (2009) qui inclus la temporalité et les 4 dimensions chez ceux-ci apparaissent pertinents pour le cadre de cette recherche.
Les données sont recueillies auprès d'élèves autochtones, provenant de milieux anglophones et francophones, et appartenant à deux nations distinctes : les Innus de Mashteuiatsh et les Mi'gmaq de Listiguj. Pour respecter la tradition orale des Autochtones, des entretiens semi-dirigés sont menés, utilisant à la fois des entrevues individuelles et des cercles de partage (Lathoud, 2016).
-
Communication orale
Analyse de la relation enseignant-élève en formation professionnelle : Perceptions des élèves sur la qualité de la relation, le respect et le soutien des enseignants.Sébastien Beauséjour (UdeS - Université de Sherbrooke), Freddy Franco Morales (Université de Saint-Boniface), Claudia Gagnon (Université de Sherbrooke)
Le nouveau référentiel des compétences professionnelles des enseignants souligne l'importance centrale de la relation enseignant-élève dans le métier (Ministère de l’Éducation, 2020). Une connexion positive avec les élèves constituerait un moyen d'améliorer les résultats scolaires et de réduire le risque de décrochage chez ceux considérés à risque (Meunier, s. d.).
En effet, les recherches en éducation (Fortin, Plante et Bradley, 2011; Hattie, 2009, 2012) soulignent que les enseignants exercent une influence significative sur la qualité des apprentissages et la réussite des élèves. Cependant, dans le contexte de la formation professionnelle (FP), le développement de cette relation peut représenter un défi en raison de la diversité des profils d'élèves au sein des groupes classes (Beaucher et al., 2021).
Cette communication vise à examiner le niveau de satisfaction des élèves concernant la qualité de cette relation en formation professionnelle, ainsi que ses répercussions. Dans le cadre d’une enquête nationale auprès d’élèves de formation professionnelle dans différents secteurs de formation (N = 15 021) (Gagnon et al., 2023), l'utilisation d’une échelle ordinale (4 points) a permis d'évaluer certains critères de leur perception de la relation générale avec leurs enseignants.
Les résultats mettent en avant le niveau de qualité de la relation, le sentiment de respect et le soutien perçu des enseignants, des facteurs qui pourraient contribuer à la réussite scolaire des élèves.
-
Communication orale
Soutien à l’autonomie des élèves et pratiques d’enseignement en formation professionnelleMylène Beaulieu (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Compte tenu du contexte particulier d’enseignement en FP, la mise en œuvre de pratiques d’enseignement repose sur des facteurs qui se distinguent des autres ordres d’enseignement. Parmi ceux-ci, on retrouve les caractéristiques des élèves de la FP. Ainsi, la FP requiert que des modèles théoriques soient adaptés à la réalité de cet ordre d’enseignement afin d’offrir des conditions d’apprentissage qui répondent aux besoins de ses élèves. Cette communication s’inscrit dans un projet plus large qui vise l’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif qui vise à soutenir le développement des compétences des enseignants à la formation professionnelle (FP) lors de situations d’enseignement et d’apprentissage. À la suite de l’analyse et l’observation de séquences d’enseignement en FP, des résultats sous-jacents à cette étude seront présentés. Il ressort que les pratiques d’enseignement qui répondent au mieux aux besoins d’apprentissage des élèves de FP requièrent un soutien à l’autonomie prédominant. Il va de soi que les résultats seront susceptibles d’avoir des retombées directes sur les pratiques d’enseignement en FP et procurera un apport important quant à la compréhension du processus d’apprentissage des élèves de FP.
Table ronde
Session 3
-
Communication orale
Conférence d'ouvertureStéphanie Breton (Université de Sherbrooke), Rachel Bélisle, Jo Anni Joncas (Université de Sherbrooke)
-
Communication orale
Appropriation des écrits de métier dans le parcours d’apprentissage d’adultes en formation professionnelleRachel Bélisle (Université de Sherbrooke), Isabelle Rioux (UdeS - Université de Sherbrooke)
Au Québec, la population de la formation professionnelle (FP) est hétérogène (Beaucher et al., 2021). Nous nous intéressons aux adultes n‘ayant pas de premier diplôme lorsqu’ils s’inscrivent en FP (Rioux et Bélisle, 2022), car l’engagement et la réussite dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles sont généralement garants de meilleures conditions de vie. Cependant, ces adultes peuvent rencontrer des défis particuliers du fait d’expériences scolaires antérieures parfois difficiles (Bélisle et Bourdon, 2015) ou en matière de littératie (OCDE, 2016). Dans une volonté de justice sociale, nous portons attention à leurs expériences issues des autres sphères de vie (domestique, professionnelle, loisirs), et aux apprentissages qui en découlent (Ivanic et al. 2009) et qui peuvent influencer et jouer un rôle de levier dans le parcours d’apprentissage qui se poursuit en FP. La communication s’appuie sur un travail doctoral par observation de situations d’utilisation d’écrits de métier par des adultes en FP. Les résultats exposés mettront l’accent sur des traces du rôle joué par les expériences antérieures d’adultes sans premier diplôme dans leur appropriation des écrits de métier et de certaines de leurs attitudes vis-à-vis de l’écrit et de l’apprentissage, en bonne partie teintées par ces expériences. Des pistes de réflexion seront dégagées concernant la prise en considération des expériences antérieures dans l’enseignement-apprentissage en FP.
-
Communication orale
Parcours en reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle (RAC-FP) : entre reconnaissance et apprentissage dans des activités de formationRachel Bélisle (Université de Sherbrooke), Sabruna Dorceus (Université de Sherbrooke), Evelyne Mottais (UdeS - Université de Sherbrooke)
Un mouvement international promeut les dispositifs de reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel comme un moyen de contribuer à la justice sociale s (ex. : UNESCO, 2012). Il soutient notamment que ces dispositifs permettraient de réduire la durée d’un parcours jusqu’au diplôme (ex. : Werquin, 2010) et ainsi faciliter l’accès à ce dernier chez des populations jusqu’alors défavorisées. En s’appuyant sur les étapes de la démarche québécoise de reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle (RAC-FP) (CERAC-FP, 2020) et l’approche par les capabilités de Sen (2010), cette communication présente des résultats d’une étude doctorale sur des profils de parcours selon la durée des séquences dans une démarche RAC-FP selon une perspective de justice sociale. Une analyse de profils latents au sein d’un échantillon de 502 personnes candidates diplômées par voie de la RAC-FP permet de dégager trois profils dont l’appartenance est associée à trois facteurs de conversion personnels (âge, sexe, statut face à immigration) et un relevant de l’organisation de la démarche (démarche en entreprise). La discussion porte sur l’intérêt de la RAC-FP pour des adultes expérimentés dans le domaine d’un programme de FP, dont ceux qui n’ont pas de premier diplôme, qui ont peu de temps à leur disposition et qui, sans ce dispositif, ne s’engageraient sans doute pas dans un processus d’apprentissage formel.
-
Communication orale
Reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle (RAC-FP) : caractéristiques de la clientèle et parcours.Marise Delisle (Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin), Liane Levasseur (Centre de services scolaire Harricana)
Les caractéristiques de la clientèle de la RAC-FP diffèrent de celles de la formation initiale, notamment par les apprentissages faits en contexte expérientiel plutôt qu’en contexte scolaire. Ainsi, une démarche individuelle, adaptée au parcours de vie, doit être mise en place pour chaque personne candidate. Les expertes-conseils en RAC-FP présenteront les défis d’adaptation que rencontrent les enseignant.es dans le rôle de spécialiste de contenu. Aussi, un portrait de l’importance de la RAC-FP en formation professionnelle sera dressé, à l’aide de statistiques.
-
Communication orale
Un modèle de formation délocalisée en communauté autochtone pour favoriser le parcours d’apprentissage d’élèves autochtones en formation professionnelleSylvain Bourdon (Université de Sherbrooke), Pauline Champagne (Université de Sherbrooke), Andréanne Gagné (Université de Sherbrooke), Xavier-Michel Grisé (Université de Sherbrooke), Jo-Anni Joncas (UdeS - Université de Sherbrooke), Jessie Lepage (Université de Sherbrooke), Tanu Lusignan (Conseil scolaire des Premières nations en éducation pour les adultes), Chantale Martin (PROCEDE)
Des études ont exposé le rôle favorable de la formation professionnelle (FP) tant pour l’insertion sociale qu’économique des personnes autochtones que pour leur bien-être (Bandias et al., 2014; Cameron et al., 2017; Ceric et al., 2022; Helme, 2007; Joncas et al., 2022). Elles indiquent notamment que, par sa nature axée sur la pratique, davantage ancrée dans le terrain et dans l’observation, la FP proposerait une méthode d’enseignement se rapprochant des méthodes d’apprentissage traditionnelles (Brigham et Taylor, 2006; Helme, 2005). De même, la FP constituerait un levier social pertinent en permettant aux diplômés de s’impliquer activement dans leur communauté et de répondre aux besoins immédiats en main d’œuvre (Brigham 2006; Cameron et al., 2017; Jorgensen 2020; Hamerton et Henare 2017; Helme, 2007). Les interventions qui s’avéreraient les plus prometteuses pour favoriser la réussite des élèves autochtones en FP seraient celles inscrites dans une approche décoloniale (Beaudry et Perry, 2020; Joncas et al., 2022). Cette communication présente un modèle de FP délocalisée en communauté autochtone qui s’inspire de cette approche. Pour documenter ce modèle, 23 gestionnaires et intervenants d’organisation autochtones et de centres de FP ont été rencontrés lors d’entretiens semi-dirigés. La mise en place d’un tel modèle partenarial apporterait un soutien important tout au long du parcours des élèves et soutiendrait l’épanouissement des communautés.
Dîner libre
Session 4
-
Communication orale
Vers l’autodétermination des Premiers Peuples en FP : récit d’expérience de l’autochtonisation du programme en Protection et exploitation de territoires fauniques.Sandra Coulombe (Université du Québec à Chicoutimi), Christine Couture (Université du Québec à Chicoutimi), Julie Rock (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
La présentation portera sur un modèle développé dans une recherche doctorale sur la formation professionnelle dans une perspective d’autodétermination (APN, 2020; CEPN, 2017; Fryer et al., 2021; ONU, 2007; Salé et al., 2020). Il présente l’exemple d’autochtonisation du programme (Gaudry et Lorenz, 2018; Lavoie et al., 2021) de formation de Protection et exploitation de territoires fauniques à partir d’un récit d’expérience en tant qu’ancienne directrice d’un Centre régional en éducation des adultes, à Uashat mak Mani-Utenam.
Cette expérience professionnelle, ayant été l’élément déclencheur pour entreprendre notre projet de recherche doctorale, nous a mené à la conception d’un modèle en arbre (Rock, Coulombe et Couture, 2023) réfléchi à partir de notre vision en tant que membre des Premiers Peuples. Il reprend également les caractéristiques proposées par Côté (2021) dans la synthèse relative à la mobilisation des perspectives autochtones en enseignement pour voir comment un programme peut être transformé en y intégrant notre vision holistique, nos savoirs, nos pédagogies et nos modèles d’apprentissage. Cette communication présentera ainsi un partage d’expérience illustrant la mise en œuvre d’un modèle de transformation des programmes en formation professionnelle pouvant contribuer à l’autodétermination de l’éducation des Premiers Peuples, droit reconnu par l’ONU (2007).
-
Communication orale
Intégrer une formation de préposée aux bénéficiaires, la conséquence de bifurcations biographiques multiples. Analyse de six cohortes en OutaouaisFrancois Aubry (UQO - Université du Québec en Outaouais)
Le métier de préposés aux bénéficiaires (PAB) au Québec se démarquent par une faible attraction et une faible rétention au métier : En 2019, il ne demeurait que 36% de PAB après 5 années d’expérience, dans l’ensemble du secteur public du Québec (MSSS, 2019). Si les facteurs qui prédisposent au départ sont connus (manque de main d’œuvre, salaire faible au regard de la charge, etc.) (Aubry et al., 2017), peu de recherches ont porté sur leur formation initiale.
L’objectif de cette communication est de présenter les trajectoires des étudiants de six cohortes d’étudiant.es en formation de PAB (DEP5358) en Outaouais. Dans le cadre d’une étude financée par le CRSH (Développement savoir), nous avons interrogé ces étudiantes à 5 reprises durant leur formation d’une durée d’environ 870 heures (8 mois). Nous avons mis en lumière la fragilité des parcours biographiques préformation (expérience de proche-aidance imposée, immigration complexe, problématiques de santé mentale). Il appert que le fait d’intégrer cette formation est perçue comme une chance professionnelle d’obtenir un emploi stable à long terme. Néanmoins, au fur et à mesure de la formation, ce projet se confrontait à des facteurs contraignants qui pouvaient modifier le projet initial : Charge de travail élevée, poste désigné sur des horaires ou des milieux de travail non voulus, etc. Nous présenterons l’évolution de la perception du projet professionnel selon les trajectoires des personnes interrogées.
-
Communication orale
Maman, Papa, j’ai (encore) besoin d’aide : la recherche d’aide auprès des parents chez les élèves de la formation professionnelleErin Barker (Université Concordia), Annie Dubeau (Université du Québec à Montréal), Karine Jacques (Centre de services scolaire des Mille-Îles), Shanyce Alyssa Joseph (UQAM - Université du Québec à Montréal), Camille Jutras-Dupont (Université du Québec à Montréal), Diane Marcotte (Université du Québec à Montréal), Isabelle Plante (Université du Québec à Montréal), Marie-Hélène Véronneau (Université du Québec à Montréal)
Alors qu’au Québec l’âge légal de la maturité est fixé à 18 ans, la transition à l’âge adulte peut s’étirer jusqu’à 30 ans (Arnett, 2014). Il n’est donc pas surprenant que bon nombre d’élèves réalisant une formation professionnelle de niveau secondaire, lesquel·le·s sont majoritairement âgé·e·s entre 15 et 30 ans, se tournent vers leurs parents lorsqu’iels font face à une situation d’adversité. Cette étude explore dans quelle mesure les parents d’élèves réalisant une formation professionnelle sont sollicités par ces dernier·ère·s lorsqu’iels rencontrent des difficultés. Pour atteindre cet objectif, des données qualitatives issues de deux projets distincts (Dubeau et al., 2023; Véronneau et al., 2017-2020) ont été étudiées et seront croisées dans le cadre de cette présentation. Une analyse déductive a été employée sur une portion des données et permet d’entrevoir que les élèves font appel à leurs parents pour quatre types d’enjeux : (a) relationnels, (b) académiques, professionnels ou financiers, (c) santé mentale ou physique et (d) autres. Sur le plan scolaires, les enjeux propres aux élèves ayant des besoins particuliers seront abordés. Dans l’ensemble, ces données permettront de mieux cerner le rôle exercé par les parents dans le parcours d’apprentissage en formation professionnelle. Des pistes d’action seront discutées pour aider personnel de centres de formation à mettre à profit le soutien fourni par les parents dans l’accompagnement des élèves vers la réussite.