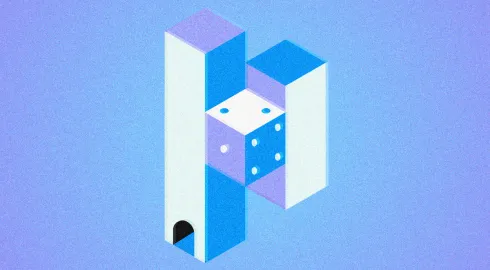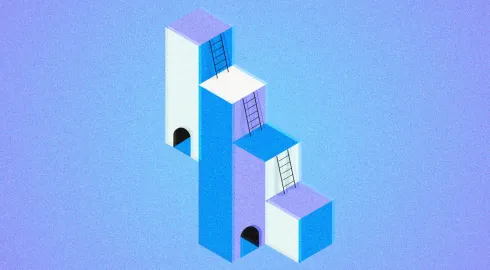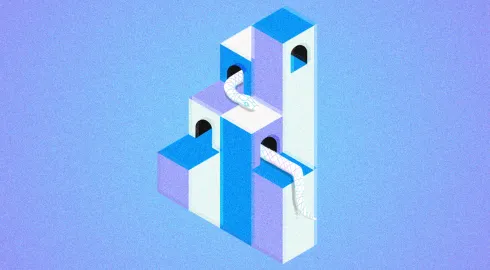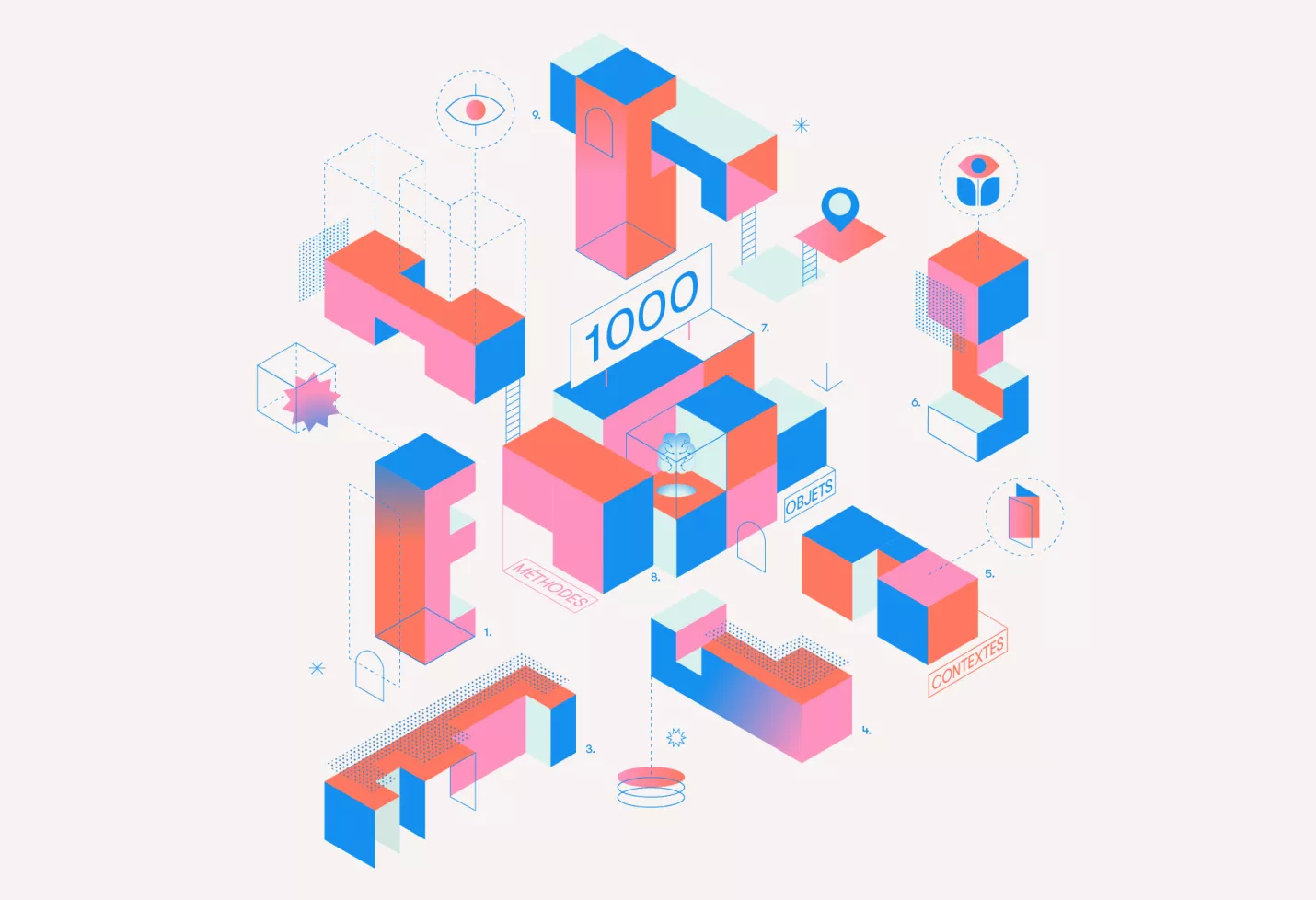Construire sa recherche est un casse-tête stimulant. Une pièce à la fois, les chercheur·euses disposent leur cadre théorique tout en demeurant à l’écoute de leurs données, font des choix méthodologiques stratégiques, puis, parfois, se (re)positionnent. Au centre de ce processus et de ce dossier thématique, une question : comment s’outiller adéquatement pour construire une méthodologie adaptée à son objet de recherche? Autrement dit, comment placer le bon morceau au bon endroit, pour représenter l’image souhaitée? Conversation avec Carole Boulebsol, professeure de travail social à l’UQO et présidente du comité relève de l’Acfas.
[Entretien réalisé par Audrey-Maude Falardeau, membre de la rédaction du Magazine de l'Acfas]
Audrey-Maude Falardeau : Carole, merci d’avoir accepté notre invitation! Nous aimerions d'abord te connaître. Pourrais-tu te présenter?
Carole Boulebsol : Je suis travailleuse sociale et nouvellement professeure au département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), sur le campus de Saint-Jérôme. Je viens de déposer ma thèse de doctorat en sciences humaines appliquées, que j’ai menée à l’Université de Montréal sous la direction de Marie-Marthe Cousineau et Sylvie Lévesque. Je suis membre du conseil d’administration de l’Acfas et présidente de son comité dédié à la relève en recherche. Je pratique depuis une quinzaine d’années une recherche essentiellement qualitative et féministe. Je me spécialise également en recherche partenariale, une approche que nous aurons l'occasion de discuter!
Mes champs d’intérêt incluent principalement les violences basées sur le genre, notamment les violences à caractère sexuel, les violences conjugales et le contrôle coercitif, ainsi que la coercition reproductive. Je me penche également sur la migration, l’intervention de groupe, les pratiques anti-oppressives ainsi que sur la formation de la relève en intervention et en recherche.
Le plus souvent, je travaille à partir de récits ou de témoignages de personnes rencontrées sur le terrain qui ont elles-mêmes subi des violences et qui me transmettent leur propre savoir d'expérience. Je parle aussi avec des intervenant·es, des professionnel·les qui me décrivent leur expertise intersectorielle et interdisciplinaire, et parfois, les défis qu’ils doivent relever. Le plus souvent, il s’agit d’entretiens individuels semi-dirigés ou de groupes de discussion focalisée.
J’amorce ma carrière professorale et mon objectif est de continuer de mobiliser, voire de développer des méthodologies inclusives et anti-oppressives, toujours dans le cadre de recherches que je souhaite être « engagées ».
A-M.F. : Si je comprends bien, tu optes pour une méthodologie adaptée, sensible aux réalités des personnes rencontrées sur le terrain. Comment décrirais-tu ton approche méthodologique?
C.B. : Je suis passionnée par la méthodologie! J’aime y réfléchir, j’aime l’enseigner et j’aime m’informer de manière continue sur tout ce qui la concerne. J’espère développer dans les prochaines années de nouvelles aptitudes sur ce plan, notamment en recherche-création.
La méthodologie traverse chaque étape de la recherche, de la formulation de la question à la diffusion des résultats. Selon la formulation de la question – « comment », « pourquoi », « qui » ou « dans quelle mesure », par exemple –, les choix méthodologiques varient. En bref, la méthodologie est au cœur de la manière de faire science et de produire des connaissances.
La méthodologie traverse chaque étape de la recherche, de la formulation de la question à la diffusion des résultats. [Elle] est au cœur de la manière de « faire science » et de produire des connaissances.
A-M.F. : En t’écoutant, j'entends autant les mots méthodologie que méthode. Quelle distinction fais-tu entre ces deux concepts?
C.B. : De manière assez simple, on peut dire que la méthodologie renvoie à une philosophie générale d’approche de la recherche. On parle ici d'ontologie et d'épistémologie, soit l’angle sous lequel les chercheur·euses observent et construisent les connaissances autour de leur objet de recherche. L’approche est-elle davantage constructiviste, réaliste ou post-positiviste, par exemple? La réponse influencera les outils et la méthode que l'on utilisera. Certaines questions se poseront : comment fait-on « preuve » avec ses données de recherche pour vérifier son hypothèse? Quel est notre rapport à la connaissance ou à la représentation de la réalité? [NDLR : Pour en lire davantage sur la construction épistémologique, consultez l'article « Le bayésianisme : une boussole épistémologique pour les sciences infirmières » de ce dossier.]
La méthode, quant à elle, renvoie aux aspects plus techniques, plus précis. Cela comprend les étapes de réalisation et les moyens mis en œuvre dans la pratique. Par quoi commence-t-on? Quels sont les outils de collecte ou d’analyse à privilégier?
Par exemple, dans le cadre de ma thèse, j’ai adopté une méthodologie qualitative, féministe et constructiviste. J’ai choisi comme méthode de collecte de données des entrevues semi-dirigées, et comme méthode d’analyse une thématisation et des typologies.
A-M.F. : Dans un cours de méthodologie de maîtrise ou de doctorat, les grandes orientations méthodologiques sont souvent présentées comme le premier élément à considérer pour la construction de son projet de recherche. On parle ainsi des méthodologies qualitatives, quantitatives et mixtes. Devant ces différentes avenues, qu’est-ce qu’un·e étudiant·e doit prendre en considération avant même d'amorcer la construction du cadre méthodologique?
C.B. : À mon avis, il ne faut pas tomber dans une espèce d'orthodoxie ou de hiérarchie stipulant qu’une approche est plus pertinente qu'une autre de manière globale, qu’une méthode a plus de prestige, etc. Chaque avenue a ses forces et ses limites, chacune s’inscrit dans des traditions disciplinaires qui parfois se distinguent, parfois se rejoignent.
D’abord, une prémisse importante est de vérifier la cohérence entre la question de recherche, le cadre théorique, les objets, les retombées anticipées et l’approche choisie. Un autre aspect à considérer est celui de la faisabilité : est-ce que l’approche est réaliste compte tenu des ressources disponibles? Parfois, on peut avoir de grandes ambitions! Or, il est possible qu’il n’y ait pas assez d'argent pour soutenir le protocole souhaité, pas assez de temps, ou pas d’accès à des outils particuliers – des logiciels de traitement de données, par exemple.
Ensuite, il faut prendre le temps d’explorer les méthodes existantes en lisant des ouvrages de référence en méthodologie ou en parcourant des recherches qui font appel à des méthodes proches de nos affinités. Il peut être aussi enrichissant de sortir de nos zones de confort en allant voir ce qui s’écrit sur des méthodologies ou des méthodes que l’on connaît moins.
Chaque avenue [méthodologique] a ses forces et ses limites, chacune s’inscrit dans des traditions disciplinaires qui parfois se distinguent, parfois se rejoignent.
A-M.F. : Après avoir choisi leur approche méthodologique, les étudiant·es-chercheur·euses doivent réfléchir aux étapes à suivre : production des savoirs, construction des questions de recherche, collecte des données, analyse. La diffusion des résultats au bout du processus importe beaucoup. Mais pourquoi devrait-on s’intéresser à ce point dès le départ?
C.B. : Quand on est chercheur·euse, peu importe l’avancement de notre carrière – que ce soit comme étudiant·e à la maîtrise, au doctorat, au postdoc, ou comme chercheur·euse d'établissement ou chercheur·euse universitaire –, on a la responsabilité de diffuser et de restituer les connaissances : publier des articles, donner des conférences, rédiger des livres, etc. Comme d’autres, je suis très attachée à la vulgarisation auprès de différentes communautés en dehors du milieu universitaire. Dans notre plan méthodologique, il est pertinent de se poser la question suivante : comment s'assurer de rejoindre un public plus large, de vulgariser nos résultats?
Bien que la diffusion auprès des universitaires ou des scientifiques soit très importante, je suis convaincue que la diffusion créative et inclusive des résultats ou des retombées des recherches est essentielle pour assurer un dialogue entre les sciences, la société et les communautés. Ainsi, l’Acfas contribue dans sa mission, notamment par l’entremise de son Magazine, à faire valoir ce genre de pratique de diffusion. [NDLR : Pour découvrir un projet de recherche-création alliant arts et sciences pour sa diffusion à différents publics, consultez l'article « Quand la danse somatique et la réalité augmentée s’invitent chez le peuple Bouyei » de ce dossier.]
Dans ma thèse, je cite un extrait d’un épisode du balado Le savoir et le dire : itinéraires de la recherche en français sur l’importance de la vulgarisation pour les autres, mais aussi pour soi. Diane Tshikudi, doctorante en immunologie à l'Université du Manitoba, affirme ce qui suit : « [Vulgariser] me permet de comprendre, en fait, sur quoi je travaille. La capacité à vulgariser son travail indique la compréhension de son travail. […] [Quand une réalité, un phénomène] touche des humains, des vraies personnes, c'est important de pouvoir leur amener les informations, de pouvoir leur indiquer ce qu'on est en train de faire pour pouvoir les aider. Et c'est important de le faire dans un langage que tout le monde peut comprendre. » Je crois que cette chercheuse touche ici un point important : la nécessité et la pertinence de la démocratisation et de l’accessibilité des savoirs, notamment pour les premières personnes concernées par les problématiques que nous étudions. Et si, en plus, on le fait de manière innovante et créative, on peut aussi se démarquer et inspirer nos collègues!
[...] la diffusion créative et inclusive des résultats ou des retombées des recherches est essentielle pour assurer un dialogue entre les sciences, la société et les communautés.
A-M.F. : Cette créativité que tu nommes m’amène à me poser des questions sur les limites de ce qu'on peut ou qu’on ne peut pas faire en construisant son projet de recherche, en élaborant la méthodologie qu’on souhaite employer. Quelles sont ces limites?
C.B. : D’abord, il est important de souligner que toutes les méthodologies ont des forces et des limites. Dans cet esprit, j’aimerais dire aux étudiant·es qu’il faut être en mesure de démontrer pourquoi on a choisi une méthode plutôt qu’une autre parmi l’éventail de possibilités. Il est essentiel de bien comprendre ses choix et d'être capable de les défendre en expliquant que la méthodologie choisie est cohérente, qu’elle permet de répondre à la question de recherche, qu’elle s'aligne avec notre sensibilité théorique, etc.
En recherche qualitative, on collecte le plus souvent les données avec de plus petits échantillons qu'en recherche quantitative. Forcément, cela constitue une première limite dans la portée et la généralisation possibles des résultats. Et en même temps, la constitution d’échantillons plus restreints et le recours, par exemple, aux récits de vie ou de pratique assurent une profondeur d’analyse des expériences recueillies en entretien que les méthodologies quantitatives ne nous donnent peut-être pas. Une autre limite méthodologique que l’on peut rencontrer, par exemple, est liée aux biais de mémoire. Quand des personnes nous racontent une expérience qui a eu lieu dans le passé, le souvenir est-il toujours fidèle à la manière dont se sont passés les événements? On suppose que oui, mais on ne peut pas dire avec certitude que ça l'est – surtout pas dans une posture constructiviste comme la mienne. [NDLR : Pour en lire davantage sur les biais méthodologiques, consultez l'article « Contrer le biais d’échantillonnage : le cas des enfants doués » de ce dossier.]
Ensuite, la question de l'éthique est aussi très importante en méthodologie. Il y a d’abord l'éthique procédurale, c’est-à-dire ce qui relève des normes des universités, où des comités internes octroient des certifications éthiques, notamment. Puis on trouve les éthiques plus larges, qui sont peut-être plus de l'ordre de la philosophie ou de l'attitude de recherche, telles les éthiques de la responsabilité, les éthiques relationnelles ou du care, etc. Celles-ci examinent la construction des savoirs dans le but de s'assurer de ne pas créer d’effets délétères dans la vie des personnes qu'on rencontre dans le cadre de nos travaux. [NDLR : Pour en lire davantage sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle en recherche, consultez l'article « Les IA, la science et vous » de ce dossier.]
Lorsqu’on fait de la recherche auprès de communautés plus vulnérables, plus marginalisées, il faut en prendre acte et réfléchir vraiment consciemment à la manière d’appréhender le terrain, de s'adresser aux personnes, d’entrer en contact avec elles, de leur donner du pouvoir et de la reconnaissance, de leur retourner les résultats etc.
Lorsqu’on fait de la recherche auprès de communautés plus vulnérables, plus marginalisées, il faut en prendre acte et réfléchir vraiment consciemment à la manière d’appréhender le terrain, de s'adresser aux personnes, d’entrer en contact avec elles, de leur donner du pouvoir et de la reconnaissance, de leur retourner les résultats etc.
On peut se poser plusieurs questions à cet égard : est-ce que je fais preuve de sollicitude quand je suis avec ces personnes? Est-ce que je les traite comme des objets ou des données inertes, ou est-ce que je les reconnais en tant que sujets – souverains et producteurs aussi de connaissances, en tant que personnes porteuses d’histoires de vie, de sensibilités, d‘émotions? Suis-je conscient·e de mes privilèges de chercheur·euse dans cette relation? L’objectif de ces questionnements est aussi de pouvoir s’éloigner de l'extractivisme, c’est-à-dire, pour le dire simplement, le fait d’aller à la rencontre des personnes, de collecter des données, mais sans leur retransmettre les informations obtenues ou reconnaître leur apport. Il faut se poser plusieurs questions en amont du projet sur nos biais et privilèges, surtout lors d’une collaboration avec des communautés ciblées telles que des populations autochtones ou allochtones. C’est essentiel pour limiter le plus possible le rapport hiérarchique, afin de créer une relation de confiance où la personne pourra nous parler sans craindre notre jugement. [NDLR : Pour lire un récit sur le développement d'une relation avec des communautés autochtones en recherche, consultez l'article « L’ethnographie pour mener un travail significatif sur le terrain » de ce dossier.]
En résumé, il y a beaucoup de questions éthiques à se poser relativement à la manière de mettre en place nos protocoles de recherche en termes de procédure, de certification, mais aussi de positionnement. Cette réflexion est d'autant plus importante lorsqu’on entre en relation avec des populations dites sensibles ou plus vulnérables. D'ailleurs, j'encourage les personnes qui nous lisent à aller suivre la formation en éthique de la recherche des trois organismes de recherche fédéraux (CRSH, CRSNG et IRSC), qui vise à introduire la communauté de la recherche aux lignes directrices de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2).
A-M.F. : La recherche en sciences humaines et sociales implique des personnes chercheuses au contact de membres de différents groupes et communautés. Tu nous a mentionné, en début de discussion, la question de la recherche partenariale. Pourrais-tu nous en parler?
C.B. : Il existe toutes sortes de recherches partenariales. De mon côté, en collaboration avec plusieurs collègues, je la pratique avec des groupes communautaires et, dans une moindre mesure, avec des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Le plus souvent, la demande vient des groupes, notamment lorsque leurs membres remarquent lacune dans la littérature scientifique, ou un manque de connaissances et de documentation sur une réalité, un besoin de documenter, de développer ou d’évaluer des programmes de services ou de formation. Un exemple de recherche partenariale porteuse est ESSIMU : Une enquête portant sur les violences sexuelles en milieu universitaire au Québec, un important projet de méthodologie mixte dirigé par la professeure Manon Bergeron, laquelle a d’ailleurs été reconnue en 2023 pour ses contributions scientifiques avec le prix Thérèse-Gouin-Décarie, remis par l’Acfas. Cette recherche, qui a compté divers partenariats, a mené, entre autres, à une loi cadre qui, maintenant, influence les pratiques des cégeps et des universités en matière de prévention et d’intervention.
Bien souvent, les projets de recherche partenariales prennent un peu plus de temps parce qu'on vise ce qu'on appelle une coconstruction. Dans cette approche, on essaye de limiter le plus possible les éléments de hiérarchisation entre les chercheur·euses universitaires, par exemple, et les chercheur·euses communautaires. L’objectif est de valoriser les savoirs en coconstruisant le protocole avec les partenaires. Ces projets sont plus longs, mais extrêmement intéressants à mener. C'est une manière de s'assurer que nos recherches répondent réellement aux besoins des communautés avec lesquelles on collabore, notamment en termes de diffusion et de restitution des données. Cette façon de faire permet aussi de rappeler que la connaissance est à la fois produite à l'université et au sein d'autres groupes et organisations, dont les savoirs sont tout aussi légitimes et pertinents. L’important ici demeure la cohérence, et ce, dans n'importe quelle méthodologie, pour assurer une pertinence scientifique et sociale et ne pas nuire. [NDLR : Pour en lire davantage sur la diffusion et la restitution de données auprès des communautés autochtones, consultez l'article « L’Atlas de biodiversité pour restituer les savoirs autochtones » de ce dossier.]
Le savoir et le temps des communautés mobilisées sont aussi précieux que ceux des chercheur·euses. Il est important de le reconnaître avec respect, en dégageant des allocations pour les groupes partenaires, par exemple. Dans le cadre de certains projets, on peut aussi travailler avec des chercheur·euses-ressources, qu’on nomme parfois expert·es de vécu – par exemple, des femmes survivantes de violence conjugale qui seront formées à la recherche dans le but de participer à plusieurs étapes du processus. Ces femmes vont notamment s’intégrer à des comités internes afin d’encadrer les recherches, participer parfois à l'interprétation des résultats et à leur diffusion, et bien plus. Là encore, il est possible de reconnaître leur implication en leur octroyant des allocations, en les ajoutant comme co-autrices de certaines publications (sous pseudonymes ou non, selon leur préférence), etc. [NDLR : Pour en lire davantage sur la recherche partenariale sous forme de recherche-action, consultez l'article « Cultiver la rédactologie grâce à la recherche-action » de ce dossier.]
[La recherche partenariale] permet aussi de rappeler que la connaissance est à la fois produite à l'université et au sein d'autres groupes et organisations, dont les savoirs sont tout aussi légitimes et pertinents.
A-M.F. : J'ai envie de parler des manières de faire de chaque domaine de recherche ou établissement universitaire. Souvent, on peut penser qu’un domaine particulier a sa méthode ou sa méthodologie particulière. Comment une personne qui débute en recherche peut-elle agir pour trouver un cadre méthodologique se situant en partie à l’extérieur de son affiliation méthodologique disciplinaire?
C.B. : Pendant mon doctorat, j'ai été formée à l'interdisciplinarité. Une des choses que je retiens de cette formation, c'est cette idée de voir les disciplines comme des cultures. Ainsi, on parle plutôt de cultures disciplinaires : chacune a son histoire qui vient colorer les manières de faire de la recherche, mais aussi les manières d’en parler. La culture donne du sens à des réalités; c’est un code, un guide; c'est rarement universel. Les disciplines de recherche fonctionnent de la même manière.
Après, il faut se demander : est-ce que l'interculturalité m’intéresse? Est-ce que je veux aller chercher de nouvelles manières de faire dans d’autres disciplines? Cette façon de considérer la science est une posture qui découle de nos formations, de nos directions de recherche, de nos établissements, etc. Mais tout dépend, encore une fois, de la cohérence de la méthodologie choisie par rapport au cadre théorique et à la question qu'on se pose. Alors, moi, j'ai envie de dire que tout est possible! Encore faut-il comprendre notre orientation, la justifier et pouvoir négocier avec la réalité de nos terrains et de nos équipes.
Cela étant dit, nous sommes en 2024. J'ai l'impression, sous toute réserve, qu'il y a une porosité un peu plus grande que jadis, et que l'influence interdisciplinaire est plus présente. Nous sommes exposé·es à plus de manières de faire aussi, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux bases de données, aux bibliothèques en ligne, etc. Nous avons accès à un plus grand éventail de possibilités, et cela nous stimule et nous inspire.
Une des choses que je retiens de cette formation [à l'interdisciplinarité], c'est cette idée de voir les disciplines comme des cultures. Ainsi, on parle plutôt de « cultures disciplinaires » : chacune a son histoire qui vient colorer les manières de faire de la recherche, mais aussi les manières d’en parler.
A-M.F. : Quels conseils donnerais-tu aux étudiant·es des cycles supérieurs qui entament le processus méthodologique?
C.B. : Une première chose que je conseille – surtout en méthodologie qualitative –, c’est d'écrire, de se munir de carnets de recherche. Il s’agit d’une pratique très présente chez les anthropologues. Je crois que c'est extrêmement important de se mettre à écrire librement à l'occasion, de faire des dessins ou même du collage. Il faut se donner des espaces de recherche dans lesquels on peut déposer nos réflexions ou nos émotions – parce que la recherche n’est pas dépourvue d’émotions! Un travail émotif est fait, avec des effets transférentiels. Lorsque nous rencontrons des personnes, lors d’entretiens par exemple, nous les invitons à témoigner, à partager des sentiments. Elles nous en font vivre en retour, et il est intéressant de le documenter ce partage, de le consigner.
Avec la pratique de l’écriture, on peut document tout librement, et ce, dès le début du processus de recherche. On peut commencer par écrire pourquoi notre objet de recherche, ou notre domaine de manière générale nous intéresse. Chaque nouvelle étape du parcours méthodologique devient ensuite une autre opportunité de réfléchir, de procéder à un « inventaire de nos a priori » avant d’aller sur le terrain, comme le disent Pierre Paillé et Alex Mucchielli. Qu'est-ce que je crois que je vais trouver? À mon avis, quels seront mes résultats? L’exercice dévoile nos préjugés ou révèle nos attentes, qui peuvent être irréalistes, etc. S’interroger sur nos biais, perceptions et limites est un exercice essentiel – après tout, on choisit rarement un sujet ou un objet de recherche sans raisons, surtout en sciences humaines. À la fin du processus, on relira tout ça pour voir si nous avons bougé, si nos réflexions ont évolué. Souvent, évidemment, notre compréhension aura changé, parce que les données trouvées nous ouvrent de nouvelles perspectives.
Une première chose que je conseille – surtout en méthodologie qualitative –, c’est d'écrire, de se munir de carnets de recherche. [...] Il faut se donner des espaces de recherche dans lesquels on peut déposer nos réflexions ou nos émotions – parce que la recherche n’est pas dépourvue d’émotions!
Un deuxième outil notable, ce sont les espaces d’échanges avec des personnes-ressources clés, comme nos directions, nos collègues ou d’autres étudiant·es, des lieux où on peut discuter librement de notre méthodologie, de nos postures, de nos stratégies de recrutement, de nos analyses, etc.
À cet effet, j’aimerais donner l’exemple du collectif Cœur à l'ouvrage (CAO), que j’ai co-lancé avec Catherine Rousseau, et que le Réseau québécois en études féministes a eu la générosité de soutenir. Nous avons souhaité rassembler d'autres étudiant·es à la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat qui travaillent sur la violence basée sur le genre afin de créer un espace de discussion et de collaboration. Nous voulions ainsi nous regrouper afin de parler de nos méthodologies et de ce que nos recherches nous faisaient vivre – bref, de l’inévitable transformation professionnelle et personnelle qui est présente quand on fait de la recherche. Ces espaces-là, surtout quand on travaille sur des sujets sensibles, sont du bonbon en méthodologie, d’une part, et pour le bien-être et la santé mentale des personnes chercheuses, d’autre part. Quand on décrit sa méthode aux autres, on se la décrit aussi à soi-même. On crée ou active un récit de la méthodologie dont il est intéressant de rendre compte, selon moi. Il est essentiel de s’offrir des moments dédiés à une pratique réflexive de la méthodologie et de la recherche en général, et de se confronter un petit peu aux interprétations de nos collègues, de nos partenaires, etc. C'est une manière de sortir de l'isolement. [NDLR : Pour en lire davantage sur le projet du collectif Cœur à l'ouvrage (CAO), consultez l'article « Le Cœur à l’ouvrage : un espace de sollicitude pour l’exercice méthodologique » de ce dossier.]
Enfin, troisièmement, il faut prendre le temps. Depuis quelques années, les scientifiques invitent la communauté de recherche à ralentir le rythme de travail à l’aide de leur Slow Science Manifesto, ou « manifeste pour la science lente ». La familiarisation avec la méthodologie est un exercice long qui traverse tout le processus de recherche et qui exige à différents moments de faire preuve d’une certaine ouverture et flexibilité. Parfois, on se rend compte que notre idée initiale était une fausse bonne idée. Ou encore, on découvre des choses que l’on croyait impossibles au départ. Tout cela fait partie de l’expérience de la recherche, qui exige du temps et nous demande parfois de sortir de nos zones de confort.
Petite anecdote : avant la pandémie, j'avais plutôt un a priori sur les entrevues en ligne. Par la force des choses, pendant cette période, j'ai eu à réaliser des entrevues virtuelles. Évidemment, on remarque rapidement les limites du virtuel, notamment la difficulté à lire la communication non verbale de la personne avec qui on discute, parce qu’on ne voit pas tout son corps. Or, ce type d’entrevue m'a donné l’occasion de rejoindre des personnes qui vivaient dans des régions plus éloignées – ce qui aurait été peu possible si les rencontres s’étaient tenues obligatoirement en personne. De plus, le virtuel permet aux personnes interrogées de rester dans le confort de leur logement ou de leur voiture, ce qui offre une aisance physique et mentale.
Bref, il y a de beaux accidents parfois… Voilà une autre habileté intéressante à développer : être capable de voir les changements et les imprévus comme des opportunités. Il faut vraiment être ouvert à avoir des surprises sur le terrain, pour toujours améliorer nos méthodologies et nos méthodes, peu importe la situation.
Voilà une autre habileté intéressante à développer : être capable de voir les changements et les imprévus comme des opportunités. Il faut vraiment être ouvert à avoir des surprises sur le terrain, pour toujours améliorer nos méthodologies et nos méthodes, peu importe la situation.
Pour poursuivre votre réflexion, quelques propositions de lecture
Sur l’importance de la pratique d’écriture pendant un processus de recherche qualitatif
- Forget, M.-H., et Malo, A. (dir.) (2021). (Se) Former à et par l’écriture du qualitatif. Presses de l’Université Laval.
Sur l’importance d’avoir des espaces formels et informels pour se renseigner sur la méthodologie
- Boulebsol, C. et C. Rousseau (2024). Devenir chercheuses ensemble : Expérimenter et investir des espaces de partage entre étudiantes comme stratégie de formation complémentaire à la recherche qualitative. Dans Morrissette, J., Demazière, D. et Dupoint-Leclerc, M.-M. Former et se former en recherche qualitative. (p. 11-27). Presses de l’Université Laval.
- Collectif CAO. (soumis). Le cœur à l’ouvrage: un groupe à soi pour penser et vivre les émotions comme chercheuses féministes de la relève. Dans G. Pagé, M. Blais, et A.-M. Veillette (dir.), (Ré)concillier les émotions et la recherche sur le féminisme et la contestation sociale. Presses de l'Université Laval.
Quelques ouvrages de référence en méthodologie
- Becker, S. H. (2002). Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales. Éditions La Découverte et Syros.
- Bourgeois, I. (dir.) (2021). Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données (7 éd.). Presses de l’Université du Québec.
- Paillé, P., et Mucchielli, A. (2016). L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Armand Colin.
Sur la recherche partenariale en contexte féministe
- Gervais, L. (2004). Relais-femmes, Rencontre entre des savoirs : la mise en action d’une utopie... Labrys, études féministes / estudos feministas, 6. https://www.labrys.net.br/labrys6/quebec/gervais.htm
- Boulebsol, C. (2022). 40 ans de recherche partenariale au service des femmes et des communautés. Magazine de l'Acfas. https://www.acfas.ca/publications/magazine/2022/09/40-ans-recherche-partenariale-au-service-femmes-communautes
Sur la recherche dans une perspective de méthodologie féministe
- Clair, I. (2016). Faire du terrain en féministe. Actes de la recherche en sciences sociales, 213(3), 66-83. https://doi.org/10.3917/arss.213.0066
- Ollivier, M., et Tremblay, M. (2000). Questionnements féministes et méthodologie de la recherche. L’Harmattan.
- Entretien avec Carole Boulebsol
Université du Québec en Outaouais
Carole Boulebsol (M.A.) est travailleuse sociale (T.S.), doctorante (UdeM) et professeure (UQO). Elle s’intéresse aux violences basées sur le genre, aux méthodologies qualitatives, au travail de groupe et à la formation de la relève en recherche et en intervention psychosociale. Elle est membre du conseil d’administration de l’Acfas et préside le comité Relève de l’Association.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre
Commentaires
Articles suggérés

Infolettre