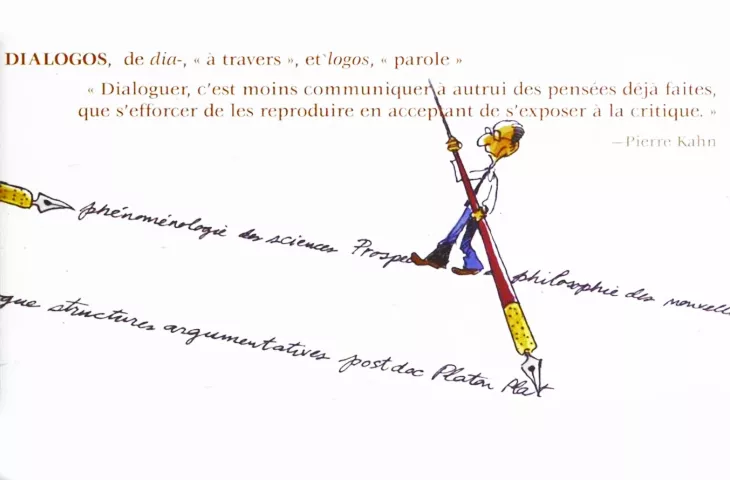Ce titre « fleuve », c'est celui de la règle no 8 de l'ouvrage de Pierre Cossette : Publier dans une revue savante, 2e édition : les 10 règles du chercheur convaincant, paru aux Presses de l'Université du Québec en 2016.
Les pages de mon exemplaire énonçant cette règle, entre les pages 93 et 104, ont été soulignées au crayon, colorées au marqueur jaune, annotées dans la marge et entre les lignes, éclairées de petites étoiles pour ne pas souligner de nouveau à la énième lecture... Bref, je relis ces pages chaque fois que je donne une atelier de vulgarisation scientifique depuis 2016. Eh oui, car les éléments composant cette règle s'appliquent au texte savant comme au vulgarisé, et les deux dernières phrases en résument le pourquoi : « Écrire un texte empirique, c’est en quelque sorte raconter une histoire [...]. Le chercheur doit faire preuve d’une clarté sans faille dans le récit de l’histoire de sa recherche, mais il doit également écrire avec conviction et même avec passion ».
Merci à l'auteur et à sa maison d'édition de permettre ici la republication de la huitième, et je vous invite à consulter la présentation de l'ouvrage par l'auteur, dans nos pages, pour y découvrir la liste des 9 autres règles + la règle d'or.
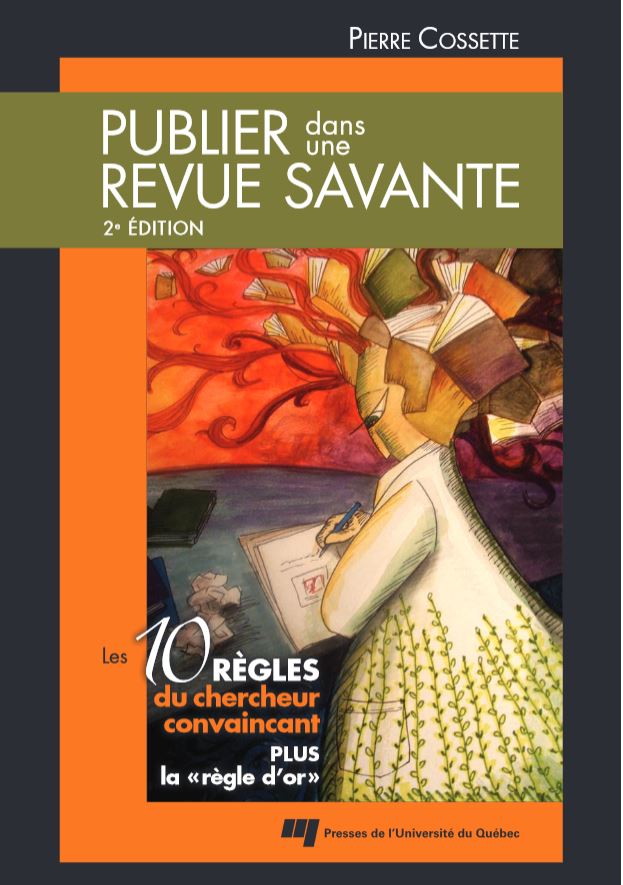
La règle no 8
La qualité de l’écriture d’un manuscrit soumis en vue d’une publication dans une revue savante exerce aujourd’hui une influence incontestable sur la recommandation que feront les évaluateurs de l’accepter ou non ainsi que sur la décision définitive que prendra le rédacteur en chef de cette revue. Campbell (1995), qui fut rédacteur en chef et rédacteur associé du Journal of Applied Psychology pendant neuf ans, affirmait que l’incapacité de bien comprendre ce qu’un auteur essayait de dire était l’une des causes les plus fréquentes du rejet d’un manuscrit. Il écrivait que « la plus grande surprise [biggest shock] qu’il avait eue durant cette période fut de découvrir combien de personnes étaient incapables de décrire clairement et directement ce qu’elles avaient voulu faire, ce qu’elles avaient, effectivement fait et ce qu’elles avaient finalement trouvé », ajoutant que, « les manuscrits rédigés avec clarté constituaient une minorité » (Cossette 2016, p. 272).
Écrire dans un langage intelligible n’a pas toujours été considéré par tous les chercheurs comme une vertu, loin de là. Ainsi, dans une recherche réalisée il y a un certain temps et dont les résultats semblent plutôt déconcertants, Armstrong (1980) avait d’abord montré que plus une revue savante en gestion était difficile à lire (une variable mesurée à l’aide d’un test portant sur la longueur des phrases et le nombre de syllabes par 100 mots), plus les professeurs de l’échantillon retenu (n = 20) la considéraient comme prestigieuse. Puis, après avoir réécrit les conclusions de quatre articles en modifiant leur niveau de lisibilité mais sans changer leur contenu (p. ex., en enlevant les mots inutiles, en remplaçant les mots difficiles à comprendre et en faisant des phrases plus courtes), il constata ceci auprès d’un autre échantillon de professeurs (n = 32) : plus les conclusions des articles étaient faciles à comprendre, moins les professeurs considéraient la recherche comme de haut niveau (competence of the research). En d’autres termes, en se fondant sur ces deux expériences, Armstrong concluait que les chercheurs étaient très impressionnés par des textes inintelligibles et qu’ils n’avaient pas tendance à valoriser la clarté. Les choses semblent avoir profondément changé depuis 1980. Mais il y a probablement encore quelques évaluateurs, surtout parmi ceux qui sont novices ou qui manquent de confiance en eux, qui ont tendance à s’incliner béatement devant ce qu’ils ne comprennent pas ou ce qui leur apparaît très complexe.
... l’incapacité de bien comprendre ce qu’un auteur essayait de dire était l’une des causes les plus fréquentes du rejet d’un manuscrit [soumis à une revue savante].
Bien écrire renvoie essentiellement aux questions de forme, c’est-à dire à la façon d’exprimer des idées. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que la forme et le fond sont intimement liés. Victor Hugo a bien rendu cette idée de la quasi inséparabilité des deux : « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface. » Ce lien entre les deux est si étroit qu’en améliorant l’un, on se trouve presque immanquablement à améliorer l’autre. Le chercheur qui veut soigner la rédaction de son texte est donc amené, dans la majorité des cas, à peaufiner les idées qu’il présente, notamment en clarifiant celles qui ont besoin de l’être (et qui sont toujours plus nombreuses qu’on ne le croit).
La plupart des idées avancées dans les pages qui suivent et portant sur l’art de l’écriture peuvent difficilement être attribuées à un auteur en particulier. Elles émanent en bonne partie de la linguistique et sont enseignées (mais pas nécessairement apprises) depuis fort longtemps. Je signale cependant que celles véhiculées dans les articles de Ragins (2012) et de Pollock et Bono (2013), de même que dans le volume remarquable de Sword (2012) et dans les merveilleux petits guides de Starbuck (1999) et de Bem (2003), ont été une bonne source d’inspiration pour la préparation de cette règle no 8. Ces idées laissent entendre que si l’on ne devait faire appel qu’à un seul mot pour caractériser un texte bien rédigé, ce serait sûrement : CLARTÉ.
...si l’on ne devait faire appel qu’à un seul mot pour caractériser un texte bien rédigé, ce serait sûrement : CLARTÉ.
Un texte clair est un texte facile à lire et à comprendre, où le lecteur ne se demande pas à tout moment ce que le chercheur voulait dire exactement en écrivant ceci ou cela. S’il est vrai, comme je l’ai mentionné précédemment, que les vertus de l’ambiguïté peuvent se manifester dans certaines circonstances, celle-ci n’a toutefois pas sa place dans un texte empirique. Le chercheur doit exprimer très clairement ce qu’il a fait, pourquoi il l’a fait, comment il l’a fait, quels résultats il a obtenus et quels commentaires il apporte sur ces résultats. Pour y arriver, il doit généralement avoir travaillé très fort, d’une part, à mettre au point les idées qu’il veut présenter et, d’autre part, à les exprimer de façon à bien se faire comprendre du lecteur, en se rappelant l’existence d’une forte relation de réciprocité entre l’écriture et la pensée, l’une aidant à améliorer l’autre (à ce sujet, voir notamment Huff, 1999).
Ainsi, en ce qui concerne la mise au point des idées qu’on veut présenter, le chercheur doit se rappeler que si des idées ne sont pas très claires pour lui, leur expression ne peut pas l’être. Boileau ne se trompait pas : « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément » ; s’il pouvait lire tous les textes pauvrement rédigés que reçoivent les rédacteurs en chef de revues savantes et qui témoignent en grande partie de « défauts de conception », il se retournerait probablement dans sa tombe à la vitesse des pales d’une éolienne fonctionnant à plein régime. Mais comment arriver à « bien concevoir » ? Bien sûr, la mise au point d’une idée ou de l’ensemble des idées rendant compte d’une recherche exige parfois beaucoup de temps et d’efforts. Réfléchir, parler, écouter, mais surtout lire et écrire sont des activités qui aident souvent à préciser ce que l’on pense. Le poète, romancier et journaliste français Louis Aragon (1897-1982) allait même jusqu’à affirmer ceci : « On pense à partir de ce qu’on écrit et pas le contraire » … Personne ne devrait se surprendre que la première version qu’on prépare d’une phrase, d’un paragraphe, d’une section ou de tout un texte qu’on veut soumettre en vue d’une publication dans une revue savante soit appelée à subir de nombreuses transformations uniquement pour correspondre à la conception qu’on a soi-même de ses propres idées et de sa propre recherche.
En ce qui a trait à l’expression des idées de façon à bien se faire comprendre du lecteur, on réalise rapidement que bien préciser ce que l’on pense ne garantit pas que le lecteur éventuel saisira exactement ce qu’on veut communiquer. Pourtant, au bout du compte, le plus important n’est peut-être pas ce que l’on écrit, mais ce que le lecteur comprend. Sans aucun doute, le chercheur ne s’adresse pas à tous, y compris à l’intérieur du domaine général dans lequel il évolue, mais si personne ne comprend ce qu’il écrit, son monologue peut difficilement stimuler la conversation. Un des défis du chercheur est de véhiculer des idées riches ou complexes dans un langage accessible à la plupart des chercheurs actifs dans une discipline ou un champ de connaissances donné. S’il n’y parvient pas, il empêche de nombreux lecteurs de profiter de la richesse qu’il attribue probablement lui-même à son travail.
Évidemment, chacun possède sa propre structure cognitive qui rend à ses yeux un texte plus ou moins difficile à comprendre. Ainsi, celle d’un expert en recherche opérationnelle est forcément différente de celle d’un spécialiste en gestion des ressources humaines. Mais le chercheur a quand même tout à gagner à essayer d’être compris essentiellement de la même manière par tous. Ceci l’oblige à ne jamais perdre de vue le lecteur éventuel de ce qu’il écrit, un point sur lequel Ragins (2012) insiste beaucoup.
La plupart des questions qui suivent et que le chercheur est invité à se poser visent donc à évaluer la clarté de son texte. Les deux dernières questions portent plutôt sur le respect des règles et usages de la langue employée par le chercheur (orthographe, grammaire, ponctuation, etc.) et sur l’adoption d’un style vivant et d’un ton approprié.
Le texte est-il rédigé dans un langage précis?
Choisir les termes justes et reflétant le sens des nuances voulues pour exprimer une idée aide à bien se faire comprendre. Idéalement, tous les lecteurs attentifs devraient être capables de saisir la signification que le chercheur donne à ses propos, assez du moins pour pouvoir les reformuler à sa satisfaction. Conséquemment, le chercheur doit faire tous les efforts pour que ses propos ne soient pas ambigus, équivoques ou cryptiques, pour reprendre la distinction proposée par Bougon (1992) et dont j’ai fait état dans l’introduction, notamment en utilisant un langage aussi précis que possible.
Sous cet aspect, un bon chercheur est donc un chercheur obsessif. Il prête beaucoup d’attention aux détails – en particulier lors de la rédaction du cadre méthodologique de la recherche – et au choix des mots, réécrivant généralement plusieurs fois la plupart des phrases et des paragraphes de son texte (Bem, 2003). Il préfère nettement les termes précis aux termes vagues, approximatifs ou flous qui, eux, prêtent à de multiples interprétations. Il n’abuse pas non plus de verbes très généraux comme « être » et « avoir ». Il est aussi conscient que certains termes peuvent porter à confusion. Par exemple, évoquer le rendement d’une entreprise sans plus de précision peut poser problème étant donné que ce rendement peut être financier – rappelons également que les ventes et les profits en sont deux composantes qui ne doivent pas être confondues –, mais qu’il peut aussi être examiné sur le plan social ou environnemental. Et que dire de l’abréviation etc. ou des points de suspension (…), qui révèlent fréquemment une pensée imprécise ou insuffisamment développée?
Par ailleurs, l’usage des synonymes comme substituts de mots importants de la recherche (p. ex., ceux employés dans la formulation de l’objectif de la recherche, de ses questions spécifiques ou de ses hypothèses) n’est habituellement pas considéré comme souhaitable. Ainsi, selon Starbuck (1999), faire appel à un synonyme peut créer de la confusion, ce que Bem (2003) croit aussi. L’opinion de Weick (1995b) semble un peu divergente. Tout en reconnaissant l’argument que « différents mots signifient différentes choses » (p. 293) et qu’il est préférable de ne pas recourir à un synonyme lorsqu’on tient à ce qu’une idée demeure très précise (accurate), il soutient qu’il peut être approprié de le faire si l’on veut donner à une idée une portée plus générale.
Tout en reconnaissant l’argument que « différents mots signifient différentes choses » (p. 293) et qu’il est préférable de ne pas recourir à un synonyme lorsqu’on tient à ce qu’une idée demeure très précise (accurate), [Weick] soutient qu’il peut être approprié de le faire si l’on veut donner à une idée une portée plus générale.
Le texte est-il rédigé dans un style concis?
La concision témoigne de la densité d’un texte, une qualité qu’apprécient particulièrement les lecteurs pour qui le temps est une ressource rare. Mais on peut être très concis en écrivant un texte long et ne pas l’être en écrivant un texte court. La concision renvoie en quelque sorte à l’efficience ou productivité dans l’écriture. Elle désigne essentiellement la capacité du chercheur à employer le minimum de mots pour rendre compte du maximum d’idées. Mais la concision n’implique pas que le chercheur néglige d’apporter tous les détails ou toutes les précisions qu’exige la clarté, ni de reformuler en d’autres termes une idée particulièrement complexe ou de résumer brièvement le contenu d’une section importante pour s’assurer d’être bien compris.
Être concis impose cependant d’éliminer non seulement les mots inutiles (souvent des adverbes ou des adjectifs), mais aussi les phrases, les paragraphes et même les sections dont l’apport est manifestement très faible ou marginal. Les notes infrapaginales sont elles aussi à éviter, plusieurs revues savantes allant même jusqu’à les interdire ou à demander à l’auteur de les réduire au strict minimum, car si leur contenu est vraiment important, il devrait figurer à l’intérieur du texte. Sans oublier que ces notes en bas de page peuvent avoir pour effet de briser un peu le « rythme » d’un article de recherche, comme si elles venaient interrompre l’histoire racontée par le chercheur.
Écrire de façon concise est habituellement très exigeant. Les propos célèbres de Voltaire le rappellent éloquemment : « Je vous écris une longue lettre parce que je n’ai pas le temps d’en écrire une courte »… Aujourd’hui, tous les rédacteurs en chef et évaluateurs vous diront qu’un texte de recherche doit absolument être concis, ce qui, je le rappelle, ne signifie pas qu’il doive être court; le devoir de concision ne doit en aucun cas céder le pas au devoir d’approfondissement.
Aujourd’hui, tous les rédacteurs en chef et évaluateurs vous diront qu’un texte de recherche doit absolument être concis, ce qui, je le rappelle, ne signifie pas qu’il doive être court; le devoir de concision ne doit en aucun cas céder le pas au devoir d’approfondissement.
Starbuck (1999) prétend qu’on peut réduire de 25 % la longueur d’à peu près n’importe quel texte sans vraiment l’appauvrir – Huff (1999) dira de 30 % à 50 % – et que cela pourrait même rendre son contenu encore plus clair. En d’autres mots, être concis peut aider à mettre plus en valeur les idées fondamentales d’un texte. Les précisions ou détails peu ou pas utiles, en particulier lors de la préparation du cadre théorique ou du cadre méthodologique de la recherche, n’ont pas leur place dans le récit de l’histoire d’une recherche (Pollock et Bono, 2013).
Le texte est-il rédigé dans un langage simple et direct?
L’auteur souhaite-t'il véritablement être compris? À lire certains manuscrits, il est permis d’en douter. Il y a d’abord les chercheurs qui s’efforcent d’impressionner le lecteur en faisant étalage de leurs vastes connaissances, en employant un langage opaque ou en montrant leur talent à faire paraître très complexes des idées qui ne le sont pas, ce qui ne contribue qu’à éloigner le lecteur ou à le faire rager. D’autres semblent particulièrement inconscients du fait qu’ils sont actuellement engagés dans une conversation et qu’ils doivent tout mettre en œuvre pour bien se faire comprendre. D’autres encore ne possèdent pas cette habileté à s’exprimer d’une manière simple et directe, ce qui peut être un très sérieux handicap chez un producteur de connaissances. Finalement, il y a les chercheurs négligents qui ne se donnent pas la peine de relire (ou faire relire) leur texte afin de le rendre plus facilement compréhensible. Un langage hermétique n’impressionne plus personne aujourd’hui, sauf peut-être celui qui l’utilise et ceux qui, pour différentes raisons, ressentent le besoin de l’admirer.
En pratique, comment s’exprime le chercheur qui emploie un langage simple et direct? Il utilise des mots que la plupart des gens comprennent, parce qu’il sait très bien que l’adoption d’un langage inintelligible ou pédant ne les rend pas plus brillants, ni lui ni son texte. Le plus souvent, il fait des phrases courtes allant droit au but, les phrases longues ayant parfois tendance à contenir plus d’une idée ou à comporter des détails inutiles; mais pour créer un peu de diversité, il est tout de même capable de faire varier la longueur de ses phrases. De plus, comme le mentionne Sword (2012), il s’assure que les noms et les verbes sont aussi près que possible les uns des autres, surtout afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté à propos de qui fait quoi. Il évite le jargon ou le vocabulaire trop spécialisé, mais s’il doit y faire appel, il s’assure de bien définir les termes qu’il emploie. Il précise également la signification des sigles et acronymes qu’il utilise. Dans la majorité des cas, il écrit comme s’il s’adressait à quelqu’un possédant d’assez bonnes connaissances dans le domaine général à l’intérieur duquel s’inscrit sa recherche, sans présumer toutefois que la personne a une expertise particulière sur l’objet spécifique de son travail, et en se rappelant toujours que les idées non comprises ne serviront à rien ni personne.
Dans la majorité des cas, [le chercheur] écrit comme s’il s’adressait à quelqu’un possédant d’assez bonnes connaissances dans le domaine général à l’intérieur duquel s’inscrit sa recherche, sans présumer toutefois que la personne a une expertise particulière sur l’objet spécifique de son travail, et en se rappelant toujours que les idées non comprises ne serviront à rien ni personne.
Le texte est-il bien structuré?
Globalement, un texte bien structuré se caractérise par un agencement logique de ses diverses parties, ce dont on a déjà un solide aperçu en jetant un simple coup d’œil aux titres des sections et sous-sections du texte. Reportons nous à la distinction que Kaplan (1964) établissait entre la logique « utilisée » (logic-in-use) et la logique « reconstruite » (reconstructed logic) en traitant du processus de constitution des connaissances. Ainsi, dans un article de recherche, le chercheur ne structure normalement pas son texte en rendant compte de la logique qu’il a effectivement suivie pour déterminer son objectif de recherche, pour construire son cadre méthodologique ou pour présenter les résultats, les analyser et en discuter. Le lecteur espère plutôt que le chercheur mette un peu d’ordre dans son texte, ne serait-ce que pour en faciliter la lecture.
Le modèle typiquement suivi pour rendre compte d’un travail empirique – et qui a guidé la présentation des cinq premières règles contenues dans cet ouvrage – recommande au chercheur de composer une introduction dans laquelle il soumet, problématise et légitime sur le plan théorique l’objectif général de sa recherche, une ou deux sections sur les fondements théoriques de la recherche, une autre sur son cadre méthodologique, une autre encore sur la présentation et l’analyse des résultats, et enfin une dernière sur la discussion de leur apport théorique et de ses implications en plus de faire état brièvement des limites de la recherche. Ce modèle est adopté dans ses grandes lignes par la presque totalité des chercheurs, y compris ceux préférant la recherche qualitative (voir, notamment, Bansal et Corley, 2012), de même que dans la plupart des revues savantes. Il est certainement discutable, mais… peu discuté, à ma connaissance. Sans se fermer à d’autres modèles, il semble que les chercheurs et autres acteurs concernés s’accommodent plutôt bien de cette structure dominante. Ceux qui voudraient s’en éloigner seraient bien avisés de justifier solidement la nouvelle logique de présentation qu’ils proposent.
Très concrètement, pour bien guider le lecteur, le chercheur introduit habituellement chacune de ces grandes sections en indiquant ce qu’elle contient et, au besoin, en justifiant ses différentes sous-sections. Il doit aussi conclure chacune d’elles par une phrase ou un court paragraphe débutant fréquemment par « en résumé », « en somme » ou « bref » et montrant ce qu’il faut en retenir. Il s’assure également qu’il y ait suffisamment de sous-titres pour que le lecteur ait des repères, mais pas trop de parenthèses ni de notes en bas de page qui ont souvent pour effet de distraire ce dernier (Daft, 1995).
Cependant, la structure d’un texte n’a pas uniquement trait à cette logique unissant chacune de ses grandes sections. Elle renvoie également à l’agencement des idées à l’intérieur de chacune de ces parties. Le déroulement de la pensée du chercheur ou l’enchaînement des idées qu’il propose ou auxquelles il fait appel doit donc être facile à suivre d’un paragraphe à l’autre. Un texte bien structuré est un texte fluide. Ainsi, on s’attend à ce que chaque paragraphe d’une section constitue vraiment une unité de sens autour d’une seule grande idée, souvent formulée dans la première phrase d’un paragraphe (topic sentence, dirait-on en anglais), un peu comme si cette phrase constituait le titre de ce paragraphe. Le chercheur développe ou étoffe ensuite cette grande idée, en se rappelant qu’un paragraphe ne devrait à peu près jamais se limiter à une seule phrase, du moins dans un texte de recherche.
Le déroulement de la pensée du chercheur ou l’enchaînement des idées qu’il propose ou auxquelles il fait appel doit donc être facile à suivre d’un paragraphe à l’autre. Un texte bien structuré est un texte fluide.
Mais il y a plus. D’un paragraphe à l’autre et même d’une phrase à l’autre, ce fil conducteur des idées dépend fortement de l’emploi de connecteurs (appelés aussi termes de liaison ou charnières) appropriés, c’est-à-dire témoignant adéquatement des liens unissant les idées présentées et contribuant énormément à la clarté d’un texte. C’est dans ces connecteurs que les idées prennent tout leur sens. La question fondamentale à se poser en ce qui a trait à l’usage d’un connecteur est la suivante : rend-il bien compte de ce qu’on veut exprimer pour lier deux mots, deux phrases, deux paragraphes? Dans la langue anglaise, Crovitz (1967) affirme qu’il existe exactement 42 termes de liaison (relation-words : because, for, from, after, or, by, etc). Tout semble un peu plus compliqué ou nuancé (et plus riche?) en français1. Ainsi, en examinant ce qu’en dit le Multidictionnaire de la langue française (Villers, 2009), les connecteurs peuvent être simples ou composés, selon qu’ils renvoient à des conjonctions (p. ex., et, mais, pourtant, donc) ou des locutions conjonctives (p. ex., en effet, étant donné que). Il existe de nombreux types de connecteurs, mais celui dit « argumentatif » (p. ex., cependant, par conséquent, par ailleurs, bien que) et indiquant la présence d’une relation logique semble particulièrement important dans un texte de recherche. Le nombre de tous ces connecteurs en français est difficile à établir, mais il pourrait bien être de plus de 200 si l’on se fie aux nombreux exemples et listes figurant dans le Multidictionnaire de la langue française. L’ennui avec toute cette complexité est que les chercheurs ne font pas toujours un usage très approprié de ces connecteurs. Par exemple, il arrive que certains utilisent la locution par contre (qui doit marquer une opposition) comme si elle était équivalente à par ailleurs, ou encore qu’ils oublient de faire suivre d’une part par d’autre part. Dans un texte bien structuré, les idées sont bien liées.
En somme, un texte clair est un texte rédigé dans un langage précis, concis, simple et direct, en plus d’être bien structuré. Mais le chercheur doit aussi respecter les règles et usages de la langue employée et adopter un style vivant et un ton approprié. Cela nous conduit à deux autres questions que le chercheur devrait se poser.
Le texte est-il rédigé dans le respect des règles et usages de la langue employée?
Toute langue a ses règles et usages qui régissent la manière d’écrire des mots, de construire des phrases et de fabriquer des paragraphes. Ces normes portent principalement sur l’orthographe, la grammaire et la ponctuation. Le chercheur qui écrit correctement la langue dans laquelle il s’exprime montre sa préoccupation pour la qualité de ce qui constitue en quelque sorte l’emballage des idées présentées; ce qui pourrait amener le lecteur, comme le laisse entendre Meyer (1995), à supposer plus ou moins implicitement que le produit est lui aussi de qualité.
Par ailleurs, le chercheur a généralement avantage à faire preuve d’une certaine prudence dans l’utilisation d’un langage qui pourrait sembler discriminatoire (sexiste, raciste, etc.). Par exemple, plusieurs font appel à des termes aussi neutres que possible (personnes, individus, etc.) pour désigner à la fois les hommes et les femmes et éviter ainsi les répétitions inutiles.
Le bon usage d’une langue préconise également de ne pas avoir recours à des tournures de phrases passives, surtout parce qu’elles rendent le texte moins vivant. Pour les transformer, Starbuck (1999) suggère de bien identifier la source de l’action et d’en faire le sujet de la phrase. Par exemple, plutôt que « il est reconnu que le rendement d’une organisation est déterminé par des variables internes et externes », la phrase « tant les chercheurs que les praticiens reconnaissent que des variables internes et externes déterminent le rendement d’une organisation » n’est-elle pas plus vivante et engageante? Le chercheur au style plus actif ou dynamique n’écrirait pas non plus « les principales caractéristiques des répondants sont présentées dans cette section » ou « le compte rendu des entretiens fut soumis aux participants aux fins d’évaluation », mais plutôt « cette section présente… » et « les participants évaluèrent… ». Cela dit, l’emploi de la forme passive n’est pas à proscrire complètement. Là comme ailleurs, un peu de diversité ne fait pas de tort. Cela nous amène à aborder brièvement la question de l’emploi du je en recherche ou du nous lorsqu’il y a plusieurs auteurs (ou comme pluriel de modestie).
Le bon usage d’une langue préconise également de ne pas avoir recours à des tournures de phrases passives, surtout parce qu’elles rendent le texte moins vivant. [...]. Par exemple, plutôt que « il est reconnu que le rendement d’une organisation est déterminé par des variables internes et externes », la phrase « tant les chercheurs que les praticiens reconnaissent que des variables internes et externes déterminent le rendement d’une organisation » n’est-elle pas plus vivante et engageante?
Traditionnellement, plusieurs estimaient que l’utilisation du je dans un texte de recherche était à proscrire parce qu’elle lui aurait donné un parfum de subjectivité inacceptable en contexte de production de connaissances. Le chercheur ne devait-il pas faire preuve d’une absolue neutralité pour préserver l’objectivité de ses propos? Aujourd’hui, de nombreux chercheurs empruntent toutefois une perspective subjectiviste pour réaliser leurs travaux de recherche. Comme ils présument qu’ils ne peuvent s’abstraire du processus de constitution des connaissances (voir, notamment, Bansal et Corley, 2012, de même que Cossette, 2004), ils ne sont pas réfractaires à l’utilisation du je. Toutefois, ils n’ont pas tendance à en abuser. Le plus souvent, ils se servent du je lors des transitions, en particulier pour introduire ou conclure une section, beaucoup plus que pour s’attribuer très explicitement le crédit d’une idée, une pratique qui rendrait le texte moins convaincant, selon Starbuck (2003). Bref, usus non abusus.
Finalement, l’utilisation du temps présent est à privilégier dans la préparation d’un texte de recherche, sauf pour faire état des travaux passés. De façon générale, comme le note bien Starbuck (1999), le temps présent interpelle (engage) davantage le lecteur que le passé ou le futur.
Le style est-il vivant et le ton, approprié?
Reportons-nous à Daft (1995). Selon lui, les procédés linguistiques de certains auteurs laissent penser qu’ils « ne savent pas ce qu’ils font, qu’ils sont des amateurs » (p. 170). Par exemple, ils abusent du point d’exclamation, de l’italique, des guillemets, du caractère gras ou d’autres signes typographiques ou de ponctuation visant à attirer l’attention sur un mot ou un point particulier, ce qui indique souvent qu’une idée n’a pas été traitée adéquatement dans le texte ou n’a pas été présentée d’une manière optimale. Les propos de Starbuck (1999) vont dans le même sens. D’après lui, l’utilisation de l’italique devrait servir uniquement à mettre l’accent sur des termes vraiment cruciaux (key words), pas sur ceux dont le chercheur aurait peur qu’ils passent inaperçus; s’il avait une telle crainte, ce serait parce que ses idées devraient être mieux formulées. Pas besoin de crier pour attirer l’attention… Starbuck invite également le chercheur à avoir recours aux guillemets seulement dans le cas d’une citation intégrale (avec le numéro de la page du document d’où elle est tirée, aurait-il pu ajouter), pas pour souligner l’importance d’un mot. En français, il y a souvent concurrence entre l’emploi de l’italique et celui des guillemets pour attirer l’attention ou insister sur un mot ou sur une expression. Quoi qu’il décide, le chercheur devrait s’efforcer d’être uniforme dans l’usage de l’un et l’autre de ces procédés et de ne pas en abuser.
Daft mentionne également que certains chercheurs amplifient tellement les limites ou faiblesses des travaux réalisés par d’autres chercheurs que leurs critiques perdent toute crédibilité. Il arrive aussi que des chercheurs surestiment grossièrement la contribution présumée de leur propre recherche, comme si les résultats obtenus constituaient la preuve irréfutable et définitive mettant fin à la conversation sur l’objet de la recherche. On ne répétera jamais assez le conseil de Daft (1995, p. 180) : « N’exagérez pas » ! J’ai ajouté le point d’exclamation…
Daft mentionne également que certains chercheurs amplifient tellement les limites ou faiblesses des travaux réalisés par d’autres chercheurs que leurs critiques perdent toute crédibilité.
Il y a un dernier point qu’il ne faut surtout pas oublier. Comme nous le rappellent notamment Kilduff (2006) et Bem (1995), le chercheur critique des idées, des théories ou des travaux, pas des personnes. La rédaction d’un article de recherche ne doit pas devenir l’occasion de régler ses comptes avec un autre chercheur, encore moins de l’attaquer personnellement ce qui, de toute façon, serait jugé totalement inacceptable lors de l’évaluation du texte.
Conclusion
Dans une conversation savante, comme dans toute communication, il est important de clarifier ses propres idées et de les transmettre de façon à bien se faire comprendre. Un chercheur convaincant s’efforce donc de bien préciser ce qu’il pense ou ce qu’il veut dire et de se mettre dans la peau du lecteur lorsqu’il écrit le texte rendant compte de sa recherche. Cela l’amène à modifier sans cesse son texte afin qu’il soit toujours plus clair ou limpide, toujours plus facile à lire et à comprendre.
De plus, et non sans lien avec ce qui précède, un texte destiné à une revue savante doit être agréable à lire. Il doit être vivant, avoir un certain rythme et susciter l’intérêt chez le lecteur. Un modèle? À mes yeux, les articles écrits par Henry Mintzberg ou par Dennis Gioia possèdent généralement ces qualités.
Écrire un texte empirique, c’est en quelque sorte raconter une histoire, comme l’ont fort bien soutenu récemment Pollock et Bono (2013; voir aussi Ragins, 2012, et Pratt, 2009). Le chercheur doit faire preuve d’une clarté sans faille dans le récit de l’histoire de sa recherche, mais il doit également écrire avec conviction et même avec passion. Écrire, c’est bien, mais bien écrire, c’est mieux.
Écrire un texte empirique, c’est en quelque sorte raconter une histoire [...]. Le chercheur doit faire preuve d’une clarté sans faille dans le récit de l’histoire de sa recherche, mais il doit également écrire avec conviction et même avec passion. Écrire, c’est bien, mais bien écrire, c’est mieux.
RÉFÉRENCES
- ARMSTRONG, J. Scott, 1980. « Unintelligible Management Research and Academic Prestige ». Interfaces 10(2):80-86. https://doi.org/10.1287/inte.10.2.80.
- BANSAL, P. and CORLEY, K., 2012. « From the editors. Publishing in AMJ Part 7: « What’s Different about Qualitative Research?, dans Academy of Management Journal », 55, 509-513. https://doi.org/10.5465/amj.2012.4003
- BEM, Daryl J., 2003. « Writing the Empirical Journal Article. https://psychology.yale.edu/sites/default/files/bemempirical.pdf
- BOUGON, Michel G., 1992. « Congregate cognitive maps: A unified dynamic theory of organization and strategy, dans Journal of Management Studies », 29 (3): 657-660. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00670.x
- COSSETTE, Pierre, 2004. L'organisation. Une perspective cognitiviste. Les Presses de l'Université Laval, 236p.
- COSSETTE, Pierre, 2016. Publier dans une revue savante, 2e édition. Les 10 règles du chercheur convaincant. Presses de l'Université du Québec, 157p.
- RAGINS, Belle Rose, 2012. « Editor's Comments: Reflections on the Craft of Clear Writing », Academy of Management Review. Vol. 37, No. 4. https://doi.org/10.5465/amr.2012.0165.
- CAMPBELL, J.P., 1995. « Editorial: Some Remarks From the Outgoing Editor », dans L.L. Cummings et P.J. Frost (dir.). Publishing in the Organizational Sciences, 2e éd. Thousand Oaks: Sage, p.269-283.
- Crovitz, H.F., 1967. « The Form of Logical Solutions », dans American Journal of Psychology; Urbana, etc. Vol. 80, N° 3, (Sep 1, 1967): 461.
- DAFT, R.L., 1995. « Why I Recommended That Your Manuscript Be Rejected and What You Can Do About It », dans L.L. Cummings et P.J. Frost (dir.). Publishing in the Organizational Sciences, 2e éd. Thousand Oaks: Sage, p.164-182. http://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Doctoral_Resources/Daft_Why_I_recommended_your_manuscript_be_rejected.pdf
- HUFF, Anne S., 1999. Writing for Scholarly Publication. Sage, 185p. https://www.africaacademyofmanagement.org/sites/default/files/Huff_Ch.1%263_0.PDF
- KILDOFF, M., 2017. « Editor's comments: The top ten reasons why your paper might not be sent out for review », dans Academy of Management Review, 32(3):700-702. DOI:10.5465/AMR.2007.25274943.
- MEYER, Alan D., 1995. « Balls, Strikes, and Collisions on the Base Path: Ruminations of a Veteran Reviewer », dans L.L. Cummings et P.J. Frost (dir.). Publishing in the Organizational Sciences, 2e éd. Thousand Oaks: Sage, p.257-267.
- POLLOCK, Timothy G. and Joyce E. BONO, 2013. « From the editors: being Scheherazade: the importance of Storytelling in Academic writing », dans The Academy of Management Journal. Vol. 56, No. 3 (June 2013), pp.629-634.
- PRATT, M. G., 2009. « From the editors: For the lack of a boilerplate: Tips on writing up (and reviewing) qualitative research [Editorial] », dans Academy of Management Journal, 52(5), pp.858–862. https://doi.org/10.5465/AMJ.2009.44632557
- SWORD, Helen, 2012. Stylish Academic Writing. Cambridge: Harvard University Press, 238p.
- https://www.hup.harvard.edu/file/feeds/PDF/9780674064485_sample.pdf
- STARBUCK, W.H.Fussy, 1999. Professor Starbuck's Cookbook of Handy-Dandy Prescriptions for Ambitious Academic Authors or Why I Hate Passive Verbs and Love My Word Processor. https://pages.stern.nyu.edu/~wstarbuc/Writing/Fussy.htm
- VILLERS, Marie-Éva de, 2009. Multidictionnaire de la langue française, Québec Amérique, 1 736p.
- 1
Ce qui nous rappelle qu’une langue est beaucoup plus qu’un moyen de communication et qu’elle constitue d’abord et avant tout une façon de se représenter le réel. Non seulement les mots ne sont pas exactement les mêmes d’une langue à l’autre et n’ont parfois pas d’équivalents pour rendre une même idée, mais les termes de liaison les unissant diffèrent souvent beaucoup, comme nous venons de le voir. On peut donc penser que l’utilisation d’une seule langue pour la production et la diffusion des connaissances serait de nature à appauvrir notre compréhension de la réalité sociale. Sur l’importance particulière du français en recherche, voir Chanlat (2014) et Gond (2013).
- Pierre Cossette
Université du Québec à Montréal
Pierre Cossette est professeur associé à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Il a obtenu un MBA et un Ph. D. en administration de l'Université Laval, après avoir complété un baccalauréat et une maîtrise ès arts en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a publié dans de nombreuses revues francophones et anglophones, dont les Journal of Management Studies, Human Relations, Journal of Business Ethics, Management Decision, M@n@gement et Revue internationale PME. Il a également servi comme évaluateur pour une dizaine de revues savantes en gestion et en psychologie. Ses intérêts portent aujourd'hui sur le métier de chercheur, le processus de publication et l'intégrité en recherche.
Vous aimez cet article?
Soutenez l’importance de la recherche en devenant membre de l’Acfas.
Devenir membre