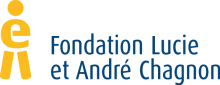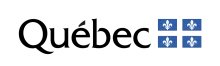Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 600 - Colloques multisectoriels
Description :Depuis 1998, la première édition de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ 1) suit une cohorte de près de 2 000 enfants nés au Québec. Elle est réalisée par l’Institut de la statistique du Québec, en collaboration avec divers partenaires. Avec son devis longitudinal et multithématique, les retombées de cette étude sont nombreuses et variées sur le plan de l’avancement des connaissances, notamment sur l’évolution comportementale ou cognitive des jeunes, leurs habitudes de vie ou encore leur engagement citoyen. Grâce aux données recueillies depuis 25 ans, il est possible d’étudier les répercussions de diverses expériences vécues lors de l’enfance et de l’adolescence sur différents aspects du passage à la vie adulte. S’ensuivent une meilleure compréhension des processus sous-jacents et la capacité de cerner des facteurs de risque et de protection, voire des leviers d’intervention.
Sachant que la société québécoise a considérablement changé au cours des dernières décennies, il est important d’étudier la réalité des enfants qui naissent plus de 20 ans après le début de l’ELDEQ 1.
C’est pourquoi la deuxième édition de l’étude (ELDEQ 2), aussi appelée Grandir au Québec, a vu le jour. Réalisée auprès d’une cohorte de plus de 4 000 enfants nés en 2020-2021 (durant la pandémie), elle a été conçue afin de répondre aux besoins de connaissance concernant le développement des enfants nés au Québec à l’aube de la décennie et sur leur évolution jusqu’à l’âge adulte.
Alors qu’on souligne les 25 ans de la première édition, il est intéressant de mettre en parallèle les retombées de l’ELDEQ 1 et les premiers résultats de l’ELDEQ 2. Qu’avons-nous appris grâce à la première édition? Que nous apprend la deuxième édition sur le contexte de vie des bébés qui grandissent au Québec dans les années 2020? Quelles perspectives pouvons-nous anticiper quant aux développements à venir dans le cadre de ces deux études de cohortes?
Remerciements :Les deux éditions de l’ELDEQ sont réalisées grâce à la collaboration essentielle des partenaires suivants : Fondation Lucie et André Chagnon, Conseil de gestion de l’assurance parentale, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, l’ISQ ainsi que plusieurs ministères du Québec et collaborateurs des milieux universitaires.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Bertrand Perron (Institut de la statistique du Québec)
- Sylvana Côté (UdeM - Université de Montréal)
Programme
Conférence d’ouverture
-
Communication orale
Cinquante ans d’études longitudinales : la place enviable de l’ELDEQ dans l’avancement des connaissances sur le développement humainMichel Boivin (Université Laval)
Le développement des individus, leur bien-être et leur santé sont les pierres d’assises de la capacité d’innovation de la société. Les avancées récentes en psychologie, en pédiatrie et en neurosciences montrent que le cerveau humain se développe rapidement pendant les premières années de vie. En effet, les systèmes neurobiologiques impliqués dans l’attention, la régulation des émotions et les apprentissages filtrent les expériences et, en cascade avec des évènements et des contextes familiaux et sociaux, orientent les trajectoires de vie. Il est donc primordial de décrire et d’analyser celles-ci très tôt, de façon longitudinale et sur la longue durée dans la population. Cette vaste perspective doit s’appuyer sur des données scientifiques probantes en constant changement. Depuis plus de 25 ans, l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec et sa plus récente cohorte remplissent cette mission. La présentation fera état du contexte scientifique à l’origine de l’ELDEQ et de son évolution. Elle passera en revue ses forces et ses limites, de même que les nouvelles avenues de recherche qu’elle permet d’étudier.
Retombées de la première édition de l’ELDEQ
Depuis 1998, l’ELDEQ 1 suit une cohorte de près 2 000 enfants nés au Québec. Elle est réalisée par l’Institut de la statistique du Québec, en collaboration avec divers partenaires.
Les données, recueillies auprès des mêmes jeunes pendant 25 ans, ont permis :
- d’évaluer l’influence des milieux de vie (la famille, la garderie et l’environnement social plus large) sur divers aspects de leur développement;
- d’étudier l’adaptation sociale des jeunes ainsi que leur parcours et leur réussite scolaire;
- d’étudier certaines nouvelles réalités pouvant émerger durant l’adolescence et le début de la vie adulte, comme la conciliation travail-études-loisirs, les relations amoureuses, les comportements à risque, l’intimidation, la violence à l’école et le décrochage scolaire.
Les retombées de cette étude sont nombreuses et variées en termes d’avancement des connaissances.
-
Communication orale
La première édition de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ 1) : survol de la méthodologie d’une étude hors du communNancy Illick (Institut statistique Québec), Bertrand Perron (Institut statistique Québec), Delphine Provençal (ISQ - Institut de la statistique du Québec)
Après de 25 ans d’existence, la première édition de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ 1) représente une mine d’or pour la communauté scientifique et tout organisme public soucieux du bien-être des jeunes du Québec. Conçue à la fin des années 1990 pour approfondir nos connaissances sur le développement des enfants, elle suit une cohorte de 2 120 enfants depuis leur naissance en 1997-1998; jusqu’à la plus récente collecte de données en 2024. Forte d’une méthodologie rigoureuse et innovante, l’étude a évoluée au fil du temps pour s’adapter à la croissance des jeunes participants tout en profitant des nouvelles technologies. Grâce à un partenariat engagé et faisant le pont entre la gouverne et le milieu de la recherche, l’étude a pu perdurer et demeurer une référence en termes de qualité et de potentiel d’analyses.
Cette communication vise à présenter un survol de la méthodologie d’enquête et de son évolution afin de situer les présentations qui suivront.
-
Communication orale
Mégatendances sociétales et santé mentale des jeunes : Perspectives à partir de l'Étude longitudinale du développement des enfants du QuébecMarie-Claude Geoffroy (Université McGill), Vincent Paquin (Université McGill), Francis Vergunst (Université de Montréal)
La santé mentale des jeunes, y compris celle des participants de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ), se détériore à l'échelle mondiale. Les participants de la première édition de l’ELDEQ (ELDEQ 1), depuis leur naissance, ont été témoins de changements sociaux significatifs susceptibles d'avoir influencé leur santé mentale. Ces changements incluent l'urbanisation croissante et la réduction du contact avec la nature, la présence des écrans dans les foyers dont l’ordinateur et les jeux vidéo, l’émergence des réseaux sociaux et du cyberharcèlement, une sensibilisation accrue aux problématiques climatiques et environnementales, ainsi que les défis posés par les mesures sanitaires durant la pandémie de COVID-19.
Cette présentation vise à mettre en lumière les recherches publiées à partir des données de l’ELDEQ 1 qui ont exploré les associations entre ces tendances sociétales (aussi appelé mega-trends) et la santé mentale à l'adolescence durant les années 2010 et à l'âge adulte dans les années 2020. L'objectif est de mettre en évidence les associations entre ces grandes tendances sociétales et divers indicateurs de santé mentale, incluant la dépression, l'anxiété, le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité, les troubles psychotiques, et les idées suicidaires chez les jeunes.
-
Communication orale
L'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec : une opportunité unique pour étudier les trajectoires développementales au cours des 25 premières années de vieMichel Boivin (Université Laval), Sylvana Côté (Université de Montréal), Marie-Claude Geoffroy (Université McGill), Massimiliano Orri (Université McGill), Richard E. Tremblay (Université de Montréal)
En 1998, plus de 2000 enfants et leurs familles ont commencé leur participation à l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ 1). Vingt-cinq ans après, leur participation à des enquêtes annuelles ou chaque 2 ans a permis à de nombreux chercheurs d’avoir une panoplie des données leur permettant de former un portrait complet du développement humain. Ces données s’étendent de la période périnatale à l’âge adulte, en passant par des étapes clés de vie telles que l’âge préscolaire, scolaire, et l’adolescence. De plus, elles comprennent les domaines les plus importants de la vie, tels que l’éducation, le développement physique, et la santé mentale. Ici, nous allons présenter des études exemplifiant ce que les données de l’ELDEQ 1 nous ont permis d’apprendre lorsqu’on adopte une perspective développementale sur plus de deux décennies de vie. Ces études montreront comment on a pu découvrir 1) les liens entre développement périnatal et santé mentale à long terme, 2) l’influence des expériences éducatives à la petite enfance sur le développement cognitif, socioaffectif, et éducatif plus tard dans la vie, et 3) les trajectoires développementales des symptômes intériorisés et extériorisés pendant l’enfance et l’adolescence. Nous allons terminer en discutant des nouvelles perspectives pour exploiter les données longitudinales de l’ELDEQ 1 au travers de l’appariement des données d’enquête avec les données médico-administratives du Québec.
-
Communication orale
Les risques de blessures professionnelles et leurs déterminants parmi les jeunes travailleurs du Québec entre 2015 et 2021Jaunathan Bilodeau (IRSST), Marc-Antoine Busque (IRSST), Martin Lebeau (IRSST), Alain Marchand (IRSST)
Les jeunes travailleurs sont identifiés comme une population particulièrement à risque de subir une blessure professionnelle. Ce constat a conduit plusieurs gouvernements, dont le Québec, à cibler prioritairement ce groupe de la population quant à la prévention des risques de blessures au travail. Malgré cet intérêt envers les jeunes travailleurs au Québec, les profils de blessures professionnelles parmi ce groupe ainsi que la contribution des différents facteurs de risques demeurent à explorer dans l’optique de mener des interventions plus adaptées. Ce projet vise ainsi à (1) documenter le profil des trajectoires de blessures professionnelles chez les jeunes en fonction de la fréquentation scolaire et du statut d’emploi et (2) identifier les déterminants des blessures professionnelles parmi ces différents groupes. Des analyses de séquences et de cheminement ont été réalisées à partir d’une cohorte de travailleurs entre 15 et 23 ans ayant répondu à l’ELDEQ 1 entre 2015 et 2021. Les résultats suggèrent que certaines trajectoires professionnelles et scolaires sont associées à davantage de risque de blessures. Néanmoins, ces associations se feraient plutôt indirectement à travers l’exposition à des facteurs de risques dont les demandes psychologiques et physiques selon les catégories de sexe. Ces résultats contribuent à fournir un portait plus compréhensif des risques de blessures professionnelles ainsi que de leurs déterminants parmi les jeunes travailleurs au Québec.
Dîner
Premiers résultats de la deuxième édition de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ 2)
Bâtissant sur le riche héritage de l’ELDEQ 1, l’ELDEQ 2 vise à répondre aux besoins de connaissance concernant le développement des enfants nés au Québec à l’aube des années 2020. Cette grande étude permettra d’en apprendre davantage sur le contexte de vie des enfants et de mieux comprendre les besoins des familles. L’Institut de la statistique du Québec et les partenaires souhaitent poursuivre l’étude jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge adulte.
L’objectif principal de l’étude Grandir au Québec est de mieux connaître les facteurs qui peuvent influencer le développement et le bien-être des enfants du Québec. Se greffent à cet objectif central plusieurs objectifs secondaires dont :
- étudier les facteurs qui prédisent l’adoption de saines habitudes de vie et un état de santé optimal;
- déterminer les prédicteurs de la persévérance et de la réussite scolaires;
- cerner les processus qui favorisent l’adaptation sociale;
- mettre en évidence les facteurs associés à la mobilité sociale;
- étudier les processus qui mènent à une insertion socioprofessionnelle réussie.
Les premiers résultats sont présentés et ouvrent la voie pour de nombreux autres à venir.
-
Communication orale
La deuxième édition de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ 2) : survol de la méthodologie de cette nouvelle étudeCatherine Fontaine (Institut statistique Québec), Nancy Illick (ISQ - Institut de la statistique du Québec), Delphine Provençal (Institut statistique Québec)
Débutée plus de vingt ans après la première édition, la deuxième édition de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, aussi appelée Grandir au Québec, a vu le jour afin de répondre aux besoins de connaissance concernant le développement des enfants nés au Québec à l’aube des années 2020. La quatrième collecte de données s’amorce en mai 2024 et l’Institut de la statistique du Québec et les partenaires de l’étude souhaitent suivre cette cohorte de plus de 4 500 bébés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte. Les orientations générales de cette étude portent, entre autres, sur le développement global de l’enfant, l’environnement familial, les comportements, les habitudes de vie et les caractéristiques socioéconomiques. Les riches expériences de la première édition ont d’ailleurs été bénéfiques pour convenir des paramètres méthodologiques, qui seront présentés lors de cette présentation. Un rapport méthodologique complet a d’ailleurs été diffusé à l’automne 2023. Quelques publications sur des thématiques variées ont été diffusées dernièrement ou le seront dans les prochains mois; les principaux résultats seront présentés dans les présentations qui suivront.
-
Communication orale
Parce que la question n’est plus de savoir si l’adversité affecte la santé future, mais comment : Examen des mécanismes de stress dans les cohortes de l’ELDEQIsabelle Ouellet-Morin (UdeM - Université de Montréal)
Il est reconnu que les expériences d’adversité, telles que la précarité économique, les pratiques parentales hostiles et l’intimidation par les pairs, sont associées à plusieurs problèmes de santé et du comportement, dont certains persistent à l’âge adulte. Cette conférence présentera plusieurs études menées (et en cours) examinant la force du lien proposé entre ces expériences et deux mécanismes de stress ‒ le cortisol et la méthylation de l’ADN‒ ainsi qu’au lien les unissant avec les symptômes dépressifs au sein de l’ELDEQ 1. Nous ferons notamment état de l’association liant les expériences d’intimidation par les pairs et les indices cumulés d’adversité recensées au cours de l’enfance et de l’adolescence avec les différences individuelles notées sur le cortisol et sur les horloges biologiques épigénétiques liées au vieillissement. Nous examinerons ensuite les limites de ces études, notamment en regard de l’absence de mesures répétées de stress. Ces constats ont permis de concevoir un projet de recherche ambitieux actuellement mené au sein de l’ELDEQ 2, incluant le prélèvement de trois mèches de cheveux réalisé lorsque les enfants ont 1½, 2½ et 3½ ans. Nous ferons un premier bilan de cette nouvelle collecte. Finalement, nous discuterons de l’importance des cohortes de l’ELDEQ pour étudier les mécanismes physiologiques, cognitifs et affectifs par lesquels les expériences d’adversité peuvent induire une vulnérabilité, mais aussi de la résilience à vivre de problème de santé.
-
Communication orale
Portrait du milieu de vie des bébés nés au tournant des années 2020 et de l’expérience périnatale de leurs parents : les premiers résultats de l’ELDEQ 2Amélie Lavoie (Institut de la statistique du Québec)
La petite enfance est une période charnière au cours de laquelle les enfants développeront de nombreuses compétences cognitives, langagières, émotionnelles et sociales. Durant leurs premières années de vie, les tout-petits sont donc particulièrement affectés par ce qui se passe dans leur environnement familial. La grossesse et l’accouchement représentent également des périodes sensibles pouvant affecter le développement de l’enfant. C’est d’ailleurs en pleine pandémie que les mères et pères des bébés nés en 2020-2021 ont traversé la période périnatale.
Dans quel environnement vivent les bébés nés en 2020-2021? Comment la grossesse de leur mère et leur naissance se sont-elles déroulées? Dans le cadre de cette présentation, nous reviendrons sur les principaux résultats diffusés dans les deux premiers rapports de l’ELDEQ 2. Il sera notamment question des caractéristiques des parents et des familles, de l’environnement résidentiel, des habitudes de vie des mères durant la grossesse, des services qu’elles ont utilisées et des répercussions qu’a eu la pandémie sur les services périnataux et sur certains aspects de la vie des parents.
-
Communication orale
Portrait des parents de l’ELDEQ 2 : pratiques parentales, relations, habitudes de vie et santé des mères et des pères des bébés d’environ 5 moisChristine Doucet (Institut de la statistique du Québec)
En tant que principaux pourvoyeurs de soins au bébé durant ses premiers mois de vie, les parents lui fournissent l’environnement qui influencera son bien-être tout au long de sa vie. Mieux comprendre le vécu des parents contribue donc à une meilleure connaissance des facteurs liés à la santé et au développement de l’enfant. Cette présentation abordera quelques aspects de la vie des parents des bébés d’environ 5 mois participant à l’ELDEQ 2, aussi appelée l’étude Grandir au Québec, par exemple leurs pratiques parentales, leurs relations conjugale et coparentale, leurs habitudes de vie et leur santé. Des éléments de réponse aux questions suivantes seront fournis :
- Comment caractériser les pratiques parentales des mères et des pères des bébés? Dans quelle mesure ces pratiques ont-elles changé depuis la première édition de l’ELDEQ en 1998?
- Comment se portent leurs relations conjugale et coparentale, 5 mois après l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille?
- Comment caractériser leurs habitudes de vie sur le plan de la consommation de substances et de l’utilisation des écrans?
- Comment perçoivent-ils leur santé?
Certains résultats seront également présentés en fonction des caractéristiques des parents (p. ex., le plus haut diplôme obtenu) de la famille (p. ex., le type de famille) et du ménage (p. ex., le niveau de revenu du ménage).
-
Communication orale
Consolidation du sommeil de nuit des enfants de l’ELDEQ 2 : une pierre d’assise pour le développement du sommeil et l’influence du stress associé à la pandémieMichel Boivin (Université Laval), Gabrielle Fréchette-Boilard (Université du Québec à Trois-Rivières), Léa Houde (Université du Québec à Trois-Rivières), Evelyne Touchette (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
Contexte. L’ELDEQ 1 a permis de constater qu’environ 23.5% des enfants à 5 mois ne dormaient pas 6h consécutivement et les comportements parents autour du sommeil se sont avérés fortement associés à la consolidation du sommeil (Touchette et al., 2005). Objectifs. Deux questions sont abordées : 1) les caractéristiques de sommeil sont-elles différentes chez le groupe de bébés ayant consolidé un sommeil de nuit (>6h) et le groupe n’ayant pas encore fait cette acquisition (<6h)? et 2) le stress perçu de la mère à l’égard de la pandémie est-il un facteur associé à une mauvaise consolidation de sommeil de nuit? Méthode. Dans l’ELDEQ 2, cohorte de bébés québécois nés entre octobre 2020 et septembre 2021, les données ont été colligées auprès des parents sur une vaste gamme de facteurs bio-psycho-sociaux dont le sommeil lorsque les bébés avaient 5 mois. Résultats. Une majorité de parents (51.6%) ont rapporté que leurs bébés ne dormaient pas 6 heures consécutivement la nuit. Ce groupe rapporte moins de sommeil de nuit, se réveille plus longtemps la nuit et a un ratio de sommeil plus élevé (jour/nuit) (P<.001) comparativement à l’autre groupe. Le stress perçu de la mère à l’égard de la pandémie a été rapporté comme un facteur diminuant la consolidation de sommeil. Conclusions. La consolidation du sommeil de nuit est un indicateur dans le développement du sommeil. Le stress perçu de la mère à l’égard de la pandémie est un facteur associé à la consolidation du sommeil de nuit.
-
Communication orale
La coparentalité perçue par le père prédit les symptômes de dépression de la mère : un modèle d’interdépendance acteur-partenaireAudrey-Ann Deneault (University of Calgary), Caroline Fitzpatrick (Université de Sherbrooke), Gabrielle Garon-Carrier (UdeS - Université de Sherbrooke), Laurie-Anne Kosak (Université de Montréal), Marie-Josée Letarte (Université de Sherbrooke), Célia Matte-Gagné (Université Laval)
La transition vers la parentalité est une étape importante à la vie adulte. Durant cette période, les parents sont plus à risque de symptômes de dépression et d’anxiété. Ceci ne serait pas sans conséquences pour l’enfant. Les enfants de mères en dépression postpartum sont eux-mêmes à risque de comportements intériorisés (ex., anxiété) et extériorisés (ex., agressivité) à 2 ans. Dans ce contexte, la coopération au sein du couple vis-à-vis l’éducation de l’enfant revêt une importance particulière. Cette étude examine l’association entre la coparentalité et la dépression de la mère et du père dans les 5 mois suivant la naissance de l’enfant et les facteurs pouvant altérer cette association, dont le revenu familial et le soutien émotionnel. Ce projet met à contribution les données de l’ELDEQ 2. Les symptômes dépressifs, la perception de la coparentalité et le soutien émotionnel reçu ont été rapportés par les pères et les mères (N= 3854 dyades). Les mères ont aussi rapporté le revenu annuel familial avant taxes. Un modèle d’interdépendance acteur-partenaire a révélé que la coparentalité perçue par la mère et par le père prédit leurs symptômes dépressifs respectifs. La coparentalité perçue par le père prédit également le niveau de dépression de la mère. Une évaluation négative de la coparentalité par le père constitue un facteur de risque additionnel aux symptômes de dépression de la mère. Les conséquences pour le développement du jeune enfant seront discutées.
En quoi les données administratives, jumelées aux données d’enquêtes longitudinales, peuvent-elles bonifier les possibilités d’analyses scientifiques? Le cas de l’ELDEQ
En recueillant des données principalement par l’administration de questionnaires auprès de différentes sources d’information (les parents, les enfants, leurs enseignants), la première édition de l’ELDEQ a permis une production scientifique très riche. Cette étude a également bénéficié de l’apport de certaines données administratives, mais de manière plutôt limitée. Lors de la conception de la deuxième édition de l’ELDEQ, la contribution potentielle des données administratives selon une approche visant à maximiser l’exploitation de telles données, combinées à celles obtenues par enquêtes, a été adoptée. Que ce soit en créant de nouveaux indicateurs ou en remplaçant des questions d’enquête par des variables de sources administratives, la combinaison de ces deux types de données offre de nouvelles possibilités d’analyses des plus innovantes. C’est avec l’objectif de discuter de ces opportunités d’analyse que cette table ronde a été organisée. Réunissant des acteurs principaux des deux études longitudinales sur le développement des enfants, ce sera l’occasion de revenir sur les utilisations de données combinées à ce jour, de présenter les avancées prévues en la matière et d’étendre les réflexions sur des plans à plus long terme.
Mot de clôture
Des collaborations exceptionnelles pour l’avancement des connaissances : depuis 25 ans et pour encore 25 ans!
Grâce à une collaboration exceptionnelle de plus d’une centaine de personnes provenant de différents milieux universitaires et gouvernementaux, l’ELDEQ 1, qui a démarré sous l’initiative de chercheurs chevronnés, a maintenant 25 ans. Des centaines d’articles et de rapports ont été produits au Québec et à l’international et d’importantes données probantes ont été communiqués aux ministères et intervenants de différents milieux. Toujours active, cette étude est devenue une plateforme inspirante et solide pour mettre en place une nouvelle cohorte, qui encore une fois voit un nombre impressionnant de professionnels, chercheurs et partenaires collaborer pour assurer la cueillette et la diffusion de résultats importants pour nos enfants nés au début des années 2020. Cette activité permettra de souligner les importantes contributions des partenaires de l’ELDEQ 1 et de l’ELDEQ 2, des chercheurs ainsi que celle des répondants qui permettent de mener à bien ces études d’envergures depuis 25 ans et pour encore de nombreuses années.