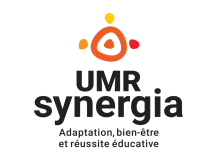Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 500 - Éducation
Description :Le plan d’intervention (PI) représente l’outil de planification et de concertation utilisé par l’école pour organiser les services éducatifs adaptés aux élèves présentant un handicap, des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (MEQ, 2004). Pour répondre à leurs besoins, le PI doit être coconstruit avec l’élève et ses parents (Cavendish et Connor, 2018). Or, plusieurs obstacles à la participation des élèves et de leurs parents à l’établissement des PI demeurent. Par ailleurs, il a été largement démontré qu’une communication et une collaboration école-famille positives font partie des premiers facteurs de protection pour favoriser la persévérance et la réussite scolaire, peu importe les milieux socioéconomiques et ethnoculturels et quels que soient l’âge, le niveau scolaire ou les caractéristiques personnelles de l’élève (p. ex., Deslandes, 2019; Epstein et al., 2018). Pour y parvenir, différentes initiatives ont été réalisées. D’une part, pour soutenir l’autodétermination des élèves ciblés par l’établissement d’un PI et, d’autre part, pour tirer profit du numérique.
Ce colloque vise ainsi à rassembler tous les acteurs du PI œuvrant dans les milieux scolaires, de la santé et des services sociaux, ainsi que les chercheurs et étudiants interpellés par l’importance de la mise en place de pratiques collaboratives efficaces, éthiques et durables selon une perspective inclusive et universelle.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables : Partenaires :Programme
Accueil
Approches en soutien au développement de pratiques collaboratives dans l’établissement des plans d’intervention
-
Communication orale
J'ai MON plan! Une approche en soutien à l'autodétermination des élèves et aux pratiques collaboratives de ceux qui les accompagnentNancy Gaudreau (Université Laval)
Bien que les politiques et cadres de références reconnaissent que les élèves et les parents doivent jouer un rôle actif dans l'établissement des PI, des recherches démontrent que ceux-ci sont souvent peu préparés et impliqués dans ce processus (Woods et al., 2013). Or, pour favoriser la réussite éducative des élèves présentant des difficultés d'adaptation, ceux-ci doivent faire l'apprentissage de comportements autodéterminés (Field et Hoffman, 2012). Pour soutenir l'autodétermination de l'élève, la démarche du PI doit lui permettre de définir et d'atteindre ses buts en fonction de sa connaissance de soi et de la reconnaissance de sa valeur (Field et Hoffman, 1994).
Considérant l'importance de la mobilisation de tous les acteurs concernés par la réussite des élèves PDA et le besoin de formation à cet égard, en partenariat avec plusieurs milieux scolaires, une équipe de chercheurs a codéveloppé la trousse J'ai MON plan!. Cette trousse a pour objectif de favoriser l'engagement de tous les acteurs du PI et le développement de l'autodétermination des élèves PDA. Cette communication présente les fondements théoriques de cette approche ainsi que les conditions de mise en œuvre de celle-ci.
-
Communication orale
J’ai MON plan Numer-ActifJustine Bourque (Collège de L'Assomption), Sarah Danis (Université Laval), Bianka Durocher (Centre de services scolaire des Affluents), Hélène Pelland (Collège de L'Assomption), Audrey Raynault (Université Laval)
La collaboration école-famille est présentée comme facteur soutenant la réussite par plusieurs auteurs (Bronfenbrenner, 1974; Deslandes, 1996; Epstein, 2018; Larivée, Kalubi et Terrisse, 2006). En effet, l’implication parentale, tout comme la participation active de l’élève dans l’élaboration et la mises en œuvre de mesures soutenant ses apprentissages favoriseraient le développement d’habiletés liées à son autodétermination. Il semble ainsi essentiel d’impliquer et d’accompagner l’élève à travers chacune des étapes de son plan d’intervention pour lui offrir un soutien adapté (Gaudreau et al., 2022; Raynault, 2022; Duchaine et al., 2020). Grâce au numérique, la communication et la collaboration entre l’école et la famille ont le potentiel de se dérouler de manière continue pour soutenir l’élève à travers son cheminement scolaire et éducatif, et ce, autant à la maison qu’à l’école (Raynault, 2022).
Cette communication présente des résultats préliminaires d’une recherche collaborative encourageant la participation active des personnes de quatre communautés scolaires et les affordances essentielles de communication et de collaboration pendant le cycle de vie du PI (Allaire, 2006; Moreno et Mayer, 2007). Les interactions entre l’élève, ses parents, ses enseignant-e-s et ses intervenant-e-s seront observées dans des contextes où le numérique est/pourrait être utilisé pendant le cycle de vie du PI afin d’identifier les facteurs facilitant et entravant leur pluridirectionnalité.
Soutien à la transformation des pratiques d’établissement des plans d’intervention
-
Communication orale
Former et accompagner les équipes-écoles à l’approche J’ai MON plan!Marie-Pier Duchaine (Université Laval), Catherine Lizotte (Conseil de la Nation huronne-wendate/École Wahta'), Catherine Lizotte (Conseil de la Nation huronne-wendate/École Wahta'), Nathalie Turmel (Centre de services scolaire de la Capitale)
Plusieurs recherches américaines ont démontré l'efficacité de dispositifs de formation sur le PI (p. ex. Field et al., 1998; Hart et Brehm, 2013) ainsi que les effets positifs liés à l'implication active des élèves dans leur PI (Wehmeyer et al., 2007). Toutefois, peu de recherches ont permis d'identifier les conditions de déploiement d'une approche similaire à celle faisant l'objet de ce symposium. Cette communication présente les facteurs favorisant et entravant l'appropriation et l'engagement des acteurs du PI dans la mise en œuvre de l'approche J'ai MON plan! Pour ce faire, 14 entretiens de groupe auprès du personnel scolaire participant et un entretien de groupe auprès des sept professionnels responsables de la formation et de l'accompagnement du personnel scolaire ont été réalisés. Les témoignages des participants ont permis d'identifier les facteurs qui favorisent ainsi que ceux qui entravent le déploiement de l'approche et l'engagement des acteurs du PI. Les modalités de formation déployées dans les divers milieux scolaires participant ainsi que les stratégies d'accompagnement utilisées seront discutées de manière à faire valoir les conditions favorables au déploiement de l'approche au sein des écoles primaires et secondaires.
-
Communication orale
Évolution de l’agentivité (pouvoir d'agir) des parents et autres participants à la recherche collaborative Mixité 2.0Stéphane Allaire (Université du Québec à Chicoutimi), Sarah Danis (Université Laval), Francine Julien-Gauthier (Université Laval), Élodie Marion (Université de Montréal), Louise Patenaude (Université Laval), Audrey Raynault (Université Laval)
Les interventions utilisées pour enseigner et promouvoir l’agentivité de l’élève, plus précisément celles liées à l'autonomie (Test et al., 2005), à l'autodétermination (Algozzine et al., 2001) et à la participation des élèves pendant les phases du cycle de leur Plan d'intervention (Chandroo et al., 2018 ; Griffin, 2011 ; Test et al., 2004) favoriseraient l'atteinte des objectifs fixés et leur réussite (Gaudreault et al., 2022). Pour Bandura (2001), l’agentivité est la capacité humaine à mobiliser son pouvoir d'agir intentionnellement sur le cours de sa vie et de ses actions. Cela peut être sous l’effet de l’intervention directe, ou collective, de la personne ou par le biais d’une procuration d’autres personnes quand on cherche à atteindre des buts par la coordination et l’interdépendance des efforts d’un groupe dans un système d'activité (Engeström, 2015). Cette communication présente comment à travers les étapes d'une méthodologie de codesign des personnes participantes à la recherche-action MIXITÉ 2.0 issues de quatre milieux scolaires (acteurs des écoles, élèves et parents), d'un CIUSSS ont fait émerger leur agentivité par leur participation active, en favorisant d’abord celle de l’élève et de leurs parents dans une approche collaborative (Rogoff et al., 2001).
Dîner libre
Participation des autres acteurs scolaires
-
Communication orale
Expérimentation de l’approche J’ai MON plan! Retombées sur les élèves et leur vécuVincent Bernier (UQAM - Université du Québec à Montréal), Isabelle Poulin (Université du Québec à Montréal)
Plusieurs auteurs reconnaissent que la participation active des élèves dans toutes les sphères de la vie scolaire est un ingrédient essentiel favoriser des expériences scolaires positives et soutenir la réussite de l’inclusion scolaire (p. ex., Groves et Welsh, 2010). Or, peu d’élèves participent à leur propre démarche d’établissement de plan d’intervention(PI) (p. ex. Martin, et al., 2006). Portant, les élèves devrait réellement être au cœur de l’élaboration leur PI et les principaux acteurs de sa mise en œuvre. Cette communication vise à présenter les retombées perçues par soixante-trois élèves du primaire et du secondaire de l’expérimentation de l’approche « J’ai MON plan! ». Les résultats obtenus se déclineront selon le degré de participation, l’appréciation de l’approche, l’efficacitédes outils et les changements perçus à la suite du PI établi lors de la démarche. Les facteurs influençant la mise en œuvre de l’approche seront aussi décrits à partir du point de vue des élèves participants.
-
Communication orale
Évolution de la participation de trois élèves HDAA inclus en classe régulière aux rencontres de développement et d’implantation du plan d’intervention Numér-Actif dans leur écoleStéphane Allaire (Université du Québec à Chicoutimi), Bianka Durocher (Centre de services scolaire des affluents), Maha Guesmi (Université Laval), Francine Julien-Gauthier (Université Laval), Audrey Raynault (Université Laval)
Bien que le plan d'intervention (PI) soit une stratégie de soutien fréquemment mise en œuvre au sein des écoles primaires québécoises pour garantir la progression et la réussite des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA), une condition essentielle pour assurer le succès de cette démarche est la participation active des élèves. Ce faisant, il est indispensable de fournir un environnement qui favorise des pratiques collaboratives entre les différents acteurs du PI (parents, enseignants, acteurs sociaux, etc.) pour maximiser la participation active de l’élève. Bien que ces recommandations ne soient pas récentes, leurs mises en pratique demeurent difficiles. Ainsi, cette étude vise à documenter l'évolution de la participation de trois élèves HDAA inclus en classe régulière aux rencontres de développement et d’implantation du plan d’intervention Numér-Actif dans leur école. Cette étude, à travers l’analyse d’un cas d’un groupe de trois élèves HDAA, poursuit une initiative plus large d’une équipe de recherche collaborative formée d’élèves, de parents et d’intervenants d’une école et d’un CIUSSS et de chercheurs ont fait émerger des résultats sur l’usage du numérique, à travers un dispositif de PI conçu pour expérimenter et observer ses affordances pendant le processus d’un cycle de vie d’un PI.
-
Communication orale
La perception des rôles des enseigants en éducation physique dans la démarche du plan d’interventionNancy Gaudreau (Université Laval), Elyse Minville (Université du Québec à Montréal), Claudia Verret (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Le plan d’intervention (PI) représente un outil privilégié pour planifier et organiser les services scolaires afin de répondre aux besoins des élèves ayant des difficultés. Or, la participation des spécialistes en éducation physique (EP) est très peu sollicitée dans la démarche du PI. Pourtant, ces personnes côtoient les élèves au quotidien et les voient évoluer dans des contextes souvent différents de celui de la salle de classe.
L’objectif de cette recherche qualitative interprétative est de documenter le point de vue des personnes enseignantes en EPS sur le rôle qu’elles jouent dans l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’intervention. Quatre personnes du primaire et quatre du secondaire seront sollicitées pour participer à une discussion de groupe qui portera sur la perception de leur rôle dans dans les étapes d’une démarche de PI ; leurs perceptions de leurs apports potentiels au PI, leurs besoins pour participer activement au PI afin de soutenir les élèves présentant des difficultés.
Les données feront l’objet d’analyses thématiques mixtes. Cette recherche éclairera un angle mort de ce processus scolaire important. Les points de vue des spécialistes en EP contribueront à soutenir les apports potentiels d’acteurs scolaires pouvant jouer un rôle important dans l’analyse systémique de la situation des élèves présentant des difficultés et faire émerger leurs forces dans des contextes scolaires différents.