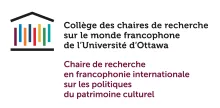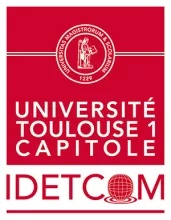Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :Dans le champ des politiques de la culture, il est d’usage de référer au modèle américain, au modèle britannique, ou encore, au modèle français comme des archétypes de politiques culturelles qui agissent comme autant de modèles nous permettant de catégoriser, d’organiser et de comparer différentes politiques et formes de gouvernance de la culture. Ces grands modèles nationaux, utilisés dans les recherches comparatives, cachent peut-être des dynamiques institutionnelles, politiques et professionnelles qui sont plus complexes.
Dans le cadre de ce colloque, nous nous intéressons aux forces de l’histoire, aux liens culturels et à la langue comme étant des vecteurs d’institutions, de modèles de référence, mais aussi comme étant des forces habilitant des manières de penser, de problématiser et de structurer le secteur des arts et du patrimoine. Plutôt que de penser aux modèles de gouvernance de la culture à partir des grands archétypes nationaux de référence, nous souhaitons décentrer le regard sur les affaires culturelles pour l’élargir et le poser sur les espaces linguistiques et civilisationnels. À l’instar du monde anglophone, hispanophone ou lusophone, le monde francophone est un espace de circulation et de diffusion d’idées culturelles, de modèles et de pratiques sur lesquels les décideurs et professionnels de la culture prennent appui.
Ce colloque invite les universitaires à s’intéresser aux politiques, aux pratiques et aux expertises de la culture (art et patrimoine) qui circulent au sein du monde francophone. Il s’agit de mettre en relief certaines singularités et différences qui émergent dans la manière dont on aborde plusieurs grands sujets actuels, notamment la restitution des biens culturels, la diplomatie culturelle, les pratiques de patrimonialisation, le financement des arts et du patrimoine, l’inclusion, la démocratisation et la participation culturelle ainsi que la culture à l’ère du numérique.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Jonathan Paquette (Université d’Ottawa)
- Christophe Alcantara (Université Toulouse 1 Capitole)
- Gabriela Sanchez (Université d’Ottawa)
- Nicolas Peyre (Université Toulouse Capitole (Idetcom))
Programme
Mot de bienvenue
Patrimoine intangible/immatériel en Afrique francophone
-
Communication orale
Repenser les pratiques culturelles « d’Autres » mondes francophones. Des sources inépuisables de savoirs patrimoniauxDe B'béri Boulou Ebanda (Université d’Ottawa)
La rumba ou « nkumba » (nombril en kikongo), dans sa formulation originale, décrit l'union et le frottement des nombrils, une danse qui marquait les célébrations pour les populations du Royaume du Kongo (qui s’étendait sur ce que nous connaissons aujourd'hui comme l’Angola, la République du Congo et la République Démocratique du Congo), (Unesco, 2022). Cette description de la rumba offre un prétexte à cette communication. En effet, dans « d’Autres » mondes francophones d’Afrique et dans les Antilles, il semble s’y produire des pratiques culturelles en marge du discours dominant sur le patrimoine culturel francophone. C’est ainsi qu’en 2021, seulement, la « rumba congolaise » réussissait d’entrer dans ce monde de la reconnaissance internationale ; mais combien d’autres expressions culturelles de ces Autres mondes sont encore dans les marges patrimoniales de la culture francophone? Cette étude préface une recherche complexe et longitudinale visant, entre autres, à conceptualiser l’arbre de connaissances d’une intelligence collective illustrant les différentes pratiques culturelles dans les mondes francophones d’Afrique et des Antilles noires, en ce qui concerne notamment : (1) leurs rapports à l’histoire ; (2) leurs pratiques de survie, de détournement ou de marronnage (de Certeau, 1990; Ebanda de B’béri, 2012) et (3) leurs stratégies opératoires pour maintenir un équilibre écologique, vivre-ensemble et assurer la paix sociale (Glissant, 2006).
-
Communication orale
L’évolution de l’implication de la femme dans le paysage artistique africain en Afrique centrale et des grands lacsSaturnin Bouye (Université des Beaux-arts, Cameroun), Julia Ndibnu-Messina Ethé (Université de Yaoundé I)
Dans son livre « l’art et l’artisanat africain », (Mveng, 1980) entreprend une rétrospective sur les différents arts en Afrique. Non seulement son étude porte sur les spécificités de l’art africain, mais également sur l’aspect du genre dans l’art. De ce qu’il en ressort, il existe des arts réservés aux hommes et des arts exclusivement réservés aux femmes. La sculpture par exemple était uniquement réservée aux Hommes parce que sollicitant un effort physique considérable. Il fallait par exemple abattre l’arbre sur lequel on allait sculpter. Cette étude se fonde sur une approche qualitative qui combine une recherche documentaire et une grille d’observation qui déterminent les pratiques artistiques en Afrique, notamment dans la sculpture, la poterie, le tissage et le dessin. Les résultats illustrent que, malgré l’évolution de l’implication de la femme dans l’art en Afrique, la conception traditionnelle de l’égalité hommes-femmes dans la transmission de l’art est loin d’être réglée. Certaines sociétés africaines présentent encore des traditions qui appellent à l’exclusion de la femme dans certains domaines requérant une force physique ou une présentation devant des personnalités masculines avec un enracinement culturel éprouvé.
-
Communication orale
Droits linguistiques et patrimoine immatériel au Congo. Quel statut juridique pour les langues vernaculaires ?Ulrich Kevin Kianguebeni (Université Marien Ngouabi)
La République du Congo est une ancienne colonie française qui a acquis son indépendance en 1960. À cet effet, le pays a opté pour le français comme langue officielle, langue de l’administration, en raison des liens historiques et culturels entre la métropole et l’ancienne colonie. Ce principe a été consacré par toutes les Constitutions que le Congo a connues depuis son indépendance. Outre la langue officielle qui est le français, il y a deux langues nationales : le kituba, majoritairement parlé au sud du pays, et le lingala, pratiqué au nord du pays. À côté de ces trois langues ayant statut officiel, il existe une multitude de langues que l’on peut qualifier de vernaculaires, communément parlées au sein de chaque communauté. Des langues qui constituent un patrimoine immatériel inestimable mais sans existence légale malgré leur importance dans la vie sociale.
-
Communication orale
Problématique de pérennisation du patrimoine linguistique et identitaire chez les Nguiemboon en pays bamiléké au Cameroun : pratiques, défis et perspectivesBasile Difouo (École normale supérieure, Université de Maroua)
Cela ne fait aucun doute, la question relative à la pérennisation et à la préservation du patrimoine culturel (vue globale) se pose avec acuité en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Sans nécessairement épouser et/ou prôner la théorie de la victimisation, il apparaît clairement que, à l’image de plusieurs autres Nations et peuples dans le monde, le continent africain vit depuis plusieurs siècles au rythme d’une mue voulue par les mouvements des hommes à des fins de conquête ou de découverte. D’une manière ou d’une autre, et pour des raisons multiples, les habitudes culturelles, sous toutes leurs formes, en ont pâti. Si l’une des raisons majeures réside en l’oralité qui est un moyen de transmission essentiellement défaillant, éphémère et volatile (contrairement à l’écrit), il reste évident que le choc avec d’autres civilisations, quoique bénéfique à plus d’un titre, a eu raison de nombreuses pratiques socioculturelles. L’art culinaire, la spiritualité, l’onomastique, les langues, la médecine et bien d’autres us/coutumes ont ainsi, par divers mécanismes, connu une sorte de phagocytose au profit de l’ailleurs. La finalité est d’aboutir à des perspectives nouvelles pour une conservation plus aboutie du patrimoine culturel en général.
Culture, patrimoine et coopération au sein du monde francophone
-
Communication orale
Les musées, entre influence et incommunicationNicolas Peyre (Université Toulouse Capitole (Idetcom))
Les musées peuvent être analysés aussi comme des « instruments de pouvoir (Paquette, 2015) car comme Dominique Poulot a pu l’écrire « le musée traditionnel incarne l’accord entre les pouvoirs et l’art, au nom d’une conception selon laquelle l’art est indispensable à la grandeur des États, voire à la paix sociale et à la prospérité des manufactures, tandis que, inversement, le génie requiert la reconnaissance publique » (Poulot, 2010). C’est à la question de la géopolitique des musées à l’instar de François Mairesse (2010) ou d’Emmanuel Lincot et d’une « géopolitique du patrimoine » (Lincot, 2021) que nous nous intéresserons et plus particulièrement à la stratégie et aux modalités de la mondialisation du Centre Pompidou (France). La création dans le monde hispanique (Espagne), asiatique (Chine) ou anglophone (États-Unis) de musées valorisant la marque « Centre Pompidou » est soutenue par la diplomatie culturelle et ses acteurs. Dès lors c’est précisément à l’objectif assigné à cette politique publique qui est « au croisement de la politique culturelle et de la politique internationale, elle est la politique internationale menée dans le champ de la culture » (Lombard, 2022) que nous porterons notre analyse. L’influence est le nouveau paradigme de la politique culturelle extérieure de la France (Chaubet, Faucher, Martin, Peyre, 2024).
-
Communication orale
Provenances, enjeux et perspectives autour de biens culturels en provenance du Bénin conservés en France. Exemple de travail collaboratif au Muséum d’histoire naturelle de ToulouseThéo Atrokpo (Tour de Théo), Sylviane Bonvin (Muséum de Toulouse), Isabel Nottaris (Université Bourgogne)
Dans un contexte de débats internationaux sur la légitimité des musées occidentaux à détenir des biens acquis dans des conditions de violence coloniale, il devient nécessaire d’approfondir les recherches de provenance des collections en collaboration avec différents acteurs universitaires, patrimoniaux et “sachants” en France comme au Bénin. Cette communication se propose de présenter un projet collaboratif et transcontinental qui s’inscrit dans le sillage des nouvelles pratiques de recherches participatives et de projets inclusifs qui se développent depuis quelques années dans les musées conservant ce type de collections. Parmi les biens culturels africains conservés au muséum d’histoire naturelle de Toulouse, les objets en provenance du Bénin sont une quarantaine. Les plus anciens datent de la fin du XIXe siècle et ont été acquis en contexte colonial, les plus récents ont été achetés sur le marché de l’art sans informations détaillées sur leur contexte d’appropriation. Le Muséum de Toulouse a initié en 2022 et 2023 un travail collaboratif autour de ces objets mobilisant une dizaine d’acteurs béninois, mêlant professionnels des musées, universitaires, étudiants et “sachants”. Ce projet s’inscrit dans la durée et doit se poursuivre dans les années à venir.
-
Communication orale
Les enjeux de la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain colonial français au Vietnam : le cas du pont Long BienChloé Phan-Labays (Université Jean Moulin Lyon 3)
Avec un siècle de colonisation française au Vietnam, il est indéniable que la culture vietnamienne d’aujourd’hui s’est imprégnée de l’héritage culturel français, ceci sur les plans matériels comme immatériels. La France a modernisé plusieurs villes vietnamiennes en y introduisant de nouveaux quartiers et infrastructures selon les normes urbaines et architecturales françaises et qui restent encore en usage.Le patrimoine urbain de la période coloniale française au Vietnam n’a pas encore fait l'objet de recherches et d'évaluations à l’échelle nationale. Choisir des méthodes et des outils appropriés pour analyser et évaluer les caractéristiques et les valeurs des quartiers formés pendant la période coloniale française dans les grandes villes du Vietnam s’avère indispensable afin de les préserver contre les tentatives croissantes de leur démolition ou déformation ainsi que de les valoriser dans la stratégie de développement du tourisme du patrimoine culturel et de l’économie nationale. Notre recherche s’appuiera sur le cas d’étude du projet de restauration du pont Long Bien dont l’ancien nom porte celui du Gouverneur de l’Indochine Paul Doumer (1897-1902).Notre travail consiste à voir dans quelle mesure la méthode de « conservation adaptative » s’appliquera au projet de restauration du pont Long Bien qui représente des enjeux multiples : architectural, culturel, historique, économique, et francophone.
-
Communication orale
Le monde francophone et les trajectoires de la coopération culturelle et patrimoniale au Vietnam, Laos et CambodgeJonathan Paquette (Université d’Ottawa), Gabriela Sanchez (Université d'Ottawa)
À l'instar des arts et des industries culturelles, le champ du patrimoine constitue une des principales matières des activités de coopération culturelle et de diplomatie culturelle. Depuis plusieurs décennie, la coopération culturelle a été un des outils de développement des relations internationales pour plusieurs grandes puissances. Or, au-delà des enjeux géostratégiques de telles coopération se cache un enjeu de développement des politiques culturelles. Cette communication documente un peu plus de quatre décennies de coopération culturelle entre la France, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. En particulier, cette communication met l'accent sur la coopération dans le champ patrimonial et met en relief les actions françaises de coopération dans le domaine architecturale, dans le domaine de la conservation, dans le domaine du livre et dans le domaine du patrimoine documentaire. Cette analyse de l'évolution des rapports entre la France et ces nations de l'Asie du Sud-Est permet d'identifier 1) comment la question de la francophonie participe à la construction de ces actions de coopération; 2) les transferts d'expertise, mais aussi les transferts de politique qui découlent de ces actions; 3) la créativité des actions et des acteurs locaux dans le cadre des coopérations.
Culture, patrimoine et citoyenneté à l’ère du numérique
-
Communication orale
Délibérons ! Les organismes de la communauté franco-colombienne et la délibération démocratique dans l’environnement numériqueAliyah Datoo (SFU - Simon Fraser University)
Ce projet interprétatif explore le rôle des organismes communautaires dans la structuration des discussions en ligne au sein de la communauté franco-colombienne. Il y a des limites en place dans le monde physique pour la communauté, telles que la domination de l’anglais et la dispersion territoriale. Les réseaux sociaux reflètent ces mêmes réalités tout en ayant parfois leurs propres limites, mais présentent aussi certaines manières de leur échapper. Ils offrent aux utilisateurs non seulement la possibilité d’entrer en dialogue avec d’autres, mais aussi de définir collectivement leur communauté d’appartenance et la nature de leurs discussions. La théorie de la délibération démocratique et de sphères publiques d’Habermas sert de cadre d’analyse pour comprendre la nature plus ou moins démocratique des discours en ligne. À travers des entretiens avec des employé.es des organismes à but non-lucratifs au sein de la communauté franco-colombienne qui, eux et elles, peuvent observer et influencer le dialogue sur les réseaux sociaux, je vise à comprendre la façon dont les communications (re)produisent la communauté en ligne. La recherche explorera dans quelle mesure les réseaux sociaux offrent un espace pour les utilisateurs dans cette communauté de se parler entre eux, et le rôle que les organisations communautaires joue dans ces discussions.
-
Communication orale
Culture scientifique et pseudoscientifique dans le paysage télévisuel québécoisAlexandre Schiele (Hebrew University of Jerusalem)
La société québécoise est technoscientifique. Et tant la science et la technologie que leur compréhension par le public sont centrales au développement collectif comme individuel. Autrement dit, elles sont l’une des dimensions fondamentales de la culture québécoise contemporaine. Or, si pour des raisons évidentes, l’État québécois est très actif dans la promotion de la culture au sens large, il l’est aujourd’hui moins dans celle de la culture scientifique. Cela dit, le Covid 19 lui a rappelé à la fois l’importance de la communication scientifique et du rôle joué par le politique dans cette communication. Par contraste, en Alberta, où l’État n’a pas activement endossé ce rôle, la mortalité a été plus importante. Mais, au Québec comme en Alberta, sans culture scientifique, comment décoder les messages, et surtout distinguer ce qui relève du fait scientifique, et ce qui n’en relève pas, d’autant que le discours antivaccin se présente comme étant raisonnable. Or, une fois la crise sanitaire passée, la communication scientifique d’État au Québec est revenue au niveau prépandémique, tandis que l’hésitation face aux vaccins augmente. L’internet et les médias sociaux jouent incontestablement un rôle. Cela dit, la télévision continue d’occuper une place centrale dans la vie des Québécois, alors que le paysage télévisuel québécois demeure peu étudié.
-
Communication orale
Sur les traces des médias de l'an 2000 : entre volatilité numérique et préservation culturelleBrigitte Sebbah (Université Toulouse 3 Paul Sabatier)
L'essor de la presse en ligne en France autour des années 2000, a engendré une pléthore d'initiatives, de la création de nouveaux médias en ligne (Mercier, 2014) à la mise en ligne des contenus de médias existants. Les médias natifs numériques ont couvert une diversité de sujets, généraliste, locale ou spécialisée. En effet, l’absence de subventions pour les médias numériques jusqu’en 2003 conjuguée à l’absence d’un répertoire national officiel des médias subventionnés et des hauteurs de subventions accordées, pose problème à la fois en termes de bien culturel public, d’histoire des médias mais également en termes de patrimoine culturel disparu ou partiellement disparu (Sebbah, 2022). Pour le chercheur en journalisme, tout questionnement sur l’évolution économique ou éditoriale des médias nés en ligne affronte le trou noir de ces disparitions. Il faut rappeler pourtant que l’information d’actualité et l’activité de presse sont peu rentables, et traversent depuis la fin des années 2000 une crise profonde, avec la fuite et baisse des revenus publicitaires et l’absence d’un modèle d’affaires clair sur le numérique (Degand, Grevisse, 2012). Cette recherche se focalise donc sur les "trous noirs" de la mémoire médiatique, et discutera du statut de ces médias en tant qu’entités culturelles non préservées et témoins essentiels de l’histoire médiatique et numérique contemporaine.
Dîner libre
Politiques de la culture : processus et stratégies patrimoniales
-
Communication orale
Politique et gestion culturelles au Bénin : défis et enjeux d’une structuration verticaleOpêoluwa Blandine Agbaka (Université d'Abomey-Calavi)
Les politiques culturelles au Bénin après les indépendances de 1960 sont restées pendant longtemps, collées à la dynamique coloniale de la France qui place l’Etat au cœur du système de gestion des programmes culturels. Il conçoit, construit et met en œuvre les politiques culturelles qui posent les bases de la gestion légale et administrative de la culture. En 1991, la Conférence Nationale des Forces vives de la Nation a replacé la culture au centre du développement et en a fait un levier important des actions de construction de la nation béninoise. Cette réorientation a permis de poser dans la charte et politique culturelles de 1991, les fondations d’un système de gestion verticale qui consacre l’Etat comme premier acteur et les collectivités territoriales comme acteurs secondaires.Toutefois, cette structuration verticale, même si elle permet de fédérer les principaux acteurs autour d’une vision centrale, peine à favoriser le dynamisme et l’intégration des acteurs locaux pour une gestion adaptée aux réalités locales. Quels sont les enjeux et défis liés à la gestion culturelle au Bénin ? Quelles sont les implications pour les principaux acteurs du secteur ? La présente communication propose une réflexion sur la politique et la gestion culturelle au Bénin à travers une analyse du cadre légal et administratif.
-
Communication orale
Les chemins de Compostelle : Approche comparative dans la gestion et la valorisation du bien UNESCO entre la France et l’Espagne.Christophe Alcantara (Université Toulouse 1 Capitole)
Les chemins de Compostelle sont un bien hétérogène inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993 pour l’Espagne et en 1998 pour la France. La croissance continue de la fréquentation des chemins depuis plus de 30 ans est à ce jour un phénomène de société qui dépasse largement la sphère religieuse. Les collectivités territoriales considèrent les chemins comme un levier économique des territoires ruraux traversés par les chemins. Au-delà de cette apparente problématique commune de chaque côté des Pyrénées, il y a des enjeux culturels, historiques, patrimoniaux et politiques propres à l’Espagne et à la France qui font qu’il n’y a pas de continuum dans la gestion du bien entre ces deux pays européens frontaliers. Cette communication propose d’interroger les singularités de chacun des pays dans leur relation au pèlerinage vers Compostelle et de mettre en tension ces réalités de terrain par rapport au label « premier itinéraire culturel » accordé par le conseil de l’Europe en 1987 et à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO accordé en 1993 aux chemins espagnols et en 1998 aux chemins français.
-
Communication orale
Villers-Cotterêt : La Cité internationale de la langue française ou des langues françaises et des cultures francophones ?Martine Corral-Regourd (Université Toulouse 1 Capitole)
La Cité internationale de la langue française a été inauguré en novembre 2023. au Château de Villers-Cotterêt , lieu hautement symbolique de l’unification de la langue française.Le projet scientifique de l’établissement porte sur la prise en compte des langues françaises et des cultures francophones, considérées comme autant de moyens d’action pour définir une notion inclusive de la francophonie articulée sur des identités transnationales.Cette communication se propose de mesurer l’effectivité de ce contenu par un dialogue instauré entre la Cité et le Forom des langues du monde, manifestation, initiée en 1990, à Toulouse, pour promouvoir la pluralité des langues, comme vecteur de cohérence culturelle. Elle se fonde sur des entretiens avec les acteurs initiateurs de la Cité et les responsables du Forom des langues.
-
Communication orale
Les processus de déploiement de Partout la culture politique culturelle du Québec : les enjeux dans la (re)configuration de l’écosystème muséal.Mariana Castellanos (ENAP - École nationale d'administration publique)
Dans cette recherche, on s’intéresse aux processus de déploiement des politiques culturelles, particulièrement ceux qui modèlent la politique culturelle du Québec Partout, la culture. On utilise le terme « déploiement » pour nommer les processus générés au moment de son renouvellement, après qu’elle a été adoptée à l’Assemblée nationale en 2018. On propose une analyse par process tracing (Van De Ven, 1992 ; Pentland, 1999 ; Langley, 2009 ; Bennett, 2012) du croisement des trois i : intérêts, idées et institutions (3i) (Palier & Surel, 2005). Cette démarche permet de constater dans quelle situation l’un ou l’autre des 3i peut être déterminant dans le déploiement d’une politique culturelle. Cette approche a la vertu d’esquisser la dynamique entourant les interactions entre les différentes dimensions sans l’établissement d’une hiérarchie fixe. Ce qui semble une manière de conceptualiser le déploiement d’une politique en dehors de la logique séquentielle et linéaire traditionnellement utilisée. De plus, l’approche du process tracing propose une façon pour (re)tracer le déploiement de Partout la culture, un phénomène temporel en évolution. On explore en particulier l’écosystème muséal québécois, en raison du rôle que jouent les termes « culture » et « patrimoine ».
Le renouveau de l’action culturelle au Québec : acteurs, politiques et stratégies
-
Communication orale
Politique culturelle du Québec « Partout la culture » : qu’en est-il dans les régions?Julie Bérubé (UQO - Université du Québec en Outaouais), Loïc Mineau-Murray (Université du Québec en Outaouais)
En 2018, le gouvernement du Québec s’est doté d’une nouvelle politique culturelle intitulée : Partout la culture. Cette politique s’appuie sur quatre orientations, dont la troisième : « Dynamiser la relation entre la culture et le territoire ». Cette orientation veut reconnaître le rôle des municipalités en termes de culture, prendre en compte la diversité des régions et prôner l’équité. Le Québec, une province francophone dans un pays majoritairement anglophone, doit protéger sa culture et une politique culturelle forte est nécessaire. La troisième orientation de la politique culturelle du Québec entend promouvoir la culture propre à chaque région du Québec. Nous identifierons quelques initiatives montrant la force de certaines régions à promouvoir la culture francophone régionale. Nous aborderons également les enjeux auxquels font face les différentes régions en nous appuyant sur la perspective des conseils régionaux de la culture. Cette communication propose une réflexion quant au lien entre une politique culturelle provinciale en milieu francophone et son déploiement dans les régions. Nous identifierons des pistes de réflexions et d’action afin de favoriser le rayonnement culture en région et de rendre la culture accessible à tous les citoyen∙nes.
-
Communication orale
Mettre en œuvre une politique des arts et de la citoyenneté culturelle pour une université : une étude auprès de la communauté universitaire et des milieux culturelsHervé Guay (Université du Québec à Trois-Rivières), Marie-Claude Larouche (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
Notre étude se veut une contribution à l’une des priorités du Plan stratégique de l’UQTR, visant à faire reconnaître Trois-Rivières comme une ville universitaire. Préparatoire à la mise en œuvre de la Politique des arts et la citoyenneté culturelle (PACC) adoptée par l’UQTR en 2021, elle comporte deux volets. Le premier, à l’interne, a donné lieu notamment à un sondage en ligne rempli par une cinquantaine de répondants et à la passation d’une quarantaine d’entretiens semi-dirigés (Larouche et Guay, 2024). Le second, réalisé à l’externe, a rejoint les milieux culturels des trois principales régions où l’UQTR a des campus, la Mauricie, le Centre-du-Québec et Lanaudière. Nous ferons état des démarches et des résultats obtenus pour le volet interne et externe, celui-là réalisé par la firme Artefact urbain grâce à l’appui financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec (Artefact urbain, 2023).
-
Communication orale
Entre Montréal et Saint-Étienne, le développement de politiques (francophones) de promotion du designGuillaume Sirois (UdeM - Université de Montréal)
En 2006, la ville de Montréal se joint au Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans la discipline du design. Elle est alors la première ville francophone à le faire, mais sera suivie, quatre ans plus tard, par la ville de Saint-Étienne en France. Les liens historiques et culturels entre le Québec et la France semblent avoir favorisé les relations entre les deux métropoles. Cette communication propose un regard croisé sur le développement des structures et politiques mises en place dans les deux villes pour favoriser la promotion du design.Les deux villes ont échafaudé des modèles organisationnels contrastés : la première privilégie une structure municipale de promotion, logée au sein de son équipe de développement économique, alors que la seconde organise son action autour d’une structure éducative chargée d’enseignement, de recherche et de diRusion du design. Malgré cette diRérence organisationnelle notable, les échanges entre les deux villes ont été importants au cours des dernières années. L’influence de Montréal est notable dès le dossier de candidature de Saint-Étienne, lequel répertorie plusieurs initiatives organisées avec la métropole québécoise. Cette collaboration s’est d’ailleurs poursuivie au sein du réseau, notamment grâce à l’organisation de plusieurs conférences conjointes, à la reproduction d’initiatives de promotion et aux échanges de créateurs.
-
Communication orale
Les passeurs culturels : pour former des ambassadeur∙ices de la culture en OutaouaisJulie Bérubé (Université du Québec en Outaouais), Julien Doris (Université d’Ottawa)
Le programme des passeurs culturels a vu de jour en 2017 à l’Université de Sherbrooke. Cette initiative permet aux étudiant∙es universitaires en enseignement d’accéder à des activités culturelles dans l’objectif de transmettre l’amour de la culture aux enseignant∙es et qu’il∙elles deviennent des ambassadeur∙trices de la culture québécoise auprès de leurs élèves. Cette initiative soutenue par le gouvernement du Québec est en adéquation avec la politique culturelle de celui-ci qui cherche notamment selon sa première orientation à « contribuer à l’épanouissement individuel et collectif grâce à la culture ». L’Université du Québec en Outaouais (UQO) est la première université du Réseau des universités du Québec à mettre en place ce projet et à avoir lancé une entente en 2023 avec trois grands diffuseurs culturels locaux : la maison de la culture de Gatineau, la galerie UQO et le conservatoire de musique de Gatineau. La situation de l’Outaouais est particulière compte tenu de sa situation frontalière avec Ottawa, majoritairement anglophone. Ce programme vise en outre à faire rayonner la culture de la région de l’Outaouais et à favoriser l’accès aux contenus culturels locaux et francophones. Cette communication soulignera ainsi le potentiel de cette initiative en postulant qu’elle puisse possiblement constituer un référentiel de politique publique culturelle à l’échelle des municipalités (Jobert et Muller, 1987).