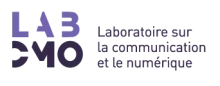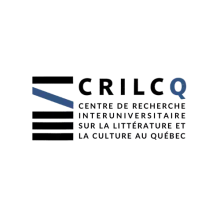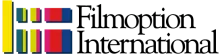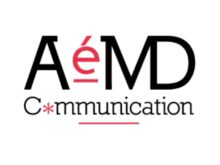Informations générales
Événement : 90e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :Depuis les années 1990, les études de fans ont participé à déconstruire les préjugés tenaces à l’endroit des fans, souvent perçus comme peu réflexifs et obsédés par leur objet culturel favori. Ces recherches ont démontré la réception active et même performative des fans, en documentant leurs pratiques culturelles, allant de la création de contenu (fan fiction, fanart) à la médiation culturelle (fan subbing). Les communautés de fans, nommées fandoms, offrent des espaces de négociation aux idéologies représentées dans les productions culturelles. D’ailleurs, plusieurs recherches démontrent que les pratiques de réception des fans leur permettent de critiquer les productions médiatiques (Jenkins, 1992).
Bien que les études de fans se soient constituées en champ de recherche fécond (Bacon-Smith, 1992; Jenkins, 1992), elles restent sujettes à certaines critiques qui entravent leur quête de légitimité (Evans et Stasi, 2014). La position des chercheur·se·s en études de fans est sujette à contestation (Hannell, 2020) et le champ entretient des rapports ambivalents quant à la méthodologie. La définition de la notion même de fans est critiquée (Sandvoss et al., 2017), alors que des recherches plus diversifiées permettraient de prendre en compte d’autres expériences (anti-fans, non-fans, etc.) et profils de fans (queers, personnes racisées, etc.). Néanmoins, les travaux sur les fans forment une contribution manifeste et même innovante à l’aspect entremêlé des pratiques de réception en ligne et hors ligne (Evans et Stasi, 2014), à l’appropriation et au détournement de la culture populaire (Bourdaa, 2021), ainsi que aux contextes de créations et productions de contenus numériques (Hills, 2015).
Depuis 30 ans, les Fan Studies forment un champ de recherche dynamique, surtout dans les milieux anglophones. Du côté de la recherche francophone, les études de fans, après avoir accusé un certain retard, semblent entrer dans une phase importante de structuration. Par exemple, l’Association française des sciences de l’information et de la communication (SFSIC) a récemment labellisé Groupe d’étude et de recherche « Fans » (GER Fans), coordonné par Mélanie Bourdaa.
Ce colloque, présenté dans le cadre du congrès de l’Acfas 2023 (colloque no 403), représente ainsi une occasion de réunir des chercheur·se·s francophones provenant de chaque côté de l’Atlantique. L’événement, en personne et en ligne, offrira ainsi une occasion fertile de contribuer à la structuration du champ d’études en français et de saisir le momentum entourant l’intérêt renouvelé autour des fans et leurs pratiques, autant chez les chercheur·se·s que chez les étudiant·e·s.
Les trois axes suivants seront mis de l’avant : 1) les enjeux méthodologiques; 2) la diversité des identités de fans; et 3) la dimension politique des pratiques de fans.
Remerciements :Le comité scientifique tient à remercier le Laboratoire sur la communication et le numérique (LabCMO), l'Association des étudiant·e·s de la maîtrise et du doctorat en communication de l'UQAM (AéMDC), Filmoption ainsi que Sébastien François, Madeleine Pastinelli, Camille Nicol et Dominique Gagnon pour leur soutien.
Dates :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Mélanie Millette (UQAM - Université du Québec à Montréal)
- Stéfany Boisvert (UQAM - Université du Québec à Montréal)
- Camille Nicol (UQAM - Université du Québec à Montréal)
- Dominique Gagnon (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Programme
Conférence d’ouverture : Mélanie Bourdaa
Conférence d’ouverture par Mélanie Bourdaa, Université Bordeaux Montaigne.
Figure incontournable des travaux sur les fans, Mélanie Bourdaa a notamment signé les ouvrages Les études de fans : communautés, pratiques et engagements (2021) et Fan Studies, Gender Studies. Le retour (avec A. Alessandrin, 2019).
Publics et réception
-
Communication orale
Le jeu d’imitation comme méthode pour tester les producteurs et leurs publics, réels et imaginés : Étude de cas de Radio-Canada Ottawa-GatineauPhilippe Ross (Université d’Ottawa)
Qu’est-ce qui caractérise le public d’un média donné et dans quelle mesure les producteurs le connaissent-ils ? Des recherches récentes se sont penchées sur le « public imaginé » de journalistes (Coddington et collab. 2021 ; Nelson 2021) et d’usagers des médias sociaux (Gil-Lopez et collab. 2018 ; Litt et Hargittai 2016), mais celles-ci n’ont généralement pas cherché à mettre les connaissances des producteurs à l’épreuve – encore moins avec le concours des publics concernés. C’est ce que nous avons fait dans le cadre d’un projet qui conceptualise l’orientation des producteurs vers leurs publics et les connaissances tacites au cœur de leurs pratiques (Ross 2014), et qui déploie – pour la première fois en communication, à notre connaissance – la méthodologie du jeu d’imitation (Collins et Evans 2017, 2013 ; Collins et collab. 2017), proche parent du test de Turing.
Cette communication présentera les résultats d’une série de 12 jeux d’imitation au cours desquels des artisans de Radio-Canada Ottawa-Gatineau ont tenté de passer pour des membres de leur auditoire aux yeux de fidèles auditeur·rices jouant le rôle de juges. Au-delà du taux de réussite des producteurs dans ce contexte, la communication portera sur les particularités de la méthodologie et ses avantages pour l’étude des publics, auditoires ou communautés de fans, notamment la production de données qualitatives potentiellement très riches en ce qui a trait à l’identité du groupe-cible. -
Communication orale
Penser l'anti-fan autrement : l'anti-fan féministe ?Dominique Gagnon (UQAM - Université du Québec à Montréal)
La communication proposée est une exploration théorique de la posture d’anti-fan (Gray, 2003), laquelle est généralement associée aux postures réactionnaires d’individus se plaçant en opposition à un texte culturel et véhiculant des propos violents (Jane, 2014, 2019). Ainsi, bien que cette haine de l’Autre soit effectivement omniprésente dans les études sur les anti-fans, la haine n’est pas être le seul élément conceptuel qui distingue le fan de l’anti-fan. En effet, des chercheur·euse·s observent une visée transformative chez certains groupes d’anti-fans (Rendell, 2019). Il importe alors de considérer le texte auquel les anti-fans réagissent et son influence sur leurs pratiques.
Une exploration de la littérature scientifique actuelle sur différents cas d’anti-fans réagissant à une marginalisation médiatique (Sobande et al., 2020) me permettra de problématiser les anti-fans de manière conceptuelle et contextuelle. L’objectif est de démontrer en quoi le contexte entourant le texte culturel influence la compréhension conceptuelle de l’anti-fan dans les travaux. Je présenterai alors les éléments qui permettent de penser la définition d’un anti-fan féministe, un concept qui m’apparait possible malgré son absence dans la littérature.
-
Communication orale
Complexifier les analyses des représentations vidéoludiques par une étude de réception : Le cas de Lara CroftElodie Simard (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Les représentations stéréotypées et hypersexualisées des personnages féminins sont souvent désignées comme un des facteurs qui dissuadent les femmes de s’intéresser au média puisque cela donne l’impression que les jeux vidéo s’adressent spécifiquement aux hommes hétérosexuels (Lynch et al., 2016). Par ailleurs, un contact répété avec les stéréotypes de genre peut renforcer leur incidence sur l’estime personnelle des joueur·se·s, leur image corporelle, leur perception de la féminité et de la masculinité, leur réflexivité par rapport aux stéréotypes de genre, etc (Trépanier-Jobin, 2012). Cependant, l’analyse textuelle ne suffit pas pour comprendre l’impact possible des représentations vidéoludiques puisque les jeux vidéo ne peuvent être pensés indépendamment de leur rapport aux joueur·se·s et de leur expérience ludique. En effet, le jeu est une « activité vécue » qui existe uniquement dans l’expérience du joueur ou de la joueuse (Bonenfant, 2015). Le jeu est donc toujours actualisé par les joueur·se·s, leurs interprétations et leurs usages. À partir d’une étude de réception sur les fans de Tomb Raider, cette communication visera à nuancer les analyses des représentations vidéoludiques. En effet, il apparaît que les fans interrogé·e·s n’objectivent pas Lara Croft, mais accordent davantage d’importance à sa personnalité, ce qui semble avoir une incidence sur la manière dont il·elle·s l’incarnent ainsi que sur la relation d’identification qu’il·elle·s établissent avec l’héroïne.
Pause dîner
Dîner libre. Notez que des options alimentaires seront offertes sur le campus, sinon plusieurs restaurants se trouvent dans le secteur Côte-Des-Neiges. Nous vous invitons à vérifier les distances sur l'application de votre choix pour vous assurer un retour en salle à 13h45.
Perspectives théoriques
-
Communication orale
L’univers de Star Trek au-delà des frontières de l’économie politique de la culture et de la communication et des Cultural StudiesÉric George (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Comment aborder les activités des fans ? Du côté des travaux en économie politique de la culture et de la communication, l’accent est mis sur leur rôle en tant que consommateurs et consommatrices très actifs, voire comme un vivier de talents potentiels susceptibles de participer à la production de nouveaux contenus. Du côté des Cultural Studies, les travaux mettent en exergue le fait que le rôle des amateurs-fans est plutôt relié à la production de l’identité à travers leurs actions avec éventuellement l’adoption d’un positionnement critique, voire d’une résistance par rapport à la marchandisation systématique de la culture ou à la domination de rapports de genre relevant du patriarcat. Dans notre présentation, nous souhaitons montrer la pertinence d’une démarche dialectique qui dépasse les analyses théoriques jusqu’alors séparées en tenant compte des différentes « réalités » à l’oeuvre OU ceci est ceci mais ceci est aussi cela.
Nous le ferons dans le cadre de l’univers de Star Trek depuis sa création en 1966 : huit séries télévisées (788 épisodes), treize longs métrages, des centaines de romans et de bandes dessinées et des dizaines de jeu vidéo… ainsi qu’une production importante de fans. De la pertinence d’analyser les relations conflictuelles entre la direction de la franchise propriétaire, Paramount Global et les fans à travers l’histoire de la série, en tenant compte à la fois d’éléments issus de l’EPCC et des CS.
-
Communication orale
Les possibles queer d’une posture incertaine pour l’étude des fansMarta Boni (UdeM - Université de Montréal)
Cette présentation explore la dimension de l’incertitude dans les méthodologies de recherche sur les fans, mobilisant des questionnements éthiques et politiques à partir d’une perspective féministe, queer et allophone. J’aborderai deux questions principales : comment étudier les fans tout en n'en étant pas une, et quelles sont les possibilités d'un bricolage méthodologique centré sur l'incertitude ?
Je conçois les séries télé comme des univers transmédiatiques élargis par les pratiques non officielles. L’observation de leurs traits formels et de leur genèse industrielle est inséparable des appropriations des fans. Cependant, dans ma pratique personnelle je ne me considère pas une fan. En travaillant sur ces objets en marge de la culture officielle qui constituent une archive désordonnée et sauvage (De Kosnik 2016 j’adopte une approche queer qui met au centre l'incertitude. Ainsi, je discuterai la place des théories faibles (Nelson 2021), des pratiques mettant ouvertes à l’échec, au sauvage (Halberstam 2011 et 2020). C’est dans cette voie intermédiaire que je développe des méthodologies mixtes, queer, parce que liées à des objets queer ou parce que croches, que l’on peut définir suivant une structure du sentiment du pathétique (Myles 2022). J’explorerai la place que les études des fans peuvent prendre dans une posture de recherche et dans l'enseignement universitaire en acceptant l'incertitude et le désordre, ce qui peut générer un dérangement des marqueurs de légitimité.
-
Communication orale
Paradigme non-représentationnel et notion d'enchantement : une exploration spéculative de l'expérience d'être fanMarie-Pierre David (Université d’Ottawa)
Vers quoi nous dirige l’« articulation » (Slack, 2016) de l’expérience d’être fan à l’aide du paradigme non-représentationnel (Vannini, 2015) ? Quels peuvent être les enjeux épistémologiques et politiques d’une telle approche (David, 2021) ? Comment penser l’expérience d’avoir été fan durant son enfance à l’aide de ce paradigme une fois devenu.e adulte et chercheur.e ? Quelles possibilités une telle démarche peut-elle offrir ? Peut-on mettre la mode et les fans en relation ? Voilà les questions que j’entends couvrir dans ma communication.
La méthode de l’« articulation » :
Issue des études culturelles, l’« articulation » est une méthode analytique permettant la cartographie d’un phénomène culturel au-delà de toute forme d’essentialisme (Slack, 1996).
La particularité du paradigme non-représentationnel :
Actuellement influent, mais aussi controversé (parce qu’il se pose aux antipodes de la pensée représentationnelle en refusant le recours à la signification et aux représentations), le paradigme non-représentationnel s’inscrit dans la continuité de la pensée post-structuraliste. Il invite les chercheurs à appréhender les phénomènes sous l’angle de l’expérimentation en ayant notamment recours aux théories de l’affect (Gibbs, 2010), à la recherche-création (Manning et Massumi, 2014) ainsi qu’aux études performatives et autoethnographiques (Jones, Adams et Ellis, 2016).
Fandoms : dynamiques et interactions
-
Communication orale
Expressivités, créativités et échanges autour de Dark et de Stranger Things. Catégorisation de dynamiques faniques en interactionSylvie Périneau-Lorenzo (Université de Limoges)
Pour aborder les pratiques faniques, notre proposition croise les perspectives des SIC et des SDL et s’appuie sur les notions d’économie culturelle (Milon 1999, Lessig 2008). L’objectif est de proposer des pistes pour une catégorisation interdisciplinaire de dynamiques faniques en interaction. Comment éclairer ensemble le remake d’une scène de Stranger Things, le partage d’une collection de goodies dédiée à cette même série ou la déclaration d’amour à Dark par des fans qui n’ont en commun que leur engouement ? Ces exemples s’inscrivent dans une productivité langagière, qu’ils servent de supports à des expressions individuelles ou qu’ils affirment une créativité aussi illimitée que diverse dans ses réalisations empiriques. Notre hypothèse est que les expressivités, créativités et échanges faniques en contextes numériques s’appréhendent en tant que :
- singularités, comme des empreintes esthético-langagières (Jeanneret 2008)
- sociabilités culturelles, comme des circulations négociées et des supports d’interactions (Bourdaa et al 2017; Le Guern 2009)
- objets symboliques, impulsés par des actes de langage plus ou moins explicites ou intentionnels (Lorenzo 2022).Nous construisons un corpus hétérogène de publications de fans francophones de Dark et de Stranger things, sur YouTube et sur Facebook. Pour expliciter ces dynamiques, nous définissons trois sphères médiatico-symboliques pertinentes : la sphère des actions, des passions, de la cognition et des représentations.
-
Communication orale
K-pop fangirls et YouTube : Une exploration de scènes culturelles numériques adolescentesNina Duque (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Plus que jamais, la culture populaire produite pour, à propos de, et par les adolescent.es, passe par une médiation numérique. Au Québec, YouTube est le réseau numérique le plus utilisé par les adolescent·es (NETendance, 2020) et offre des espaces uniques pour afficher leurs appartenances culturelles (Burgess et Green, 2009). La K-pop, un fandom transculturel (Chin et Morimoto, 2013), permet d’observer l’entrelacement entre culture populaire, technologie et pratiques culturelles adolescentes (Han, 2017). Ainsi nous proposons une réflexion sur la construction d’espaces de pratiques culturelles numériques à l’intersection de la culture participative (Jenkins, 2004), des cultures adolescentes (Pasquier, 2005) et de la sociologie des usages (Proulx, 2015). Les résultats présentés sont issus d’une recherche exploratoire d’un groupe d’ami·es fangirls de K-pop de Montréal effectuée en 2018-19. Les pratiques observées se déclinent dans trois espaces numériques organisés et bricolés : un niveau macro qui agit à l’étape de la découvrabilité et qui s’inscrit dans une dynamique dialogique et participative ; un niveau intermédiaire où les frontières entre produits officiels, pratiques professionnelles et productions amateurs s’entremêlent ; et la présence de « micros-communautés », signes d’une culture participative locale. Notre communication vise à apporter une contribution à l’étude d’une population adolescente à partir de leurs propres pratiques culturelles et numériques.
-
Communication orale
Les fangames ou comment mettre sa passion au travailSacha Maltais (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Notre communication a comme objectif de questionner les enjeux liés au travail nécessaire dans la production de fangame en positionnant les fangames comme une pratique de fan.
Les fangames sont des jeux créés gratuitement par des fans. Cela signifie que les fans ne sont pas rémunérés pour leur travail sur ces jeux. Il est possible de mettre en corrélation la production des fans - qui est liée à leur passion pour un objet culturel - et leur exploitation par des compagnies qui utilisent cette passion comme levier d’exploitation économique (Standfill, 2019 : 151-152). Les compagnies profitent alors de la passion de leurs employés pour les jeux vidéo pour normaliser des conditions de travail qui seraient souvent considérées comme étant inacceptables. (Standfill et Condis, 2014 : 2.5).
Face à ce brouillage des frontières entre amateurs et professionnels; lovebor, production de fan et travail salarié, nous nous posons la question suivante : En quoi les pratiques de fans nécessaires dans la production d’un fangame relèvent d’une forme de travail et quels sont les enjeux de telles pratiques ?
Lors de notre communication, nous voulons discuter de la place des fangames au sein des industries culturelles. Pour appuyer notre discussion, nous allons fournir une observation préliminaire de notre terrain de recherche, le Studio Lovelies, qui est un regroupement de fans qui produisent un fangame basé sur l’univers de la chaine YouTube GameGrumps.
Fans et formes d’engagement politique
-
Communication orale
Passion du football et expression patriotique des Camerounais fans de l'équipe nationale (Lions indomptables) sur les plateformes numériquesIsmaïla Datidjo (Université de Dschang), Freddy Tsopfack Fofack (INRS - Institut national de la recherche scientifique)
L'organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football en 2022 au Cameroun a été sujet de controverses avant et pendant la compétition, sur la capacité à assurer un bon déroulement du tournoi. Le report pour défaut de préparation et les incommodités de sécurité, de qualité des stades et de fiabilité des tests Covid évoquées par les nations participantes et les fans de leurs équipes au cours de l’évènement ont suscité des réactions à élan patriotique des Camerounais. Simultanément à la mobilisation des autorités publiques et du comité local d'organisation, celle des fans des Lions indomptables sur les réseaux sociaux numériques s’est développée pour défendre et promouvoir le label Cameroun. Autour du slogan «C’est notre CAN(NE)», «elle doit être sucrée», les témoignages «online» recueillies durant cette compétition entre janvier et février 2022, meublent la présente réflexion qui fonde son analyse sur le concept de «nationalisme par le bas», selon lequel le patriotisme peut trouver sa source dans les pratiques quotidiennes. Ce qui permet de rendre compte de celui des Camerounais fans de leur sélection nationale. Ainsi, cette étude s’oppose aux travaux sur la politisation des fans de football et sur l’activisme-fan qui appréhendent les fans comme des figures de contestation et de confrontation avec les autorités politiques de leur pays. Elle s’inscrit plutôt en ligne des études en dehors du sport qui soutiennent que le fanatisme est un instigateur de nationalisme.
-
Communication orale
De la longue éclipse aux gilets roses : de la marginalisation à la reconnaissance du fandom féminin dans le complexe médiatico-sportifFannie Valois-Nadeau (UQO - Université du Québec en Outaouais)
Cette présentation vise d’abord à documenter, nommer et reconnaître les femmes fans de sport professionnel qui font peu l’objet d’attention médiatique et académique. Le fandom féminin constitue la porte d’entrée pour interroger les transformations d’un sport media complex (Rowe, 2013) qui s’est construit au fil des années à travers la reproduction d’une hégémonie masculine et d’une marginalisation du public féminin (Esmonde et al., 2015; Svienson & Hoeber, 2016). Dès le début des transmissions télévisuelles dans les années 50 est apparu un complexe médiatico-sportif complètement « malestream » : athlètes, journalistes, dirigeants, commanditaires, etc. ont été les acteurs d’une industrie médiatique pensée par et pour les hommes (Cooky et al., 2013, 2021). Pourtant, le public féminin constitue de 30 à 50 % de l’auditoire des spectacles sportifs (Esmonde et al., 2015). Aussi, la présence d’un public féminin et de femmes fans ne date pas d’hier; des recherches à caractère historiques ont relevé leur existence au sein des périodes pré-télévisuelles (Field, 2012; Melançon, 2006). Depuis quelques années, le vent semble toutefois tourner dans le complexe médiatico-sportif: on assiste de plus en plus une certaine reconnaissance du fandom sportif féminin avec la venue d’un « marketing rose » (certes stéréotypé), mais aussi avec la montée de la professionnalisation des clubs sportifs féminins de même que la présence accrue de journalistes sportives (St-Pierre, 2020).
-
Communication orale
Les pratiques féministes des fans de littérature en ligne : exploration de Bookstagram et BooktokCamille Nicol (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Alors que le féminisme trouve de plus en plus sa place dans la culture populaire (Trier-Bieniek, 2020), les études montrent que les femmes sont encore sous-représentées ou réduites à des personnages stéréotypés ou sexualisés (Lupien et al., 2021). La culture populaire produit et partage des représentations hégémoniques du genre (Djavadzadeh, 2016), qui peuvent être critiquées par les fans. En effet, leur passion est parfois la source d’un engagement civique voire d’un activisme de fans (Brough et Shresthova, 2012 ; Jenkins et al., 2020). Les fans investissent alors les médias sociaux pour « faire bouger les choses » (Barel et Breda, 2020).
Sur Instagram et TikTok, les fans de littérature se rassemblent autour des mots-clics #Bookstagram et #Booktok. L’influence de ces communautés est telle que l’industrie du livre attribue une hausse de ses ventes au « phénomène Booktok » (Wiederhold, 2022). Je souhaite comprendre en quoi les pratiques engagées des fans sur ces plateformes participent à la remise en cause des représentations hégémoniques du genre dans la littérature et à la diffusion d’idées féministes.
Cette recherche s’appuie sur une méthodologie qualitative basée sur un modèle des données denses (Latzko-Toth et al., 2020). Cette communication abordera les résultats préliminaires issus de l’observation participante des communautés #Bookstagram et #Booktok, ainsi que des premières pistes de réflexion concernant les différentes catégories de pratiques féministes observées.
Fans et approches queers
-
Communication orale
De fans passionnés à fans toxiques: RuPaul’s Drag Race et la montée des cultures participatives LGBTQ+Vincent Arseneault (INRS), David Myles (INRS - Institut national de la recherche scientifique)
Cette présentation cartographie les mutations des cultures de drag engendrées par la montée des cultures participatives LGBTQ+. Si la relation entre les artistes drag et leurs publics s’est traditionnellement développée dans des lieux physiques, le Web 2.0 a contribué à l’émergence de nouvelles communautés de fans. Alors que l’art de la drag était initialement réservé à un public d’initiés, aujourd’hui, les médias sociaux permettent aux artistes drag de diversifier leurs publics géographiquement et démographiquement. Face à la popularité de la série de téléréalité RuPaul’s Drag Race, des artistes drag émergents ont su tirer profit des médias sociaux afin de bâtir des communautés de fans en ligne. De leur côté, les fans se sont appropriés les médias sociaux pour bâtir des relations de proximité avec les artistes drag et se réapproprier les contenus télévisuels à travers des mèmes et autres artefacts numériques. Ces communautés de fans sont également un lieu où se développe une littératie, quoique limitée, en matière de militantisme LGBTQ+. Les communautés de fans jouant désormais un rôle actif dans l’organisation des cultures de drag, les artistes drag sont devenus la cible d’adulation, mais aussi de violence en ligne de la part de fans particulièrement « toxiques ». À la lumière de ces mutations, cette présentation examine les implications des cultures participatives LGBTQ+ pour la scène de drag montréalaise en prévision d’un terrain ethnographique.
-
Communication orale
Identités et communautés lesbiennes : le rôle de la série télévisée The L WordAmy Rhanim (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Pour les minorités de genre ou sexuelles, les représentations dans la culture populaire ont une importance particulière en termes de points de repères, d’identification, de validation et de sentiment d’existence dans la sphère collective. Les représentations LGBTQ+ participent au sentiment d’appartenance à une communauté et peuvent faciliter la socialisation avec d’autres personnes partageant les mêmes référents. La série The L Word, créée par Ilene Chaiken met en scène la vie d’un groupe d’amies lesbiennes et la scène culturelle lesbienne dans le quartier West Hollywood à Los Angeles. En représentant de façon unique une culture et une communauté lesbienne, avec ses enjeux propres comme l’homoparentalité, la place de la transidentité, le désir lesbien, la lesbophobie ou l’hypersexualisation, la série est rapidement devenue centrale dans la culture populaire lesbienne. Elle est devenue un point de repère et de rencontre pour bon nombre de fans s’identifiant comme lesbiennes, tant sur internet que dans la vie réelle. Il est alors pertinent d’observer les espaces de socialisation et de solidarité lesbienne que cette série a permis de créer, ainsi que la façon dont elle a contribué au développement d’un sentiment d'appartenance à la communauté lesbienne en partageant des référentiels culturels communs, un idéal de vie inscrit dans la culture lesbienne, ainsi qu’une volonté de reproduction et d'identification sociale
-
Communication orale
« Love it or hate it, this is me, this is who I am ». Construction de l’iconicité queer de Nicki Minaj par les fans-artistes queersLucile Ouriou (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Dans le langage courant, le terme « icône queer » semble évident dans sa signification… Pourtant, lorsque l’on s’y attarde davantage, on observe des contradictions et des débats autour du terme, notamment concernant la prédominance des femmes (cisgenres) ayant ce titre (Besanvalle, 2017 ; Eilmus, 2020 ; Fekadu, 2012 ; Mann, 2020 ; Scott, 2019). Cettecontribution vise ainsi à explorer la manière dont Nicki Minaj est porteuse de sens queer, à travers les perspectives d’artistes et activistes queer. Comment les artistes queer perçoivent et interprètent-iels l’iconicité queer de Nicki Minaj ? Quel(s) rôle(s) symbolique(s) a-t-elle ou incarne-t-elle pour la communauté queer ?
Pour y répondre, des entretiens avec 5 artistes queers, fans de la rappeuse ont été réalisés et explorent les manières dont iels interprètent l’iconicité de Minaj. La rappeuse semble incarner une forme de rôle modèle (Fraser et Brown, 2002) pour elleux.Si ce terme, débattu en périphérie des fans studies et des youth studies, peut prêter à des débats (Morey et al., 2011), ici on observe une vision valorisante du statut de rôle modèle. Les participant.es suggèrent que Minaj démontre l’existence d’efféminités puissantes (Hale et Ojeda, 2018), et serait un modèle d’affirmation, performant les stéréotypes de genres, les déjouant et les transcendant. Ces points d’identifications semblent primordiaux pour les participant.es qui les étoffent par la suite d’enjeux queer et personnels dans leurs créations.
Pause dîner
Méthodes et méthodologie
-
Communication orale
À l’ère du game as a service : le moissonnage de données textuelles comme outil méthodologique pour analyser les dynamiques de co-construction du jeu OverwatchAntoine Jobin (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Depuis une quinzaine d’années, l’interconnectivité des consoles, les plateformes de ventes dématérialisées de jeux et l’importance croissante accordée à la captation des données numériques générées par les joueur.se.s ont mené l’industrie vidéoludique à transitionner du modèle économique du « jeu comme produit » vers celui du « jeu comme service ». Dans ce contexte, les joueur.se.s se voient attribuer un important pouvoir de co-construction : leurs pratiques et discours ont de plus en plus d’influence sur le développement d’un jeu alors que les entreprises cherchent à capitaliser sur les intérêts du public.
Cette présentation s’intéressera aux dynamiques de co-construction particulières du jeu Overwatch. Nous nous pencherons plus spécifiquement sur les rapports de force entre joueur.se.s et développeur.se.s qui ont guidé l’évolution du jeu de 2016 à 2020. Avec le logiciel WordStat, nous analyserons un corpus de données textuelles récolté avec un outil de moissonnage automatique pour comprendre : 1) l’évolution diachronique des discours des joueur.se.s et développeur.se.s afin d’identifier les tendances discursives dominantes propres à chaque phase de développement du jeu; 2) qui des joueur.se.s ou développeur.se.s instiguent ces tendances ainsi que leurs effets sur les pratiques émergentes dans la communauté et sur les décisions concernant les modifications apportées au jeu. En conclusion, nous discuterons de la pertinence et des limites de cette approche méthodologique. -
Communication orale
L’interprétation des signes à l’ère de la convergence. Une analyse de QAnon à travers le regard des études sur les communautés de fansMegan Bedard (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Cette présentation explorera comment les théories développées par les études sur les fans peuvent être utilisées pour analyser d’autres types de communautés en ligne. Plus spécifiquement, nous verrons comment les modes de lecture propre à la convergence médiatique et culturelle (Jenkins, 2006) peuvent éclairer les interprétations effectuées par la communauté conspirationniste Qanon. Cette dernière établit sa mythologie et ses croyances de manière collective à travers l’analyse de publications en ligne, d’œuvres de la culture populaire et de documents gouvernementaux. En outre, ce mouvement présente des éléments similaires aux communautés de fans : construction et consolidation de liens sociaux (en ligne et hors ligne) à travers un travail d’interprétation collective; une relation affective et cognitive complexe aux objets populaires; et, enfin, un élément performatif qui amène les gens à agir en fonction de leurs croyances, provoquant des campagnes de harcèlement similaires à celles qui ont déchiré certains fandoms. En appliquant les concepts et les théories développées par les fan studies aux communautés conspirationnistes en ligne, plus spécifiquement en étudiant les similarités et les différences entre leurs modes d’interprétations et de surinterprétation (Gervais, 2007), nous serons en mesure de développer un savoir plus nuancé sur ces communautés et leurs pratiques afin de comprendre ce qui peut mener les individus à adhérer aux discours de haine et de désinformation.
-
Communication orale
Une analyse de la formation et du développement d'organisations de fans d'idoles : du point de vue de l’approche constitutive de la communication organisationnelleAnqi Li (UdeM - Université de Montréal)
En 2020, pour la première fois, un groupe sud-coréen appelé BTS a été nominé aux Grammys 2020 (BTS, 2020). Depuis cet événement, de nombreux jeunes d’un peu partout dans le monde sont devenus familiers de la culture fans qui gravite autour de groupes similaires. L'organisation dans ces fandoms met généralement en place une division claire du travail et une planification minutieuse des activités, ce qui leur confère une grande influence (Hong, 2020). Cette influence touche non seulement à la culture pop, mais aussi à tous les aspects de la vie quotidienne des fans, en particulier la façon dont ils communiquent et socialisent. Cette communication vise à approcher ces phénomènes à partir d’une perspective centrée sur la communication organisationnelle et, plus précisément, sur les propriétés organisantes de la communication(Cooren & Martine, 2016). Cette perspective suggère que l’organisation et les formes organisées en général se développent à travers des processus communicationnels. Afin de tester cette conjecture, j’ai utilisé l'analyse du dialogue pour mener une enquête sur le terrain auprès des organisations de fans d'idoles asiatiques, et collecté des images, des vidéos et de l'audio au sein de l'organisation et interrogé des membres à tous les niveaux de l'organisation. Je souhaite ainsi résumer les règles de formation et de développement des organisations de fans basées sur la théorie de la communication organisationnelle, et explorer d'où provient leur influence.
Projection et table ronde
Projection du documentaire Que le fan soit avec toi de Marc Joly-Corcoran
Table ronde et mot de la fin
Table ronde avec Marc Joly-Corcoran, Madeleine Pastinelli, Mélanie Millette et Stéfany Boisvert.
Réseautage
Mot de la fin et cocktail de clôture.