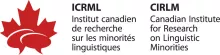Informations générales
Événement : 89e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 600 - Colloques multisectoriels
Description :Ce colloque propose d’aborder différentes problématiques liées au numérique dans les communautés linguistiques en milieu minoritaire, notamment les communautés de langues officielles en situation minoritaire (francophonie canadienne, communautés d’expression anglaise au Québec) ainsi que toute autre minorité linguistique au Canada ou ailleurs (ex. : communautés autochtones). L’utilisation du numérique est aujourd’hui transversale à un ensemble de pratiques informationnelles et d’usages des technologies de l’information et des communications (TICs). Elle rend nécessaire une meilleure littératie numérique et informationnelle de la population et soulève des enjeux généraux comme celui de combattre la désinformation en ligne, et d’autres plus spécifiques comme les contextes linguistiques minoritaires. Ces enjeux impliquent notamment différentes stratégies d’action en ce qui concerne l’accès à des services dans la langue de la minorité (en santé, en éducation, en justice), la revitalisation et le maintien des langues et des cultures des communautés ainsi que la « découvrabilité » des contenus culturels et des œuvres en ligne (des œuvres récentes ou patrimoniales). Le numérique peut aussi jouer un rôle dans le renforcement du sentiment d’appartenance à des communautés, ainsi que dans la possibilité de créer de nouvelles communautés en ligne qui vont au-delà des frontières physiques. Cette utilisation accrue du numérique pose également des questions d’inégalités sociales, de fractures et de littératies numériques à l’intérieur même de ces communautés en fonction de différentes caractéristiques de leurs populations (âge, géographie, sexe, revenu, scolarité). Elle a un impact sur les médias de ces communautés et leurs moyens de s’y adapter ainsi que sur leur développement économique. Enfin, elle transforme également les méthodes de recherche, notamment en sciences sociales, pour mieux comprendre la complexité des usages du numérique et de ses répercussions.
Pour saisir l’ampleur des changements, des enjeux et des innovations apportés par le numérique sur des communautés linguistiques en situation minoritaire, ce colloque invite les chercheuses et chercheurs ainsi que les étudiantes et étudiants à proposer une communication sur cette thématique.
Dates :- Anne Robineau (ICRML - Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques)
- Patrick Donovan (Université Concordia)
- Lina Shoumarova (Université Concordia)
- Michel Bourque (IInstitut canadien de recherche sur les minorités linguistiques)
Programme
Mots d’ouverture
Le numérique comme outil d’affirmation culturelle et de vitalité linguistique
-
Communication orale
#LaRésistance franco-ontarienne contre l’arrêt de financement de l’Université de l’Ontario français : perspectives des principaux acteursMireille Lalancette (Université du Québec à Trois-Rivières), François-René Lord (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Jason Luckerhoff (Université du Québec à Trois-Rivières), Vincent Raynault (Emerson College)
Cette communication aborde le mouvement #LaRésistance qui rassemblait et donnait une voie à la communauté franco-canadienne contestant l’arrêt de financement de l’Université de l’Ontario français par le gouvernement progressiste-conservateur en 2018. Ce mouvement populaire est la dernière initiative citoyenne en lice de la mobilisation franco-canadienne pour la défense de ses droits linguistiques et la première à se dérouler en grande partie sur les plateformes de communication socionumériques. Cette étude vise ainsi à mieux comprendre comment cette communauté a utilisé les médias socionumériques durant cette crise.
Pour ce faire, nous avons étudié la perspective et les usages des médias socionumériques de trois acteurs clés engagés dans la crise linguistique de 2018 en Ontario : associations franco-ontariennes, politiciens, Université de l’Ontario français. Nous avons également réalisé une analyse qualitative du contenu de leurs pages Facebook et de leurs fils Twitter. Ces analyses sont complétées par dix-sept entretiens qualitatifs avec ces actrices et acteurs engagé(e)s dans ce débat de société. Il ressort de cela que l’usage des médias socionumériques a permis d’amplifier la portée des messages liés au mouvement et a facilité l’organisation des actions militantes. Cette recherche offre une perspective inédite sur l’utilisation des médias socionumériques dans le cadre d’un débat public en milieu minoritaire.
-
Communication orale
Le numérique comme vecteur de promotion de l'identité touristique des Franco-ManitobainsAmelie Lajoie (UQAM - Université du Québec à Montréal), Mohamed Reda Khomsi (ESG-UQÀM)
Au Canada, les questions associées à la préservation de l’identité des francophones en situation minoritaire font souvent partie des enjeux avec lesquels la classe politique doit composer et plus particulièrement lorsque les droits de ces communautés sont menacés. Plusieurs chercheurs ont étudié ces questions au cours des trois dernières décennies (Chaput-Roland, 1990; Hébert, 1994; Juteau, 1994; Lamarre, 2016), cependant, la dimension touristique comme vecteur d’affirmation identitaire de ces communautés a reçu peu d’attention. Or, pour plusieurs chercheurs (Debarbieux, 2012 ; Cousin & Apchain, 2016), le tourisme est un marqueur de la culture d’un territoire et une image de son patrimoine. Notre communication propose donc de comprendre comment le tourisme, perçu comme un marqueur culturel, contribue à l’épanouissement de l’identité des Franco-manitobains à travers l’analyse des expériences conçues par ces derniers et proposées aux touristes qui visitent leur territoire. Autrement dit, nous nous interrogeons sur le rôle que peut jouer le tourisme dans la construction, la conservation et la préservation de l’identité des Franco-Manitobains. Nous mobiliserons deux approches : 1) une analyse du discours des acteurs de l’industrie touristique franco-manitobaine lisible via leurs sites web et des brochures numériques; 2) une approche ethnographique qui consiste à analyser les commentaires formulés par les touristes qui ont consommé ce type d’expérience.
-
Communication orale
La Bibliothèque ouverte du savoir communautaire et la vitalité mémorielle des communautés d'expression anglaise du QuébecPatrick Donovan (Université Concordia), Lorraine O' Donnell (Université Concordia)
La littérature grise est une importante source de données issues des communautés. Elle comprend des documents qui n’ont pas été publiés de façon officielle et amasse des connaissances sur les minorités, les groupes marginalisés et les activités des femmes qui contribuent à cette documentation, mais dont le travail peut passer sous silence. Cependant, les engagements limités de la communauté et du secteur des bibliothèques pour la préserver et la rendre accessible signifient qu’une grande partie de la littérature grise est perdue. La Bibliothèque ouverte du savoir communautaire (BOSC; https://ckol.quescren.ca/) de QUESCREN est une base de données en ligne où la littérature grise d’organismes communautaires des communautés québécoises d’expression anglaise est archivée et consultable en texte intégral en format PDF. Jusqu’à présent, la BOSC compte 25 organismes participants et plus de 1 200 articles archivés. La BOSC s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet de QUESCREN intitulé « People's History of English-Speaking Quebec ». Le développement de la BOSC permet d’augmenter les liens entre les organismes communautaires et QUESCREN. Il permet également le progrès des connaissances sur ces organismes grâce à cet accès à la littérature grise et à nos futures publications sur l’histoire communautaire. Ces outils font en sorte que la BOSC contribue au « dynamisme mémoriel » des communautés québécoises d’expression anglaise (Roy, 2021).
-
Communication orale
Soins de proximité et compétences numériques au Québec : le cas de la Basse-Côte-NordManek Kolhatkar (UdeS - Université de Sherbrooke), Diane Martin-Moya (Université de Montréal)
Cette communication présente un projet d’archéologie numérique publique mené dans une des régions à la frontière est du Québec, la Basse-Côte-Nord. Il décrit les difficultés et les conséquences du développement de compétences numériques dans les différentes communautés de la région. Pendant des milliers d’années, cette région éloignée a été une plaque tournante pour les échanges culturels, et des fouilles y ont été réalisées par divers archéologues. Aujourd’hui, elle est toujours privée d’un bon accès routier et n’est dotée d’une infrastructure à large bande que depuis 2019. Des communautés autochtones (Innus) et non autochtones (francophones et anglophones) y cohabitent. Le projet « Archéologie numérique en Basse-Côte-Nord » cherche à répondre aux besoins de développement des communautés en stimulant la croissance et en attirant des jeunes pour qu’ils découvrent le riche patrimoine et le paysage exceptionnel de ce territoire. Le projet intègre l’éducation numérique au programme scolaire régional. Les communautés peuvent préserver leur patrimoine et leur territoire et participer à l’élaboration d’une vitrine virtuelle, ou d’un musée en ligne, tout en développant des compétences numériques qui permettront aux jeunes d’élargir leur horizon de possibilités.
Enseignement et pandémie : défis et innovations
-
Communication orale
La vie en ligne en français et les inégalités numériques: des réflexions du personnel enseignant en Ontario durant la pandémie de la COVID-19Megan Cotnam-Kappel (Université d’Ottawa)
La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière en quoi des inégalités numériques divisent les apprenants partout dans monde, y inclus au Canada. Toutefois, nous constatons des zones d’ombres dans la littérature scientifique concernant la façon dont ces inégalités touchent le personnel et les élèves des écoles de langue française en contexte linguistique minoritaire. Les quelques études menées sur cette population révèlent le manque de ressources et de développement professionnel adapté à leurs réalités (Gilbert et al., 2004 ; Gratton et Chiasson, 2014) et l’absence de ressources et d’espaces qui reflètent leurs langues, cultures et expériences (auteure 2018, 2020; Chaput et Champagne, 2012)
Cette communication présentera les propos de 22 membres du personnel enseignant en Ontario français, ayant participé à des entrevues semi-dirigées virtuelles de 75 minutes de mars à juin 2020, soit durant la première vague de la pandémie de la COVID. Cette communication présentera la façon dont le personnel estime que leurs élèves vivent des inégalités numériques de trois types: 1) de l’avoir (accès et types d’accès aux technologies); 2) du savoir (compétences en littératies numériques); et 3) du pouvoir ou la capacité de mettre à profit son bagage technologique pour s’exprimer et servir ses intérêts et ceux de sa communauté (Bihr et Pfefferkorn, 2008, cité par Collin, 2013), la façon dont leur(s) langue(s) influencent ces inégalités et de futures pistes de recherche et d’action.
-
Communication orale
Le paysage numérique des écoles de langue anglaise de la maternelle au secondaire au Québec : aperçu du travail sur le terrain pendant la pandémieCraig Bullett (LEARN Quebec), Ben Loomer (LEARN)
La pandémie de la COVID-19 a dévoilé et exacerbé de nombreux défis numériques auxquels se heurtent les communautés d’expression anglaise du Québec, notamment l’accès équitable aux technologies et à Internet haute vitesse, les pratiques pédagogiques en ligne et notre capacité à favoriser l’acquisition de compétences numériques en milieu scolaire et à la maison. La pandémie a également entraîné de remarquables innovations, dont la Quebec Online Alliance, un portail destiné aux élèves exemptés de fréquenter l’école pour des raisons médicales, et le projet « I Belong », une initiative entièrement pensée et réalisée à distance qui donne aux élèves et aux enseignants des outils pour explorer leur identité et leur sentiment d’appartenance à la société québécoise. En plus de faire connaître ces défis et innovations, LEARN souhaite souligner certains aspects du « Cadre de référence de la compétence numérique » destinés aux élèves de la maternelle au secondaire tout en fournissant des ressources pour poursuivre l’exploration de ce cadre. Nous réfléchirons à certains des plus grands obstacles et atouts liés au perfectionnement professionnel des enseignants de la maternelle au secondaire, y compris la « culture d’experts », la place des compétences numériques dans le programme scolaire et l’apprentissage avant l’entrée en fonction et la popularité croissante des espaces d’apprentissage informels.
-
Communication orale
Enseignement virtuel en milieu minoritaire francophone en Nouvelle-Écosse et au Manitoba: les expériences vécues et les pistes pour l'avenirAndrea Burke-Saulnier (Université Sainte-Anne), Gail Cormier (Université de Saint-Boniface)
Dans le cadre du projet de recherche « L’enseignement en milieu minoritaire à l’ère de la pandémie en Nouvelle-Écosse et au Manitoba : les perspectives d’enseignants » ont été explorées et les expériences des enseignants oeuvrant dans les provinces identifiées. Le but de ce projet était de décrire les expériences vécues par les enseignants en contexte minoritaire francophone pendant la pandémie de CoVID-19. Pour réaliser cet objectif, quarante entretiens semi-dirigés ont été réalisés – vingt dans chaque province – pendant lesquels les participants ont pu partager leurs expériences concrètes de l’enseignement en mode virtuelle. En explorant les données qualitatives cueillies lors de ces entretiens, certains défis et impacts saillants et signifiants ont été identifiés. Les défis et les impacts décrits par les participants correspondent à divers éléments liés à l’enseignement, entre autres la didactique, les outils d’enseignement, les ressources, la gestion de classe et la motivation. Ce qui diffère ces histoires des récits d’autrefois est que le tout se déroulait lors d’une pandémie mondiale et dans des salles de classe virtuelles. Lors de cette communication, les défis d’enseignement en mode virtuel seront partagés, spécifiquement en contexte minoritaire francophone, les impacts seront identifiés ainsi que les futures pistes qui pourraient mener à des pratiques gagnantes pour cette nouvelle réalité de l’enseignement dans les écoles de langue française en milieu minoritaire.
Les jeunes et le numérique : se divertir, se lier, s’informer
-
Communication orale
Le Francopass ou les défis de l'innovation en contexte de francophonie minoritaireMartine Cavanagh (Université de l'Alberta), Sathya Rao (University of Alberta)
Le Francopass (FP) est une application Web développée par une équipe interdisciplinaire de chercheurs de l’Université de l’Alberta en 2019. L’application s’appuie sur des stratégies de ludification pour encourager les étudiants à participer à des activités en français au sein de la communauté francophone locale et le campus de l’Université de l’Alberta. Le FP est la première application à tirer parti du dynamisme d’une francophonie en contexte minoritaire afin de permettre aux apprenants du français de renforcer leurs compétences linguistiques et culturelles et d’accroître leur sentiment d’appartenance à cette communauté. Les études que nous avons menées sur les effets du FP ont montré que les stratégies de ludification n’étaient pas suffisantes pour assurer le succès de l’application. Ce succès passe par une intégration réussie de l’application au sein des institutions postsecondaires où elle est utilisée, à savoir l’Université de l’Alberta et son campus francophone, le Campus Saint-Jean. Dans cette communication, nous analyserons les difficultés que nous avons rencontrées s’agissant de l’intégration du FP au sein des programmes de français et de formation des futurs enseignants. Nous montrerons que ces difficultés tiennent notamment à la difficulté à envisager un cadre de collaboration entre l’université et la communauté francophone. Or, comme l’ont montré plusieurs chercheurs, cette collaboration revêt une importance capitale en contexte de francophonie minoritaire.
-
Communication orale
Le sentiment d’appartenance des jeunes anglophones au Québec : lutter contre l’isolement par le renforcement communautaire en mode numériqueAlexandre Pettem (Y4Y Québec), Adrienne Winrow (Y4Y Quebec)
Depuis le début de la COVID-19, l’idée de ce que représente une communauté est devenue une réalité numérique chez beaucoup de jeunes anglophones du Québec. Y4Y, un organisme communautaire pour les jeunes, cherche à connaître les approches numériques adoptées par ceux-ci pour lutter contre l’isolement physique. Nous avons analysé les commentaires recueillis depuis le début de la pandémie auprès des participants aux initiatives de Y4Y partout au Québec. En se basant sur des commentaires de sources primaires, nous avons brossé un portrait qualitatif de ce segment des communautés de langue officielle en situation minoritaire que nous avons subdivisé tout d'abord entre jeunes anglophones résidents en centre urbain et en région rurale, puis selon les catégories suivantes : étudiants, employés, sous-employés et sans emploi. Ce portrait permet de rendre compte de manière exhaustive et sociodémographique de l'ensemble des outils numériques déployés pour répondre aux différents niveaux d'isolement physique des jeunes par Y4Y. Nous avons découvert que les projets de Y4Y offraient un aperçu des changements dans leur vie depuis le début de la COVID-19. Nous recommandations les meilleures pratiques en matière de sensibilisation des jeunes et que le renforcement communautaire en mode numérique aura un rôle à jouer dans le travail communautaire, surtout auprès des jeunes. Nous espérons démontrer la nécessité pour le Québec de se doter de solides politiques de lutte contre l’isolement.
-
Communication orale
Littératie et citoyenneté numériques chez les jeunes d'expression française en milieu minoritaire au Canada dans un contexte de désinformation en ligneJosée Guignard Noël (Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques), Anne Robineau (Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques), Sylvain St-Onge (ICRML)
Dans cette communication, nous présentons les résultats d’une recherche quantitative et qualitative menée sur la littératie et la citoyenneté numériques chez les jeunes des communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) âgés de 16 à 25 ans qui fréquentent une école secondaire ou une institution postsecondaire (universités, collèges) de la francophonie canadienne. À ce jour, il n’existe pas d’études qui nous renseignent très spécifiquement sur les usages actuels que les jeunes issus des CFSM font de l’Internet et des médias sociaux. Nous connaissons peu leurs compétences à cet égard, et encore moins la façon dont ces jeunes s’informent ou transmettent de l’information en ligne.
Pour avoir un portrait de la situation, nous avons fait passer un sondage pancanadien entre décembre 2021 et février 2022 auprès de ces jeunes. Nous avons aussi réalisé plusieurs groupes de discussion auprès de jeunes, de membres du personnel enseignant et de parents des CFSM. Le but était de savoir quelles ressources sont à leur disposition en français pour lutter contre le phénomène de désinformation en ligne et de connaître leurs stratégies, le cas échéant, pour mieux accompagner les jeunes dans le développement de leur citoyenneté numérique. Cette présentation analysera le lien entre l’usage de l’Internet, le type de médias consultés, la langue utilisée, la fréquence de ces usages et divers autres facteurs sociologiques.
La culture et le numérique : connaissance des publics et visibilité des artistes
-
Communication orale
Étude ethnographique sur les festivals multiculturels du Canada: la francophonie et la musique du mondeMichelle Thompson (Université Carleton)
Cette étude ethnographique explore les stratégies de représentation culturelle et linguistique, chez les musiciens francophones qui performent dans cinq festivals canadiens, par leur participation dans le monde numérique. L'étude démontre que les musiciens et chanteurs francophones représentant les communautés afrodescendantes du Canada et du monde utilisent leurs performances artistiques et leurs communautés virtuelles de Facebook pour promouvoir leur musique, leurs identités culturelles et linguistiques, et les mouvements sociaux qu'ils/elles appuient. L'étude utilise une méthodologie ethnographique qui consiste en visites sur terrain entre juillet et novembre 2019, d'une analyse de contenus de sites Web et de médias sociaux, et d'une analyse d'images et de discours écrits, oraux, et chantés.
-
Communication orale
Connaître les publics de la culture par les données numériques: pratiques et perceptions dans la francophonie canadienneNathalie Casemajor (INRS), Guillaume Sirois (UdeM - Université de Montréal)
Afin de favoriser la découvrabilité des produits culturels, plusieurs organismes se tournent aujourd’hui vers les données numériques (personnelles, sociodémographiques, comportementales), celles-ci étant réputées permettre une connaissance plus fine des publics. Devant cette « mise en donnée » (datafication) des publics, les plus enthousiastes soutiennent qu’il est urgent de développer une « culture des données » dans les milieux culturels, alors que les pratiques demeurent fortement liées au niveau de littératie numérique des intervenants. Notre enquête (questionnaire et groupes de discussion) auprès des organismes de la francophonie canadienne a cherché à mieux comprendre les pratiques actuelles et les opinions des professionnels. Le portrait qui s’en dégage permet de constater que les pratiques de collecte, d’analyse et d’archivage des données numériques sont très hétérogènes. Les technologies numériques ont offert de nouveaux moyens de connaissance des publics –souvent peu exploités – sans pour autant avoir remplacé les méthodes traditionnelles. Pour les participants à l’enquête, la « relation est plus personnelle » dans les communautés de petite taille, ce qui les pousse à placer la « programmation au coeur de la communauté ». Loin du modèle d’affaires des géants du numérique dans lequel les données sont centrales, les organismes de la francophonie couplent les données au savoir instinctif né de la relation de proximité qu’ils entretiennent avec leurs publics.
-
Communication orale
La visibilité et la découvrabilité des contenus culturels et artistiques en ligne chez les communautés noires et d'ascendance africaine de la francophonie canadienne et du QuébecAnne Robineau (Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques), Destiny Tchéhouali (UQAM - Université du Québec à Montréal)
Dans cette communication, nous présenterons des résultats d’une recherche qui met en perspective les habitudes de consommation en ligne de produits culturels par des membres des communautés noires et afrodescendantes au Canada avec des problématiques sous-jacentes de sous-représentativité médiatique des oeuvres et des contenus créatifs, produits par des talents canadiens issus de la diversité. En effet, à l’heure actuelle, une majorité de travaux se concentrent sur des analyses distinctes entre les trois dimensions suivantes : 1) la diversité des sources ou la diversité d’exposition de l’offre de contenus (culturels et informationnels), 2) les comportements des usagers (ou récepteurs) de contenus, et 3) le rôle des algorithmes dans la structuration et la mise en valeur de l’offre culturelle et médiatique. Notre contribution entend donc élargir le regard porté jusqu’ici sur ces trois enjeux (diversité, visibilité et découvrabilité), en les étudiant dans une approche systémique, qui tente de mettre en évidence les principaux impacts, biais ou dangers des systèmes algorithmiques sur le contenu auquel les utilisateurs canadiens sont exposés et qu'ils consomment sur les plateformes en ligne. Pour réaliser cette étude, nous avons eu recours à plusieurs méthodes dont l’analyse de contenu du parcours de découvrabilité d’oeuvres en ligne, d’entretiens semi-dirigés avec des artistes, des diffuseurs artistiques et culturels et des consommateurs de contenus culturels en ligne.
Pratiques langagières et identité linguistique sur les réseaux sociaux
-
Communication orale
Deux langues minorées dans la bulle internet: gallo de Haute-Bretagne (France) et berbère de l'Île de Djerba (Tunisie)Francis Manzano (Université Lyon-3 Jean Moulin, Centre d'Etudes Linguistiques)
L’examen de deux langues distinctes révèle plusieurs traits supralangagiers et sociétaux qui les rapprochent : minorisation importante, ou totale ; longue absence d’écriture propre ; reconnaissance faible (gallo) ou nulle (berbère) par les États concernés ; pas d’enseignement nettement assumé (gallo), ou son inexistence (berbère). Leur (re)présentation sur le WEB est sujette à critiques utiles si l’on veut les soutenir efficacement.
Le berbère djerbien se rattache à une langue historique de la Méditerranée, exposée à des pressions sociolinguistiques combinées (arabe, français, langues européennes liées au tourisme).
Les derniers locuteurs dans l’île sont abandonnés et la langue locale est en passe de disparaitre, faute d’élite régionale et de soutiens institutionnels. L’examen de quelques documents en ligne révèle ainsi un raccrochement tardif à des concepts élaborés ailleurs : nom de la langue (amazigh, tamazight vs chelha vs berbère), ritualisation du drapeau berbère et de tamazgha (nom berbère de l’Afrique du Nord), et arguments plus sociétaux que langagiers (artisanat, modes de vie et oecuménisme local).
L’article « gallo » (Wikipédia) est à dominante militante, non sans considérations typologiques et sociolinguistiques. Mais cet appareil séduisant n’illustre-t-il pas une sorte de placement de produit dans une vitrine mondiale qui ne comporte que ce que l’on y dépose, en ouvrant au passage des brèches importantes dans la définition même de la langue et des langues?
-
Communication orale
Le podcast par et pour la communauté, un nouveau marché franc pour une variété de langue stigmatisée? Le cas d’un podcast « tout en chiac »Laurence Arrighi (Université de Moncton), Tommy Berger (Université de Sherbrooke)
Notre objectif est d’explorer la dimension sociolinguistique des podcasts produits par et pour la communauté en Acadie du Nouveau-Brunswick, milieu francophone minoritaire. Après avoir défini le phénomène du podcasting, donner une idée de sa mesure en Acadie et rappeler l’importance pour une communauté d’avoir des médias faits non seulement pour elle, mais aussi par elle (Bernier et al. 2013), nous prendrons le cas précis d’un podcast, « Cossé t’en penses? ».
L’émission choisie est réalisée et animée par Frank et Lee, natifs du sud-est de la province. Ils interviewent une personne qui a une carrière professionnelle inspirante et à qui il est explicitement demandé de parler de son parcours en chiac. Dans la mesure où cette variété non-standard (marquée par des archaïsmes et des anglicismes) est virtuellement absente du paysage médiatique traditionnel (journaux et grandes chaines de télé et radiodiffusion), nous nous demanderons si le podcast constitue un marché franc (Bourdieu 1982) pour cette variété. Dans un paysage médiatique dominé par l’anglais ou le français standard, nous nous demanderons si, à l’ère du Web social 2.0, ce type de création numérique peut offrir un espace de diffusion à la langue locale et alors sous quelles formes. Nous analyserons pour ce faire certains choix et certaines pratiques linguistiques performés dans le cadre de l’émission.
-
Communication orale
Le marqueur « coudon » dans la communication numérique écriteFiona Patterson (York University)
Le français québécois populaire est une énigme constituée d’une complexité d’emprunts lexicaux aussi bien que syntaxiques, de néologismes, de calques du moyen français et de déformations de ces derniers. Le cas de l’expression coudon est particulier, puisqu’il s’agirait d’un ancien impératif figé (Léard, 1989 : 87), une déformation alors de l’expression écoute donc (Laurendeau, 1985 : 108 ; Dostie, 2013 : 16 ; Lapointe, 2017 : 35), mais qui démontre en même temps une variété de sens divergents de ses origines lexicales.
Dans une perspective énonciative, nous tenterons de décrire et d’examiner le marqueur coudon tel qu’utilisé dans les réseaux sociaux, à partir d’une série d’exemples, en comparaison aux emplois à l’oral. Partant de la description énonciative de Laurendeau (1985) des emplois et des fonctions de coudon, ce travail sera nourri des perspectives de Berthoud (1996), Léard (1989), Dostie (2009 et 2013) et Lapointe (2017). À travers cette analyse, nous trouvons que coudon garde les mêmes sens et les mêmes fonctions dans les communications médiatisées par ordinateur que dans d’autres contextes, et nous avançons la thèse d’une nouvelle fonction déictique de ce marqueur, quand coudon est accompagné d’une photo. Cette présentation propose alors d’examiner l’effet du numérique sur les innovations langagières potentielles des Québécois, qui représentent une communauté de langue officielle en situation minoritaire au Canada.
Les médias minoritaires : l’apport du numérique et le développement de nouvelles pratiques
-
Communication orale
Présentation des avancées linguistiques et numériques par les radios communautaires francophones en Ontario: déjà 30 ans de progrès continu, mais méconnuChristian Martel (Université de l'Ontario français)
Les radios communautaires de l’Ontario, dès leur première mise en ondes, ont choisi un système de programmation numérique, car la discussion sur la venue de fréquences numériques de la part du ministère de l’Industrie pour de nouveaux canaux libérés dans le spectre des fréquences qu’il administrait a débuté dans les années 90.
Au niveau culturel, les radios présentent régulièrement des spectacles d’artistes francophones dans leur communauté, ou sont des partenaires de choix pour la promotion de toutes les activités culturelles des centres culturels, d’activités entourant la fête de la Saint-Jean-Baptiste, et pour l’anniversaire officiel du drapeau franco-ontarien avec les différents conseils scolaires francophones de leur région.
Le développement économique de toutes les communautés francophones de l’Ontario abritant une radio communautaire francophone a accès au meilleur outil de soutien permettant la promotion et la mise en marché des produits et services francophones en milieu minoritaire. Les radios elles-mêmes sont des petites entreprises qui forment du personnel et offrent des emplois, des stages de perfectionnement et des opportunités économiques de toutes sortes.
Une caractéristique demeure, plus on est exposé à de la musique francophone, plus nos chances de l’aimer et de la valoriser augmente.
Étude faite par Annette Boudreau et Stéphane Guitard de l’Université de Moncton intitulée : Les radios communautaires: instrument de francisation.
-
Communication orale
Les avantages et inconvénients liés à l’utilisation des technologies de l’information et des communications dans les communautés de langue officielle en situation minoritaireHugh Maynard (Université Concordia)
L’éventail de possibilités qui découlent de l’application des technologies de l’information et des communications (TIC) est impressionnant : transcription en temps réel, traduction simultanée et applications mobiles qui analysent et présentent les données dans des formats visuels à la fois percutants et faciles à comprendre. Pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), il en résulte un large éventail d’informations et de services offerts en ligne dans leur langue, une amélioration constante de la traduction des communications en temps réel et le tissage de liens inédits entre les communautés. Parmi les inconvénients, on retrouve bon nombre des mêmes inégalités qui prolifèrent de manière générale sur le Web : l’accès du dernier kilomètre, le fossé entre riches et pauvres (coûts, matériel ou compétences) et le déclin des interactions en personne. Privés d’accès à une connexion haute vitesse, les communautés de langue minoritaire restent souvent prises dans les routes secondaires des réseaux informatiques. Cette présentation permettra de découvrir comment profiter des avantages et atténuer les inconvénients liés à l’utilisation des TIC afin d’améliorer la vitalité des CLOSM et de soutenir leur développement.
Enjeux du numérique en santé : des services et des connaissances à évaluer
-
Communication orale
Un questionnaire de satisfaction en télémédecine : un outil clinique linguistiquement et culturellement adapté pour les communautés de langues officielles en situation minoritaireÉric Dionne (Université d'Ottawa), Michelle Dorion (Université d’Ottawa)
Au Canada, l’utilisation de la télémédecine, une façon de communiquer avec un professionnel de la santé par voie électronique, est l’une des applications émergentes des technologies de l’information et des communications (TIC) dans le secteur de la santé. Différents programmes de télémédecine sont, désormais, présents dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire (CLOSM) pour soutenir un nombre important d’activités cliniques dans les différents domaines de la santé. Or, si les innovations sont nombreuses et rapides en télémédecine, l’outil mis de l’avant pour mesurer la satisfaction des utilisateurs est problématique, car il existe uniquement en anglais, ce qui ne permet pas de capter le ressenti des patients et professionnels de la santé francophone. D’ailleurs, reconnaître la sensibilité culturelle des communautés francophones constitue un des déterminants sociaux de la santé au Canada. Ainsi, cette étude vise à développer des questionnaires de satisfaction qui sont appuyés par des choix méthodologiques qui tiennent compte de la réalité sociolinguistique des francophones et qui sont sensibles pour détecter les besoins des CLOSM en ce qui concerne l’utilisation de la télémédecine, une pratique en pleine ascension.
-
Communication orale
Améliorer l’accès aux soins de santé et aux services sociaux des minorités linguistiques grâce aux technologies numériques : défis et possibilitésTyler Brown (Université McGill), Jonathan A. Caballero (Université McGill), Andrew Durand (Université McGill), Carmen G. Loiselle (Université McGill), Marika Monarque (Université McGill), Jacqueline Vachon (Université McGill)
Les technologies numériques peuvent contribuer à fournir un accès élargi aux soins de santé et aux services sociaux, particulièrement en présence d’obstacles (géographiques, linguistiques, etc.) à l’accès aux soins. Plus précisément, le domaine en plein essor des technologies de la parole et de la langue repose sur l’analyse informatique et le traitement de données en langage naturel (traduction automatique, synthèse vocale, analyses de textes, etc.), et ces applications constituent des solutions prometteuses pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les utilisateurs de services en situation linguistique minoritaire. Nous décrivons des exemples d’initiatives fondées sur les technologies numériques qui ont permis de réduire les obstacles linguistiques dans des contextes sociaux et de santé. Nous abordons les enjeux importants liés à leur mise en œuvre, notamment les exigences de conformité, les perceptions des utilisateurs et des professionnels ainsi que les enjeux éthiques. Enfin, nous discutons des principaux défis et possibilités découlant de l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’accès des utilisateurs de services qui sont membres de la minorité anglophone au Québec.
-
Communication orale
Qui sont-ils? Une exploration multicritère des profils sociaux de la communauté linguistique de langue minoritaire anglaise au QuébecLaura-Lee Bolger (Service communautaire Jeffery Hale CIUSSS de la Capitale-Nationale), Jan Warnke (Université Laval)
Nous proposons de décrire les principaux traits sociodémographiques des communautés d’expression anglaise dans les régions du Québec par des cartes et par des tableaux régionaux comparatifs. Nous utilisons un nouvel outil en ligne, un tableau de bord dynamique qui permet d’explorer le paysage social selon les profils multicritères de la population anglaise. Notre analyse se sert d’une base de données personnalisée de Statistiques Canada (2016) selon 380 déterminants sociaux de la santé recoupés par 11 groupes d’âge et 7 catégories de première langue officielle parlée. Ces données ont subi un traitement statistique de réduction de dimensionnalité et une classification par un algorithme de classification spatiale SKATER pour créer des profils multicritères de la population de langue anglaise. Notre classification utilise une vaste étendue de variables reconnues comme déterminants sociaux de la santé : revenu, statut social, emploi, conditions de travail, éducation, littératie, occupation, statut d’immigrant, habitation, identité ethnique, origine ethnique, race. Notre présentation met en évidence les différences et similarités multicritères entre les quartiers peuplés par la population d’expression anglaise au Québec et montre comment un outil en ligne pourrait servir à mieux informer le public et les décideurs sur les facettes critiques de leur vitalité communautaire et de surmonter les défis de l’accès à l’information lors d’une crise sociétale telle la pandémie.
-
Communication orale
COVID-19 et variabilité des méfaits et réponses numériques chez les aînés francophones en contexte minoritaireBoniface Bahi (University of Alberta), Martine Pellerin (Université de l'Alberta)
Cette communication vise à décrire et analyser l’impact des réponses sociales, politiques et de santé publique en matière de communication, d'endiguement ou de réduction des méfaits, de l’isolement social dus à de la COVID-19 chez les aînés francophones en contexte minoritaire canadien. Cette communication va présenter les lignes centrales de notre étude reposant sur l’idée que la COVID-19 et ses mesures-barrières impactent non seulement les individus et groupes des aînés dans leur adhésion à de nouvelles formes numériques de communication ou de gestion de leur quotidienneté, mais aussi les organismes socio-sanitaires en milieu francophone minoritaire. Nous nous appuyons sur des témoignages d’aînés et du personnel de soutien à ces aînés pour mettre de l’avant des pratiques numériques gagnantes pour leur mieux-être. Nous examinons aussi les processus administratifs numériques d’adaptation aux mesures-barrières mis de l’avant par les organismes socio-sanitaires pour des services de qualité aux aînés sans nouveaux coûts de fonctionnement. À ces témoignages, s’ajoute une analyse de contenu de sources documentaires relatives à des discours de responsables de santé publique. L’ensemble nous permet de présenter de nouvelles perspectives numériques permettant de réduire, à défaut de le supprimer, l’isolement voire le double isolement psychosocial lié aux mesures-barrières, et pour la suite de leur vie, chez la population des aînés francophones en contexte minoritaire canadien.