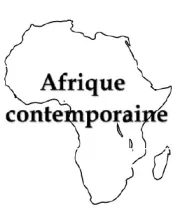Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 600 - Colloques multisectoriels
Description :La demande en services sociaux de base demeure un enjeu majeur dans plusieurs pays africains en raison de la persistance de la pauvreté (Banque mondiale, 2016). En effet, les États africains sont confrontés à un manque de ressources aux effets pervers qui révèlent des problématiques notamment en ce qui a trait à la rétention des forces vives des nations. À titre d’exemple, ces dernières années, des milliers de jeunes africain·es ont migré surtout vers l’Europe, mais aussi ailleurs en quête d’un avenir meilleur. Ce phénomène se consolide avec l’apparition récente de nouvelles voies illégales d’émigrations, toujours au départ de l’Afrique, vers l’Amérique du Nord, en passant par le Nicaragua ou même le Brésil. Que révèle l’intensification de cette migration illégale? Dans quelle mesure des politiques sociales efficaces peuvent-elles contribuer à ralentir, voire arrêter ces départs aux issues parfois macabres? Dans quelle mesure l’état des politiques sociales à l’échelle du continent africain participe-t-il à renforcer le désarroi des jeunes menant à la forte émigration clandestine?
Les politiques sociales concernent l’ensemble des dispositifs institutionnels d’action collective visant le développement social, la protection et les droits des individus au sein de la société (Jamot-Robert, 2006).
S’interroger sur le développement économique et social des pays africains sous l’angle des politiques sociales revient à s’interroger sur la place des États et des organismes communautaires, sur leur marge de manœuvre dans l’élaboration et la mise en application de celles-ci. C’est aussi s’interroger sur les expériences pertinentes conduites par les associations de la société civile.
Remerciements :Nous remercions nos partenaires institutionnels, scientifiques et financiers : Association Nouvelle Afrique contemporaine, Gender Equitable and Transformative Social Policy for Post-COVID-19 Africa (GETSPA) project, Université du Québec à Chicoutimi, ACFAS.
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Marie Fall (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
- Louise Carignan (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
- Ndeye Faty Sarr (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
- Pierre Jacquemot (Association Afrique contemporaine)
Programme
Ouverture du colloque
-
Communication orale
Mot de bienvenue et introduction au colloqueMarie Fall (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
-
Communication orale
Conférence d'ouverture: L’inclusion du genre dans les politiques sociales liées à l'agriculture en AfriquePierre Jacquemot (Association Afrique contemporaine)
Pendant longtemps, les politiques agricoles ont été menées en Afrique sans référence à la notion de genre. Un timide changement est intervenu autour des années 1990 sous la pression du mouvement des femmes, lorsque l’étendue des inégalités est apparue comme un facteur de blocage du développement, au point de devenir par la suite un point de focalisation tant des politiques que de la recherche académique. En matière de politique publique vertueuse, on cite souvent la Namibie qui dès 1996 a établi l’égalité des droits de propriété et accordé aux femmes le droit de signer des contrats, d’ouvrir un compte bancaire ou d’intenter un procès sans l’avis de leur mari. Le taux d’activité des femmes a progressé dans le pays au cours des dix années suivantes. On peut affirmer que l’un des grands défis de l’Afrique de demain sera celui porté par les femmes, leur place, leurs droits, leur espace de responsabilité. Loin de la caricature encore trop fréquente, les paysannes ne sont pas les victimes silencieuses de rapports de pouvoirs — coutumiers ou modernes — oppressants. Les transformations plus ou moins accélérées du monde rural, confrontées à la persistance de rapports sociaux et de genre qu’elles jugent inégaux, suscitent l’efflorescence de résistances et de stratégies inventives. Actions individuelles visant la sphère du foyer, construction d’espaces de résistance et d’inventivité face à des situations critiques, luttes collectives visant des changements institutionnels.
Approches inclusives et sexospécifiques dans les politiques sociales
-
Communication orale
Analyse genrée de l’efficacité et de la durabilité des politiques sociales d’urgence de riposte à la Covid-19. Cas du Programme d’Appui à la Résilience des Ménages et des Groupes VOumoul Khaïry Coulibaly (Université Cheikh Anta Diop), Babacar Bonnaire (Université Cheikh Anta diop)
Les mesures prises par le Sénégal pour endiguer le coronavirus ont mis en évidence la faiblesse de ses politiques sociales. Il a ainsi mis en place le Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES), comme réponse de politique publique. C’est dans ce cadre que le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, a mis sur pied le Programme de Renforcement de la Résilience des Ménages et Groupes vulnérables (PAREM). Il cible, entre autres, les femmes, et leurs activités entrepreneuriales, en tant que pilier de la survie des ménages vulnérables, et qui sont affectées de façon disproportionnée. S’appuyant sur les résultats d’une étude de cas ayant adopté la méthode mixte et menée en 2023 dans la région de Thiès, nous proposons d’analyser, sous le prisme du genre, les leçons apprises de l’intervention du PAREM. Les résultats montrent que, contrairement à la plupart des mesures sociales de riposte qui ont principalement visé l’homme, en tant que « breadwinner» et le ménage comme principal bénéficiaire ou encore les entreprises formelles, le PAREM cible les femmes, et leurs activités informelles, comme sujets, au-delà de leurs rôles assignés. De même, outre l’approche correctrice et réparatrice traditionnelle des politiques sociales, le PAREM cherche à être plus « capacitant». Ainsi, bien qu’il n’ait pas clairement défini d’objectifs égalitaires, l’intervention a favorisé une relance des activités des femmes et influé sur leur pouvoir décisionnel.
-
Communication orale
L’extension de l’accès à la sécurité sociale et à l’assurance maladie aux couches vulnérables en Mauritanie : leçons apprises de la Covid19 et nouvelles approchesCheikh Saad Bouh Camara (Université de Nouakchott)
Autrefois réservés à une certaine classe dite des fonctionnaires et d’agents de l’Etat, l’accès à la sécurité sociale et à l’Assurance Maladie en Mauritanie, ne couvrait qu’un nombre peu élevé de la population mauritanienne. Il s’agit singulièrement des salariés, des agents de l’Etat, des élèves des écoles professionnelles. Partant d’une observation directe, d’une analyse de contenu de différents documents institutionnels, de presse et des rapports techniques en plus des discours officiels, cette présente communication s’évertuera à analyser les conditions socioéconomiques ayant entravé, de par le passé, l’accès des couches vulnérables de la Mauritanie profonde à la sécurité sociale et à l’assurance maladie, en insistant sur les variables sociologiques, historiques, géographiques, économiques ayant accentué la pauvreté et l’exclusion des pauvres des services sociaux de base. Elle tentera de décrypter les principales leçons apprises du contexte de la Covid-19 qui avait vu ces populations déshéritées de la Mauritanie payer le plus lourd tribut. Enfin, cette communication étalera les leçons apprises de cette pandémie et qui englobent, entre autres, la mise en place d’une nouvelle approche à savoir la nécessité de faciliter un accès massif des populations pauvres aux services sociaux de base, la santé, l’éducation, bref et surtout à avoir une protection sociale intégrale.
Initiatives prometteuses des politiques sociales
-
Communication orale
Lutte contre la pauvreté chronique dans la ville de Ouagadougou: les leçons tirées du programme national de filets sociaux "Burkin Naong Saya"Honorine Pegdwendé Sawadogo (Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST))
Le programme national de filets sociaux « Burkin Naong Saya » est né en septembre 2014, de la volonté du gouvernement burkinabè, d’appuyer les ménages pauvres. Il vise à accompagner l’autonomisation financière des bénéficiaires. Le projet qui existe depuis 9 ans est mis en œuvre dans la région du Centre plus précisément à Ouagadougou depuis 2021 dans les quartiers Polesgo, Nioko 2, Nonghin, Kilwin et Tanghin.L’objectif de cette proposition est de mettre en exergue la contribution du programme de filets sociaux «Burkin Naong Saya» à la réduction de la précarité des ménages bénéficiaires dans la ville de Ouagadougou. L’approche méthodologique est essentiellement qualitative. La collecte de données a consisté en l’analyse documentaire et les entrevues semi-dirigées approfondies auprès des acteurs et actrices étatiques et des bénéficiaires du projet. Les résultats montrent que les transferts monétaires ont une incidence positive sur les conditions de vie des bénéficiaires directs en améliorant leur accès aux services sociaux de base et leur dignité. Cependant, l’impact sur les revenus globaux des ménages des bénéficiaires n’est pas significatif.
-
Communication orale
Analyse des effets de la politique de subvention de l’énergie en AlgérieThira Bellache (Université Abderrahmane MIRA de Bejaia), Slimane MERZOUG (Université Abderrahmane MIRA de Bejaia)
Les crises environnementales, économiques et financières que traverse le monde aujourd’hui remettent en cause le modèle de croissance actuel ainsi que les politiques socio-économiques adoptés dans certains pays. En Algérie, les subventions sont un vecteur important de la politique économique et sociale de l’Etat. Elles sont en vigueur depuis l’indépendance et se justifient comme étant un moyen pour assurer un approvisionnement énergétique à bon marché pour les ménages et les différents secteurs de l’économie nationale. Avec la pandémie de la COVID-19 et l’effondrement des prix du pétrole et suite aux tensions récentes entre la Russie et l’Ukraine, on assistait à un rebond des prix des hydrocarbures à l’échelle mondiale. Cela pourrait être le dernier super cycle pétrolier, car les grandes économies semblent engagées à remplacer ces politiques de subventions énergétiques par des politiques sociales bien ciblées, inclusives et transformatrices. Dans un premier temps, notre recherche sera consacrée à traiter les instruments et les mécanismes de mise en œuvre de la politique de subvention de l’énergie en Algérie. Dans un second temps, on va essayer d’analyser les retombées de cette politique, tout en suivant une analyse descriptive hybride (quantitative et qualitative) des données recueillies à travers différentes statistiques des ministères des finances et de l’énergie, reflétant le poids des subventions à l’énergie dans le Budget de l’Etat.
Dîner
Les enjeux et les défis des politiques sociales
-
Communication orale
Les agriculteurs et éleveurs du Guidimakha (sud de la Mauritanie) face aux défis de l’accès à la protection sociale en période Post-covid.Ousmane Wague (Université Nouakchott Al Aasriya)
Considérée comme « Le grenier de la Mauritanie », abritant une population de 315 694[1] habitants en 2022, le Guidimakha, une région frontalière avec le Mali et le Sénégal abrite des activités à vocation agricole et de transhumance animale importante. Ces deux activités sont soumises aux aléas climatiques (sècheresses, inondations, invasion acridienne) et dernièrement à l’impact novice de la covid 19 ayant attisé la crise du secteur agropastoral faisant que les agriculteurs et les éleveurs font sont en proie à des contraintes pour leur accès aux services sociaux de base. Il ressort de l’investigation sur le terrain les constats suivants : dans l’activité agro-sylvo-pastorale qui caractérise la wilaya de Guidimakha, l’inclusion citoyenne reste faible. La faible productivité (baisse des ressources, déséquilibre alimentaire, désorganisation de la filière aliment bétail) complique encore plus l’institution d’un régime de protection sociale conséquent et la formalisation de l’activité agricole-sylvo-pastorale. La faible disponibilité des services de base, couplée, notamment pour les ménages pauvres, à de nombreuses barrières d’accès aux services disponibles, rend l’éducation en milieu pastoral pas aisée. L’accès aux centres de santé reste conditionné à la proximité, à la qualité du service mais également aux coûts. Les grandes mutations des systèmes d’élevage côtoyant davantage les villes vont dans le sens d’une meilleure intégration d’une partie des éleveurs.
-
Communication orale
Les défis de l’education inclusive au Cameroun : Mon enfant a une maladie rare, à l’aide !Rose-Danielle Ngoumou (Université de Yaoundé 1)
La protection de l’enfance est un important aspect des droits de l’enfance. Ce droit est inscrit dans des accords internationaux et de plus en plus reconnu dans la législation Camerounaise en matière d’éducation. Cette disposition part du postulat que les enfants ont droit à une éducation de qualité. Cependant, cette politique tarde à prendre son envol pour les enfants victimes de maladies rares. Ils sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination ayant un accès limité à une éducation de qualité. Le but de cette étude est de montrer les défis et contraintes de l’éducation inclusive des enfants vivants avec une maladie rare au Cameroun. Cette étude est basée sur le modèle social du handicap qui a complètement changé la pensée populaire sur les personnes handicapées en définissant le handicap comme un phénomène social qui se situe au-delà des expériences individuelles. Pour ce faire, des entretiens individuels approfondis ont été réalisés avec dix mères d’enfants souffrant de maladies rares dans la ville de Yaound2 sélectionné par une méthode d’échantillonnage non probabiliste au sein d’une association de soutien aux enfants victimes de maladies rares d’Octobre à Décembre 2022. Les résultats montrent que les enfants victimes de maladies rares sont discriminés dans l’accès à l’école et qu’ils ne sont presque pas scolarises et le personnel enseignant n’est pas formé pour encadrer ces enfants en situation d’apprentissage.
-
Communication orale
Enjeux et défis de la politique de mutation des centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale au BéninBaké Gani Nicole Gouroubera Chabi (Université de Parakou), Emmanuel SAMBIENI N’koué (Université Parakou)
Le gouvernement du Bénin a mis sur pied le programme « GBESSOKE » 2023-2026 qui vise à réduire la pauvreté et les inégalités grâce à l’accroissement des capacités productives des ménages les plus vulnérables. C’est dans ce cadre que s’inscrit la mutation des Centres de Promotion Sociale (CPS) en Guichet Unique de Protection Sociale (GUPS). Cette communication tente de contextualiser cette réforme en relevant ses enjeux et ses défis. Outre les données bibliographiques et les expériences professionnelles, le recueil des données se base sur les entretiens réalisés avec des acteurs du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), des élus locaux et usagers des CPS. Les résultats indiquent que le programme « GBESSOKE » prévoit la réhabilitation des quatre-vingt-cinq (85) CPS existants et la construction de trente-cinq (35) nouvelles infrastructures sur le modèle de GUPS ; le GUPS a pour mission de renforcer la résilience des personnes face aux chocs socio-économiques, environnementaux et climatiques. Le GUPS pourrait améliorer la protection sociale à travers une prise en charge holistique des couches vulnérables. Par ailleurs, des défis importants ont été soulignés à savoir : la difficulté à faire converger des interventions multiples sur les mêmes bénéficiaires qui nécessite une planification et une coordination minutieuses ; les difficultés de la mise en place d’un registre social unique face à la forte mobilité des populations et le taux élevé d’analphabètes.
-
Communication orale
Rompre avec les effets pervers de l’assistance sociale des personnes en situation de Handicap la redevabilité, le défi de la société civile au BéninRodrigue Sèdjrofidé Montcho (Université de Parakou (Bénin))
La redevabilité est devenue un concept en vogue en matière de gouvernance. Face aux défis en matière de protection sociale notamment des personnes vulnérables, les politiques sociales intègrent de plus en plus des pratiques de reddition des comptes aux fins de plus performance et de rentabilité sociale. Mais le processus d’assistance sociale couvent souvent des effets pervers surtout lorsqu’on est dans un environnement de positionnement des acteurs du secteur des personnes handicapées. Dans ce contexte, comment peut-on alors assurer la gouvernabilité de l’assistance sociale sans aliéner les acteurs bénéficiaires par la redevabilité ? A partir de l’expérience du PAIPH (Programme d’Appui à l’Inclusion des Personnes Handicapées), une analyse est faite pour apprécier les promesses et les incertitudes de la redevabilité aux fins de rompre avec les effets pervers de l’assistance sociale. Pour atteindre cet objectif, cette recherche de nature qualitative a mobilisé 60 personnes ressources avec des techniques d’échantillonnage par choix raisonné et boule de neige. Les techniques de recherche documentaire et d’entretiens individuels et collectifs sont utilisées pour la collecte des données. . Le modèle théorique de la recherche mobilisé est la théorie des effets pervers de R. Boudon. Les résultats révèlent que la redevabilité est une piste porteuse pour une meilleure gouvernabilité du secteur de l’assistance sociale.
Les forces et les limites des politiques sociales
-
Communication orale
L’analyse translocale de la contribution des migrants à l’établissement des politiques sociales dans leurs communautés d’origine au Burkina Faso.Abdoul-Kader Minoungou (Université Joseph Ki-Zerbo/Institut Supérieur des Sciences de la Population), Alexis Clotaire BASSOLE (Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ)), Hubert Bonayi DABIRE (Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ))
Le Burkina Faso est enclavé et dispose d’une population en majorité rurale (80%). Ces caractéristiques de la population entrainent une augmentation de la couverture en services sociaux de base. De ce fait, d’autres acteurs notamment les migrants participent à l’établissement de projets communautaires pour combler les carences régaliennes. À travers l’approche translocale, notre objectif est d’analyser la contribution des migrants à l’implantation d’infrastructures communautaires dans leurs localités d’origine. À cet effet, dans le cadre du projet « Migration and Translocality in West Africa » (MiTra/WA), cette recherche ambitionne cerner l’importance des transferts des migrants sur l’investissement en infrastructures sociocommunautaire des villages d’origine et les mutations sociales induites. Pour ce faire, une enquête mixte (qualitative et quantitative) bilocale a été conduite auprès des leaders communautaires, associatifs, des médias, des chefs de ménages et des migrants. Les résultats de l’enquête montrent que la majorité des migrants burkinabè sont translocaux et investissent dans les secteurs sociaux de base et dans les infrastructures économiques, d’une part. D’autre part, ces investissements induisent des transformations sociales qui se manifestent entre autres par la mobilité sociale, les déperditions scolaires, la dislocation des cellules familiales, les pratiques occultes, la perte ou l’affaiblissement de certaines normes sociales.
-
Communication orale
Limites des politiques sociales liées à l'emploi des jeunes et des femmes depuis la période coloniale jusqu'à la période post-Covid-19 : les cas du Mali, Mauritanie et SénégalNdeye Faty Sarr (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi)
Cette communication présente les résultats de notre recherche sur les politiques sociales transformatrices et genrées en Afrique post-Covid. La recherche visait aussi à analyser l’interconnexion entre les politiques sociales et les politiques économiques ainsi que les incidences des deux sur le genre, les classes sociales et les inégalités spatiales. La démarche méthodologique retenue repose sur une revue littéraire et une analyse des données secondaires (rapports nationaux, notes de politiques, décrets, publications scientifiques, etc.). Des entrevues ont été effectuées avec des personnes bénéficiaires et non bénéficiaires des politiques sociales. Sur le plan théorique, les concept d’Empowerment, de l’intersectionnalité et la théorie du changement social ont été mobilisés. Les résultats révèlent que les politiques sociales liées à l’emploi des femmes et des jeunes ont été tributaires des conjonctures sociopolitiques et économiques des trois pays. Ils révèlent aussi: une absence d’arrimage de ces politiques sociales ciblant les femmes et les jeunes à leurs fonctions principales de production et de reproduction, une insensibilité aux normes de genre, la non-prise en compte de la segmentation du travail productif, une asymétrie entre les structures économiques des pays et leur ancrage à l’idéologie économique dominante.
-
Communication orale
Conférence de clôture: Politiques sociales transformatrices et genrées : éthique et inclusion numériqueLouise Carignan (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Jean-Pierre Béland (UQAC)
Notre communication vise à montrer l’interrelation entre les communications présentées sur les difficultés d’opérationnalisation des politiques sociales, l’éthique et l’inclusion numérique. Tout d'abord, elle souligne les difficultés d'opérationnalisation des politiques sociales, notamment en raison d'un processus encore majoritairement "top down" qui ne favorise pas l'engagement et la reprise du pouvoir d'agir des communautés locales. Cependant, certaines initiatives, telles que les projets de recherche sur les jeunes, les femmes, le logement et l'agriculture, offrent des perspectives d'amélioration. Ensuite, l'éthique est présentée comme une voie d'avenir dans l'application et la transformation des politiques sociales. Elle offre un cadre pour orienter les décideurs et instaurer des pratiques individuelles, professionnelles, organisationnelles et sociétales. L'éthique est également vue comme une démarche axée sur le dialogue co-constructif pour assurer la démocratie et la participation citoyenne, tout en évitant les abus de pouvoir et la corruption. Enfin, l'inclusion numérique est considérée comme un levier de l'inclusion sociale et économique des individus et des communautés. Elle est un outil puissant pour atteindre les objectifs du développement durable, notamment dans les secteurs cruciaux de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'économie.