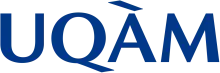Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 600 - Colloques multisectoriels
Description :Dans les facultés et les établissements d’enseignement supérieur qui forment les futurs professionnels infirmiers, il est fréquent que les enseignants soient eux-mêmes des professionnels de la santé. Ceux-ci ont été initialement formés à la pratique clinique et nombre d’entre eux ont exercé dans les milieux de soins avant de réorienter leur carrière vers l’enseignement. Toutefois, tous n’ont pas bénéficié d’une formation en pédagogie universitaire. En outre, il arrive que ces enseignants novices soient chargés de cours sans avoir eu l’occasion de développer leurs compétences en enseignement préalablement à leur entrée en fonction. Enfin, dans certains programmes, il est fréquent de faire appel à des professionnels de la santé à titre d’experts dans leur domaine clinique pour occuper des fonctions d’enseignants contractuels, sans que ceux-ci aient de formation pédagogique. Cet état de fait peut générer chez eux des maladresses, de l’inconfort et du stress, ce qui ne permet pas une expérience d’apprentissage optimale pour les étudiants. Comment favoriser la qualité des enseignements et le bien-être au travail des enseignants novices en sciences de la santé? Il paraît nécessaire que ceux-ci aient l’occasion de s’initier à la pédagogie universitaire en étant accompagnés, et aussi qu’ils puissent poursuivre leur développement professionnel en la matière. Dans ce cadre, encourager le partage des savoirs expérientiels d’enseignants experts avec l’ensemble de la communauté professionnelle des enseignants en sciences de la santé peut aussi contribuer à plus d’expertise individuelle et collective. Quels sont les constats et les expériences en la matière dans différents pays francophones? Quelles sont les recherches réalisées sur le sujet? Quelles innovations les enseignants en sciences de l’éducation et en sciences infirmières mettent-ils en œuvre pour soutenir le développement professionnel de leurs pairs?
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Dan Lecocq (Université du Luxembourg)
- Julie Lefebvre (UQAM - Université du Québec à Montréal)
- Chantal Caux (UdeM - Université de Montréal)
- Pascaline Herpelinck (Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine)
Programme
Session du matin
-
Communication orale
De novice à expert en enseignement dans le secteur de la santé : l’apport de la pratique réflexive pour améliorer les compétences pédagogiquesDan Lecocq (Université du Luxembourg), Julie Lefebvre (UQAM - Université du Québec à Montréal)
À l’ordre d’enseignement supérieur en santé, des enseignants s’insèrent dans la profession enseignante sans formation spécifique en pédagogie. Comme les compétences pédagogiques sont peu développées, la réflexion sur la pratique pouvant contribuer à améliorer ces compétences est peu mise de l’avant. Deux modèles, un québécois de développement de la pratique réflexive déployé en sciences de l'éducation et un belgo-québécois de partenariat humaniste en santé déployé en sciences infirmières ont été intégrés en un modèle de partenariat réflexif en enseignement. Celui-ci est actuellement expérimenté par des enseignants en sciences infirmières de la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine.
Deux recherches qualitatives visant à comprendre la réflexion sur l’action pédagogique des enseignants novices en santé avaient pour but de développer les compétences pédagogiques par l’expérimentation des modèles. Dès le début des expérimentations, les enseignants novices et experts se sont jumelés. Afin d’opérationnaliser les modèles, des outils réflexifs (rétroaction vidéo, journal de bord combiné à l’autoévaluation, autoconfrontation simple) ont été utilisés favorisant la prise de conscience des éléments pédagogiques à améliorer.
Le développement des compétences pédagogiques, comme le pilotage et la planification de leçons, s’est avéré positif. Dans le cadre de cette communication, les résultats des expériences québécoise et bruxelloise seront présentés.
-
Communication orale
Développer le savoir-être dans les programmes professionnalisants dans le domaine de la santé: entre nécessité et possibilitéMarie Beauchamp (UQAM - Université du Québec à Montréal)
L’importance de développer le savoir-être, notamment dans les métiers relationnels, fait consensus. La rareté des moyens et la complexité du sujet génèrent cependant de nombreux questionnements : Comment identifier cet objet d’apprentissage (Scallon, 2004) que nous définissons par ailleurs difficilement (Bellier, 2004) ? Comment conjuguer avec la subjectivité des enseignants et des maitres de stage ? Est-ce possible d’évaluer le savoir-être ? Un projet de recherche-action-formation (Guay, Prud’homme et Dolbec, 2016) mené à l’ordre d’enseignement supérieur au collégial avec une équipe enseignante d’un programme d’études lié au secteur de la santé fournit certaines réponses à ces questions. Précédée d’une analyse de besoins de formation (Roussel, 2011), la mise en place d'une communauté d’apprentissage comme dispositif d’accompagnement a permis la mise en œuvre d’un processus d’accompagnement des stagiaires et d’évaluation des compétences qui prend en compte le savoir-être et s’appuie sur le jugement professionnel (Beauchamp, 2020). Misant sur une compréhension renouvelée de la notion de savoir-être et s’appuyant sur le processus d’évaluation des compétences (Leroux et Bélair, 2015), l’identification de gestes clés permet de structurer une démarche permettant de développer le savoir-être. Dans cette communication, nous présenterons ce processus transférable dans d’autres programmes mettant de l’avant l’importance de l’accompagnement et de la pratique réflexive.
-
Communication orale
Un environnement capacitant: une nécessité pour pérenniser des dispositifs pédagogiques innovants. Recherche qualitative descriptive dans l'enseignement supérieur en BelgiquePierre D'Ans (Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine), Jennifer Foucart (Université libre de Bruxelles), Delphine Kirkove (Université de Liège), Dan Lecocq (Université du Luxembourg), Céline Mahieu (Université libre de Bruxelles), Benoit Pétré (Université de Liège)
Introduction: Des chercheurs belges ont exploré les obstacles et les leviers relatifs à la mise en œuvre et à la pérennisation de dispositifs pédagogiques innovants (DiPI) développés pour répondre aux besoins des acteurs de la première ligne d’aide et de soin au sein de programmes de formation initiale de professionnels de santé et du social dans l’enseignement supérieur. Méthode: Une approche qualitative descriptive a été utilisée: des entretiens semi-dirigés ont été réalisés auprès d’enseignants. Leur contenu a fait l’objet d’une analyse thématique. Résultats: Les chercheurs ont pu identifier 8 thèmes qui décrivent les conditions à la pérennisation d'un dispositif pédagogique innovant: 1/s'appuyer sur d'autres initiatives pour se renforcer; 2/avoir les moyens de ses ambitions; 3/communiquer de façon transparente pour emporter l'adhésion; 4/pouvoir compter sur des personnes soutenantes; 5/être porté par des valeurs et de l'enthousiasme partagés; 6/"faire son trou" dans le programme et être reconnu; 7/collaborer avec de nouveaux acteurs et 8/résister aux impondérables. Discussion: Ces résultats sont congruents avec la littérature scientifique à propos des innovations pédagogiques en général, et avec le concept d’environnement capacitant en particulier. Conclusion: Cette étude met en lumière des points d’attention pour développer des DiPI pérennes au sein des programmes de formation initiale des futurs professionnels de santé et du social dans l’enseignement supérieur.
-
Communication orale
La pratique pédagogique informée par des résultats probants d’infirmières enseignantes en Belgique francophone : une étude de cas multiples utilisant une méthode mixteNadine Jacqmin (Centre Hospitalier de Luxembourg)
Introduction. La pratique pédagogique informée par des résultats probants (pratique EBT) consiste en l’utilisation contextualisée des résultats probants dans la pratique pédagogique. Cette recherche vise à comprendre comment les infirmières enseignant dans la formation infirmière de niveau bachelier en Belgique francophone conçoivent et mettent en œuvre la pratique EBT en tant qu'innovation induisant une transition de rôle professionnel.
Méthode. Une étude de cas multiples imbriquée utilisant une méthode mixte a été utilisée dans cette recherche. Des données qualitatives et quantitatives ont été récoltées grâce à l’analyse de 18 documents et auprès de 184 participants issus de cursus infirmiers de quatre Écoles (HÉ) de Belgique francophone et d’instances politiques ou associatives.
Résultats et discussion.L’intégration des données qualitatives et quantitatives a mis en évidence que la pratique EBT est partiellement implantée par les enseignantes. Suite à cette implantation partielle, les enseignantes vivent une transition de rôle professionnel. De plus, la mise en œuvre de la pratique EBT est influencée par des facteurs liés à l’enseignante, à la HÉ et au contexte belge. Enfin, les enseignantes exercent peu la pratique EBT alors qu’elles se sentent capables de la mettre en œuvre. Ainsi, la mise en œuvre de cette pratique pourrait être améliorée afin de devenir systématique.
-
Communication orale
PreSHum - Une recherche qualitative sur l'enseignement au prendre soin humanisteVéronique Baudewyns (Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine), Pascaline Herpelinck (Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine)
En sciences infirmières, Finfgeld-Connett (2006) affirme que « le soin comprend des aspects affectifs ou humanistes relatifs à l’attitude et à l’engagement et des aspects instrumentaux ou techniques, et […] [qu’] il est important de ne pas les séparer ». Il découle de cette affirmation qu’un prendre soin de qualité requiert des qualités relationnelles et humaines. D’autres métiers de l’humain, dans les domaines de la santé, du social et de l’éducation exigent ces qualités que l’on peut qualifier de compétence au prendre soin humaniste par laquelle les professionnels, s'appuyant sur des valeurs humanistes, s’engagent de façon authentique, empathique et réflexive dans une relation mutuelle et réciproque, afin de favoriser la capacité de la personne accompagnée à être actrice de son projet.
La formation requiert alors des stratégies pédagogiques visant le développement de cette compétence en créant un environnement bienveillant et sécurisant pour les apprenants. De telles stratégies sont utilisées au sein de la section soins infirmiers de la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine , mais à ce jour, aucun monitoring n’a été réalisé pour s’assurer qu’elles contribuaient au développement de la compétence au « prendre soin humaniste ».
La recherche PreSHum porte sur l’efficacité et la transférabilité de pratiques de formation à la lumière des théories « humanistes-caring » en sciences infirmières et des pédagogies conatives, humanistes et critiques en sciences de l’éducation.
-
Communication orale
Pistes de réflexion et recommandations pour soutenir le développement d’une posture interdisciplinaire des infirmières et infirmiers dans la formationEmilie Allard (Université de Montréal), Chantal Caux (Université de Montréal), Sabrina Fournelle (UdeM - Université de Montréal)
L’infirmier.ère, comme les autres professionnels.les de la santé, doit développer une vision globale, en collaboration avec d’autres professionnels, pour agir face aux situations complexes de soins de santé. La prise en charge de cette complexité des situations et des besoins de soins nécessite des capacités réflexives, d’évaluation et d’action en interdisciplinarité de la part des professionnels.les de la santé. La posture interdisciplinaire de l’infirmier.ère lui permet de relier et d’intégrer plusieurs perspectives et savoirs afin de comprendre et répondre aux situations complexes. Toutefois, la posture interdisciplinaire et son développement demeurent peu documentés jusqu’à présent. De ce fait, peu d’écrits abordent comment les formateurs et formatrices peuvent contribuer au développement de cette posture des futurs professionnels de la santé.
Cette communication présente des pistes de réflexion et des recommandations pour soutenir le développement d’une posture interdisciplinaire des infirmiers.ères dans la formation, issues de résultats d’une théorisation ancrée. Un modèle du développement d’une posture interdisciplinaire sera présenté, suivi de recommandations pour la formation des infirmiers.ères et d’autres professionnels de la santé.
Pause dîner
Session de l’après-midi
-
Communication orale
Récit d’expériences interculturelles en pédagogie universitaire des sciences infirmièresLaurence Bernard (Université du Luxembourg), Thibault Dubois (Université du Luxembourg)
Les sciences infirmières sont en plein développement au Luxembourg: les formations initiales et de spécialités étaient initialement enseignées uniquement au Lycée Technique pour Professions de Santé. Elles sont à présent enseignées à l'Université du Luxembourg depuis 2023. Cette universitarisation surgit dans un contexte de pénurie infirmière puisque 3800 nouvelles infrmières devraient être formées d'ici 2030 (Plan National). Dans ce contexte, l'introduction de cette discipline professionnelle à l'Université mobilise des enseignants issus de différents horizons. Leurs formations hétéroclites et l'interculturalisme constituent des défis pédagogiques au sein de ces nouveaux programmes de formation universitaire. C'est dans ce contexte innovant qu'un récit narratif prend place sous forme de dialogue entre un enseignant novice et une enseignante chevronnée. Ce récit d'expérience en contexte interculturel permet de poser un jalon sociohistorique de l'émergence de la discipline infirmière au Luxembourg.
-
Communication orale
L'intégration des enseignants-chercheurs dans la formation universitaire : un défi perpétuelPhilippe Delmas (Institut et Haute École de la santé la source)
Les accords de Bologne ont permis à l'Europe d'organiser les formations universitaires selon l'approche Licence-Master-Doctorat (LMD) pour être plus visibles sur la scène internationale. La formation des infirmières en francophonie européenne était jusqu'alors principalement dispensée dans des écoles en soins infirmiers. La Suisse a été pionnière dans le domaine en créant une université des métiers regroupant plusieurs professions dont les soins infirmiers. Ces écoles ont dû se doter d'un axe de recherche, ouvrant ainsi des postes de professeurs de carrière et de maitres d'enseignement. Cela n'a pas été sans mal, car cela a questionné les enseignements, les approches pédagogiques et la place de ces enseignants-chercheurs au sein d'une institution auparavant principalement axée sur la formation. Dans ce contexte, afin d'optimiser leur intégration, la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a développé des formations continues en pédagogie afin de doter les professeurs de compétences dans ce domaine, passant par une validation d'un certain nombre de modules obligatoires pour obtenir le certificat d'enseignant. De même chaque institution s'est dotée d'un centre pédagogique pour soutenir la qualité pédagogique des enseignants. En outre, un mentorat des jeunes chercheurs a été institué afin d'accompagner ces derniers dans le développement de leurs compétences. Cette communication va décrire plus en détail l'accompagnement pour soutenir la carrière universitaire.
-
Communication orale
Devenir-imperceptible: inscrire le mentorat académique dans une résistance aux impératifs néolibérauxDave Holmes (Université d'Ottawa), Pier-Luc Turcotte (Université d’Ottawa)
Sous l'influence du néolibéralisme, le travail académique est soumis à une pression croissante de se conformer aux impératifs de visibilité et de perceptibilité. Dans cette présentation, nous soutenons que les universitaires devraient résister à l'imposition de cette « grille » néolibérale et s'engager dans une démarche de « devenir-imperceptible », s'inspirant des idées de Deleuze et Guattari. En s'appuyant sur une expérience de mentorat établie depuis 3 ans entre deux professeurs (junior et sénior) en ergothérapie et en sciences infirmières, nous mettons en lumière le potentiel transformateur des absences temporaires. Devenir-imperceptible n'implique pas un désengagement silencieux; au contraire, il représente une forme créative de résistance remettant en question les modes d'évaluation prédominants basés sur la visibilité et la perceptibilité. En exploitant ces moments d'absence, les universitaires peuvent intensifier leurs liens affectifs tant avec leurs pairs qu'avec leur travail, les rendant indiscernables face aux contraintes du milieu académique. Nous soutenons que ces instances d'imperceptibilité créent un terrain propice à un travail académique créatif en marge des frontières établies, où la recherche originale peut s'épanouir. Une telle approche subversive est particulièrement pertinente dans des domaines tels que les sciences infirmières et de la santé en général, où elle peut remettre en question les discours dominants caractéristiques de l'académie néolibérale.
-
Communication orale
L'intégration des philosophies dans la discipline infirmière: un levier pour l'innovation et l’émancipation dans un contexte académiquePawel Krol (Université Laval)
Aujourd'hui, la discipline infirmière est solidement établie dans les universités en Amérique du Nord et dans certains pays européens. Son intégration ne dépend pas uniquement de l'évolution des théories spécifiques à la profession, contrairement à certaines assertions. Son crédit réside plutôt dans sa capacité à former des professionnels qualifiés pour répondre aux besoins de soins de diverses populations dans des environnements de pratique complexes. Cette réussite découle de l'incorporation d'un éventail de philosophies. Dans cette perspective, l'ouvrage "Philosophies et sciences infirmières : contributions essentielles à la discipline" explore différentes philosophies et expose leur utilisation dans l'enseignement et la pratique. Ce recueil examine les bases et les moyens d'intégrer les philosophies dans la discipline, répondant ainsi à un besoin urgent de formation pour les étudiants et fournissant une ressource inestimable aux enseignants, qu'ils soient débutants ou expérimentés, souhaitant comprendre le rôle de la philosophie dans l'étude des phénomènes liés à la pratique infirmière. Cette présentation, à la fois interactive et herméneutique, aborde l’histoire de la création de l'ouvrage et expose son objectif principal : être un moteur de développement pour la discipline, tant dans le domaine de la formation que de la recherche, afin de garantir des pratiques infirmières novatrices dans des environnements complexes et variés.
Lancement du livre « Philosophie en sciences infirmières »
Cet ouvrage pédagogique regroupe 18 chapitres écrits par des auteurs en sciences infirmières issus de champs d’expertise variés et des plus pertinents. Chaque chapitre présente les fondements ontologiques et épistémologiques de même que l’articulation des concepts clés de philosophes qui exercent une influence majeure sur les sciences infirmières et la pratique des soins infirmiers à l’aide d’exemples pour la pratique, la recherche et la théorisation dans cette discipline. Cet ouvrage collectif est le fruit d’années de réflexion au regard du développement des connaissances en sciences infirmières. Il est une réponse mesurée et assumée à certains discours dominants qui circulent au sein de notre discipline et de notre profession. La position générale qu’une majorité d’autrices et d’auteurs défendent est très claire : il s’agit, d’une part, d’une position d’ouverture vers des disciplines extérieures aux sciences infirmières et, d’autre part, d’un encouragement à la mobilisation des savoirs dits « empruntés » à d’autres disciplines au sein même des sciences infirmières. Les auteurs, issus de la Belgique, du Canada, de l’Espagne, des États-Unis, de la France, du Luxembourg, de la Suisse et de la Tunisie montrent que plusieurs philosophes ou philosophies ont une influence déterminante sur le développement des connaissances dans notre discipline, constituant ainsi une preuve avérée de l’importance des connaissances extradisciplinaires pour le développement des savoirs infirmiers.