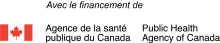Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :La recherche montre que les insatisfactions corporelles et la stigmatisation en lien avec le poids et l’apparence sont associées à des symptômes dépressifs et anxieux, ainsi qu’à un risque accru de développer des troubles de comportements alimentaires. En plus d’être étroitement liées les unes à l’autre, les insatisfactions corporelles et la stigmatisation se retrouvent dans différentes sphères de la vie des personnes qui les subissent. Elles débutent tôt dans la vie, proviennent de plusieurs sources et tendent à se chroniciser. C’est pourquoi il est essentiel de connaître et de cibler les interventions qui agissent sur l’image corporelle et la stigmatisation en lien avec le poids et l’apparence, de même que de faire état des résultats de ces interventions.
Bien que les recherches portant sur l’image corporelle et la stigmatisation en lien avec le poids et l’apparence soient nombreuses, elles portent le plus souvent sur des échantillons américains ou européens. C’est dans ce contexte qu’il semble important de s’intéresser de plus près aux données et aux constats issus de recherches conduites au Québec en lien avec ces deux construits. Notons aussi que la recherche sur ces thématiques foisonne actuellement au Québec, avec un nombre grandissant de chercheurs et chercheuses issus de différentes disciplines et travaillant dans différents milieux qui s’y intéressent.
Le colloque fera le pont entre les avancées scientifiques et leurs applications concrètes sur le plan de l’intervention, et ce, de manière à éclairer les acteurs d’influence des milieux scolaires, communautaires et de la santé. Il présentera des connaissances, savoirs expérimentaux et expérientiels permettant de mieux déterminer comment agir sur l’acceptation de la diversité corporelle ainsi que sur toute forme de stigmatisation en lien avec l’apparence et le poids. Il privilégie une approche intersectorielle visant à mettre en relief des interventions prometteuses afin de prévenir et contrer les problématiques pouvant émerger de ces deux construits.
Dans ce colloque, nous proposons donc de réunir des chercheurs et chercheuses du Québec qui s’intéressent à l’image corporelle et à la stigmatisation en lien avec le poids et l’apparence. Ils présenteront les résultats de leurs recherches les plus récentes en ce qui a trait à leurs interrelations, à leurs corrélats et déterminants, ainsi qu’aux interventions disposant déjà d’appuis empiriques à l’échelle québécoise, ou encore semblant prometteuses pour améliorer l’image corporelle et réduire la stigmatisation. Pour ce faire, différents types d’échantillons, d’âges et de genres variés, issus de divers contextes de vie, mais tous d’origine québécoise seront présentés.
Remerciements :Ce colloque a été rendu possible grâce au soutien financier de l'Agence pour la santé publique du Canada et la Chaire de recherche du Canada sur les déterminants psychologiques et sociaux des comportements alimentaires. Nous remercions également les partenaires suivants : la Table éducation Outaouais, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université du Québec en Outaouais
Date :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Annie Aimé (UQO - Université du Québec en Outaouais)
- Mylène Dault (Experte-conseil en mobilisation des connaissances)
- Noémie Carbonneau (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
Programme
Mot d’introduction
Session 1
-
Communication orale
Le poids de la pandémie : Préoccupation à l’égard du poids chez les étudiantes et étudiants collégiaux du QuébecJulie Auclair (Cégep de Jonquière), Marie-Ève Blackburn (Cégep de Jonquière), Jacinthe Dion (UQTR), Virginie Houle (cégep de Jonquière)
Les collégien(ne)s n’ont pas échappé aux conséquences de la pandémie sur leurs habitudes de vie. Ces conséquences influencent immanquablement l’image corporelle et leur préoccupation à l’égard de leur poids.Une enquête portant sur l’Adaptation psychologique des étudiants collégiaux face à la COVID-19 a été réalisée à l’automne 2021 dans 18 collèges québécois. La moitié des 5 000 personnes répondantes (2 434 étudiant(e)s) a été soumise à une série de questions portant sur leur poids et leur image corporelle. Au total, 50,1% des femmes, 36,6 % des hommes and 44,7% des personnes non-binaires ont déclaré être plus préoccupés par leur poids qu’avant la pandémie. Des analyses de régression multinomiales distinctes selon le sexe ont permis d’identifier les facteurs influençant leur niveau de préoccupation à l’égard du poids. En raison du plus petit nombre, des analyses bivariées ont été réalisées chez les personnes s’identifiant non-binaires. Plusieurs facteurs ont été testés tels que le fait de vivre de la détresse (PHQ-9) qui augmente le risque de vivre une préoccupation accrue. Aussi, plus l’appréciation corporelle (BAS-2) est élevée moins fort est le risque d’avoir vu sa préoccupation augmenter et plus grand est le risque de l’avoir vu diminuer. Aussi, le fait de se trouver trop gros augmente la préoccupation. Cette enquête souligne la nécessité de soutenir les jeunes à développer de meilleures habitudes de vie, mais surtout de mettre en valeur la diversité corporelle.
-
Communication orale
L’effet des normes sociales de popularité et d’apparence sur les préoccupations liées au poids et la restriction alimentaire chez les enfants du primaireFanny-Alexandra Guimond (Université d’Ottawa), Brett Laursen (Florida Atlantic University)
Cette étude vise à examiner l’effet des normes sociales liées à l’apparence par rapport aux préoccupations liées au poids et la restriction alimentaire selon le genre et l’âge des enfants. Au total, 353 élèves de 3ième à 5ième année du primaire (n =171 filles, 167 garçons, 15 autre, Mâge = 9,2 ans) d’une école à charte de l’État de la Floride ont encerclé le nom de chaque élève de leur classe qui correspondait à la description de la popularité et d’une belle apparence et ont complété un questionnaire sur leurs préoccupations liées au poids et la restriction alimentaire à deux temps de mesure. Les normes sociales ont été opérationnalisées comme étant la valorisation par les pairs (i.e., atteinte d’un statut d’enfant populaire) de l’apparence dans chaque classe. Les analyses préliminaires montrent que les jeunes qui sont perçus comme étant beaux sont plus populaires et appréciés de leurs pairs. De plus, des analyses multi-niveaux montrent que les préoccupations par rapport au poids sont modérées par les normes sociales de la classe, indépendamment du genre de l’enfant. En effet, les préoccupations semblent s’aggraver au cours de l’année scolaire chez les enfants qui sont dans une classe où la beauté est socialement récompensée. Des différences d’âge sont notés, mais tous les enfants semblent vivre, à différents degrés, cette réalité. Ains, les élèves du primaire semblent déjà subir les effets des idéaux sociétaires de beauté. Des pistes d’interventions seront discutées.
-
Communication orale
Image corporelle et surplus de peau : la chirurgie bariatrique a-t-elle réponse à tout?Aurélie Baillot (UQO - Université du Québec en Outaouais)
Les personnes candidates à une chirurgie bariatrique sont davantage sujettes à l’insatisfaction corporelle comparativement aux personnes présentant un indice de masse corporelle identique ne souhaitant pas de chirurgie bariatrique. Alors que la chirurgie bariatrique permet une amélioration de l’image corporelle dans la majorité des cas, l’apparition du surplus de peau vient brouiller les pistes. Le surplus de peau est présent dans plus de 70% des cas après la chirurgie bariatrique, et affecte la santé et qualité de vie des personnes en raison de nombreux défis au quotidien en particulier au niveau psychosocial. Dans le cadre de cette présentation, les conséquences de la chirurgie bariatrique sur l’image corporelle seront abordées suivi d’une synthèse des conséquences biopsychosociales du surplus de peau. Les résultats de recherche quant aux interrelations entre image corporelle et surplus de peau seront ensuite présentés pour finir avec une discussion sur les pistes de solution quant à la prise en charge du surplus de peau à la suite de la chirurgie bariatrique.
-
Communication orale
L’évaluation de la pré-implantation du programme « Simplement Moi » : explorer les raisons de son adoption, cibler les stratégies d’adaptation et les mesures de soutienAnnie Aimé (UQP), Camille Boutin (UQO), Mylène Dault (Les Ateliers Silhouette), Line Leblanc (UQO - Université du Québec en Outaouais), Lunie Louis (UQO), Jeanie Pinard-Duhaime (Table Éducation Outaouais)
L’intimidation par rapport au poids et à l’apparence est un phénomène préoccupant dès l’école primaire puisqu’il peut nuire au développement de l’identité, de l’estime de soi et à la transition vers l’école secondaire. La plupart des programmes existants n’ont pas nécessairement considéré l’opinion des acteurs clés du milieu scolaire lors de leur développement, ce qui limite leur capacité de répondre aux besoins. La présente étude qualitative vise à évaluer l'adoption, les mesures d’adaptation et les conditions d’implantation du programme « Simplement Moi » à l’intention des élèves de 10 à 12 ans fréquentant trois écoles primaires du Québec. Les participants sont quatre directions et 16 enseignantes. Les résultats indiquent que le programme « Simplement Moi » est jugé pertinent en raison des conséquences graves liées à l’intimidation par rapport au poids et à l’apparence. De plus, cette problématique devrait faire l’objet d’une intervention structurante puisqu’elle compromet les valeurs fondamentales poursuivies par l’école, comme la bienveillance et l’unicité de la personne. L’adoption de ce programme repose donc sur le besoin de soutien afin que les directions et le personnel scolaire soient en mesure d’agir de manière proactive et ainsi assurer le bien-être des élèves et leur sécurité. Il apparait essentiel de consulter les acteurs-clés au moment de développer un nouveau programme pour l’adapter au contexte et anticiper concrètement les obstacles à son implantation.
Dîner (en même temps que les présentation par affiches)
Présentation par affiches
-
Communication par affiche
Explorer les commentaires négatifs sur le poids au sein de programmes à volet particulier dans les écoles primairesOlivia Gardam (Université d'Ottawa), Fanny-alexandra Guimond (Université d'Ottawa), Sahej Kaur (Université d’Ottawa), Philip MacGregor (Université d'Ottawa), Jonathan Smith (Université de Sherbrooke)
De nombreux jeunes sont affectés par la stigmatisation liée au poids (Puhl et al., 2020). Par exemple, les enfants qui subissent des commentaires et des taquineries sur leur poids sont plus susceptibles d'avoir une faible estime d'eux-mêmes (Fiels et al., 2021). L'objectif de cette étude est de déterminer si la prévalence de ces commentaires diffère selon des programmes à volet particulier au primaire (i.e., général, spécialisé dans les arts, dans les sports ou axé sur les études) étant donné l'importance accordée à l'esthétisme ou au corps dans certains sports et activités artistiques ou à un plus grand niveau de perfectionnisme dans les programmes axés sur les études. Un questionnaire a été diffusé auprès de 1 400 élèves du primaire (9-12 ans) sur leurs préoccupations en matière d'image corporelle, leur parcours scolaire et la fréquence des commentaires négatifs reçus sur leur poids de la part de leurs pairs. Les résultats ont montré une prévalence plus élevée des commentaires négatifs sur le poids chez les élèves dans le volet artistique comparativement aux autres volets. Les résultats suggèrent que les élèves en arts accordent une plus grande importance à l'apparence, et ce dès l'enfance. Ainsi, cette étude indique qu’il est important de considérer la prévalence des commentaires négatifs sur le poids selon les volets d'enseignement tôt dans la scolarisation afin de créer des ressources et des interventions pour les élèves qui pourraient en être le plus à risque.
-
Communication par affiche
Les répercussions des commentaires négatifs sur le poids émanant d’amis et de pairs sur l’image corporelle des enfants et des adolescentsAbderrahmane Aberdaa (Université d’Ottawa), Olivia Gardam (Université d'Ottawa), Fanny-Alexandra Guimond (Université d'Ottawa), Philip MacGregor (Université d'Ottawa)
La littérature scientifique a bien exploré l’effet négatif que peuvent avoir les commentaires sur le poids émanant des pairs sur l’image corporelle des jeunes. Toutefois, il apparaît qu'une distinction n'a pas été clairement établie concernant la notion de « pairs », soit la différence entre des commentaires reçus par des amis ou par d’autres pairs. De plus, les jeunes peuvent taquiner leurs amis sur leur poids et les répercussions de ces commentaires ne sont pas clairs sur le développement. Ainsi, notre étude vient explorer l’effet différentiel des commentaires liés au poids sur l'image corporelle chez les enfants et les adolescents, en distinguant les effets des amis et des pairs. Notre échantillon comprend 2675 élèves québécois (9-16 ans) qui ont répondu à un questionnaire en début et à la fin d'une année scolaire. Les préoccupations corporelles ont été a évaluées via le Body Uneasiness Test et les répercussions des commentaires négatifs sur le poids des pairs et des amis ont été mesurées à l’aide d’une adaptation de l'Inventaire de l'influence des pairs sur les préoccupations alimentaires. On a également exploré l’effet modérateur de l’âge et du genre des jeunes dans ces dynamiques. Les résultats nous informent de la pertinence d’adresser directement les commentaires liés au poids, et ce peu importe la forme et dès l’enfance. Des pistes de prévention et d’intervention seront suggérées.
-
Communication par affiche
Facteurs associés à la gêne lors de la pratique d’activité physique en post-chirurgie bariatriqueAnnie Aimé (UQO), Aurélie Baillot (UQO), Paquito Bernard (UQAM), Laurent Biertho (Université Laval), Stéphane Bouchard (UQO), Jennifer Brunet (Université d'Ottawa), Alexia Duciaume (UQO - Université du Québec en Outaouais), Shaina A. Gabriel (UQO), Pierre Y. Garneau (Université de Montréal), Marie-France Langlois (Université de Sherbrooke), Lucie Lemelin (UQO), Rémi Rabasa-Lhoret (Université de Montréal), Ahmed J. Romain (Université de Montréal), André Tchernof (Université Laval)
Après une chirurgie bariatrique, jusqu’à 93% des personnes doivent composer avec un surplus de peau (SP), qui peut être à l’origine de gêne lors de l’activité physique (AP). L’objectif de cette étude est de comparer les caractéristiques biopsychosociales et comportementaux des personnes avec ou sans gêne causée par leur SP lors de l’AP. Une étude multicentrique transversale a été menée auprès de 124 adultes (92,7% de femmes, 46,5±9,9 ans) au Québec. Le poids, la taille et la quantité de SP ont été mesurés en laboratoire. Les participants ont rempli des questionnaires auto-rapportés sur la gêne causée par le SP, l’estime corporelle, l’anxiété physique sociale (APS), les attitudes socioculturelles envers l’apparence et l’AP d’intensité modérée à vigoureuse. Les résultats montrent que les participants avec de la gêne lors d’activités sportives, de la course ou de la marche rapide ont une moins bonne estime corporelle, davantage d’APS, d’internalisation des attitudes envers l’apparence et de SP, sans différence significative quant à la pratique d’AP auto-rapportée, comparativement aux personnes sans gêne. En conclusion, l’étude révèle que les facteurs psychosociaux en lien avec l’image corporelle et la quantité de SP devraient être considérés chez les personnes gênées par leur SP lors de la prise en charge pour la pratique d’AP en post-chirurgie bariatrique. Davantage d’études sont toutefois nécessaires afin d’établir les liens de causalité de ces relations.
-
Communication par affiche
Adaptation et adoption du programme « Simplement Moi » : le point de vue des élèvesAnnie Aimé (UQO), Camille Boutin (UQO - Université du Québec en Outaouais), Mylène Dault (Ateliers Silhouette), Line LeBlanc (UQO), Lunie Louis (UQO), Jeanie Pinard-Duhaime (Table Éducation Outaouais)Affiche
Au Québec, le quart des enfants d’âge scolaire seraient victimes d’intimidation. Dès l’école primaire, on constate les conséquences des moqueries concernant le poids et l’apparence physique sur l’estime de soi et la transition vers l’école secondaire. La présente étude vise à évaluer les mesures d’adaptation envisagées pour l’adoption du programme « Simplement Moi ». Dix élèves, âgés entre 10 et 12 ans et fréquentant deux écoles de la région de l’Outaouais, ont émis des recommandations relativement à l’implantation du programme. L’analyse qualitative des verbatim a fait ressortir que, selon les élèves, le programme est pertinent en raison des graves conséquences de l’intimidation liée au poids et à l’apparence. Ils considèrent que l’implantation du programme sera utile pour aborder ce sujet en profondeur avec leur enseignant.e, mieux comprendre l’impact de l’intimidation et les aider à se sentir mieux dans leur peau. Quant aux adaptations nécessaires, les élèves s’attendent à plus de surveillance, à des interventions plus strictes envers les intimidateurs, à la création d’un outil de dénonciation et à l’identification d’une personne-ressource pour les victimes d’intimidation. Ces résultats suggèrent que, malgré les efforts notables pour prévenir et contrer toutes les situations ou formes d’intimidation en milieu scolaire, le besoin d’adresser l’intimidation en lien avec le poids et l’apparence demeure présent pour les élèves.
-
Communication par affiche
Corrélats biopsychosociaux des biais liés au poids chez les étudiant.e.s universitaires québécoisAnnie Aimé (UQO), Angela Alberga (Université Concordia), Aurélie Baillot (UQO), Patricia Blackburn (UQAC), Marilou Côté (Université Laval), Vida Forouhar (Université Concordia), Alice Jeanningros (UQO - Université du Québec en Outaouais), Martin Lavallière (UQAC), Christophe Maïano (UQO)
Les études révèlent que les étudiant.e.s universitaires présentent des Biais Liés au Poids (BLP). Cette étude vise à explorer les facteurs biopsychosociaux et comportementaux contribuants aux BLP chez les Étudiant.e.s universitaires Québécois (EQc) en psychologie et social, santé, et éducation. Les BLP ont été évalués auprès de 585 EQc (88% femmes, Mâge=25.5±6.3) avec le questionnaire AntiFat Attitude 3 dimensions: BLP-dépréciation des personnes avec obésité, -peur de prendre du poids, et -contrôlabilité du poids. Les données sociodémographiques, de parcours éducatif, d’habitudes de vie, liées au poids et à l’image corporelle ont été recueillies. Les régressions multivariées ont montré qu’être aux études à temps plein, avoir une formation sur l’obésité, et des scores élevés BLP-contrôlabilité et -peur expliquent un score élevé de BLP-dépréciation (R2adj: 0.33, p<.001). Le genre féminin, un faible indice de masse corporelle, des scores élevés d’Internalisation des BLP (IBLP), et de BLP-dépréciation et -contrôlabilité expliquent un score élevé de BLP-peur (R2adj: 0.43, p<.001). Le genre masculin, être aux études de 1er cycle, l’absence de compte de rencontre en ligne, et des scores élevés BLP-dépréciation et -peur expliquent un score élevé de BLP-contrôlabilité (R2adj: 0.32, p<.001). Les EQc présentent des BLP qui varient avec les facteurs modifiables : IBLP et avoir reçu une formation sur l'obésité. Davantage d’études sont nécessaires pour déterminer les liens de causalités.
-
Communication par affiche
Le contexte compétitif : Une victoire qui fait malKathy Bélanger (UQTR), Noémie Carbonneau (UQTR), Marie-Pierre Gagnon-Girouard (UQTR), Gabriel Parent (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
L’activité physique procure de nombreux bienfaits pour la santé, mais peut aussi être associée à des difficultés en termes d’image corporelle. Notamment, le fait de pratiquer l’activité physique pour contrôler son apparence pourrait entrainer une activité physique moins intuitive, ce qui est associé à plus de risque pour la santé globale. L’objectif de cette étude est d’examiner comment l’image corporelle et l’activité physique intuitive diffèrent en fonction du type de pratique sportive chez les adolescents. Ce projet s’intéresse plus particulièrement à ces différences en lien avec la pratique du volleyball (pratique compétitive, pratique récréative et absence de pratique du volleyball). Au total, 216 participants âgés de 14 à 17 ans ont été recrutés dans les écoles pour une étude en ligne. Les résultats montrent que les groupes diffèrent significativement, F(10, 420) = 3,631, p < 0,01. Les personnes pratiquant le volleyball de façon récréative présentent généralement un profil plus positif. Elles montrent une plus grande confiance corporelle (p = 0,003) et une moins grande rigidité dans la pratique de l’activité physique (p = 0,014), mais également plus d’exercice émotionnel, (p=0,01). Les groupes ne diffèrent pas en termes d’image corporelle. Les résultats montrent que la pratique d’un sport en contexte récréatif pourrait être associée à une pratique de l’activité physique plus intuitive.
-
Communication par affiche
Impact de l’exposition à une campagne de sensibilisation sur la grossophobie : une étude randomiséeLaurence Banville (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Ariane Cassista (UQTR), Marie-Pierre Gagnon-Girouard (UQTR), Maria Del Mar Poveda (UQTR)
Le projet évalue l’impact d’une campagne de sensibilisation effectuée par l’OBNL ÉquiLibre, qui fait la promotion d’une image corporelle positive et de la diversité corporelle. Directement implantée sur les réseaux sociaux, la campagne d’une durée d’un mois s’intitule « La grossophobie, ça suffit! ». La grossophobie inclut l’ensemble des dévaluations sociales, discrimination et stigmatisation envers les personnes au poids élevé. Elle a augmenté de 66% depuis les dix dernières années, il s’agit donc d’un problème social majeur. Avec des vidéos humoristiques, articles, balados, billets de blogue et opinions d’experts, ÉquiLibre souhaitait sensibiliser les gens à ce phénomène, ses manifestations, ses impacts et déconstruire les préjugés qui l’entretiennent. L’objectif de ce projet est d’évaluer l’évolution des préjugés relatifs au poids envers les personnes au poids élevé chez les participantes à la suite de l’exposition en ligne à la campagne. Cent cinquante participantes ont été recrutées afin de participer à l’étude et les soixante-quinze participantes ayant été exposées à la campagne. Les participantes ayant été exposées à la campagne ont montré une amélioration significative pour une seule des dimensions mesurant les préjugés, soit l’aversion envers les personnes au poids élevé F(2,128)= 7,99, p < 0,01. C’est la première étude au Québec qui évalue l’impact d’une campagne de sensibilisation auprès de la population générale afin de réduire les préjugés liés au poids.
-
Communication par affiche
Associations entre traits d’appétit et image corporelle chez les adolescent.e.s : Une analyse de profils latentsNoémie Carbonneau (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Geneviève Lavigne (UQTR), Camille Lavoie (UQTR), Thomas Sire (UQTR), Laurence Vermette (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
Les traits d'appétit sont des prédispositions envers la nourriture qui interagissent avec des facteurs environnementaux pour influencer les habitudes alimentaires et les trajectoires de poids. À ce jour, peu d'études ont utilisé les analyses centrées sur la personne pour examiner les traits d’appétit chez les adolescent.e.s. De plus, aucune recherche n’a examiné les associations entre les traits d’appétit et l’image corporelle. L'objectif principal de notre étude était donc d'étudier ces associations dans un échantillon d'adolescent.e.s en utilisant des analyses de profils latents (LPA). Les participant.e.s (n=280 adolescent.e.s québécois.e.s âgé.e.s de 14 à 17 ans) ont rempli un questionnaire en ligne évaluant les traits d’appétit, l’estime corporelle, l’appréciation du corps et l’insatisfaction corporelle. Des sous-groupes homogènes de participant.e.s ont été identifiés en fonction de leurs scores aux différents traits d'appétit. Les LPA ont révélé trois profils : les mangeur.euse.s avides, modéré.e.s et évitant.e.s. Les mangeur.euse.s modéré.e.s ont rapporté une image corporelle plus positive (c.-à-d. scores plus faibles d’insatisfaction corporelle et scores plus élevés d’estime et d’appréciation corporelle) que les mangeur.euse.s avides et évitant.e.s. De plus, les mangeur.euse.s avides ont rapporté une insatisfaction corporelle plus élevée que les évitant.e.s. Cette recherche a des implications importantes pour le domaine de la psychologie de l’alimentation.
Flashtalks
-
Communication orale
Les parents franco-canadiens : Une analyse thématique de leurs pratiques parentales liées à l’image corporelleOlivia Gardam (Université d’Ottawa), Fanny-Alexandra Guimond (Université d'Ottawa), Laurence Vermette (UQTR)
Les pratiques parentales sont une grande source d’influence dans le développement de l’image corporelle des jeunes. Plusieurs pratiques problématiques et aidantes liées à l’image corporelle ont été identifiées dans la recherche (p. ex. enseigner la littéracie médiatique). Cependant, peu d’études ont observé des conversations parent-enfant afin de comprendre si les pratiques identifiées dans la littérature sont utilisées par les parents en pratique et, si oui, comment elles sont communiquées aux enfants. De plus, les familles franco-canadiennes ont été peu étudiées dans ce domaine, bien que la culture et le contexte linguistique peuvent influencer les pratiques parentales et l’image corporelle. Ainsi, les objectifs de cette étude étaient d’investiguer : (a) si les pratiques parentales identifiées dans la littérature s’alignent avec celles utilisées par les parents franco-canadiens et (b) comment les pratiques parentales sont communiquées par les parents à leurs enfants pendant nos observations. Dans cette étude, 10 dyades parent-enfant franco-canadiennes ont discuté d’une série de vignettes adressant des dilemmes familiaux fictifs liés à l’image corporelle. Une analyse thématique des discussions a été complétée afin d’identifier les pratiques parentales abordées, ainsi que les moyens utilisés par les parents pour aborder chaque pratique. Les pistes de recherche futures auprès des familles franco-canadiennes, ainsi que les implications cliniques des résultats seront discutées.
-
Communication orale
L’influence de la stigmatisation en lien avec le poids sur des femmes québécoises physiquement inactives accomplissant des entraînements sur ergocycle en réalité virtuelleAurélie Baillot (UQO), Paquito Bernard (UQAM), Stéphane Bouchard (UQO), Daniel Fiset (UQO), Joël Guérette (UQO - Université du Québec en Outaouais)
La stigmatisation en lien avec le poids est omniprésente, notamment dans les milieux fréquentés pour améliorer son apparence, comme les centres d’entraînement. Ces éléments stigmatisants pourraient avoir des effets délétères, particulièrement chez les personnes qui internalisent les biais liés au poids (BLP). Pour étudier les conséquences physiologiques et psychologiques de l’internalisation des BLP, une étude pilote avec devis expérimental croisé a été réalisée. Vingt-neuf femmes physiquement inactives ont complété deux entraînements sur ergocycle dans une salle de conditionnement physique virtuelle comportant ou non des éléments stigmatisants en lien avec le poids. Les résultats préliminaires suggèrent un effet de l’internalisation des BLP sur les calories consommées post-entraînement (F(1,29)=4,550; p=0,042; h2=0,14) et sur le plaisir perçu pendant l’effort (F(1,29)=6,543; p=0,042; h2=0,18). Une influence de la condition (stigmatisante; non stigmatisante) sur la distance parcourue sur l’ergocycle (F(1,29)=6,037; p=0,020; h2=0,17) et sur la performance en reconnaissance d’expressions faciales (F(3,75)=4,680; p=0,005; h2=0,03) est également observée. La pratique d’activité physique en contexte stigmatisant semble influencer l’expérience de femmes inactives pratiquant des séances d’activité physique, avec des effets distincts pour celles qui internalisent les BLP. Les interventions visant à rendre ces femmes physiquement actives devraient considérer ces résultats.
-
Communication orale
Analyse des associations dyadiques entre les préjugés à l’égard du poids et la satisfaction relationnelle chez les couples : la pression corporelle comme médiateur potentielNoémie Carbonneau (UQTR), Geneviève Lavigne (UQTR), Carolanne Tanguay (UQTR), Carolanne Verdon (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières)
Il est bien établi dans la littérature que le fait de recevoir des commentaires négatifs au sujet de son apparence de la part de son/sa partenaire amoureux.se nuit à l'image corporelle et à la satisfaction relationnelle. Or, peu d’études ont exploré les conséquences des préjugés à l’égard du poids exprimés par le/la partenaire. Conséquemment, l’objectif général de la présente étude est d'examiner, au sein de couples, les associations intrapersonnelles et interpersonnelles entre les préjugés à l’égard du poids (c.-à-d. les attitudes, les croyances et les jugements négatifs à l’égard des personnes grosses), la pression corporelle ressentie (c.-à-d. le sentiment de devoir présenter un certain poids ou une certaine apparence) et la satisfaction relationnelle (c.-à-d. l’évaluation globale de la qualité de la relation de couple). Au total, 296 participants (148 couples) ont rempli un questionnaire en ligne évaluant les trois variables à l’étude. Un modèle par équations structurelles a été testé et des analyses de médiation par « bootstrap » ont été réalisées. Les résultats montrent que la pression corporelle joue un rôle médiateur dans les associations entre les préjugés et la satisfaction relationnelle des deux partenaires. Ces résultats suggèrent notamment que les individus dont le/la partenaire entretient des préjugés à l’égard du poids sont plus susceptibles de ressentir une pression corporelle, laquelle est liée négativement à leur satisfaction relationnelle.
Session 2
-
Communication orale
Victimisation liée au poids et activité physique chez les adolescents : Analyse longitudinale de l’étude REALAngela S. Alberga (Université Concordia), Annick Buchholz (Children’s Hospital of Eastern Ontario), Marilou Côté (Université Laval), Gary S. Goldfield (Children’s Hospital of Eastern Ontario Research Institute), Natasha Hudek (Ottawa Hospital Research Institute), Nicole Obeid (Children’s Hospital of Eastern Ontario Research Institute)
La victimisation liée au poids (VP) est très répandue chez les jeunes. Bien qu’associée à divers comportements néfastes pour la santé, le lien entre la VP et la pratique d’activité physique (AP) a peu été étudié. Cette étude vise à vérifier si la VP venant des parents et des pairs est associée longitudinalement à la pratique d’AP chez des adolescents. Dans le cadre de l’étude REAL, 374 filles et 238 garçons (Mâge=13.3) de 25 écoles en Ontario ont complété des questionnaires (Godin Leisure-Time Exercice Questionnaire et McKnight Risk Factor Survey IV) au début de l'étude et un an plus tard. Des régressions linéaires ont été testées séparément pour les deux sexes. Les résultats montrent que, chez les filles, la VP venant de leurs deux parents est associée à des niveaux élevés d’AP l’année suivante (β=0.12, p=.03), alors que chez les garçons, la VP venant de pairs masculins est associée à des niveaux faibles d’AP l’année suivante (β=-0.17, p=.01). Ceci suggère que, pour les garçons, être la cible de moqueries venant de jeunes du même sexe semble décourager l’AP. Pour les filles, c’est plutôt la victimisation de la part de leurs parents qui semble, au contraire, augmenter leur pratique d’AP. Il est possible de se questionner sur le caractère sain de cette association entre la VP et l’AP chez les filles. De futures études examinant d’éventuels médiateurs, comme des facteurs liés à l’image corporelle et à la santé mentale, sont essentielles pour mieux comprendre cette relation.
-
Communication orale
Ton corps, mon corps, leur corps : mesurer les attitudes négatives liées au poids envers les autres et envers soiMarcos Balbinotti (UQTR), Anne-Sophie Coulombe (UQTR), Alexandra Desjardins (UQTR), Marie-Pierre Girouard (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Gabriel Parent (UQTR)
La stigmatisation liée au poids représente un enjeu de santé publique majeur, qui affecte la santé physique, mentale et sociale des personnes de toutes les silhouettes (Romano et al., 2023). Cette stigmatisation peut être externalisée (attitudes négatives envers le poids des autres) ou internalisée (attitudes négatives envers soi-même en lien avec le poids). La mesure des préjugés corporels externalisés et internalisés pose des enjeux conceptuels dans la distinction avec des construits qui s’en rapprochent (par exemple, l’image corporelle). L’étude décrit le processus de développement et de validation d’un nouvel outil de mesure des préjugés corporels internalisés et externalisés, le Externalized/Internalized Weight-Bias Scale (EIWBS; Gagnon-Girouard et al., en préparation). Au total, 551 personnes ont participé à l’étude de validation du EIWBS en ligne. Sept facteurs sont mis en évidence par l’analyse factorielle exploratoire : trois dimensions des préjugés corporels externalisés (blâme quant aux habitudes de vie, apparence repoussante et croyances quant au déni des conséquences) et quatre dimensions des préjugés corporels internalisés (blâme quant aux habitudes de vie – activité physique, blâme quant aux habitudes de vie – alimentation, apparence repoussante et croyances quant au déni des conséquences). Les échelles du EIWBS sont faiblement à modérément associées aux autres mesures des préjugés corporels externalisés (r = .344 à .683) et internalisés (r = .326 à .658).
Mot de la fin et invitation à la conférence panel et au coquetel
Savoirs expérientiels : Le pont entre la science et la vie au quotidien
PANEL ET COCQUETEL
Organisé par la Table Éducation Outaouais, ce panel se veut un événement de partage pour démontrer le rôle primordial de la science et comment elle a un impact dans la vie de tous.tes.
Des témoignages, accompagnés d’informations sur les ressources communautaires disponibles seront présentés. Des présentateurs.trices de différents milieux s’entretiendront sur comment les enjeux liés à l’image corporelle ont eu un impact dans leur vie.
Les médias et le grand public seront invités à participer à cet événement partage de savoirs expérientiels.