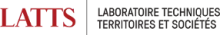Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :Les transformations numériques en santé ne sont pas récentes et d’innombrables technologies sont aujourd’hui disponibles telles que des applications mobiles dédiées à la santé ou au bien-être, des objets connectés pour accompagner les patients souffrant de maladies chroniques, des robots pour opérer ou stimuler cognitivement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, des dispositifs portables ou implantables pour diagnostiquer des troubles neurologiques, cardiaques ou autres. Autant de technologies émergentes qui sont fréquemment présentées comme une réponse aux enjeux de soutenabilité des systèmes de santé dans un contexte de vieillissement de la population et d’augmentation des maladies chroniques, l’objectif étant l’amélioration de la performance des systèmes de santé. Néanmoins, l’usage de technologies numériques de santé tant par les soignants que les patients soulèvent de nombreux enjeux à la fois communicationnels (ex. : pertes d’information, sentiment de distance), relationnels (ex. : reconfiguration des interactions patients-soignants et de la relation thérapeutique, nouvelles formes de proximité à distance), organisationnels (ex. : travail d’articulation supplémentaire, redistribution des responsabilités), sociétaux (ex. : inégalités territoriales, enjeux d’accessibilité, risques de discrimination), éducatifs (ex. : formation des professionnel·le·s, transformation des dispositifs d’éducation thérapeutique) et de conceptions (ex. : engagement des usagers — dont les patients — dans la conception).
L’objectif général de ce colloque est donc de réunir la communauté scientifique francophone autour de la question des usages projetés et concrets des technologies numériques de santé en invitant les chercheur·e·s (de diverses disciplines des sciences de la santé, sciences sociales et humaines, génie et gestion) à analyser le caractère socialement situé, incarné et équipé des usages des technologies numériques de santé et de « rendre visible » des pratiques sociales, des « trajectoires d’usage » imaginées ou réelles ou des processus de « domestication ». Le colloque s’organisera autour de trois axes :
Axe 1 : Télémédecine et activités du patient-soignant : soin distant, présence connectée et proximité renégociée
Axe 2 : Technologies d’autosurveillance et d’autosoin : du « soi quantifié » au « soin connecté »
Axe 3 : L’intelligence artificielle (IA) et la médecine « 4P » (personnalisée-préventive-prédictive-participative) : de la « datafication » au clinicien-patient-soin « augmenté »
Dates :Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Sylvie Grosjean (Université d’Ottawa)
- Alexandre Mathieu-Fritz (Université Gustave Eiffel)
- Fabienne Martin-Juchat (Université Grenoble Alpes)
- Ambre Davat (Université Grenoble Alpes)
- Dilara Vanessa Trupia (Université Gustave Eiffel)
Programme
Conférences d'ouverture
L'objectif de cette session est d'aborder la question de l'engagement des patients, des aidants et des professionnels dans la conception et le développement de technologies numériques de santé. À partir de la présentation d'un projet canadien (Projet Transplant'Action Connecté) et d'un projet français (Projet DynSanté), nous aborderons les questions suivantes: Comment mieux prendre en compte les besoins des utilisateurs finaux dans le développement de solutions technologiques en santé ? Quel partenariat mettre en oeuvre pour engager divers parties-prenantes lors du développement et de l'implantation de solutions technologiques en santé ? Comment intégrer au mieux les besoins des patients et leurs attentes dans le développement de technologies numériques de santé ? etc.
-
Communication orale
Vers un nouveau modèle de soins intégré et connecté pour engager les patients dans leurs soins : le projet Transplant’Action Connecté pour les patients transplantés hépatiquesManuel Escalona
La clinique de transplantations hépatiques du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) développe un nouveau modèle de soins de santé couvrant tout le continuum de soins pré-, per- et post-greffe qui comprend le suivi des patients par une équipe interdisciplinaire comprenant des patients accompagnateurs, une plateforme numérique d'hébergement d'un plan clinique, et de collecte de données à partir d'objets connectés.
-
Communication orale
La méthode CML (Concept Maturity Level) appliquée aux technologies médicales: le projet DynSantéAlexandre Delalleau
La méthode CML (Concept Maturity Level) a initialement été développée par la NASA pour guider les chercheurs et ingénieurs dans l’anticipation des points clefs inhérents au développement de lanceurs spatiaux et ainsi éviter des cycles de reconception particulièrement coûteux dans ce domaine. Dans le cadre d’un projet de l’Agence Nationale pour la Recherche française (ANR) nommé DynSanté, le CEA a participé à une adaptation de cette échelle pour le domaine des technologies médicales et, depuis 24 mois, a proposé son expérimentation à différents chercheurs de son institution afin d’analyser de premiers retours concrets de son appropriation. Ceci a permis de confirmer le bien-fondé de cette approche, mais également d’identifier des propositions d’améliorations et de nouvelles perspectives pour cette échelle que nous développerons dans cette communication.
Session 1 : Concevoir des dispositifs visant à améliorer la qualité et la coordination des soins
-
Communication orale
Entre coopération inter-organisationnelle et gestion des soins aux patients : une analyse de l'appropriation de deux systèmes de téléconsultation dans un hôpitalMyriam Lewkowicz (Université de Technologies de Troyes, LIST3N), Khuloud Abou Amsha (Université de Technologies de Troyes, LIST3N), Clément Cormi (Chaire Innovation du Bloc Opératoire Augmenté (BOPA), AP-HP, Institut Mines-Telecom, Université Paris Saclay), Matthieu Tixier (Université de Technologie de Troyes)
Durant l'année 2020, encore marquée par la pandémie, nous nous sommes intéressés à l'impact des choix de conception de logiciels de téléconsultation sur le développement de nouvelles pratiques médicales. Nous avons en particulier suivi les usages et les parcours parallèles de deux systèmes de téléconsultation qui ont cohabité dans un centre hospitalier en France sur la période (16 mois). Notre analyse s'appuie sur des entretiens auprès de 10 médecins et des observations dans leurs services. Elle souligne que l'objet téléconsultation a permis de développer de nouvelles pratiques de coopération inter-organisationnelle et de gestion des soins. En focalisant notre regard sur le travail réalisé par les médecins pour intégrer la téléconsultation dans leurs pratiques et leurs écologies d'artefacts, nous soulignons que chacun des deux logiciels ne supporte pas ces pratiques de façon équivalente. Ainsi nous montrons les choix de conception ont un impact et que certains peuvent limiter le développement de nouvelles pratiques médicales.
-
Communication orale
Développement d'un Système d'Apprentissage pour les Soins de Santé Primaires grâce à la Collecte Régulière de Rétroactions des PatientsDoug Archibald (Université d’Ottawa), Kris Aubrey-Bassler (Memorial University of Newfoundland), David Bynoe (Institut du Savoir Montfort), Stéphanie Chenail (Institut du Savoir Montfort), Sylvie Grosjean (Université d'Ottawa), William Hogg (Institut du Savoir Montfort), Sharon Johnston (Institut de Savoir Montfort), Veera Miravoudi (Université d’Ottawa), Mwali Nachishali Muray (Université d’Ottawa), Julienne Niyikora (Institut du Savoir Montfort), Kamila Premji (Université d’Ottawa), Gretchen Seitz (Eastern Ontario Health Unit)
La mise en place d'un système d'information pour les soins de santé primaires (SSP) est cruciale, nécessitant des méthodes efficaces pour collecter les retours d'expérience des patients (PREMs) et les mesures des résultats auto-déclarées (PROMs). L'objectif de cette communication est de présenter les résultats d’un projet évaluant la faisabilité de la collecte routinière de PREMs/PROMs dans les cliniques de première ligne via le Réseau Canadian d'Information pour les Cliniques de Première Ligne pour ensuite les coupler avec des données du dossier médical électronique. Les résultats incluront des mesures sur l'accès aux soins, sur l'engagement des patients et les barrières à la collecte de données. En conclusion, le projet soutiendra le développement d'un système canadien d'information en SSP et évaluera l'efficacité de la communication numérique avec les patients et identifiant les lacunes d'équité.
-
Communication orale
Participation du gestionnaire de cas dans la coordination de soins transfrontaliers en expérimentation de télésurveillance de maladies chroniques sévèresJean-Luc Novella (Université de Reims Champagne-Ardenne, EA 3797), Didier Schoevaerdts (Département de gériatrie, CHU UCL Namur), Dimitri Voilmy (Université de Technologie de Troyes)
Une étude qualitative a été menée sur l'utilisation de la télésurveillance chez les patients de plus de 65 ans souffrant d'insuffisance cardiaque chronique et/ou de BPCO. L'étude a été réalisée dans le cadre d'un projet clinique exploratoire en zone organisée d'accès aux soins transfrontaliers franco-belge. Les résultats montrent que la télésurveillance avec l’implication de la gestionnaire de cas de territoire est bien acceptée par les patients et les professionnels de santé. Comment procède la gestionnaire de cas territorial pour assurer la continuité des soins dans une situation par nature complexe ? L’activité de la gestionnaire de cas se réalise dans et avec l’accomplissement des liens entre les seuils d'alerte identifiés par les télé-capteurs et leur utilisation individuelle, puis avec l'outil d'aide à la décision d'hospitalisation, la communication avec les différents établissements médicaux et le domicile des patients.
Dîner
Session 2 : Technologies d’autosurveillance et objets connectés : entre reconfiguration des pratiques et mise au travail des acteurs
-
Communication orale
Vivre avec la dialyse : appropriation des technologies d’auto-soin et de suivi de l’insuffisance rénale chronique (IRC) par les patientsMarie-Julie Catoir-Brisson (Audencia Business School), Susana Paixão-Barradas (l’Ecole de Design, Département de Stratégie de Kedge Business School.)
Cette communication porte sur la relation aux technologies de soin liées à l’IRC, une maladie chronique liée au dysfonctionnement des reins. Il s’agit de présenter les résultats obtenus suite à des observations, des entretiens et une enquête collective avec les patients en dialyse à domicile et en centres, dans le projet de recherche Di@dom mené depuis 2020 avec un collectif de chercheurs de différentes disciplines. L’article interroge le rapport des patients aux différentes technologies de soin et de télé-suivi et leur apport en termes de vie à domicile et de compréhension de sa maladie. L’objectif est de comprendre des usages situés et incarnés dans des situations de soin différentes (à domicile, en centre privé ou public) et de montrer l’ambivalence du rapport à ces technologies, dans des trajectoires de vie singulières.
-
Communication orale
L’expérience et la prise en charge de la mucoviscidose à travers l’usage d’un dispositif d’autosurveillance connectéAlexandre Mathieu-Fritz (Université Gustave Eiffel), Dilara Vanessa TRUPIA (Université Gustave Eiffel)
Cette recherche porte sur la manière dont l’expérience et la prise en charge de la mucoviscidose évoluent avec l’introduction, dans le quotidien des patients, d’un nouveau dispositif d’autosurveillance connecté qui doit permettre à ces derniers de mieux anticiper les dégradations de la maladie et de bénéficier ainsi d’une plus grande autonomie. Ce dispositif consiste en un ensemble d’objets connectés (montre, balance, spiromètre, etc.) permettant de relever et de suivre des paramètres physiologiques (poids, oxygénation, fréquence cardiaque, etc.) au sein d’une application mobile où peuvent également être saisis des ressentis (fatigue, essoufflement, etc.) et des traitements. L’objectif de la recherche est de décrire les usages de manière longitudinale et de rendre compte des effets de ce processus d’autosurveillance sur l’expérience de la mucoviscidose et, plus généralement, sur sa prise en charge.
-
Communication orale
Les transformations du “travail de surveillance” avec l’introduction d'un dispositif d'autosurveillance numérique pour les patients atteints de fibrose kystique en physiothérapiePauline Lemersre (UdeM - Université de Montréal)
La fibrose kystique (FK) est une maladie qui nécessite une gestion constante pour éviter les hospitalisations fréquentes. Cette enquête s'inscrit dans un projet global explorant l'introduction d'un dispositif numérique d'autosurveillance dans la prise en charge des patients atteints de FK, en mettant l'accent sur les transformations des pratiques professionnelles des physiothérapeutes. Il développe une triangulation de techniques d’enquête, dont huit entretiens semi-structurés approfondis avec des physiothérapeutes. Les résultats révèlent que le dispositif transforme le "travail de surveillance" partagé entre le patient et le physiothérapeute, affectant la temporalité, la spatialisation et les rôles, notamment en déléguant des tâches aux patients. Des objectifs clairs doivent être définis en collaboration avec les patients et physiothérapeutes incitant à réfléchir l'introduction et l'utilisation de ces dispositifs dans les prises en charge.
-
Communication orale
Explorer différentes trajectoires d’usage de dispositifs d’autosoin « intelligents » avec les patients en utilisant la méthode du récit à acheverSylvie Grosjean (Université d’Ottawa), Tiago Mestre (Parkinson’s Disease and Movement Disorders Clinic, Division of Neurology, Department of Medicine, The Ottawa Hospital Research Institute, The University of Ottawa Brain and Mind Research Institute)
Cette communication a pour objectif de penser les « usages avant l’usage » de dispositifs portables ou capteurs sensoriels intelligents pour des personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Pour ce faire, nous prendrons appui sur un projet où plusieurs dispositifs d’autosoin impliquant des algorithmes d’apprentissage sont en développement. À partir de « récits d’usage » obtenus via une méthode d’enquête nommée « Story Completion Method », nous révèlerons des « trajectoires d’usage » et des formes de mise au travail des patients : travail d’équipement, travail émotionnel et travail réflexif équipé. Ces trois modalités de mise au travail des patients, nous permettront d’ouvrir une réflexion sur l’importance de penser l’intrication entre usages et design lors de la conception de technologies d’intelligence artificielle en santé.
Quelles approches et méthodes privilégier pour comprendre les usages « situés » et « projetés » des technologies numériques de santé ?
Ce panel sera consacré à la présentation et la discussion de projets de recherche en lien avec le développement et l'usage de technologies numériques de santé (ex., télésoins, objets connectés, plateformes d'autosoins, etc.) menés par des équipes au Canada et en France. Le panel se déroulera en deux temps, une présentation rapide des projets (5 minutes/projets) suivi d'une discussion collective autour des questions suivantes : (1) Quelles approches ou méthodes devraient être privilégiées pour saisir les usages qu'ils soient situés ou projetés ? (2) Quel rôle est accordé aux divers parties-prenantes (ex., patients, professionnels de la santé, designers, développeurs) dans l’analyse des usages de technologies numériques de santé ? (3) En quoi étudier les usages peut-il "nourrir", alimenter le processus de design de ces technologies ?
Conférence plénière
-
Communication orale
Créer et déployer Navig, une IA d'orientation des patients en première ligne : l'expérience québécoiseAlexandre Chagnon (Université Laval)
En décembre 2022 au terme de 6 ans de recherche et développement, Vitrai lança Navig (navig.ai), une intelligence artificielle (IA) prenant la forme d'un système d'aide à la décision pour le personnel chargé de l'octroi de rendez-vous en première ligne. Cette présentation se veut le récit de la création et du déploiement de Navig, en débutant par l'idéation et en terminant par le processus de déploiement en contexte de vie réelle, en passant par les étapes de validation de la technologie et du potentiel commercial, ainsi que l'analyse des besoins des patients et des cliniques médicales.
Session 3 : Intelligence artificielle en santé : entre usages projetés et usages réels
-
Communication orale
Modéliser les usages situés avec les parties prenantes pour co-construire les conditions de la « recevabilité » des technologies de « soin augmenté »Ambre Davat (Université Grenoble Alpes), Aurélie Gauchet (LIP/PC2S, Université Savoie Mont Blanc), Maryame Ichiba (Université d'Ottawa), Fabienne Martin-Juchat (GRESEC, Université Grenoble Alpes), Thierry Menissier (IPhiG, Université Grenoble Alpes), Emmanuel Monfort (TIMC, Université Grenoble Alpes), Eloria Vigouroux-Zugasti (GRESEC, Université Grenoble Alpes)
À travers l’étude des usages de plusieurs dispositifs de médecine « 4P » en cours de développement, nous cherchons à dépasser le concept d’acceptabilité technologique, centré sur un utilisateur projeté, pour développer celui de « recevabilité ». Nous nous appuyons sur une approche participative, dont des récits d’expérience centrés sur les affects, pour révéler les usages et les représentations situés de l’ensemble des parties prenantes. Après la mise en place de comités de pilotage pour accompagner chaque dispositif, nous avons choisi de mener une étude qualitative et jouer le rôle de médiateur entre les membres du projet et les représentants des parties prenantes. Nous présenterons les résultats liés au VELIS (Vélo Electrique Intelligent pour la Santé) : un dispositif à la fois technique, médical et social, conçu pour aider des personnes atteintes de maladies chroniques à reprendre une activité physique.
-
Communication orale
L’intelligence artificielle à l’épreuve des pratiques et des réflexivités professionnelles en dermatologie. Le cas de la détection précoce des mélanomesDilara Vanessa TRUPIA (Université Gustave Eiffel), Alexandre Mathieu-Fritz (Université Gustave Eiffel)
Selon quelles modalités les outils d’IA sont-ils intégrés et appropriés par les dermatologues ? Quelle place ces derniers leur donnent-ils dans leur pratique ? Comment la confiance en l’IA se construit-elle ? L’enjeu est de saisir la manière dont les dermatologues collaborent concrètement avec des outils d’IA, afin de repérer des lésions cancéreuses et de prendre une décision thérapeutique. L’analyse montre que les usages de l’IA se développent très peu en situation clinique où elle est davantage mobilisée dans des moments d’incertitude médicale, pour soutenir une fonction d’aiguillage de l’attention des professionnels qui, dans un contexte d’exercice marqué par une très forte pénurie de praticiens, se voient de plus en plus contraints. L’intervention décrit la confrontation de l’IA aux pratiques et aux réflexivités professionnelles, pour rendre compte des évolutions des activités des dermatologues, notamment celles liées à leur « vision professionnelle ».
-
Communication orale
L’IA en régime d’analyse médicale : un support cognitif et émotionnel pour une confiance rationaliséeLaurent Collet (Université Paul Valery Montpellier 3), Michel Durampart (Université de Toulon)
Le développement de l’IA en appui d’une analyse médicale ne s’organise pas autour de la question du remplacement de l’homme par la machine, ou bien encore de déshumanisation de l’activité, mais par rapport à trois dimensions : le rapport au temps (accorder plus de temps aux cas les plus compliqués), le rapport à soi (prendre confiance en soi), et le rapport à la connaissance (développer des routines cognitives différentes selon le niveau de difficulté). Tels sont les résultats d’une recherche sur l’expérience vécue par des médecins anatomopathologistes du déploiement d’une intelligence artificielle (IA) au sein de leur cabinet médical, que nous avons obtenu via la méthode de la restitution subjective en situation couplée à un focus group de validation des résultats observés.
-
Communication orale
Du posthumanisme dans le transhumanisme ? Situer l’usage numérique de santé dans la dimension du vivantEloria Vigouroux-Zugasti (Université Grenoble Alpes, laboratoire GRESEC)
De nombreux chercheurs (Moschetta, 2019 ; Le Breton 2018 ; Tapia, 2018, etc.) s’interrogent sur l’approche que les technologies numériques de santé font du corps : écologie du corps, marchandisation du corps, corps pensant, savoir expérientiel, etc. Nous nous intéressons ici à la dimension anthropotechnique de la santé (Magnin, 2019), abordant ainsi la promesse transhumaniste au regard de l’approche posthumaniste questionnant la place accordée à la dimension du vivant dans une société largement dominée par l’IA et par les technologies numériques (Damour, 2018). Pour ce faire, nous avons établi une méthodologie qualitative par entretiens semi-directifs, avec des patients utilisateurs de technologies numériques, ainsi qu’avec des professionnels de santé, afin d’investiguer sur les usages « projetés » des technologies et leurs promesses, face à leurs applications concrètes pour la santé.
Dîner
Séance de communication par affiche
Cette séance de communication par affiches sera l'occasion pour le public de poser des questions aux auteur.e.s des affiches. Les affiches seront consultables en ligne.
La session se déroulera en deux temps:
1- Les auteur.es auront 2 minutes pour rapidement introduire l'objectif de leur communication.
2- Cette rapide introduction sera suivie d'une courte période de questions.
-
Communication par affiche
Le sujet au défi du corps quantifié : enquête sur les effets et ambivalences de la quantification de soi en contexte de maladie chronique.Elise Brayet (Université de Nanterre)Affiche
Les dispositifs numériques de quantification de soi sont aujourd’hui promus par le gouvernement Français pour favoriser de concert prévention sanitaire et alimentation du Big data. Mais de quelle nature sont ces images grapho-numériques auxquelles le patient se confronte, seul, depuis l’écran de sa montre ou de son téléphone et surtout, que lui font-elles vraiment ? Comment ne pas craindre que la représentation quantifiée de son propre corps renforce à même la conscience de soi la pensée d’un corps objet et étouffe par-là les possibilités de subjectivation, de symbolisation, structurantes du vécu en première personne de la maladie ? Nous nous sommes entretenue avec des patients atteints de problèmes de santé chroniques et avons relevé des ambivalences très nettes quant à l’impact de ces représentations numériques inédites sur le vécu du corps et de la maladie.
-
Communication par affiche
Vers une nouvelle stratégie de santé pour les populations des milieux ruraux en Côte d’Ivoire : le cas de télémédecineYoga Lucie Sopoudé (Université de Bourgogne)
Ce travail mené en Côte d’Ivoire questionne l’implication des professionnels de santé dans une nouvelle forme d’organisation hospitalière qu’est la télémédecine et la manière dont ces derniers interagissent avec les patients. Nous nous sommes appuyés sur une recherche empirique et une littérature riche. Nous avons interrogé les professionnels de santé exerçant dans les hôpitaux publics et les patients. Les résultats obtenus montrent que sur 19 programmes de télémédecine, 2 sont intégrés dans le système de santé et les autres ne se qu’à une étape préliminaire. Enfin, il se dégage que la relation ‘‘professionnels de santé/patients’’ qui est de type virtuel, ne requiert pas le même impact que la relation traditionnelle (physique) qui plus basée sur la confiance.
-
Communication par affiche
Intervention du textile intelligent dans la médecine 4P : vers une amélioration de design d’expérience usager-patientBalkis Ellouze (institut supérieur des arts et métiers de Sfax)Affiche
Cet présentation évoque les avancées de l'intelligence artificielle (IA) appliquée en santé, mettant l’accent sur son rôle dans la médecine 4P. En outre, les textiles intelligents (TI), assimilés à une forme d'IA, émergent comme des outils prometteurs pour améliorer l'expérience patient. Dans ce contexte, nous allons parler de l'utilisation des TI dans le domaine de la santé. Nous allons analyser des exemples des TI équipés de capteurs afin d’ouvrir une perspective concrète dans le contexte de la médecine 4P, citons l’exemple des chercheurs de l’MIT, le E-TeCS. Ces textiles peuvent collecter en temps réel des données physiologiques contribuant ainsi à la personnalisation des soins et à la prévention des problèmes de santé. Dans ce sens, le design d'expérience utilisateur joue un rôle clé en intégrant des éléments de confort, et de personnalisation dans les vêtements intelligents afin d’améliorer l’expérience usager-patient.
Session 4 : Télésoin et téléconsultation : variations dans les usages et les expériences
-
Communication orale
L’adoption d’un programme de télésanté de prévention des chutesJacinthe Savard (Université d'Ottawa), Jennifer O'Neil (Institut de recherche Bruyère)
Les chutes sont une source d’hospitalisation la plus fréquente chez les ainés1 et le nombre de programmes de prévention des chutes offerts en français est très limité. Le programme de télésanté « Marche vers le futur » a donc été adopté pour améliorer l’accès et réduire les facteurs de risque de chutes. Notre objectif était de documenter l’adoption du programme de télésanté afin de faciliter son adoption à large échelle. Par l’entremise d’un questionnaire et d’une entrevue, douze animateurs ont rapporté leurs expériences vécues permettant d’identifier les opportunités et stratégies gagnantes. Le programme de télésanté MVF a permis d’améliorer l’accès à un programme ayant un effet positif sur la prévention des chutes chez les ainés et de renforcer les capacités des animateurs et communautés francophones éloignées. Les stratégies rapportées pourraient faciliter l’adoption de programme futur.
-
Communication orale
Le télésoin en physiothérapie : un bouleversement des pratiques ?Pauline Lemersre (UdeM - Université de Montréal)
La COVID-19 a fortement accéléré le déploiement de la télémédecine en France. Afin de comprendre comment les usages du télésoin (TS) transforment les pratiques professionnelles des physiothérapeutes français, une enquête comprenant huit entretiens semi-directifs avec ces professionnels et l’observation d'une séance de TS a été mise en place. Elle révèle que les principes de rééducation demeurent constants (techniques transposables), mais que le travail des physiothérapeutes se trouve requalifié, nécessitant une adaptation à l'outil numérique et une réorganisation du soin (4 espaces thérapeutiques, délégation de tâches au patient. Le TS peut être appréhendé comme un fait social technicisé et non pas comme un bouleversement durable des pratiques de soin en physiothérapie.
-
Communication orale
La mesure de la satisfaction quant à l’utilisation de la téléconsultation: perspectives actuelles des patients et professionnels de la santé en contexte francophone minoritaireMichelle Dorion (Université d’Ottawa)
Au Canada, la situation pandémique de la COVID-19 a donné un coup d’accélérateur à la téléconsultation qui est en plein essor. Ce dispositif est intégré dans plusieurs milieux cliniques et représente un terrain fertile pour rehausser la disponibilité et l’accessibilité des services de santé en français pour les communautés francophones vivant en situation minoritaire (CFSM). Or, pour mieux comprendre les usages de la téléconsultation parmi cette population, il est impératif que ce dispositif soit intégré de manière réfléchie et équitable en tenant compte de l’opinion des patients et professionnels de la santé francophones. Selon la littérature, les questionnaires pour mesurer le degré de satisfaction de ces utilisateurs existent uniquement en anglais, ce qui rend problématique la mesure du ressenti des francophones. Nous avons donc mené une étude pour développer des questionnaires de satisfaction qui tiennent compte de la réalité sociolinguistique des francophones et qui sont sensibles pour détecter les besoins cliniques des patients et professionnels de la santé quant à l’utilisation de la téléconsultation en contexte francophone minoritaire.
-
Communication orale
Examiner le « travail sensoriel » s’accomplissant lors de téléconsultations médicales afin de guider la formation des professionnels de la santé.Luc Bonneville (Université d'Ottawa), Maria Cherba (Université d’Ottawa), Sylvie Grosjean (Université d'Ottawa), Richard Waldolf (Université d'Ottawa)
La télémédecine reconfigure la relation avec le patient et la pratique de l’examen physique lorsqu’il s’agit de « sentir à distance » le corps du patient. Or, les approches de formation actuelles demeurent limitées pour aborder ces enjeux. Nous présenterons les résultats d’une analyse des interactions s’accomplissant lors de téléconsultations post-chirurgicales avec un patient simulé et d’entretiens auto-confrontation avec des médecins. Nous montrerons comment des « affordances sensorielles » s’accomplissant lors des interactions patient-soignant et le développement d’une « vigilance sensorielle » cultivée par les médecins contribuent à soutenir la réalisation d’un examen physique à distance. Les analyses nous permettront d’identifier les pratiques de communication qui soutiennent une forme de « travail sensoriel » à distance et qui peuvent être mobilisées dans de futurs programmes de formation.