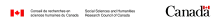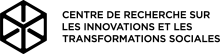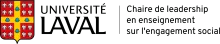Informations générales
Événement : 91e Congrès de l'Acfas
Type : Colloque
Section : Section 400 - Sciences sociales
Description :« Les communs sont partout ! » observaient déjà plusieurs auteurs et autrices au tournant du 21ᵉ siècle (Dardot et Laval, 2014; Federici, 2019). Le constat de l’utilisation du terme « communs » dans divers contextes, allant de la guerre de l’eau à Cochabamba, en Bolivie, au mouvement altermondialiste, ainsi qu’aux occupations de places comme à Wall Street et Ghezi à Istanbul, a suscité l’intérêt de la recherche pour ce thème. Il y a déjà plus d’une décennie, George Caffentzis (2012) recensait des milliers de publications sur les communs, une littérature qui n’a fait qu’augmenter depuis. Parmi ces travaux, nous retrouvons différentes compréhensions et définitions des communs, qui se revendiquent de traditions théoriques fort distinctes, menant parfois à des analyses contradictoires du même phénomène. De plus, différents organismes font usage du terme dans des contextes qui en déforment passablement le sens, comme lorsque la Banque mondiale expulse des peuples traditionnels de leurs territoires au nom du « patrimoine commun de l’humanité » (Federici, 2019). Dans ce contexte, il devient pressant de prendre la mesure de ces enjeux et de cartographier les différentes approches des communs pour tenter d’y voir plus clair, notamment par rapport à certaines thématiques que ce colloque entend prioriser.
Selon la définition proposée par le Collectif de recherche sur les initiatives, transformations et institutions des communs (CRITIC), qui organise ce colloque, les communs sont des ensembles de pratiques sociales ancrés dans des collectivités autodéterminées et des formes de communalisation. Ils répondent à différents besoins et aspirations au moyen de valeurs de partage, de soin, de participation, d’inclusion, de soutenabilité et de convivialité. Promouvant le droit d’usage et le devoir de responsabilité, les communs préfigurent une alternative à la propriété privée et constituent un processus d’apprentissage collectif. Cette définition affiche une volonté explicite de situer les communs dans un contexte sociohistorique, politique et économique plus large pour comprendre leurs dynamiques relationnelles avec les systèmes économiques et les normativités politiques, sociales et culturelles dans lesquelles ils s’insèrent.
En présence de Pierre Dardot et Christian Laval, invités d’honneur du colloque, nous vous proposons d’explorer les communs par le truchement de six axes dans deux conférences de nos invités d’honneur et vingt-cinq présentations universitaires ou terrains :
- Politiques des communs;
- Communs numériques;
- Économie sociale et solidaire, et communs;
- Care, féminisme et commoning;
- Communs de connaissances et de transfert de savoirs;
- Partenariats public-communs et espaces réappropriés.
À ces interventions s’ajoutera une visite hors site à l’Atelier Mauril-Bélanger, où se dérouleront nos activités de réseautage de fin de journée.
Coresponsables : Yann Pezzini, Ambre Fournier et Jonathan Veillette
Remerciements :Merci à nos partenaires :
- CRSH
- Atelier d'Innovation Sociale Mauril-Bélanger
- Transition en Commun
- Projet Collectif
- Centre de recherche sur les innovations et transformations sociales (CRITS)
- Chaire de leadership Alban D'Amours en sociologie de la coopération
- Chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social
- Chaire du Canada en droit des biens transsystémique et communautés durables
Format : Sur place et en ligne
Responsables :- Charmain Levy (UQO - Université du Québec en Outaouais)
- Marie-Anne Perreault (USP - Université Saint-Paul)
- Jonathan Durand Folco (USP - Université Saint-Paul)
- Dan Furukawa Marques (Université Laval)
- Luc Audebrand (Université Laval)
- Alexandre Michaud (USP - Université Saint-Paul)
- Félix Beauchemin (Université d’Ottawa)
Programme
Ouverture
-
Communication orale
Une réflexion introductive autour de la question : Les communs peuvent-ils devenir une politique ?Christian Laval (Université Paris Nanterre)
Il s’agirait de se demander comment les communs peuvent échapper à la dépolitisation qui en fait des niches au sein du système néolibéral, à l’illusion de la diffusion mimétique des « bonnes pratiques », à l’évitement de la conflictualité systémique. Donc se demander comment les communs peuvent se poser comme des acteurs politiques à part entière dans le champ des luttes politiques. Ce serait pour nous une manière de réintroduire « le principe politique du commun » contre toutes les variantes dépolitisantes qui prolifèrent aujourd'hui.
Axe 1 : Politiques des communs
-
Communication orale
Les communs urbains à México : entre institutionnalisation, autonomie, résistance et autogestionJonathan Veillette (Cégep Édouard-Montpetit)
Les pratiques de commoning ont bénéficié d’une certaine reconnaissance par des gouvernements municipaux, qui les ont intégrés en réponse aux grands enjeux du XXIe siècle comme ce fut le cas à Barcelone entre 2015 à 2023. Cette institutionnalisation des communs implique toutefois des tensions, des résistances, des revendications d’autonomie, des tendances à la cooptation. Ces tensions qui sont potentiellement plus fortes lorsque les pratiques de commoning sont le résultat de la nécessité (Aguilar, 2011 ; Composto et Navarro Trujillo, 2018 ; Navarro Trujillo, 2016). Dans cette communication, j’aborderai le cas du Laboratorio para la ciudad, une initiative de la ville de Mexico (2013-2018) qui visait à cocréer la ville avec les citoyens. Ce modèle institutionnel présente toutefois des limites. Comme l’écrit Salvador Medina Rámirez : « le socialisme n’arrivera pas à bicyclette » (Ramírez, 2022), et des municipalités comme la ville de México ne peuvent se contenter de construire des pistes cyclables ou de favoriser la participation citoyenne dans les quartiers cossus. Elles doivent aussi répondre aux besoins criants de populations vivant dans les marges de la ville, où le commoning est nécessité. Le cas de l’Organisation populaire Francisco Villa et le Yuguelito servira de second exemple pour explorer les rapports qu'entretiennent ces communs urbains avec les institutions.
-
Communication orale
Les stratégies politiques du mouvement des communs, esquisse d’une théorie meta-institutionnelle des communs de Elinor Ostrom à Erik Olin Wright.Sébastien Shulz (Université de Technologie de Compiègne)
La théorie des communs explique comment des commoneurs s'auto-organisent pour gérer de manière durable des ressources partagées, en dehors des cadres institutionnels du marché et de l'État. Toutefois, cette théorie n'intègre pas assez les stratégies qu’ils déploient pour se prémunir contre les menaces du capitalisme, et pour se développer en transformant l’État à leur avantage. À partir des travaux du sociologue E. O. Wright, cet article défend l'hypothèse selon laquelle ces stratégies politiques sont cruciales pour expliquer la soutenabilité des communs dans le temps. Leur intégration dans la théorie des communs enrichirait non seulement la compréhension scientifique des facteurs assurant la pérennité des communs, mais fournirait également des outils tactiques essentiels pour le mouvement qui cherche à promouvoir les communs comme un modèle structurant de notre société. Pour tester cette hypothèse, je m’appuie sur l’analyse d’un corpus de 10 observations d’évènements et 17 entretiens menés dans le cadre de ma recherche doctorale portant sur le mouvement des communs numériques en France. Je commencerai par faire une revue de littérature pour montrer les avancées et les limites de la théorie ostromienne des communs ainsi que les tentatives menées pour y intégrer les perspectives stratégiques. J’exposerai le cadre analytique pour enrichir la revue de littérature. Je présenterai enfin les résultats de ma recherche avant de discuter les perspectives que cela ouvre en conclusion.
-
Communication orale
Vers une gouvernance partagée : rôles des cadres juridiques dans la promotion des communsMarie-Soleil L'Allier (Sciences de l’environnement à l’Université du Québec à Montréal), Stella Warnier (Cour suprême du Canada)
S’il n’existe pas de communs « purs » dans une société capitaliste (Euler, Le Roy), pour certains, le soutien de l’État est essentiel pour éviter la marchandisation des communs. (Abraham et Fourrier). Or, selon le degré de contrôle de l’État, il existe un risque que ces partenariats introduisent une ontologie capitaliste qui transforme les pratiques internes des communs, ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec d’autres organismes ou entreprises. Dans cette optique, comment éviter de tomber dans le piège de la logique marchande ou bureaucratique, alors que certains véhicules juridiques semblent l’imposer de facto ? Sur un échantillon de 70 projets de communs potentiels recensés au Québec, 35 étaient des OBNL, 17 des coopératives, 12 étaient des groupes informels, et 6 avaient une autre forme. Mais l’OBNL et les coopératives sont-elles véritablement les véhicules juridiques les plus adaptés aux pratiques de commoning ? Nous émettons l’hypothèse que de par leur structure même, les OBNL et les coopératives influencent la gouvernance au sein des projets de communs. Nous émettons ensuite la proposition que la fiducie d’utilité sociale pourrait être une piste à creuser pour protéger les infrastructures nécessaires aux pratiques de commoning, tout en laissant la flexibilité nécessaire aux commoneur.ses pour choisir leur mode de gouvernance. Les partenariats public-communs, au niveau municipal, permettraient également de soutenir des pratiques de commoning.
Axe 2 : Communs numériques
-
Communication orale
Comment faire en-commun en ligne? Les défis de constitution, de souveraineté et de pérennité des communs informationnels en ces temps d'IAGuillaume Coulombe (Procédurable), Yves Otis (Remix the Commons)
En dépit de l'existence d'alternatives aux GAFAM, l'usage de ces grandes plateformes extractivistes et de surveillance (données et maintenant la production culturelle et les savoirs pour alimenter l'ogre de l'IA) demeure encore dominante chez les acteurs de la société civile qui militent pourtant pour la transition et la justice sociale. Comment faire basculer cette tendance –
ce repli confortable – et favoriser le développement d'un fediverse inclusif, vivant et diversifié, à l'image des communs. Quelles sont les stratégies et les tactiques pour la souveraineté numérique des commoners ? L’une des tentatives consiste à entreprendre la construction d’éco-systèmes alternatifs et le plus autonome possible en renversant les rapports de production et de consommation. C’est par exemple le cas lorsque Remix the Commons s’inspire des expériences des Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) pour déployer le konbit numérique. Cette contribution portera sur la capacité de créer des infrastructures partagées dans le but d’atteindre une condition de souveraineté numérique. La problématique au coeur de ce travail sera les stratégies à implémenter pour la création d’un fediverse des communs informationnels. A partir d’un retour des pratiques d’autonomie numériques dans lesquelles Remix et d’autres acteurs se sont investis on identifiera les leçons que l’on peut en tirer ainsi que les perspectives qu’elles ouvrent. -
Communication orale
Dépasser le capitalisme algorithmique par les communs? Vers un communisme décroissant et techno-sobreJonathan Durand Folco (USP - Université Saint-Paul)
Suite à la crise financière de 2007-2008, le monde a basculé vers un nouveau stade du capitalisme basé sur l’extraction massive de données personnelles, l’hégémonie des plateformes et le développement accéléré de l’intelligence artificielle (Srnicek 2018, Zuboff 2019, Dyer-Whiteford et al. 2019). Ce capitalisme algorithmique amplifie les inégalités existantes, la consolidation du pouvoir des géants du numérique, l’émergence de nouvelles formes de contrôle social, et l’exacerbation de la crise climatique, le tout via la mainmise du capital sur les données, des infrastructures technologiques et des institutions politiques (Martineau et Durand Folco 2023). Heureusement, des luttes populaires et alternatives socio-économiques esquissent la voie vers la construction d’une société postcapitaliste. Dans cette conférence, nous démontrerons que le commun constitue un principe politique fédérateur (Dardot et Laval 2014) permettant de lier ces formes de résistances et utopies réelles (Wright 2017) afin de bâtir une société des communs plus juste, écologique et démocratique.
-
Communication orale
Infra-politique numérique et communs de la connaissanceCaroline Chambon (Université Jean Monnet)
Mis en lumière lorsque les individus produisent de la démocratie dans leurs activités collectives et gouvernées par le bas, il exige un travail du commun (Nicolas-Le Strat, 2016), un commoning suivant des règles ni fondées sur une appartenance identitaire quelconque, ni sur la fiction juridique d’un contrat social (Sauvêtre, 2014), mais sur la participation à une même activité. La communication investiguera ce travail du commun au sein d’une activité infra-politique numérique menant potentiellement à l’émergence de communs de la connaissance. Mobiliser ces derniers se justifie par la conviction que le savoir humain grandit par l’incrémentation des expériences provenant de tous. S’agissant du numérique comme vecteur de pratiques des communs (Le Crosnier, 2018), il peut coordonner des individus distants qui réfléchissent ensemble. Il s’agit d’un idéal, car leurs points de vue se croisent plus qu’ils ne se rencontrent. En participant à la construction d’identités singulières, il peut soutenir la constitution d’une identité commune. L’individuation est nécessaire au commun pour conduire à la subjectivation du co-pouvoir (Laval et al., 2019). Finalement, le principe de commun sera questionné au sein d’expressions numériques parce qu’elles participent à convaincre les citoyens de leur capacité à faire en commun et « c’est seulement l’activité pratique des hommes qui peut rendre des choses communes » (Dardot et Laval, 2014, p. 49).
Dîner
Lieu: Université d'Ottawa
Axe 3 : Économie sociale et solidaire, et communs
-
Communication orale
Communs, capitalisme et ESS: vers une articulation théoriqueDan Furukawa Marques (Université Laval)
Depuis la fin du 20e siècle, les communs ont été largement mobilisés dans la recherche académique et dans les mouvements sociaux et initiatives collectives citoyennes. Certaines de ces initiatives construisent des structures permanentes comme des organisations autogérées qui investissent le sens du travail et de la vie sociale. Bien qu’elles se revendiquent souvent des communs, ces initiatives empruntent des outils juridiques et organisationnels issus de l’économie sociale et solidaire (ESS). Comment comprendre dès lors la relation entre communs et ESS ? Nous présentons une cartographie des perspectives sur les communs que nous regroupons en deux écoles de pensées non mutuellement exclusives : l’École de Bloomington et celle des communs et du capitalisme. Vu l'articulation de cette dernière, la deuxième partie de la communication présentera quatre propositions théoriques pour articuler les communs, compris dans leur relation intrinsèque au capitalisme, et l’ESS, conçue comme un projet politique capable de préfigurer une société post-capitaliste.
-
Communication orale
La Coop des communs: au croisement entre communs et ESSVera Vidal (La Coop des Communs)
La communication vise à présenter la démarche de La Coop des Communs, association française réunissant depuis 2016 praticiens et chercheurs. Elle œuvre au renforcement politique des communs au sens de la mise en mouvement de personnes concernées dans l’espace collectif qui (1) accroissent leur pouvoir économique et social, (2) en révélant leur légitimité et leur capacité collective à s’organiser en système de ressources et règles pour répondre aux situations complexes qui les concernent (3) au service de l’intérêt général qu’ils placent sous contrôle démocratique des personnes concernées, dans un souci d’accès ouvert à la ressource (4) afin d'inventer des solutions économiques, écologiques et sociales justes dans le temps long. Nous partagerons nos apprentissages sur les croisements et différenciations entre ESS et communs. L’ambition initiale est de favoriser une revitalisation de l’ESS à partir de la philosophie qui anime les communs et de leurs pratiques, tout en permettant aux communs de tirer parti de l’expérience acquise par l’ESS. Nous aborderons ensuite notre méthode de travail faisant travailler praticiens et chercheurs sur des situations de transformation sociale, écologique et/ou économique, selon les principes des communs : ce que nous sommes (la communauté), ce que nous faisons (mutualiser et croiser des connaissances pour expérimenter) et la façon dont nous le faisons (co-construction ouverte sur le monde) forment un tout indissociable.
-
Communication orale
Le magasin participatif : entre proto-commun et cheval de TroieLuc Audebrand (Université Laval), Gabrielle Laverdière (Université Laval)
Un magasin participatif est un commerce où la clientèle a la possibilité, voire l’obligation, de s'impliquer activement dans la gouvernance, la gestion et le fonctionnement quotidien. La Park Slope Food Coop, établie à New York en 1973, est le cas emblématique, s'étant fixée pour mission de diminuer les coûts par rapport aux grandes enseignes tout en assurant une rémunération juste aux producteurs. Cette innovation sociale s’est ensuite propagée dans plusieurs pays dont en France (Grassart, 2023) et pourraient être envisagées dans d’autres secteurs qu’alimentaire (ex.: librairie, garderie, quincaillerie, buanderie, station-service). Bien que les magasins participatifs ne répondent pas entièrement à l’idéal-type de la communalisation (Abraham & Fourrier, 2023), il est possible de les concevoir comme des proto-communs. Les défis économiques des régions sont une occasion de promouvoir la transformation des magasins conventionnels en magasins participatifs, rendant les communs plus crédibles et concrets, tels des chevaux de Troie.
-
Communication orale
Les coopératives de solidarité comme véhicule pour l'institutionnalisation de communs productifs?Luc Audebrand (Université Laval), Dan Furukawa Marques (Université Laval), Myriam Michaud (Université Téluq), Olivier Rafélis De Broves (Université Laval)
Cette communication éclaire le potentiel des coopératives multisociétaires pour institutionnaliser des « communs productifs » (Coutrot, 2022). La coopérative de solidarité (CS) québécoise incarne selon Erik Olin Wright un « modèle idéal » de démocratisation de la sphère économique (Wright, 2020). Depuis son introduction dans la loi sur les coopératives en 1997, la CS associe dans sa gouvernance plusieurs catégories de membres (souvent les travailleurs et les consommateurs) (Girard, 2008; Pezzini & Girard, 2018). Ce faisant, elle bouscule les règles de la propriété collective des coopératives traditionnelles. Comme le note Coutrot (2022, p. 74), « [f]aire de l'entreprise un bien commun productif suppose aussi, bien sûr, de repenser la propriété des moyens de production ». Ainsi, le multisociétariat élargit le principe participatif à plusieurs groupes de personnes « dont l’existence est affectée par l’utilisation de ces moyens de production » (Wright, 2020, p. 165), et la catégorie de « membres de soutien » ouvre la gouvernance de l’organisation à des non-usagers de la coopérative (Michaud et Audebrand, 2019). Basée sur une enquête empirique mixte menée en 2022 (N=71), cette communication explore comment les coopératives multi-sociétaires dépassent les apories du membrariat fermé des coopératives unisociétaires. Elle interroge aussi leur potentiel de transformation sociale par la communalisation du tissu socio-économique québécois (Furukawa Marques et Durand Folco, 2023).
-
Communication orale
L'argent, du "commun" aux "communs"?Jean-François Bissonnette (Université Laval)
Parce qu’elle se voue à la recherche d’alternatives au régime capitaliste, et à ce qui en constitue les fondations, la propriété privée, la pensée des communs tend parfois à esquiver la réflexion sur d’autres éléments constitutifs dudit régime, mais dont ces alternatives ne sauraient peut-être se passer. Quelle place une économie des communs devrait-elle faire au marché, par exemple, ou à ce qui en forme l’instrument principal, l’argent ? Si l’argent, disait Georg Simmel, « rend les choses “communes” (gemein) dans tous les sens du terme » (1987 [1900]), trouvera-t-on dans cette polysémie un sens qui le rapproche des « communs »? Si ces derniers doivent s’entendre comme « l’institution de l’inappropriable » (Dardot et Laval 2014), y a-t-il du sens à vouloir communaliser ce qui reste en son fondement une « technologie d’appropriation » (Hornborg 2021)? Si l’argent représente un « bien public », diront les économistes, c’est à condition de le soustraire à toute possibilité d’ingérence politique. Comment pourrait-on alors en faire l’objet d’une « politique des communs » sans, ce faisant, en altérer les fonctions ? À travers l’examen de cette série de paradoxes, en confrontant l’argent aux communs, il s’agira de les critiquer tous deux, l’un par l’autre, ceci afin d’esquisser le potentiel et les limites d’un « commun monétaire » (Servet 2017).
Conférence de fin de journée
-
Communication orale
Une réflexion prospective autour du thème de notre prochain livre : Pour une cosmopolitique des communsPierre Dardot (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense)
Les communs ne constituent pas n’importe quelle politique, ils constituent une cosmo-politique, à distinguer des cosmopolitismes d’ancienne facture et des différentes formes d’internationalisme. Cette cosmopolitique se forme dès aujourd’hui dans les luttes transnationales, au sein desquelles le mouvement des communs doit avoir une place centrale à la fois pour aider à l’institution des mouvements comme des communs et pour figurer l’objectif convergent des luttes : une société des communs.
Souper de réseautage
Lieu: Atelier d'innovation sociale Mauril-Bélanger
95 rue Clegg, Ottawa, K1S 1C5
Il y a un système de navette gratuite entre l'Université d'Ottawa et l'Atelier Mauril-Bélanger (Université Saint-Paul). La marche est également une option en longeant le Canal Rideau.
Les détails pour ce réseautage suivront.
Axe 4 : Care, féminisme et commoning
-
Communication orale
Les communs urbains féministes, le care et l'empowermentChiara Belingardi (University of Florence, Department of Architecture), Charmain Levy (UQO - Université du Québec en Outaouais)
La plupart des théories et des études de cas empiriques sur les communs féministes concernent des expériences autour de la terre, de l'agriculture et de l'eau, et les rares exemples qui ont été étudiés dans un contexte urbain concernent les jardins et les cuisines urbaines. Il existe plusieurs expériences de communs féministes urbains dans différents pays, mais peu de recherches sur leur théorisation, contrairement à la vaste littérature sur les expériences de communs urbains dans le monde. Conséquemment, il y a peu d'écrits sur les communs urbains féministes dans la littérature sur le genre, le féminisme et les villes qui a traditionnellement traité de l'espace urbain, du logement, de la sécurité et de la politique urbaine, et de la planification en fonction du genre. Cette communication vise à combler ces lacunes dans la littérature sur les communs urbains et sur le genre et la ville en utilisant un cadre théorique féministe, la littérature sur les communs urbains et deux études de cas empiriques - l'une dans le Nord (Lucha y Siesta à Rome) et l'autre dans le Sud (Plaza las Pioneras à Montevideo) - afin de contribuer à une définition des communs urbains féministes et de faire appel au concept féministe de care dans le cadre du débat sur les biens communs urbains. Ces deux cas impliquent des processus de soins/reproduction et d’empowerment ainsi que des objectifs et des méthodes féministes en faveur des droits sociaux, politiques et économiques des femmes dans la ville.
-
Communication orale
Prendre soin des espaces partagés dans les tiers-lieux en FranceAmélie Tehel (Sciences Po Rennes - Institut d'éudes politiques)
Au sein des tiers-lieux, espaces hybrides multi-acteurs ancrés sur leurs territoires, l’engagement en faveur du commun, dans sa dimension participative des usagers, apparaît inconstante (Idelon, 2022). À rebours des idéaux de collaboration promus par les tiers-lieux, on observe des postures attentistes, consommatrices, distantes, de la part de certains acteurs. Le cas du ménage des espaces partagés s’impose en figure archétypique d’un commun qui peine à se faire (Martin et Pereira, 2021). Tâche socialement disqualifiée et précaire, confiée en majorité à des personnes minorisées, la pratique du ménage est propice à la reproduction d’inégalités de pouvoir qui mettent à mal la gouvernance du commun (Ostrom, 2010). Comment faire du soin des lieux une responsabilité collective (Denis et Pontille, 2022) ? Cette communication s’appuie sur une enquête ethnographique réalisée dans le cadre d’un postdoctorat sur l’étude des processus d’empowerment dans les tiers-lieux solidaires. À partir d’exemples empiriques, cette communication montrera le ménage comme source de déséquilibre du collectif en tiers-lieu. S’il est parfois signal d’un engagement topophile pour des espaces singuliers, il est aussi sujet de frictions, tout autant qu’enjeu politique de remise en visibilité d’un travail structurellement invisibilisé.
-
Communication orale
Du care au capital social : Solon, acteur d’une caring city ?Marie-Anne Perreault (USP - Université Saint-Paul)
Plusieurs auteurs reconnaissent aux communs un potentiel transformatif qui vient nourrir l’idée du caring with (Mandalaki & Fotaki, 2020; Tronto, 2020). Ils accroissent le partage et l’entraide dans nos communautés (Bollier et al., 2022; De Angelis, 2017; Euler, 2018) et pallient à un déficit démocratique (Tronto, 2013) qui nuit à l’adoption de comportements favorisant la transition socio-écologique (Mazé & Ragueneau, 2022). Dès lors, la mise en place de politiques publiques promouvant l'émergence des communs semble porteuse pour faire de nos villes des caring city (Davis, 2022; Kussy et al., 2023). Conséquemment, on peut se demander s’il est possible de mesurer les liens du caring with qui émanent des communs et d’explorer comment ces liens contribuent au concept de caring city. Permettent-ils de justifier la création de partenariats entre les villes et les communs ? Pour répondre à ces questions, je mobilise le concept de capital social (Ech-Chahed, 2022; Perras & Normandin, 2019; Safarzynska & Sylwestrzak, 2023) pour évaluer l’impact de la participation de citoyens dans leurs quartiers. Dans le cadre de cette contribution, je présenterai les résultats de ma collecte de données réalisée auprès des commoneurs impliqués à l’Espace des possibles Ahuntsic-Cartierville; un lieu créé par Solon dans la foulée d’un partenariat intervenue avec la ville de Montréal. J'exposerai mes analyses préliminaires ainsi que les prochaines étapes de ce projet de recherche en cours.
-
Communication orale
Vivre ensemble autrement: relation avec la nature en éco-communautéChloé Demuynck (Université Laval)
Souvent étudiées sous l’angle politique de la critique sociale et de l’alternatif, les communautés écologiques représentent un phénomène de marge et de mobilisation identitaire. Ma recherche vise plutôt à les approcher sous l’angle des transformations socio-écologiques qu’elles inspirent à partir de leur déconstruction et de leur remodelage culturel, nous invitant à penser de nouvelles réalités. Pour ce colloque, je propose de réfléchir aux pratiques que les communs produisent en écovillage à partir d’une ethnographie menée à La Cité Écologique de août à novembre 2023. À l’instar de Lachapelle et Furukawa Marques (2023) qui présentent une convergence entre les transformations socio-politiques des communs et des pratiques émancipatoires de l’autogestion, nous pourrons aborder les initiatives éco-communautaires sous l’angle théorique de la deuxième école de pensée des communs, soit selon la forme particulière d’organisation sociale que ces communautés incarnent à plusieurs égards à des fins d’émancipation du capitalisme (Dardot et Laval, 2014 ; Furukawa Marques et Durand, 2023). Après avoir présenté en quoi consistent les aspirations communes autour desquelles se réunissent les personnes pour créer un « commun », nous pourrons réfléchir aux perspectives de transférabilité qu’elles offrent pour concevoir les transformations écologiques dans leurs pratiques de communalisation (Abraham et Fourrier, 2023).
-
Communication orale
Vie quotidienne et stratégies de survie: politique des communs à IstanbulHande Gulen (L'université Paris 8, IFG)
Ce travail explore les pratiques militantes de base féministes et queers qui se sont multipliées suite aux manifestations au parc Gezi (d’Istanbul, mai et juin 2013). Il analyse les acteurs, les répertoires d’action et les stratégies qui s’y rattachent. Mon objectif est de démontrer que les manifestations du parc Gezi ont donné lieu à un engagement inspiré par les approches des biens communs à Istanbul qui s’étendent au tissu de la vie urbaine et de la politique. Cette analyse redéfinie les stratégies géopolitiques locales mises en œuvre par les différents acteurs comme commoners. Nous explorons la manière dont ces initiatives, ces réseaux et ces organisations ont mobilisés leurs relations réciproques, leurs impacts sur la politique locale et leurs manières autonomes d’être, d’agir et de survivre. En nous intéressant aux formes de mouvements et d’activisme apparaissent dans la condition post-Gezi, nous nous sommes demandés quels sont leurs pouvoirs préfiguratifs et leurs effets sur ces acteurs et quelle relation ils crééent entre les pratiques de mise en commun et le mouvement du parc Gezi. Nous nous sommes aussi demandé comment ces pratiques modifient les représentations politiques à l’échelle macro et locale. À partir d’entretiens semi-structurés menés entre 2016 et 2022 avec 62 militant.e.s, nous révélons que ces organisations et réseaux ont engendré de nouvelles mobilisations et pratiques de mise en commun.
Axe 5 : Communs de connaissance et transferts de savoirs
Bâtiment : Pavillon des Sciences sociales (FSS) Local : FSS 1030
-
Communication orale
Produire des savoirs Communs dans le cadre institutionnel : un récit du Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural (CRPPMR)Équipe De Recherche Collectif De Recherche Participative Sur La Pauvreté En Milieu Rural (UQAR - Université du Québec à Rimouski)
Notre Collectif s’inscrit dans un courant de pensée qui met de l’avant la production des savoirs dans l’ordre des Communs. Nous considérons les Communs comme étant une approche, des pratiques et des actions ancrées dans une perspective participative de « faire AVEC » et de « tisser Avec » les personnes premières concernées. Notre démarche s’inscrit dans une visée de justice épistémique et cognitive, nous reconnaissons qu’il existe des mécanismes d’exclusion et de hiérarchisation épistémologique dans la production scientifique. En ce sens, nous avons adopté une mode de gouvernance et de coproduction des connaissances sur la pauvreté, la ruralité et la recherche participative qui reposent sur trois types d’expertises : académiques, de la pratique et du vécu de la pauvreté. Chacune des expertises est appréhendée avec une valeur égale et les décisions sont prises de façon horizontale. Ce mode de gouvernance se heurte souvent à l’hégémonie de la recherche universitaire basée sur l’expertise académique et des formes de production de savoirs enracinés dans une perspective de production « sur » ou « pour » les personnes, notamment en situation de pauvreté. L’objectif de notre communication est de présenter notre mode de gouvernance participative AVEC, et de relever les défis et enjeux de pouvoir que cela soulève au sein des membres, et avec les institutions académiques et de recherche qui gravitent dans l’univers de la recherche.
-
Communication orale
Retour d’expérience de l’École des communsJules Desgoutte (Artfactories/autreparts), Fred Ortuño (Remix the commons)
Dans l’en-commun de l’alimentation, les pratiques des acteurs visent à défaire la dépendance des mangeurs à l’industrie agroalimentaire et à (ré)inventer des actes collectifs pour la subsistance. Dans la perspective progressiste, le terme subsistance est un stigmate qui évoque survie, pauvreté, manque. Ce verrou idéologique justifie l’accaparement et l’expropriation des conditions autonomes de la subsistance (les enclosures) par le marché ou l’état ou les deux ensemble. Faire commun consiste en un retournement du stigmate. Il s’agit de rendre visible une société de la subsistance déjà là et désarrimée de la production du capital et où les servitudes favorisent les interdépendances. La mise en valeur des ressources opère par le renouvellement
du récit partagé. L’École des communs propose de soumettre à l’enquête les relations entre les différents protagonistes concernés, dévoiler ce qui est une préoccupation partagée. Puis, en suivant les personnes dans leurs attachements et en reliant les objets de leur concernement, faire émerger les controverses qui sous-tendent l’action et les pratiques de chacun et chacune. Nous explorerons comment l’école des communs mobilise l’économie communautaire, les modèles de comportements des communautés et comment cet outillage pourrait être élargi pour évaluer les effets des communs sur le bien être des personnes et de la communauté elle-même. -
Communication orale
Fabriquer les communs: des Fabs Labs au Fab CityPhonesavanh Thongsouksanoumane (Communautique)
Les Fab Labs sont des communautés produisant et partageant des connaissances et des outils basés sur la production pair-à-pair. Ils gèrent les ressources comme des biens communs, dans un processus démocratique de collaboration, de solidarité et d'innovations écologiques. Ils font de l'expérience partagée le moteur de la transformation culturelle pour inventer une nouvelle société avec toutes les générations de citoyens. Cette session abordera en quoi le développement de communs de connaissance sont au coeur du parcours des Fab Labs au Québec, du 1er à voir le jour jusqu'à la création de la Coop Fab Labs Québec et au mouvement des Fab City. La Fab City propose une nouvelle relation entre production et consommation à échelle locale et reconsidère les flots d’importation et d’exportation des villes, comme des flots de données; soit l’information, la connaissance, la conception, le code. L’initiative globale Fab City agit comme infrastructure mondiale et source de connaissances pour la transformation de notre façon de travailler, de vivre, d’interagir et d’évoluer dans les villes. Fab City agit en complémentarité avec le développement durable, l’économie circulaire, la ville participative. C'est un projet d’économie régénérative qui contribue à la transition écologique, à la mobilité durable et à l’aménagement du territoire. La ville devient un cadre de développement qui offre à toutes et tous la capacité d’explorer des modes de production et de consommation innovants.
Axe 6 : Partenariats public-communs et espaces réappropriés
-
Communication orale
Les partenariats avec l'économie sociale: un avenir pour les communs?Alexandre Michaud (USP - Université Saint-Paul)
Depuis les années 1990 (de Bettignies et Ross 2004, 136 ; Vining, Boardman et Poschmann 2004, 32 ; Vining, Boardman et Poschmann 2005), les partenariats public-privé (PPP) furent institutionnalisés et deviennent clés dans les politiques publiques canadiennes (Opara 2020, 593-596 ; Hains-Pouliot 2012, 24-33, Hamel 2007, 21-26). Leurs résultats, souvent critiqué pour leur coût, qualité, et gestion des risques/responsabilités (Siemiatycki 2015, 356-359; Opara 2020, 585-586 ; Centre Canadien de Politiques Alternatives 2015), en plus de leur tendance à promouvoir une logique marchande (Boucher 2019; Hudon 2011), rendent les partenariats public-économie sociale (PPÉS) une alternative envisageable. L’émergence de ces partenariats suscite de nombreuses recherches aux résultats nuancés (Durand Folco et al. 2020; Girard 2005; Vézina et Girard 2002) et demandant des éclaircissements. Conséquemment, nous avons étudié deux PPÉS des régions de l'Outaouais et des Laurentides. Les PPÉS peuvent-ils servir de vecteur de démocratisation et favoriser la gestion des biens publics selon des intérêts communautaires? Nous avons analysé nos résultats avec les typologies des sous-traitances et des effets sociaux (Durand Folco et al. 2020; Dufort 2022) afin de discerner leur degré de socialisation et de démocratisation. Nous exposerons les résultats de nos recherches, illustrerons comment les PPÉS peuvent limiter ou encourager la participation citoyenne et formulerons des recommandations.
-
Communication orale
Vivre en commun dans la ruralité: exemple du PPC de CMetisFélix Beauchemin (Université d’Ottawa)
Cette recherche s’insère dans la volonté de développer des études de cas spécifiques aux partenariats public-communs (PPC) au Québec. Pour ce faire, l’expérience de l’organisme à but non lucratif CMétis qui a conclu, en 2022, un partenariat novateur avec la municipalité de Métis-sur-Mer est pertinente. Offrant à CMétis des terrains à coût nul et un congé de taxes foncières sur plus de 35 ans, le partenariat vise à la construction d’un écoquartier rassemblant des lots de logements sociaux et d’éco-demeures. S’inspirant des apports théoriques d’Érik Olin Wright (Utopies Réelles, 2010), CMétis vise l’élaboration d’une alternative au capitalisme au sein de ce même système grâce à la création d’interstices pour sortir l’habitation des logiques marchandes. La mutualisation de ressources et les règles de procédures communes de cohabitation font de cet écovillage un commun unique en contexte rural québécois et un modèle inspirant pour d’autres villes.
-
Communication orale
Neutraliser les BigPharmas : le partenariat public-commun dans la production de médicamentsGaëlle Krikorian (Association Remix the Commons)
Au cours de la dernière décennie, les possibilités offertes par les biens communs dans le domaine des produits pharmaceutiques ont commencé à être examinées. Notre hypothèse est que l’approche des communs peut changer l’économie politique des produits pharmaceutiques essentiels et qu’elle pourrait être mise en œuvre à court terme pour les anciens médicaments essentiels. Cependant, la production de médicaments subit les contraintes propres au domaine de la santé publique dans la mesure qui guident cette production, en garantissant l'accès universel à la santé, le respect des normes et la création d'une économie de la santé encadrée par un système national de protection sociale. Afin d’envisager une production des médicaments en tant que biens communs, il est incontournable de concevoir et déployer un Partenariat Public Commun (PCP). Dans cette contribution nous essaierons d’analyser ce qui pourrait caractériser la mise en place de ce type de collaboration. Les questions qui guident ce travail portent sur la constitution d'un réseau d’acteurs hétérogènes, ses conditions économiques, juridiques et techniques, et sur la nature des dispositifs qui garantissent l’utilisation démocratique et transparente des ressources publiques. Cette contribution s’appuie sur le travail réalisé entre 2021 et 2023 en France par les collectifs militants et les chercheurs en SSH pour modéliser le développement de la production de communs pharmaceutiques.
-
Communication orale
Vers une société des communs : l’expansion par le legs de bâtiments religieux à une coopérative de solidaritéMaggy Berthelot (Université Laval)
Que l’on parle d’autonomie matérielle (De Angelis 2017) ou de la production de subjectivités communes (Stravides 2016) en tant que stratégies pour accroître la présence de communs, les travaux semblent porter davantage sur la manière dont les communs devraient se développer plutôt que sur la manière dont ils se développent réellement (Varvarousis 2020). Pour contribuer à ces réflexions, le cas du legs de bâtiments par la congrégation religieuse des soeurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (NDPS) à la coopérative de solidarité des Choux Gras à St-Damien-de-Buckland dans le comté de Bellechasse au Québec sera exploré en tant qu’exemple d’expansion d’un commun. Ce lègue intentionnel advient dans un contexte de crise du patrimoine religieux immobilier à l’échelle nationale québécoise et caractérisée par la baisse de la pratique religieuse, l’absence de la relève et la diminution des revenus des fabriques de paroisses. Ce cas sera donc exploré à travers une description de la coopérative de solidarité des Choux Gras pour tenir compte de la complexité des relations sociales et matérielles (Huron 2018) en plus de replacer les activités, les pratiques de commoning et le lègue dans un portrait social, économique, géographique et politique plus large. Cette discussion permettra ainsi d’approfondir la question suivante : Comment prend forme ce type de partenariat encore marginal entre communauté religieuse et coopérative de solidarité dans l’élaboration d’une société des communs ?
Dîner et déplacement pour l’après-midi
Déplacement vers l'Atelier Mauril-Bélanger au 95, rue Clegg, Ottawa, K1S 1C5 et dîner offert sur place.
Il y a un système de navette gratuite entre l'Université d'Ottawa et l'Atelier Mauril-Bélanger (Université Saint-Paul), sinon, la marche est également une option en longeant le Canal Rideau (prévoir 40 minutes).
Atelier prospectif et causerie synthèse
Lieu: Atelier d'Innovation sociale Mauril-Bélanger, 95, rue Clegg, Ottawa, K1S 1C5
Atelier de design prospectif - Imaginer une société des communs
Imaginer une société des communs sur la base des partenariats publics-communs. Au travers d’une série d’exemples de partenariats publics-communs, notamment l’exemple de l’alliance Transition en Commun à Montréal, cet atelier de design prospectif sera l’occasion de pouvoir se projeter et tenter de poser les bases d’une société des communs.
Nous explorerons notamment la mise à l’échelle des communs et les ajustements collectifs et institutionnels nécessaires pour envisager une société des communs. Nous porterons une attention particulière sur les conditions d’émergence de partenariats publics-communs, ainsi que les ajustements collectifs et institutionnels que ce type de communs pourraient exiger pour envisager une société des communs.
Atelier proposé par:
Nadim Tadjine - Coordonnateur démocratie participative et gouvernance municipale - Transition en Commun
Raphaël Guyard - Conseiller à la Maison de l'innovation sociale
Causerie synthèse - Prochaines étapes pour une société des communs
Animée par Dan Furukawa Marques en présence de Christian Laval, Pierre Dardot et Charmain Lévy. Cet échange sera l'occasion de revenir sur les apprentissages dispensés pendant le Colloque et se questionner sur la suite. Quel avenir pour les communs ? Comment rendre ce projet de société concret ?
Apéro et réseautage
Lieu: Atelier d'innovation sociale Mauril-Bélanger
95, rue Clegg, Ottawa, K1S 1C5
Les détails pour ce réseautage suivront.